TROISIÈME SÉRIE. LETTRES CXXIV -
CCXXXI LETTRES ÉCRITES DEPUIS L'ANNÉE DE LA CONFÉRENCE DE CARTHAGE, EN 411, JUSQU'À
SA MORT, EN 450.
Albine , Pinien
et Mélanie désiraient voir saint Augustin et s'étaient rendus en Afrique; nous ignorons
quels motifs les avaient d'abord empêchés d'aller à Hippone; c'est à Thagaste, la cité natale du grand évêque, que ces pieux
personnages avaient passé l'hiver Saint Augustin écrit à ces illustres chrétiens de
Rome pour leur expliquer comment il a été obligé de rester tout l'hiver sans aller les
visiter. Son peuple d'Hippone était en proie aux tribulations; le pasteur ne pouvait pas
se séparer du troupeau.
Nous avons raconté, dans l'Histoire de saint Augustin (2), comment Pinien, s'étant
rendu à Hippone et assistant à la célébration des saints mystères, fut surpris par
les acclamations du peuple qui demanda de l'avoir pour prêtre et sollicita son
ordination. Cette sorte de violence à l'égard de Pinien déplut à sa famille et devint
une grande affaire. L'évêque Alype avait été présent aux scènes bruyantes du peuple
d'Hippone; on l'accusait de vouloir garder pour son église de Thagaste l'illustre et
riche Romain. Cette affaire donna à saint Augustin bien du souci ; voici une lettre qu'il
écrivit à cette occasion à son cher et vénérable collègue de Thagaste. On y trouve
un grand sentiment des devoirs chrétiens et surtout des, devoirs des évêques, On y
remarquera aussi la fermeté de la doctrine de saint Augustin sur le serment.
Saint Augustin raconte comment l'affaire de Pinien s'est passée dans l'église
d'Hippone ; il venge son peuple d'injustes soupçons, et comme les plaintes d'Albine
n'avaient pas épargné le saint évêque, il parle de lui avec une simplicité très-
belle et une attachante humilité. sa doctrine sur le serment se produisit de nouveau dans
cette lettre avec inflexibilité.
Un illustre personnage, Armeutarius, et sa femme, Pauline, qu'il ne faut pas
confondre avec la sainte dame Pauline, épouse de Pammaque et louée par saint Jérôme,
avaient fait voeu de continence; c'étaient des amis de saint Augustin; en apprenant ce
voeu, l'évêque d'Hippone écrivit la lettre suivante à Armentarius et à Pauline pour
les fortifier dans leur résolution. Le monde retentissait alors de la chute de Rome et
des ravages des Barbares; saint Augustin, sous les coups de ces vastes malheurs, fait
remarquer que la vie humaine a perdu de son charme et que les joies du temps sont devenues
trop peu de chose pour qu'on n'en fasse pas aisément le sacrifice à Dieu. On trouve dans
cette lettre des pensées ingénieuses et profondes sur notre passage ici-bas.
La lettre suivante, rédigée par saint Augustin, fut adressée au nom des évêques
catholiques de l'Afrique au tribun Marcellin, chargé de présider la conférence de
Carthage du 1er juin 411, convoquée au nom de l'empereur Honorius. On peut voir dans
notre Histoire de saint Augustin un récit complet de cette conférence d'où l’on
avait espéré que sortirait la paix de l'Église d'Afrique. Cette lettre était, de la
part des catholiques, comme l'acceptation des conditions et des règlements de
l'assemblée; en tête figurait le nom d'Aurèle, évêque de Carthage, et le nom de
Sylvain, primat de Numidie, qui se trouvait. le plus ancien d'ordination. Les évêques
catholiques offraient de renoncer à leurs sièges si les donatistes parvenaient à
prouver qu'ils eussent raison; ils consentaient à ce que les évêques de ce parti, s'ils
étaient vaincus, gardassent leur dignité en rentrant dans l'unité de l'Église. Ces
offres généreuses sont un beau souvenir pour l'Église d'Afrique.
Marcellin avait pensé qu'un petit nombre d'évêques choisis de part et d'autre par
leurs collègues suffiraient pour une sérieuse et sincère discussion dans la
conférence; mais les évêques donatistes demandèrent à y être tous présents. Les
catholiques écrivirent à ce sujet à Marcellin; saint Augustin rédigea la lettre; elle
va au fond de la question; elle est très-habile, très-forte : c'est une argumentation
directe et sans réplique.
Cette belle lettre forme comme un livre sur la prière; elle est
adressée à une veuve romaine, d'un sang illustre, qui avait été femme de Probus,
préfet du prétoire et consul; elle était aïeule de Démétrias
à qui saint Jérôme écrivit une lettre célèbre sur la virginité, et belle-mère de
Juliana qui eut Démétrias pour fille. Proba,surnommée Faltonie, s'était retirée
en Afrique après le sac de Rome. Saint Jérôme s'exprime ainsi sur l’aïeule de la
jeune vierge romaine : « Proba, ce nom plus illustre que
toute dignité et que toute noblesse dans l'univers romain; à Proba
qui, par sa sainteté et sa bonté envers tous, s'est rendue vénérable aux Barbares
mêmes, et qui s'est peu inquiétée des consulats ordinaires de ses trois fils, Probinus, Olybrius et Probus; cette femme, pendant que tout est
esclave à Rome au milieu de l'incendie et de la dévastation, vend, dit-on, en ce moment,
les biens qu'elle tient de ses pères, et se fait, avec l'unique Mammone,
des amis qui puissent la recevoir dans les tabernacles
éternels. » Voilà ce qu'était la veuve à laquelle saint Augustin parle de la prière
avec tant d'âme, de charme et d'élévation. Les gens du monde et surtout les riches de
la terre qui ont le goût de la vie chrétienne ne peuvent rien lire de meilleur et de
plus nourrissant que cet écrit de l'évêque d'Hippone.
Les lettres des dames romaines qui avaient l'honneur de correspondre avec saint
Augustin auraient été bien intéressantes pour nous, comme étude religieuse et comme
étude littéraire; leur perte est regrettable. La petite lettre qu'on va lire est une
réponse à Proba; elle nous donne une idée des sentiments
élevés qui s'échangeaient entre l'évêque et l'illustre veuve.
Volusien, à qui cette lettre est
adressée, avait rempli les fonctions de proconsul en Afrique; il était frère d'Albine dont nous avons eu occasion de parler, mais n'appartenait pas
encore à la religion chrétienne; saint Augustin l'engage à
lire l'Ecriture sainte et à lui faire part des difficultés et des doutes qui pourront
l'arrêter. Nolusien ne se fit chrétien qu'aux approches de
la mort.
L'ignorance ou la mauvaise foi des ennemis de l'Eglise ne s'est pas lassée de
travestir saint Augustin en persécuteur acharné; la lettre suivante est un des nombreux
témoignages de la douceur de l'évêque d'Hippone et de la douceur du génie catholique. on remarquera avec quelle autorité l'évêque parle de miséricorde
à un grand personnage de l'empire.
Voici la lettre au proconsul; on admirera le même esprit de douceur à l'égard des
coupables, et l'on remarquera, comme dans la précédente lettre, le ton d'autorité
épiscopale.
On se rappelle en quels termes l'évêque d'Hippone engageait Volusien
à faire connaissance avec nos saintes Écritures ; celui-ci ne communique pas encore à
saint Augustin le résultat de ses propres études religieuses, mais il lui rend compte
d'une conversation entre amis où l'on avait touché à des sujets divers, et lui soumet
des doutes exprimés par l'un d'eux sur le christianisme. Cette lettre est curieuse ; on y
voit comment saint Augustin était jugé de ses contemporains. Nous avons dit que Volusien était encore païen.
Marcellin, qui avait à coeur ta conversion de Volusien au christianisme, prie saint
Augustin de répondre aux difficultés proposées par son ami; il ajoute d'autres
difficultés qu'il savait occuper l’esprit de Volusien.
On lira avec profit et admiration cette célèbre lettre où l'évêque d'Hippone
répond aux objections que Volusien lui avait soumises; rien
de plus fort, de plus profond que cette manière de rendre raison d'un grand mystère.
Cette lettre à Volusien, où une vive éloquence accompagne
toujours la pénétrante originalité de la pensée, où tout est si serré et si plein,
si animé et si frappant, est le plus beau rayon de lumière qui ait été jeté sur le
mystère de l'incarnation.
Ceci est la réponse aux questions que Marcellin avait cru utile de soumettre à
l'évêque d'Hippone; il s'agit de montrer comment Dieu, malgré son immutabilité, a pu
substituer à la loi ancienne une loi nouvelle. Il s'agit aussi de faire justice des
accusations portées contre le christianisme au nom de la conservation et des intérêts
des Etats; ces accusations se sont renouvelées dans le dix-huitième siècle et surtout
sous la plume de Rousseau ; elles ne subsistent pas longtemps devant la raison éloquente
de saint Augustin.
On remarquera dans cette lettre les efforts de saint Augustin pour arracher au
glaive de la loi les donatistes coupables, et l'on verra aussi de quel poids d'affaires
était constamment écrasée la vie de l'évêque d'Hippone.
Un habitant de Carthage, nommé Honoré, mais dont nous ne
connaissons pas la vie et que saint Augustin comptait au nombre de ses amis, avait
adressé cinq questions au grand évêque, le priant de vouloir bien lui répondre par
écrit ; voici la réponse de l'évêque d'Hippone qui a l'étendue d'un livre ; l'examen
des cinq questions s'y déroule avec un admirable enchaînement; saint Augustin y avait
ajouté une sixième question sur la grâce pour mieux faire comprendre toute l'économie
du christianisme, et pour prémunir contre la propagande pélagienne. Il commente dans
cette lettre le fameux psaume prophétique dont Jésus. Christ, sur la croix, prononça le
premier verset. Avant de lire la lettre à Honoré, on ferait bien de voir ce que nous
avons dit sur le pélagianisme dans le XXIXe chapitre de l'Histoire de saint Augustin.
Honoré n'était pas encore chrétien; saint Augustin avait besoin de lui expliquer toutes
choses et de revenir souvent sur les mêmes idées et les mêmes détails ; voilà la
raison des longueurs et des répétitions qu'on rencontre parfois dans cette lettre ; mais
la lumière n'en jaillit que plus vivement.
Après la conférence de Carthage, en 411, où les donatistes furent si
solennellement condamnés, beaucoup d'évêques du parti vaincu firent courir le bruit que
les évêques catholiques avaient gagné à prix d'argent Marcellin, le président et le
juge de la conférence. II importait de ne pas laisser sans réponse ces menteuses
accusations. Le 14 juin 412, des évêques catholiques, réunis en concile à Zerta en
Numidie, adressèrent aux donatistes une lettre qui établissait la vérité et rappelait
l'ensemble des actes de la conférence. Saint Augustin nous apprend lui-même que cette
lettre synodique fut son ouvrage.
Les efforts de saint Augustin en faveur de l'unité n'étaient pas stériles ; il
avait de douces paroles pour les donatistes ramenés à la foi catholique; voici ce qu'il
écrivait à des ecclésiastiques revenus à la vérité.
La première partie de cette lettre renferme d'admirables leçons de modestie dont
tous ceux qui écrivent doivent profiter. Le reste est consacré à l'examens ou plutôt
à l'exposition des opinions diverses sur l'origine de l'âme. Saint Augustin n'a jamais
voulu prendre parti dans cette difficile question.
Les persistants efforts de saint Augustin avaient converti à l'unité catholique la
population de Cirta ou Constantine; les principaux de cette ville écrivirent à
l'évêque d'Hippone pour le lui annoncer et pour l'engager à les visiter et à jouir sur
les lieux de son oeuvre de paix. On va voir avec quel sentiment chrétien saint Augustin
leur répond; il ne perd pas cette occasion, de faire toucher du doigt la vérité aux
donatistes non encore ramenés à l'unité.
Saint Augustin, dont la vie est sans repos, parie du repos sur la terre et des
charmes puissants du monde; il établit que ce n'est pas la crainte mais l'amour de la
justice qui doit nous exciter à fuir le mal ; en peu de lignes précises et fortes, il
met en garde contre la naissante doctrine des pélagiens.
Pélage, au concile de Diospolis, en 415, chercha à
tirer parti d'une lettre de saint Augustin à son adresse ; voici cette petite lettre de
simple politesse que l'évêque d'Hippone a rapportée dans son livre des Gestes de
Pélage et dont pas un mot ne pouvait autoriser les doctrines du moine breton.
Cette lettre, adressée à une femme dont nous avons déjà prononcé le nom, et la
lettre suivante adressée à Fortunatien, évêque de Sicca, ont pour but d'établir que
Dieu ne peut être vu des yeux du corps, et que la vue de Dieu dans la vie future est
réservée à ceux qui auront le cœur pur. Saint Augustin, dans le deuxième livre de
la Revue de ses ouvrages, chap. XII, mentionne la lettre à Pauline qui a
l'étendue d'un livre, et fait observer qu'il n'y a pas traité la question de savoir si,
après la résurrection de la fin des temps, Dieu pourra être vu des yeux du corps
spirituel. « Mais, ajoute l'évêque d'Hippone, je crois avoir suffisamment éclairci
cette question si difficile dans le dernier livre, c'est-à-dire dans le vingt-deuxième
livre de la Cité de Dieu. » Saint Augustin, dans la Revue, mentionne aussi
sa lettre à Fortunatien qu'il appelle un mémoire, mais sans en faire le sujet d'aucune
remarque. La lettre à Pauline, indépendamment de sa valeur théologique, est un long
effort du génie pour franchir le monde des corps et s'élever dans le monde de l'âme;
les principes de la métaphysique chrétienne sont là. Le témoignage du sens intime se
trouve invoque dans cet écrit comme motif de certitude. Plus d'une fois saint Augustin se
répète, évidemment pour se faire comprendre d'une femme, et, à plus de quatorze
siècles de distance, nous avons une grande considération pour cette Pauline, que
l'évêque d'Hippone jugea digne de recevoir communication de ses pensées sur un sujet
aussi difficile c'est un grand exemple pour les femmes chrétiennes de notre temps.
Fortunatien fut un des sept évêques catholiques choisis pour soutenir la dispute
contre les donatistes dans la conférence de Carthage. Saint Augustin le prie en des
termes à la fois humbles, doux et charmants, de lui obtenir son pardon d'un collègue qui
avait été blessé de quelques passages de la lettre à Pauline , où l'anthropomorphisme
est vivement et sévèrement condamné. L'évêque d'Hippone traite de nouveau de la
nature de Dieu, de son invisibilité, de l'état futur des corps après la résurrection,
et rappelle que, selon la parole du Christ, la vue de Dieu est réservée À ceux qui ont
le coeur pur.
Cette réponse, au saint évêque de Nole, entièrement consacrée à l'explication
de plusieurs passages de l'Ecriture, intéresse les ecclésiastiques beaucoup plus que les
gens du monde; toutefois elle renferme de temps en temps des pensées qui vous font
pénétrer dans les entrailles mêmes du christianisme; l’espoir de rencontrer de
tels rayons de lumière mérite qu'on brave l’aridité de certains commentaires.
Dans le XVIe chapitre de l'Histoire de saint Augustin, nous avons eu occasion de
parler de Démétrias, cette jeune romain d'un sang illustre, qui fit voeu de virginité
à Carthage; ce fût comme un grand événement dont l'Italie , l'Afrique et l'Orient
retentirent. Juliana et Proba l'annoncèrent à l'évêque d’Hippone qui n'avait pas
été étranger à la pieuse résolution à la jeune romaine. Voici la réponse; que leur
adressa saint Augustin.
La mort de Marcellin et de son frère Apringius, qui avait été proconsul d'Afrique
, fut un grand crime ; nous en avons raconté les détails dans l'Histoire de saint
Augustin, chap. XV. Marin, vainqueur du rebelle Héraclien pour le compte d'Honorius,
arrivé à Carthage avec toute l'autorité que lui donnaient sa mission et ses succès,
traita l'illustre et pieux Marcellin comme un ennemi de l'empereur et se montra aussi
rusé qu'impitoyable. L'histoire accuse Cécilien, ancien Préfet d'Italie, d'avoir été
le complice du comte Marin ; il gardait des rancunes contre Marcellin et son frère. La
rumeur contemporaine a pleinement autorisé ce soupçon. La lettre qu'on va lire a toute
la valeur d'une pièce historique, relativement au meurtre odieux de l'ancien président
de la conférence de Carthage. Cécilien, à qui saint Augustin avait cessé d'écrire ,
s'était plaint à l'évêque d'Hippone de son silence ; le grand et saint homme, dans sa
réponse, dit qu'il n'est pas du nombre de ceux qui croient à la culpabilité de
Cécilien, mais sa façon de lui rappeler des souvenirs et de lui poser des questions
laisse autour de Cécilien bien des ombres. Un passage de la fin de cette lettre nous
apprend que Cécilien n'était encore que catéchumène.
Macédonius, vicaire d'Afrique, à qui saint Augustin s'était plus d'une fois
adressé en faveur des gens coupables , lui demande de vouloir bien lui donner les raisons
chrétiennes de l'intercession épiscopale auprès des hommes revêtus du pouvoir.
Saint Augustin, répondant à Macédonius, expose toute la pensée de notre religion
sur la punition des crimes; cette lettre mérite d'être lue et relue par tous ceux qui
sont chargés de la justice humaine en ce monde. Elle fait aussi beaucoup penser à la
question de la peine de mort dans les sociétés chrétiennes. Cette lettre qui va au fond
de tant de choses est un monument du génie miséricordieux de l'Évangile.
Le vicaire d'Afrique exprime à saint Augustin ses sentiments de respectueuse
admiration ; il avait reçu et tu les trois premiers livres de la Cité de Dieu.
Toutes les beautés de la philosophie chrétienne se trouvent dans cette lettre où
saint Augustin entretient Macédonius des conditions de la vie heureuse et des devoirs de
ceux qui sont à la tête des peuples. Cette lettre est pleine de choses admirables; elle
établit les fondements de la politique chrétienne.
Un pieux et docte laïque de Syracuse , nommé Hilaire ,
le même peut-être dont nous retrouverons une lettre sous là date de 429, adresse à
saint Augustin d'importantes questions.
La réponse à Hilaire est célèbre; saint Jérôme l'appelle ai livre. Orose lut
cette lettre dans l'assemblée de Jérusalem ai se trouvait Pélage, à la fin de juin 440
; elle fut lue aussi dans la réunion de Diospolis ou Lydda , au mois de décembre de la même année (voir l’Histoire
de saint Augustin, chap. XVIII). L'évêque d'Hippone établit la doctrine de la gràce contre lea naissantes erreurs des
Pélagiens qu'il désigne sans les nommer; il établit aussi la vérité de l'enseignement
chrétien relativement aux riches.
Evode, évêque d'Uzale, un des plus anciens et des meilleurs amis de saint
Augustin, était un esprit curieux qui ne manquait ni de vigueur ni de pénétration ; les
recherches métaphysiques avaient pour lui un attrait particulier. Après avoir raconté
la mort touchante d'un pieux adolescent, Evode interroge saint Augustin sur les
apparitions des morts dans les songes et sur l'état de l'âme après qu'elle est
séparée du corps. Il ne lui semble pas que l'âme, par-delà cette vie, puisse subsister
sans être unie à un corps quelconque.
Saint Augustin répond avec réserve aux questions d'Evode il cite lui-même une
vision curieuse et instructive d'un célèbre médecin de son temps, appelé Gennadius. Il
renvoie Evode au XIIe livre de son ouvrage sur la Genèse.
Questions d'Evode sur la raison et sur Dieu.
Evode soumet à saint Augustin deux difficultés
tirées, l'une de la lettre CXXXVII à Volusien, l'autre de la
lettre XCII à Italica : la première de ces difficultés est
relative à l'incarnation de Jésus-Christ; la seconde à la question de savoir si on peul
voir Dieu, même avec les yeux d'un corps glorifié.
Saint Augustin se plaint d'être interrompu dans ses travaux par les questions
nouvelles qui lui sont continuellement adressées; il lui faudrait du temps pour résoudre
convenablement tant de difficultés , car ses lettres tombent en beaucoup de mains. En
réponse à des questions d'Evode, il lui rappelle ceux de ces ouvrages qui pourraient
l'aider. L'évêque d'Hippone parle des songes et de l'état de l'âme dans le sommeil; il
distingue les choses qui n'ont pas de raison d'être de celles dont la raison nous est
cachée, et s'attache à prouver que Dieu ne peut pas être vu des yeux du corps.
Evode propose quelques doutes à Augustin.
Saint Augustin répond aux difficultés proposées par Evode dans la lettre qu'on
vient de lire. L'évêque d'Hippone commence comme un homme qui croit ne pas savoir, qui,
au lieu d'instruire les autres, demande qu'on l'instruise lui-même, et puis de sa parole
réservée s'échappent les plus vives et les plus belles lumières.
Cette lettre, écrite en 410 , eût demandé , par sa
date, une autre place ; on l'a mise ici parce que le grand solitaire de Bethléem y engage
Marcellin à consulter saint Augustin sur la question de l'origine de l'âme, traitée
dans la lettre CLXVIe, adressée à saint Jérôme. On y voit les malheurs du monde à
cette époque pénétrer jusque dans la cellule du laborieux et profond commentateur des
livres divins.
Cette lettre à saint Jérôme est une des plus remarquables
qu'ait écrites l'évêque d'Hippone ; il établit d'abord ce qu'il y a de certain sur
l'âme , son immortalité , sa spiritualité, et comment l'âme est dans le corps. Saint
Jérôme croyait que Dieu crée des âmes pour chaque homme qui arrive au monde; saint
Augustin voudrait pouvoir admettre cette opinion qu'il défend contre beaucoup
d'objections, mais la difficulté tirée du péché originel l'arrête ; il supplie le
solitaire de Bethléem de dissiper tous ses doutes à cet égard. Que de rectitude, de
pénétration, et souvent que d'éloquence dans cette lettre ! que de génie et que
d'humilité! quelle réserve dans les choses douteuses ! On verra plus d'une fois
l'imagination se mêler ici à la profondeur; on sera frappé d'une comparaison tirée de
la musique pour exprimer l'harmonieuse beauté de l'ordre en ce monde dans la succession
des choses passagères.
Il s'agit ici du passage de l'épître de saint Jacques, où il est dit : «
Quiconque ayant gardé tout la loi la viole en un seul point, est coupable comme s'il
l'avait violée tout entière.» Saint Augustin demande à saint Jérôme l'explication de
ce passage ; il en donne lui-même un commentaire qu'il soumet au solitaire de Bethléem.
Avant de présenter ce lumineux et beau commentaire, il examine la doctrine des
philosophes anciens et particulièrement des stoïciens sur les vertus et les vices. On
voit ici le moraliste chrétien dans la sûreté et la profondeur de son jugement.
Timase et Jacques, deux jeunes hommes, nobles et
lettrés, s'étaient laissé prendre aux doctrines de Pélage et avaient eu le bonheur
d'être éclairés par saint Augustin. Ils envoyèrent à l'évêque d'Hippone un ouvrage
du novateur breton, en forme de dialogue, où la grâce chrétienne recevait de graves
atteintes; ils priaient le saint docteur de réfuter cet ouvrage. C'est ce que fit saint
Augustin par son livre De la Nature et de la Grâce (1); il en adressa une copie à
Timase et à Jacques, et ceux-ci écrivirent à l'évêque
d'Hippone une lettre de remerciement : c'est la lettre qu'on va lire, tirée des Gestes
de Pélage.
Saint Augustin énumère les ouvrages qui absorbent ses loisirs et se plaint qu'on
le détourne de ses travaux par des questions nouvelles d'une moindre importance et d'un
intérêt moins général; il donne à Evode le vrai sens d'un passage de saint Paul et
répond à ses questions sur. la Trinité.
Maxime, médecin de Ténès, l'ancienne Cartonna, à qui cette lettre est adressée
, avait quitté l'arianisme pour rentrer dans l'unité catholique ; saint Augustin le
presse de ramener à la vérité tous ceux de sa maison, et, pour affermir sa foi et le
mettre à même d'instruire les autres, l'évêque d'Hippone, de concert avec son
collègue Alype, établit en termes précis la divinité de Jésus-Christ et le dogme de
la Sainte-Trinité.
Les lettres à de grands personnages n'étaient écrites que d'un seul côté; on
écrivait des deux côtés avec des amis ou avec des personnes qu'on traitait sans
cérémonie; la lettre au médecin Maxime avait cette forme; saint Augustin et Alype croient devoir s'expliquer à ce sujet dans un billet adressé
à l'évêque Pérégrin.
Nous donnons ici le fragment d'une lettre de saint Augustin qui ne figure pas dans
les éditions latines des lettres de l’évêque d'Hippone , si on excepte l'édition
de 1845 (2). On suppose qu'elle est adressée au médecin Maxime ,
de Ténès, et c'est pourquoi nous la plaçons ici. Ce fragment, qui touche aux sept
béatitudes, marque les sept degrés de la vie chrétienne. il
a été trouvé dans les commentaires de Primase sur
l'Apocalypse.
C'est la lettre qu'écrivit saint Jérôme après avoir vu Orose et reçu les deux
livres sur l'origine de l'âme et sur le passage de l'épure de saint Jacques ; il loue le
travail de saint Augustin ; le langage du grand solitaire fait bien voir que toute trace
d'anciens dissentiments était effacée de son coeur.
Saint Augustin, dans cette lettre adressée à un prêtre donatiste, établit
brièvement le crime religieux de la séparation, et nous donne une idée des emportements
frénétiques des gens du parti donatiste.
Saint Augustin, en envoyant à l'évêque de Carthage une copie de ses livres sur la
Trinité, qu'il vient d'achever, lui fait comme l'historique de cet ouvrage. Cette lettre
a été placée , par ordre de l'évêque d'Hippone , en tête des quinze livres sur la
Trinité.
Les doctrines de Pélage et de Célestius sont
condamnées par le concile de Carthage au mois de juin 416 ; les Pères du concile
informent de leurs décisions le pape Innocent Ier.
Au mois de septembre 416 , les évêques catholiques de
la province de Numidie, réunis à Milève , appellent de leur
coté l'attention du pape Innocent sur les erreurs des pélagiens ; voici la lettre
collective qu'ils adressent au souverain pontife; elle fut rédigée par saint Augustin.
Cinq évêques d'Afrique signalent au pape Innocent les erreurs du pélagianisme, et
c'est saint Augustin qui parle ; on remarquera avec quelle respectueuse soumission ces
évêques du Ve siècle s'adressent au Saint-Siège. La primauté du Pape n'est donc pas
une invention moderne.
Le personnage de nom d'Hilaire, à qui cette lettre est adressée, était
évidemment évêque ; ce n'est donc pas Hilaire d'Arles, puisque celui-ci ne fut élevé
à l'épiscopat qu'en 428; c'est probablement l'évêque de Narbonne;vous n'avons pas
besoin d'ajouter qu'il n'a rien de commun avec Hilaire de Syracuse dont nous avons
reproduit une lettre sous la date de 414; celui-ci, qui, du reste, était laïque, avait
entendu parler des erreurs des pélagiens, puisqu'il en informa l'évêque d'Hippone, et
la lettre qu'on va lire est adressée à quelqu'un que saint Augustin suppose ne rien
savoir de l'hérésie nouvelle.
Jean était évêque de Jérusalem; nous avons dit dans l'Histoire de saint Augustin
(2) quelle fut son attitude en face de Pélage à l'assemblée de Diospolis. Saint
Augustin , profitant d'une occasion pour Jérusalem, écrit à Jean pour l'avertir et
l'instruire. Toutes ces lettres; à la naissance d'une grande hérésie, sont
très-intéressantes, et nous font assister à l'impression même des contemporains.
On connaît Océanus qui fut l'ami, le correspondant de saint Jérôme. C'est dans
cette lettre que saint augustin nous apprend que le grand solitaire de Bethléem avait
fini par se ranger à son sentiment sur la célèbre question du mensonge officieux; on
remarquera l'humilité de l'évêque d'Hippone qui se borne à dire que saint Jérôme
avait adopté en cela l'opinion de saint Cyprien.
Cette lettre du pape Innocent est belle, éloquente, rapide; on aime à entendre le
chef de l'Église déclarer sa conformité de sentiments avec la vieille Afrique
chrétienne sur les grands points de la foi.
Le pape Innocent répond aux pères du concile de Milève sur les erreurs de Pélage
et de Célestius.
Le pape Innocent répond aux cinq évêques sur Pélage et ses erreurs.
Un billet du pape Innocent pour Aurèle et Augustin.
La plus grande partie de cette lettre si forte de doctrine, roule sur le péché
originel et l'état des enfants qui meurent sans le baptême; saint Augustin parle ensuite
des questions qu'il traite et des adversaires qu'il combat dans la Cité de Dieu.
Cette lettre que saint Augustin mentionne dans la Revue de ses ouvrages (liv. II,
chap. XLVIII), forme comme un livre elle fut adressée au comte Boniface dont le nom se
mêle aux événements de cette époque. L'évêque d'Hippone l'instruit de ce qui fait
l'hérésie des donatistes, en retrace l'histoire, et raconte comment il est arrivé que
des lois impériales aient été portées contre eux. Cette lettre est célèbre et d'un
grand intérêt religieux et historique ; il faut la lire avec attention et ne pas perdre
de vue la société et les temps au milieu desquels écrivait saint Augustin.
Saint Paulin avait connu et aimé Pélage ; il est à craindre qu'il ne fût point
assez en garde contre ses erreurs, ou plutôt contre ses artifices ; saint Augustin lui
écrit pour l'instruire de tout ce qui s'est passé , pour lui marquer les points
condamnables de la doctrine de Pélage et pour établir l'enseignement de l'Église
catholique sur la grâce. Cette matière si difficile et si délicate est traitée avec
beaucoup de force et d'autorité ; l'évêque d'Hippone use de ménagements admirables
envers saint Pantin. C'est polir mieux arriver à son cœur qu'il associe à sa
démarche Alype qui était particulièrement cher à l'évêque de Nole.
Saint Augustin, dans la Revue de ses ouvrages (3), mentionne cette lettre
qu'il appelle un livre Sur la présence de Dieu; elle est adressée à Dardanus
(4), préfet des Gaules , qui lui avait demandé l'explication de ces paroles du Christ
mourant au bon larron : « Tu seras aujourd'hui avec moi en paradis. » Dardanus mêlait
à cette question d'autres questions sur le Christ, sur le ciel , sur Dieu. Comme saint
Jean tressaillit de joie dans le sein d'Elisabeth aux approches de Marie , le préfet des
Gaules demande à l'évêque d'Hippone si les enfants ne peuvent pas connaître Dieu ,
même lorsqu'ils sont encore dans le sein maternel. Saint Augustin répond à tout avec
une grande abondance de détails, de témoignages et d'idées ; il montre comment Dieu est
présent partout tout entier, comment il habite en ceux qu'il aime, comment les saints
forment son temple. La question de Dardanus sur saint Jean et les enfants amène
l'évêque d'Hippone à attaquer à fond le pélagianisme sans parler de Pélage. II
importait de prémunir les Gaules contre les ravages de l'erreur naissante, et saint
Augustin démontre tout ce que la doctrine nouvelle a de faux et de contraire au
christianisme.
Démétrias, l'illustre vierge, romaine dont les veaux sacrés furent un si grand
événement, avait reçu de Pélage une lettre qui inquiétait saint Augustin; elle
formait comme un livre. L'évêque d'Hippone crut devoir s'adresser à la mère de
Démétrias, pour la mettre en garde , elle et sa fille,, contre l'erreur. Alype se
trouvait alors à Hippone ; Julienne lui avait écrit en même temps qu'à saint Augustin
et voilà pourquoi la lettre qu'on va lire porte les noms des deus saints amis.
Cette lettre au comte Boniface, écrite fort à la hâte parce que le porteur
pressait l'évêque d'Hippone, renferme d'éloquentes et belles exhortations dont peuvent
profiter les gens de guerre.
L'évêque Optat dont il s'agit ici et qu'il ne faut pas confondre avec Optat (de
Milève), avait écrit un livre sur l'origine de l'âme ; il désirait savoir l'opinion de
saint Augustin sur cette question. L'évêque d'Hippone l'avertit de ce à quoi il faut
prendre garde et semble craindre qu'Optat ne se laisse entraîner peut-être vers l'erreur
pélagienne. Il tient avant tout à établir et à sauvegarder la doctrine du péché
originel.
Sixte, à qui cette lettre est adressée, était alors simple prêtre à Rome; il
fut élevé plus tard à la papauté sous le nom de Sixte III. N'étant encore que prêtre
, il s'était laissé tromper par les artifices des Pélagiens. Mais ses lumières et sa
bonne foi triomphèrent des ruses des novateurs; il rendit publiquement témoignage à la
vérité. Sixte écrivit, en faveur de la grâce chrétienne, à Aurèle , évêque de
Carthage, et à saint Augustin. Os verra par cette réponse de l'évêque d'Hippone toute
sa joie on recevant la preuve du complet retour de Sixte à la pure et exacte doctrine
catholique.
Saint Augustin répond à Marius Mercator, écrivain laïque qui défendit la
vérité catholique contre les erreurs de Pélage et de Nestorius (2). II tire grand parti
d'une concession des pélagiens qui avouaient que les enfants croient dans la personne de
ceux qui les présentent au baptême. Il réfute une objection tirée des exemples d'Enoch
et d'Elie qui n'ont pas subi la peine générale de la postérité d'Adam condamnée à la
mort.
L'évêque d'Hippone, dans cette lettre au diacre Célestin (1), trace en quelques
lignes le caractère et les devoirs de la charité (2).
Les artifices des pélagiens avaient trompé une portion du clergé de Rome ; le
prêtre Sixte, qui s'était mal défendu contre leurs piéges, était un des hommes les
plus considérables du clergé Romain; nous avons vu qu'il revint promptement à la
vérité catholique. Plus son influence était grande à Rome, plus il importait de porter
autour de lui la lumière et de le mettre en mesure de répondre à toutes les subtilités
des pélagiens; c'est ce que comprit saint Augustin. Il adressa à Sixte la lettre
suivante où il établit la doctrine catholique avec des témoignages surabondants.
Ces lignes sont un grand hommage de saint Jérôme à saint Augustin; on sent que
nul vestige des dissidences du passé ne demeure dans 1'àme du solitaire de Bethléem ;
il ne voit plus que les grands services rendus à la cause de la vérité par l'évêque
d'Hippone , et surtout des victorieux combats d'Augustin dans la question pélagienne.
Saint Augustin distingue dans le judaïsme ce qui est aboli et ce qui subsiste
toujours; il développe la doctrine de saint Paul sur la différence entre les juifs selon
la chair et les juifs selon l'esprit; il montre que, depuis le Nouveau Testament, le
chrétien seul est le véritable israélite, et que l'israélite de race ne l'est que de
nom parce qu'il a perdu le bénéfice des promesses divines.
Hésychius, évêque de Salonne
en Dalmatie, s'était adressé à saint Augustin pour l'interprétation de certains
endroits de l'Ecriture sur la fin du monde ; l'évêque d'Hippone lui envoie des
explications tirées de saint Jérôme et lui dit que la seule chose certaine sur la fin
des temps, c'est qu'elle n'arrivera pas avant que l'Evangile soit prêché par toute la
terre.
Hésychius reconnaît , d'après les termes de l'Evangile , que personne ne peut
savoir le jour ni l'heure de la fin du monde, mais il croit que Dieu n'a pas voulu nous
cacher les temps et qu'il faut se préparer au second avènement du Sauveur; les malheurs
de l'époque où il vivait lui semblent faire partie des signes marqués dans l'Evangile.
L'évêque de Salonne exprime des doutes sur les semaines de Daniel et demande à saint
Aupatin qu'il veuille bien l'éclairer par une réponse étendue.
Saint Augustin, dans cette seconde réponse à Hésychius, traite à fond la
question de la fin du monde d'après les témoignages des divines Ecritures; nous y
trouvons les impressions et les terreurs contemporaines, mais nous y trouvons aussi la
tranquille sérénité d'un grand esprit, la mesure et la réserve qui n'abandonnent
jamais l'évêque d'Hippone. Il s'attache à prouver qu'on ne peut rien savoir sur
l'époque de la fin des temps. Saint Augustin a mentionné cette lettre dans le XXe livre,
chap. V, de la Cité de Dieu.
L’ouvrage de saint Augustin, intitulé : du Mariage et de la Concupiscence, est
dédié au comte Valère ; voici la lettre que lui écrivit l'évêque d'Hippone en lui
envoyant son livre.
Cette lettre, adressée à Auréle de Carthage, et dont
une copie spéciale fut envoyée à saint Augustin , est un
témoignage de l'intervention directe des empereurs chrétiens dans les affaires
chrétiennes; on y trouve à la fois la soumission au jugement des évêques en matière
ecclésiastique et le zèle pour le maintien de l’unité catholique. La cause de la
religion était devenue celle de l’Etat.
On a déjà vu dans la lettre qui fait la CXCVe de ce recueil l'admiration de saint
Jérôme pour les grands combats de saint Augustin contre le pélagianisme; nous trouvons
ici une expression nouvelle de ce sentiment. Saint Jérôme , chargé d'ans , voudrait
avoir les ailes de la colombe pour aller embrasser l'évêque d'Hippone.
L'origine de l'âme est encore le sujet de cette lettre. Saint Augustin parle de la
lettre qu'il a adressée à saint Jérôme et à laquelle il n'a encore reçu aucune
réponse; il ne veut pas livrer son travail sans l'accompagner de cette réponse qu'il
attend du grand solitaire. L'évêque Optat ne pensait pas que les âmes tirassent leur
origine de l'âme du premier homme; l'évêque d'Hippone cherche à le tenir en garde
contre une disposition à résoudre trop aisément une question remplie de tant de
mystères. Il conserve, quant à lui, tous ses doutes, et attend qu'on l'éclaire.
Cette petite lettre , adressée à un personnage que nous croyons avoir été
proconsul en Afrique, est une leçon donnée à tous ceux qui se jettent dans les choses
humaines sans en avoir senti le néant.
Saint Augustin éclaire et rassure le tribun Dulcitius
sur ses propres devoirs à l'égard des donatistes; il s'explique sur les furieux de ce
parti qui poussaient le délire jusqu'à se donner la mort.
Saint Augustin répond à diverses questions, entre autres sur le corps de
Jésus-Christ dans le ciel, depuis son ascension. Il satisfait à une curiosité pieuse et
répand sans effort les plus intéressantes observations Le début de la lettre est
charmant; l'évêque d'Hippone cherche toujours l'invisible beauté de l'homme intérieur.
Lettre de recommandation.
Saint Augustin envoie Claude , que nous
croyons être un, évêque d'Italie, ses six livres contre Julien, alors le chef de lai
secte pélagienne.
Il y a des chrétiens qui se laissent troubler parles scandales qui arrivent dans
l'Église ; cette lettre de saint Augustin est faite pour dissiper les dangereuses
inquiétudes de leur esprit.
Il s'agit ici de l'affaire d'Antoine, évêque de Fussale, qui fut une grande
douleur dans la vie de saint Augustin. Voyez ce que nous en avons dit dans le XLVIe
chapitre de notre Histoire de saint Augustin.
Félicité était la supérieure et Rustique le supérieur d'un monastère de femmes
où était entrée la division; saint Augustin leur adresse d'utiles et de belles
exhortations
L'évêque d'Hippone, après des reproches paternels et des plaintes touchantes,
adresse à des religieuses un ensemble de prescriptions restées célèbres dans le monde
chrétien sous le nom de Règle de saint Augustin. On peut voir ce que nous en avons dit
dans l’Histoire de saint Augustin.
Saint Augustin recommande à son collègue Quintilien une veuve et sa fille, toutes
les deux consacrées à Dieu; les lignes qui terminent cette courte lettre seront pour les
protestants un témoignage de l'antiquité du culte des reliques.
On est convenu de donner sous le titre de lettre CCXIII l'acte qui fut dressé le 26
septembre 426 dans l'église de la Paix à Hippone, en présence du clergé et du peuple,
et par lequel les fidèles d'Hippone acceptèrent comme successeur de leur évêque le
prêtre Héraclius, désigné par saint Augustin lui-même. Cette pièce est d'un grand et
touchant intérêt.
Saint Augustin écrit au supérieur .et aux religieux du monastère d'Adrumet (1)
où s'était montrée une certaine émotion à l'occasion de la lettre de notre docteur au
prêtre Sixte sur la question pélagienne. Deux jeunes gens de ce couvent étaient venus
trouver l'évêque d'Hippone. On verra tout au long dans la lettre CCXVI l'origine et le
récit des troubles d'Adrumet.
Saint Augustin n'avait pas laissé repartir pour Adrumet les moines Cresconius et
Félix, afin de les mettre en mesure de bien comprendre la vérité dans la question
pélagienne ; lorsqu'ils forent près de quitter Hippone avec toutes les pièces relatives
au pélagianisme et avec un livre de notre docteur composé tout exprès pour les moines
d'Adrumet , le saint évêque leur donna la lettre suivante adressée à leur abbé et à
leurs frères.
Valentin raconte ce qui s'est passé dans son monastère , il explique comment il
n'a pas écrit à l'évêque d'Hippone par ceux de ses frères qui sont allés trouver le
saint Docteur; il avoue humblement sa honte et condamne ce qui a été fait. Sa
reconnaissance est vive pour le livre que saint Augustin a adressé aux moines d'Adrumet.
La lettre de Valentin, écrite dans des termes de vénération profonde et dans un langage
animé, nous donne une idée de l'immense considération dont jouissait saint Augustin
parmi ses contemporains.
Vital, de Carthage, ne partageait pas toutes les erreurs de Pélage, mais il
prétendait que le commencement de la foi était l'œuvre même de la volonté de
l'homme; saint Augustin lui prouve le contraire par les saintes Ecritures et par les
prières de l'Eglise. Il établit douze points qui comprennent toute la vérité
catholique sur la question de la grâce ; il éclaircit brièvement chacun de ces points.
Saint Augustin encourage à la vie chrétienne un jeune homme du monde dont le coeur
s'était séparé des choses de la terre; et comme le pélagianisme, était alors le grand
péril des âmes, l'évêque d'Hippone ne manque pas de prémunir son jeune ami.
Cette lettre, rédigée par saint Augustin, de concert avec trois évêques
d'Afrique, est adressée à Procule, évêque de Marseille, et à un autre évêque du
midi des Gaules, appelé Cylinnin Elle est un monument du respect des évêques les uns
pour les autres. Le moine Léporius, du diocèse de Marseille, ayant été chassé à
cause de ses persistantes erreurs sur l'incarnation, était venu en Afrique et s'était
mis entre les mains de saint Augustin. Notre saint Docteur eut le bonheur de le ramener à
la vérité et de ramener aussi ceux que Léporius avait séduits , et qui l'avaient suivi
en Afrique. Saint Augustin s'excuse d'avoir accueilli un moine chassé par ses collègues
des Gaules et les prie de vouloir bien les recevoir, lui et ses compagnons, maintenant
qu'ils sont revenus à la vraie doctrine. Il joint à sa lettre la profession de foi,
signée de Léporius et de ses compagnons. On croit que cette profession de foi fut
rédigée par saint Augustin lui-même. Il y a, dans la lettre qu'on va lire, un tact
admirable et des précautions parfaites pour ne pas déplaire aux deux évêques des
Gaules. Gennade, dans son livre des Ecrivains Ecclésiastiques, Cassien, dans son Traité
de l'Incarnation, le pape Jean II dans une lettre, Facundus, dans ses douze livres sur les
trois chapitres, ont mentionné le retour de Léporius à la foi catholique par les soins
de saint Augustin.
Boniface fut un des derniers hommes d'épée qui soutinrent la
grandeur romaine; on sait comment les machinations de son rival Aétius lui firent perdre
la confiance de l'impératrice Placidie et le firent tomber au rang des rebelles.
Boniface, obligé de se défendre contre les forces de l'empire, ne recula point devant
une alliance avec les vandales et leur ouvrit les portes de l'Afrique. Les barbares de
l'intérieur avaient levé la tète; les intérêts catholiques étaient menacés comme
les intérêts romains. Saint Augustin, ami de Boniface, souffrait d'une situation aussi
mauvaise ; il écrivit au gouverneur de l'Afrique la lettre suivante, où des faits
curieux se mêlent à une grande sévérité chrétienne. L'exhortation à ne pas rendre
le mal pour le mal est ici d'un grand effet. Cette lettre remua profondément Boniface et
prépara sa réconciliation avec Placidie. Voyez ce que nous en avons dit dans notre Histoire
de saint Augustin, chapitre LI.
Quodvultdeus, de sainte mémoire, alors diacre, et qui
occupa plus tard le siége de Carthage, demande à saint Augustin un travail où soient
brièvement marquées les erreurs de chaque hérésie et les réponses des catholiques.s
L'évêque d'Hippone parle de la difficulté du travail qui lui est demandé et
rappelle ce qui a été fait par saint Epiphane et par Philastre.
Quodvultdeus s'afflige de ne pouvoir obtenir ce qu'il souhaite et fait de grandes
instances auprès de saint Augustin. Il se compare à l'importun dont parle l'Evangile et
veut frapper à la porte jusqu'à ce qu'on lui ouvre.
Saint Augustin promet au diacre de Carthage de faire ce qu'il désire, dès que sa
réponse aux livres de Julien lui laissera quelque loisir ; il donne de curieux détails
sur la Revue de ses ouvrages qui a occupé les derniers temps de sa vie.
Saint Prosper (d'Aquitaine), l'auteur du Poème contre les ingrats, écrivain
de talent et d'une foi profonde, a glorieusement mêlé son nom au luttes contre le
semi-pélagianiste. Le parti des semi-pélagiens, dans les Gaules, avait pour chef le
célèbre Jean Cassien, fondateur de l'abbaye de Saint-Victor, à Marseille; Prosper
était retiré dans cette ville pendant que de pieux prêtres et même d'illustres
évêques du midi des Gaules refusaient d'accepter toute la doctrine de saint Augustin,
sur la grâce. Il écrivit à l'évêque d'Hippone la lettre suivante pour le mettre au
courant de tout ce qui se passait autour de lui et pour le supplier de venir en aide à la
vérité méconnue. On lira tout a l'heure une lettre écrite dans le même sens par
Hilaire qui était laïque comme Prosper. Les livres de la Prédestination des saints
et du Don de la persévérance furent la réponse de saint Augustin aux deux
laïques des Gaules.
Voici la lettre d' Hilaire sur les semi-pélagiens des Gaules ; elle n'est pas d'une
aussi bonne latinité que la lettre de saint Prosper, mais on sent un esprit pieux et vif,
très-appliqué aux études religieuses, et auquel les matières de la grâce étaient
familières Hilaire ramasse, autant qu'il le peut, les objections et les raisonnements des
semi-pélagiens et s'attache à ne rien laisser ignorer au grand évêque dont il invoque
les lumières. On comprendra, par sa lettre, qu'il avait vu saint Augustin à Nippone ;
c'est lui qui avait engagé Prosper à écrire de son côté au grand docteur. Quinze ans
auparavant, un laïque , du nom d'Hilaire, écrivait de Syracuse à saint Augustin,
précisément sur la question pélagienne, et le saint évêque lui répondait; cet
Hilaire de Syracuse, qui écrivait en 414, est-il le même que le laïque de ce nom
écrivant de Marseille en 429 ? c'est possible mais nous ne l'affirmons pas Ce qui est
indubitable, c'est que l'auteur de la lettre que nous allons traduire est différent de
saint Hilaire, évêque d'Arles.
Saint Augustin annonce à son vieil et saint ami Alype la conversion de deux païens
de leur connaissance ; la conversion de l'un d'eux avait été précédée de miracles
frappants.
Honoré, évêque de Thiave, avait consulté saint Augustin sur ta conduite que
devaient tenir les pasteurs au milieu des dangers qui menaçaient les villes de l'Afrique
; il parait que ses sentiments n'étaient pas tout à fait conformes aux vrais devoirs des
ministres de Dieu. Saint Augustin lui répondit ; on va voir la belle fermeté de son
langage. Cette lettre, qui doit être relue par les ecclésiastiques dans les temps de
calamités publiques, touche aux moeurs et à l’histoire de l'Afrique chrétienne.
Darius, personnage important de la cour impériale, fut le négociateur qui
réconcilia le comte Boniface avec l'impératrice Placidie; il obtint des vandales une
trêve qui, malheureusement, ne fut pas longue. C'est à l'occasion de cette paix,
accueillie en Afrique avec tant de joie, que saint Augusutin écrivit à Darius la lettre
suivante.
Darius répondit à saint Augustin; c'est une lettre d'enthousiasme pour l'évêque
d'Hippone. Il est heureux que le grand
évêque lui ait écrit ; il serait plus heureux encore s'il pouvait le voir. Darios
souhaite que la trêve conclue avec les vandales puisse devenir une paix durable. Il a lu
quelques ouvrages de saint augustin et voudrait bien lire les Confessions. En demandant à
l'évêque d'Hippone son intercession auprès de Jésus-Christ, il rappelle la prétendue
correspondance entre Abgare et le Sauveur.
Saint Augustin témoigne à Darius le plaisir que lui a fait sa lettre; il parle de
l'amour de la louange et nous apprend dans quel sens on peut aimer à être loué. Il
espère que le goût de Darius, pour ses écrits contre le paganisme, contribuera à les
répandre afin d'effacer dans la société romaine les derniers vestiges du polythéisme.
L'évêque d'Hippone parle admirablement de ses Confessions qu'il envoie à Darius; il lui
adresse en même temps quelques-uns de ses antres ouvrages. Cette lettre est la dernière
de saint Augustin dont nous connaissions la date et assurément une des dernières qu'il
ait écrites. Il mourut le 28 août 430.
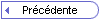 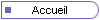 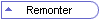  |