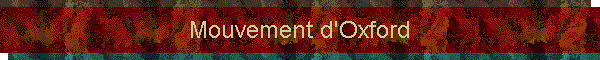
|
|
LA RENAISSANCE CATHOLIQUE EN ANGLETERRE AU XIXe SIÈCLEPREMIÈRE PARTIENEWMAN ET LE MOUVEMENT D’OXFORD
Par PAUL THUREAU-DANGIN DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE
DEUXIÈME ÉDITION, Paris 1899
Abbaye Saint Benoît ; Bibliothèque ;
Table des Matières :
LA RENAISSANCE CATHOLIQUE EN ANGLETERRE AU XIXe SIÈCLE NEWMAN ET LE MOUVEMENT D’OXFORD Voici la liste des principaux ouvrages que j’ai consultés EN ANGLETERRE AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE NEWMAN ET LE MOUVEMENT D’OXFORD
I. La pensée anglaise et le problème religieux après Waterloo. En quoi l’Eglise anglicane ne répondait pas aux besoins du moment. Déclin du parti evangelical. L’école « libérale »; Whately et Arnold. — . II Que restait-il du High Church? J. Keble et The Christian Year. Richard Hurrell Froude. — III . La jeunesse de Newman. Il est élu fellow d’Oriel. Ses rapports avec Whately et sa phase « libérale ». Il devient l’ami de Pusey. Son ordination. — IV. Newman est nommé tutor à Oriel, puis vicar de Sainte-Marie. Il commence à devenir un centre. Côtés tendres de sa nature. — V. Newman se dégage du « libéralisme ». Il se lie avec Froude, se laisse gagner à ses idées et, par lui, se rapproche de Keble. Mécontentement de ses amis « libéraux ». Mariage de Pusey. Newman et le ménage de Pusey. Les opinions de Pusey à cette époque. — VI . Première action publique de Newman lors de la candidature de Robert Peel à Oxford. Contre-coup de la Révolution de 1830 en Angleterre. L’Eglise établie paraît menacée: Newman et Froude sentent qu’elle ne peut être sauvée que par une contre-réforme. — VII. Voyage de Froude et de Newman dans le midi de l’Europe. Leur impression à Rome. Newman a l’idée d’une œuvre à faire en Angleterre. Sa maladie en Sicile. Son retour en Angleterre.
LES DÉBUTS DU MOUVEMENT (1833-1836)
I. Le sermon de Keble sur « l’Apostasie nationale » donne le signal du Mouvement. Tendances différentes de Newman et Froude d’une part, et de Palmer, Perceval et Rose d’autre part. Publication du premier Tract for the Times. Les Tracts suivants. Etat d’esprit de Newman. Diffusion des Tracts. Palmer voudrait les arrêter. Newman, poussé par Froude, s’y refuse. — II . Adresse à l’archevêque de Canterbury. Succès des Tracts. Leurs doctrines. Newman et l’Eglise de Rome. — III. Accession de Pusey au Mouvement. Modification de la forme des Tracts. La « Bibliothèque des Pères ». Newman se félicite de la position prise par Pusey. Il n’en reste pas moins le chef du Mouvement. — IV. Maladie et mort de Frouée. Que fût-il devenu s’il avait vécu? — V . Newman à Sainte-Marie. Ses efforts pour y développer le culte et la piété. Ses sermons. Caractère de son éloquence. Sujets traités. Action extraordinaire de ces sermons.
L’APOGÉE DU MOUVEMENT (1836-1839)
I. Polémiques soulevées par la nomination du Dr Hampden. Attaques contre les tractarians. Newman et la question du romanisme. — II. Wiseman. Son origine. Ses débuts à Rome. Comment il est amené à s’occuper de la situation religieuse de l’Angleterre. Ses lectures à Londres en 1835 et 1836. Grand effet produit. — III. Newman croit nécessaire de faire paraître un nouveau livre sur la Via media et contre le romanisme. Certains tracts paraissent au contraire suspects de papisme. Publication des Remains de Froude. Irritation des protestants. Blâme inattendu de l’évêque d’Oxford contre les tracts. Après négociations, l’accord se fait entre cet évêque et Newman. Premiers indices de l’hostilité de l’épiscopat. — IV. Wiseman suit, de Rome, le Mouvement. Ses rapports avec les voyageurs anglais, notamment avec Gladstone et Macaulay. — V. Le Mouvement grandit. Ses principaux adhérents. Bien que disciple d’Arnold, Stanley est un moment tenté de suivre Newman. W. G. Ward, son origine, ses évolutions, son caractère. Ses discussions avec Tait. Changement dans l’état moral de la jeunesse universitaire. Amitié de Pusey et de Newman. Newman demeure le vrai chef du Mouvement. Credo in Newmanum. — VI. Premier doute de Newman sur l’Anglicanisme, à propos de l’histoire des Monophysites et des Donatistes. Il en fait confidence à deux amis. Raisons par lesquelles il essaye de se rassurer. Son sermon sur les Appels divins. Le doute s’éloigne, mais non sans laisser de trace.
I. Newman obligé de chercher un autre fondement pour sa via media. Ses préventions contre les catholiques, à raison de leur alliance avec O’Connell. il fait mauvais accueil à Spencer. — II. Parmi les jeunes disciples de Newman, plusieurs sont moins attachés à l’anglicanisme et plus attirés vers Rome. Opinions de Ward. Embarras et inquiétudes de Newman en présence de cet état d’esprit. Il songe à résigner sa cure. — III . Le tract 90 cherche à établir que les XXXIX Articles peuvent être entendus dans un sens catholique. Newman ne s’attend pas à un orage. — IV. Soulèvement contre le tract 90. La censure des chefs de Collèges. Calme de Newman. Violence des attaques dirigées contre lui. Ses pourparlers avec l’évêque d’Oxford. Il refuse de désavouer le tract 90, mais consent à interrompre la publication des tracts. — V .Les polémiques continuent sur le tract 90. Arnold professeur à Oxford. Les évêques se mettent à censurer le tract. L’évêché de Jérusalem. — VI. Wiseman à Oscott. Ses efforts pour entrer en relations avec les tractarians. Il est blâmé par beaucoup de catholiques. Il s’explique publiquement sur la conduite à suivre à l’égard du Mouvement d’Oxford. —VII . Newman est très blessé des censures épiscopales. Il répudie néanmoins toute idée de conversion au catholicisme romain. Sa théorie sur l’anglicanisme et Samarie. Raideur avec laquelle il repousse l’intervention des prêtres catholiques. Le doute traverse de nouveau son esprit. — VIII. Ward et ses amis se montrent de plus en plus favorables à Rome. Leurs relations avec les catholiques. Alarmes de Pusey. Il essaye vainement de retenir Ward. Sa lettre à l’archevêque de Canterbury. Embarras de Newman sollicité par Pusey de désavouer Ward. Il se retire à Littlemore. — IX. Newman à Littlemore. Il y offre asile à ses amis. Le projet de monastère. La vie à Littlemore. Les dénonciations contre le prétendu monastère. Impatience de Newman. — X. Pusey ne peut obtenir de Newman qu’il désavoue Ward. Attitude de Keble. Williams et Rogers s’éloignent. Sermon de Pusey sur l’Eucharistie, dénoncé (191) au vice-chancelier. Une commission prononce contre lui la suspension du droit de prêcher pendant deux ans dans l’Université. —XI . Etat d’esprit de Newman. Il désavoue ses anciennes attaques contre Rome. Si ébranlée que soit sa foi dans l’Anglicanisme, il continue à détourner ses disciples d’aller à l’Eglise Romaine. C’est lui qui retient Ward et Faber. Wiseman n’admet pas la légitimité de ces retards. Conversion de Smith. — XII . Lockhart à Littlemore. Son abjuration. Elle détermine Newman à résigner sa cure. Comment il répond à ceux qui cherchent à l’en détourner. Son sermon d’adieu à Littlemore.
I. Emotion causée par la retraite de Newman. Sa conversion devait cependant se faire attendre encore pendant deux ans. Raisons de cette attente. Il se dégoûte de toute action publique. Il souffre de la perplexité et de la tristesse de ses amis. Ses rapports avec Keble, avec Pusey. Mort de la fille de Pusey. Celui-ci traduit des livres de dévotion catholique et se refuse à attaquer l’Eglise romaine. — II . Ward publie l’Idéal d’une Eglise chrétienne. Controverses soulevées par les doctrines hardiment romanistes de ce livre. Les chefs de Collèges le défèrent à la Convocation et veulent, en même temps, faire édicter un nouveau test, ou au moins censurer le tract 90. Séance de la Convocation. Ward est condamné, mais l’autre mesure est arrêtée par le veto des Proctors. Oakeley suspendu par la cour des Arches. — III. Effet de la condamnation de Ward sur Newwan. Il étudie la théorie du Développement de la doctrine chrétienne et se met à écrire nn Essai sur ce sujet. II avertit ses amis de sa prochaine conversion. Accueil fait à cette nouvelle. Newman dans la communauté de Littlemore. Il persiste à se tenir à l’écart des catholiques. Wiseman envoie Smith à Littlemore. — IV. Conversions de Ward et de plusieurs autres disciples de Newman. Newman se décide et appelle le P. Dominique. L’abjuration. L’impression produite. Nombreuses conversions. Les vieux amis de Newman ne le suivent pas. Entrevue de Newman et de Wiseman. Newman quitte Littlemore et Oxford.
INTRODUCTION
I
Au cours de 1895 et dans les premiers mois de 1896, l’attention des catholiques français se trouva subitement appelée sur des manifestations, pour eux fort inattendues, qui se produisaient outre-Manche, dans certaines parties de l’Eglise anglicane. De cette terre du bigotisme protestant où l’on était habitué à dénoncer l’idolâtrie romaine, arrivait l’écho de paroles si nouvelles que plusieurs se demandaient tout émus si une grande conversion n’était pas sur le point de s’y accomplir. Un pair d’Angleterre, président d’une nombreuse et puissante association de churchmen, lord. Halifax, faisait, dans l’un des meetings de cette association 1, un appel, d’une éloquente et poignante sincérité, au rétablissement de l’unité chrétienne. Après avoir évoqué l’époque regrettée où il n’y avait qu’une seule Eglise, sous la primauté de Rome, il exprimait le voeu que l’Eglise d’Angleterre « fût unie de nouveau, par les liens d’une communion visible, avec le Saint-Siège »; cette union, qu’il décla-
1. Assemblée de l’English Church Union, tenue à Bristol, le 14 février 4893.
II
rait « désirer de toute son âme », il la proclamait «possible » et affirmait que « les documents autorisés de l’Eglise anglicane ne contenaient rien d’essentiellement inconciliable avec les doctrines de l’Eglise de Rome »; il invitait ses coreligionnaires à travailler à ce rapprochement, à dépouiller l’orgueil national, les préjugés séculaires, à s’humilier sur les fautes de leur propre Eglise, et surtout à beaucoup prier, avec la conviction « que rien ne touche de plus près le coeur de Notre-Seigneur que la paix de son Eglise »; enfin il saluait, dans Léon XIII, un esprit large, une âme généreuse, capable de comprendre cette oeuvre, de la mener à bonne fin, et il lui donnait l’assurance « qu’il pouvait compter sur une réponse sympathique à tout appel qui serait adressé à l’Eglise d’Angleterre. » Ne devait-on pas croire que cette invitation avait été entendue du Souverain Pontife et l’avait touché, quand on le voyait, quelques semaines après, lancer sa lettre fameuse ad Anglos 1? « Aux Anglais, y disait-il, qui cherchent le royaume du Christ dans l’unité de la foi, salut et paix dans le Seigneur. » Puis, avec l’accent d’une sollicitude apostolique, d’une tendresse paternelle, où revivait l’âme du saint pontife qui, de Rome, au VIe siècle, avait voulu et dirigé la conversion de l’Angleterre, il félicitait les Anglais des marques de la grâce divine visibles dans leur nation, des efforts qu’ils avaient fait s pour se rapprocher du catholicisme; il les invitait, «quelle que fût la communauté ou l’institution à laquelle ils appartenaient, à poursuivre la
1. 14 avril 1895.
III
sainte entreprise de ramener l’union,» priait Dieu pour eux et leur demandait de prier pour lui. En même temps, comme pour donner une preuve de ses intentions conciliantes, il remettait en jugement la question de la validité des ordres dans l’Eglise anglicane, et nommait, pour l’étudier, une commission dont une partie des membres était notoirement favorable à cette validité. Pour la première fois depuis trois siècles, le coeur de l’Angleterre parut touché par mine parole venue de Rome. Lord Halifax, plus plein que jamais d’ardeur et d’espérance, sans cesse en mouvement de Londres à Paris, de Paris à Rome, en relations étroites avec des prêtres français, reçu au Vatican, triomphait devant ses coreligionnaires, au Congrès de Norwich 1, de voir la question de la réunion de la chrétienté s’imposer désormais à tous les esprits. L’un des primats de l’Eglise anglicane, l’archevêque d’York, au même congrès, faisait tout un discours sur ce sujet : « La réunion est dans l’air », disait-il ; il saluait avec respect « la voix venue de Rome », et regardait comme un devoir de faire « bon accueil» à « cette lettre remarquable en bien des manières et, dans un certain sens unique»; il rappelait que son auteur « présidait une Eglise qui avait produit une multitude de saints et lancé une noble armée de martyrs, une Eglise à laquelle on devait un vaste trésor de littérature, théologique, une Eglise dont les Anglais avaient reçu, dans les
1. Octobre 1895.
IV
siècles passés, au temps de leur faiblesse et de leur malheur, un secours considérable et plein d’amour »; bien qu’il marquât les points de divergence, il insistait sur le « désir profond » et de plus en plus répandu de voir cesser le « grand scandale » de la division de la chrétienté; sur le devoir de travailler à l’union; il invitait les anglicans à ne pas « se complaire en eux-mêmes », à « reviser », sur plusieurs points, leur « position » particulière, et exprimait l’espoir qu’un jour viendrait où «un pape aurait la gloire de réconcilier les deux grandes branches de l’Eglise catholique». Par toute l’Angleterre, dans les diverses assemblées religieuses, la question de l’union était à l’ordre du jour, débattue par tous, sinon résolue, avec une sollicitude anxieuse. L’archevêque de Canterbury prescrivait des prières. M. Gladstone qui, au lendemain du concile du Vatican, par son pamphlet du Vaticanism, avait réveillé toutes les vieilles haines anglaises contre la Papauté, intervenait par un mémoire public 1, pour proclamer à son tour la nécessité de l’union; il montrait que l’anglicanisme, en se rapprochant maintenant, sur beaucoup de points, de l’Eglise romaine, avouait ses torts passés; il parlait avec déférence du Pape, le «premier évêque de la chrétienté », rendait hommage à sa conduite et à son langage. « Selon moi, disait-il en terminant, c’est une attitude paternelle au sens le plus large du mot, et, bien qu’elle prenne place parmi les derniers souvenirs de ma vie, j’en garderai toujours la
1. Ce Mémoire, daté de mai 1896, était transmis au Times par l’archevêque d’York, et publié par ce journal, le 1er juin.
V
précieuse mémoire, avec de tendres sentiments de respect, de gratitude et de haute estime. » En présence de telles manifestations, les espérances les plus hardies semblaient permises: des imaginations optimistes entrevoyaient déjà le retour en corps (corporate-reunion) d’une partie de I’Eglise anglicane et la constitution, outre-Manche, d’une sorte d’Eglise uniate qui serait, par rapport à Rome, dans une position analogue à celle de certaines Eglises orientales. On mesurait d’avance, avec émotion, tout ce que le catholicisme gagnerait à une pareille accession, de quel avantage serait cette infusion d’esprit anglo-saxon dans une société religieuse que le malheur des schismes passés avait laissée trop exclusivement latine. II n’était pas jusqu’à la prodigieuse expansion de l’Empire britannique, qui, vue à cette lumière, ne prtt une signification providentielle et qui ne semblât destinée, comme autrefois celle de l’Empire romain, à étendre le règne du Christ et de son Vicaire. Sans doute, quelques mois plus tard, toutes ces belles visions d’unions s’évanouissaient subitement; il avait suffi pour cela de la bulle décrétant définitivement la non-validité des ordres conférés par l’Eglise d’Angleterre. Ceux des membres de cette Eglise qui s’étaient le plus avancés vers le catholicisme, se montraient aussi les plus attristés, les plus embarrassés, les plus blessés. Ils accusaient fort injustement Rome d’avoir fait preuve d’obstination, d’intolérance, d’avoir même tendu un piège à leur crédulité trop confiante, d’avoir machiné une sorte de guet-apens. Ils s’en prenaient surtout à leurs compa-
VI
triotes, les catholiques anglais, qui, en effet, n’avaient pas dissimulé leur opposition à toute entreprise d’union en corps, et ils leur reprochaient d’avoir travaillé par de petits motifs à faire échouer une grande oeuvre. Loin, d’ailleurs, de s’avouer troublés ou affaiblis par la répudiation pontificale, ils affirmaient dédaigneusement n’avoir aucun besoin de Rome, proclamaient que leur Eglise avait plus que jamais conscience de son droit et de sa puissance, et se félicitaient même que la bulle l’eût fortifiée en faisant comprendre aux partis qui la divisaient, la nécessité de se concentrer contre le vieil ennemi. Si l’on parlait encore d’union, ce n’était plus avec le Pape, c’était avec ceux qu’on savait en révolte contré lui; de là, des coquetteries plus empressées à l’adresse de l’Eglise russe et la protection dont l’épiscopat anglican affectait de couvrir les sectaires vieux catholiques d’Allemagne et d’Italie. Le fossé semblait donc redevenu aussi profond que jamais entre l’Angleterre et Rome, et, de la tentative faite pour le combler, rien ne paraissait rester, outre-Manche, qu’une déception douloureuse et irritée. Depuis lors d’autres événements se sont produits, en Angleterre, qui semblent y marquer davantage encore la ruine des espérances catholiques et le triomphe de l’esprit protestant. Un soulèvement a soudainement éclaté contre ceux des Anglicans qui, à défaut d’une union avec Rome jugée désormais impossible, prétendaient du moins continuer à se rapprocher des croyances et des pratiques catholiques. Commencé par des personnages de petite considération et au moyen de pro-
VII
cédés assez grossiers, ce soulèvement a pris un développement que son origine ne faisait pas prévoir. Tous les journaux se sont mis à discuter sur la messe ou sur le confessionnal; le Times, entre autres, a été, durant des mois, une tribune ouverte à tous ceux qui voulaient revendiquer les vieilles traditions protestantes de l’Eglise d’Angleterre, contre les innovations du moderne High Church. De nombreux meetings de laïques ou de clercs ont été convoqués sur tous les points du territoire. Les deux chambres du parlement ont été, à plusieurs reprises, saisies de la question; les leaders des divers partis se sont expliqués sur ce sujet, et diverses propositions ont été faites pour intervenir législativement ou judiciairement contre ceux qu’on accuse d’être « romanisants». En même temps les évêques, sous le coup de sommations répétées, ont dû se mettre en mouvement et s’engager à user de leur autorité pour réprimer les abus dont on se plaignait. Que sortira-t-il de tout cela? Il est visible que gouvernement et évêques sont au fond très embarrassés, qu’ils sentent le péril et l’inefficacité des armes dont on les presse de se servir, doutent de leur compétence ou de leur pouvoir, et seraient heureux de gagner du temps en agissant le moins possible. Le leur permettra-t-on? Déjà la poussée de l’opinion les a contraints de s’avancer plus qu’ils n’avaient intention de le faire au début. S’ils se déterminent à prendre quelques mesures de rigueur, quel en sera l’effet? Ceux que ces mesures menacent semblent, pour le moment, un peu surpris et comme abasourdis du soulèvement qui s’est fait contre eux. Si quelques-uns,
VIII
comme lord Halifax, tiennent un langage assez ferme, d’autres sont loin de paraître prêts au martyre. Accepteront-ils, de la part de l’épiscopat, — en supposant que celui-ci puisse s’entendre sur une seule opinion commune, — des interdictions liturgiques et des prescriptions dogmatiques, opposées aux principes qu’ils ont vingt fois proclamés être de l’essence de leur Eglise? Reconnaîtront-ils au parlement ou aux tribunaux civils une autorité religieuse, conforme sans doute au passé de l’anglicanisme, mais contraire aux idées qu’ils se flattaient d’avoir fait prévaloir? S’il y a résistance, jusqu’où s’étendra-t-elle? Sera-t-elle le fait de tout le parti High Church ou seulement de la fraction la plus avancée de ce parti? Cette résistance amènera-t-elle une scission qui serait comme une première brèche dans l’édifice ecclésiastique d’Angleterre, un premier pas dans la voie du « desétablissement »? Ou bien, au prix d’équivoques et d’inconséquences qui ne seraient certes pas les premières dans l’histoire de l’Eglise d’Angleterre, trouvera-t-on moyen de maintenir, côte à côte, dans les cadres de l’Etablissement, des hommes dont les oppositions de croyances seront devenues encore plus criantes? Toutes questions auxquelles il serait téméraire, surtout pour un étranger, de prétendre répondre aujourd’hui. Les événements sont en marche, et l’on peut d’autant moins en prévoir l’issue qu’ils paraissent obéir à une impulsion anonyme et plus ou moins irréfléchie. Bornons-nous à constater que, pour le moment, il y a, en Angleterre, un retour offensif du vieil esprit
IX
protestant, une réaction contre les tendances catholiques qui se manifestaient dans une partie notable de l’anglicanisme. Cette réaction, suivant de près l’échec de la tentative de réunion avec Rome, n’est-elle pas de nature à dissiper toutes les espérances qu’auraient pu nous faire concevoir les modifications survenues, depuis quelque temps, dans l’état religieux de l’Angleterre, et le royaume d’Henri VIII et d’Elisabeth n’apparaît-il pas plus que jamais acquis au vieil esprit de schisme et de révolte du XVIe siècle? S’en tenir à cette conclusion, serait apporter, dans le découragement, la même précipitation peu raisonnée qu’on avait pu montrer naguère dans l’espérance. Pour bien juger d’un mouvement, de ses chances d’avenir, il ne faut pas s’attacher aux effets plus ou moins passagers de telles crises particulières, mais regarder les choses dans leur ensemble, de haut et de loin. Des accidents, pour regrettables qu’ils soient, ne peuvent pas détruire, en quelques mois, l’oeuvre de longues années. Or, si l’on considère, non plus les à-coups momentanés qui viennent de se produire, mais les grandes lignes et les résultats généraux de l’évolution qui s’accomplit en Angleterre, depuis bientôt un siècle, le fait s’impose saisissant : on ne peut nier l’importance du changement produit; on voit se dessiner clairement la direction dans laquelle il s’accomplit, et l’on constate qu’il en est résulté un progrès aussi incontestable qu’inattendu des idées catholiques.
X
II
Pour mesurer ce progrès, il convient tout d’abord de comparer ce qu’était l’Eglise catholique en Angleterre, au commencement de ce siècle, à ce qu’elle est aujourd’hui. Dans ce pays, la Réforme, qui était, pour une bonne part, l’oeuvre du caprice royal, n’avait pas, du jour au lendemain, fait disparaître la vieille foi du coeur de la nation. Beaucoup étaient demeurés catholiques de sentiments, soit qu’ils refusassent hautement de s’associer à la révolte de leur roi, soit qu’ils se fissent illusion sur la gravité de cette révolte. Mais, durant trois siècles, tout avait été employé à avoir raison de ces fidélités, conscientes ou non : pression du pouvoir, spoliations, supplices et enfin, à partir de la fin du XVIIe siècle, un ensemble de lois savamment combinées, ne laissant échapper aucun des actes du catholique, le frappant dans sa conscience, dans sa fortune, dans ses droits publics et privés. Ajoutez la défaveur et la ruine des causes politiques auxquelles le papisme s’était trouvé lié. Est-il étonnant qu’à ce régime le nombre des fidèles ait été sans cesse diminuant? Des vieilles familles qui, dans diverses parties du royaume, étaient demeurées longtemps, en dépit des persécutions, comme les points fixes où s’appuyait la résistance, beaucoup avaient été détruites dans les guerres civiles: d’autres, lassées ou séduites, avaient fini par capituler. Aussi, au début du XIXe siècle, quand une détente se
XI
produisit et que l’Angleterre protestante commençai avoir honte de son intolérance, il ne restait plus qu’un petit nombre de catholiques pour jouir de la paix et de la liberté qu’on se montrait enfin disposé à leur rendre. De ces catholiques, les uns s’enfermaient et s’isolaient dans leurs manoirs, les autres étaient dispersés et comme noyés dans la population des grandes villes. Combien étaient-ils? Les éléments manquent pour donner un chiffre certain. D’après les évaluations les plus sérieuses, vers 1814, on n’en comptait guère, dans l’Angleterre proprement dite, qu’environ 160.000. Pas d’évêques, mais, comme en pays de mission, de simples vicaires apostoliques, alors au nombre de quatre. A peine quatre cents prêtres, vivant presque cachés, par souvenir des persécutions, et n’osant porter aucun costume qui révélât leur caractère. Les églises, ou, pour parler plus juste, les chapelles étaient rares, sans signe extérieur, dissimulées dans les coins les plus obscurs des villes. Quelque téméraire s’oubliait-il à élever une croix sur la porte de l’une de ces chapelles, la police la faisait aussitôt supprimer, par crainte d’une émeute. A l’intérieur, presque pas de ces ornements symboliques auxquels s’est plu de tout temps la piété catholique; le culte était comme empêché de s’épanouir; rarement un office solennel, une grand’messe, une bénédiction du Saint-Sacrement; on eût dit que la prière n’était permise qu’à voix basse. Dans beaucoup d’églises, on ne célébrait la messe que deux fois par semaine ; ce seul mot de messe faisait peur; on ne disait pas « aller à la messe », mais « aller aux prières ».
XII
En somme, à cette époque, l’Eglise catholique, bien que délivrée de la persécution violente, se faisait encore humble et tâchait presque d’être invisible. Le cardinal Vaughan l’a comparée à ces bateaux qui, au lendemain de la tempête, quand le vent est encore dur, bien qu’affaibli, diminuent leurs voiles pour y donner le moins de prise possible. Sans doute, la masse du public ne ressentait plus au même degré, contre les papistes, cette aversion mêlée d’effroi qui était autrefois l’une des manifestations du sentiment national, alors qu’en tout Anglais catholique on soupçonnait un suppôt de l’Espagne ou un conspirateur méditant de faire sauter le Parlement et de mettre le feu aux quatre coins de Londres. Mais, si la passion était amortie, les préventions et l’éloignement demeuraient 1. Le maître de maison s’excusait auprès de ses convives, s’il les faisait se rencontrer avec un catholique. De ce que pouvait bien être le catholicisme, on n’avait du reste aucune idée précise; il apparaissait de loin comme je ne sais quel amalgame de superstitions, d’idolâtrie et d’immoralité. Ainsi que l’a rapporté l’un des convertis de la première heure 2,
1 Des observateurs ont noté cependant quelques faits qui, à la fin du siècle dernier et au commencement de celui-ci, avaient un peu atténué ces préventions. C’est d’abord l’émigration, en Angleterre, de milliers de prêtres français, proscrits par la Révolution; ils furent bien accueillis et, par leurs vertus forcèrent l’estime de leurs hôtes. C’est aussi l’influence considérable des romans de Walter Scott, qui habituèrent les imaginations anglaises à sympathiser avec des personnages catholiques; en octobre 1896, à Nottingham, Mgr Harnet a fait une lecture sur Sir Walter Scott and the Revival of catholic sympathies. 2. Le chanoine Oakeley.
XIII
les Anglais, à cette époque, savaient mieux les coutumes des Egyptiens que celles des catholiques, leurs compatriotes, demeurés fidèles à la vieille foi; ils avaient répugnance à causer entre eux de ce sujet, et beaucoup vivaient une longue vie sans s’être demandé une seule fois ce qu’il en était. Les libéraux eux-mêmes, qui réclamaient alors l’émancipation des catholiques, témoignaient à leur égard de moins de sympathie que de dédain; ils arguaient de leur insignifiance et de leur discrédit pour soutenir qu’on pouvait sans danger leur faire justice. De cet état, si complètement disparu aujourd’hui qu’on a quelque peine à se le figurer, un témoin, autorisé entre tous, Newman, a fait un tableau saisissant, dans un sermon prononcé quelques années après sa conversion 1 évoquant des souvenirs alors peu éloignés, il exposait, en ces termes, sous quel aspect, au temps de son enfance et de sa jeunesse, lui étaient apparus le catholicisme et les catholiques
Dans cette contrée, il n’y avait plus d’Eglise catholique; il n’y avait plus même de communauté catholique, mais un petit nombre d’adhérents à la vieille religion, passant silencieux et tristes, comme un souvenir de ce qui avait été. Les « catholiques romains » n’étaient pas une secte..., un corps, si petit qu’il fût, représentant la grande communion du dehors, mais une simple poignée d’individus que l’on pouvait compter, comme les pierres et les débris du grand déluge... Ici, c’était une bande de pauvres Irlandais, allant et venant au temps de la moisson, ou une colonie.
1. The Second Spring, prêché à Oscott, le 13 juillet 1852. lors du premier concile provincial de Westminster. (Newman’s Occasional sermons.)
XIV
des mêmes dans un quartier misérable de la grande métropole; là, peut-être, c’était un homme âgé que l’on votait se promener dans les rues, grave, solitaire, étrange, quoique de noble maintien, et dont on disait qu’il était de bonne famille et « catholique romain »; c’était une maison de vieux style, de sombre apparence, enfermée derrière de grands murs, avec une porte de fer, des ifs : on racontait que là vivaient des « catholiques romains »; mais qui ils étaient, ce qu’ils faisaient, ce qu’on voulait dire quand on les appelait catholiques romains, nul n’aurait pu l’expliquer; on savait seulement que cela sonnait mal et parlait de formalisme et de superstition... Telle était à peu près l’espèce de connaissance qu’avaient du christianisme les païens de l’ancien temps, qui persécutaient les fidèles et cherchaient à les faire disparaître de la face de la terre, et qui les appelaient ensuite gens lucifuga, une race qui fuit la lumière du jour. On ne retrouvait les catholiques, en Angle-terre, que dans les endroits reculés, dans les ruelles, dans les caves, dans les mansardes ou dans la solitude de la campagne, séparés de la foule au milieu de laquelle ils vivaient; on les entrevoyait seulement dans l’obscurité, à travers le brouillard ou le crépuscule, fantômes fuyant de-ci, de-là, devant les fiers protestants, maîtres de la terre. A la fin, ils devinrent si faibles, tombèrent si bas que le dédain fit naître la pitié; et les plus généreux parmi leurs tyrans commencèrent à désirer de leur accorder quelque faveur, persuadés que leurs opinions étaient trop absurdes pour trouver des prosélytes, et qu’eux-mêmes, si on leur accordait une position plus importante dans l’Etat, ne tarderaient pas à renoncer à leurs doctrines et à en rougir. Un symptôme plus significatif encore que le dédain des protestants, c’était le sentiment que les catholiques eux-mêmes avaient de leur anéantissement. A force d’avoir été, pendant des siècles, mis hors la loi, d’être
XV
demeurés étrangers à la vie publique et privée de leurs compatriotes, d’avoir subi une proscription sociale plus sensible encore que la légale, ils s’étaient habitués à une situation de parias; on eût dit une autre race, sans mélange ni relations avec l’autre, résignée à son infériorité, et en ayant gardé je ne sais quoi de déprimé, ainsi qu’il arrive aux peuples depuis longtemps vaincus et dominés. Quelques-uns de ces catholiques en devenaient comme embarrassés et presque honteux de leur foi; ils cherchaient à la dissimuler à leurs voisins ou à se la faire pardonner, en la minimisant, notamment en affichant à l’égard du Pape une indépendance qui frisait la révolte. Chez beaucoup d’autres, il est vrai, l’épreuve et l’isolement n’avaient fait que rendre cette foi plus profonde et plus résistante; loin de vouloir rentrer en grâce auprès de la société qui les excluait, ils s’en détournaient avec méfiance et ressentiment; mais, chez eux, aucune pensée de revanche et d’offensive; obstinés, nullement entreprenants, plus préparés à souffrir qu’à engager le combat, ils ne songeaient pas un seul moment qu’il pût être question pour Rome de reprendre possession du royaume d’Henri VIII et d’Elisabeth, bornaient leur ambition à sauver leur âme et à garder leur honneur, vivaient de souvenir, non d’espérance. Tel était le catholicisme en Angleterre dans le premier quart du siècle. Aujourd’hui, quel changement! Au lieu de 160.000 catholiques, on en compte, dans la seule Angleterre, en dehors de l’Irlande et de l’Ecosse, environ 1.500.000. En place des quatre
XVI
pauvres vicaires apostoliques et de leurs quatre cents prêtres, une hiérarchie normalement constituée avec dix-sept évêques, dont un archevêque, trois mille prêtres, des ordres religieux de toute sorte. Les conversions, bien qu’un peu ralenties par les derniers incidents, sont encore, au témoignage du cardinal Vaughan, d’environ six cents par mois 1 sans doute elles sont en partie compensées par la défection de familles catholiques d’origine, généralement pauvres, transplantées dans des milieux .exclusivement protestants : déchet douloureux que le zèle du clergé se préoccupe d’arrêter; mais ce qui se perd ainsi ne saurait, tout au moins comme importance sociale et intellectuelle, se comparer à ce qu’on gagne par les conversions. Les églises, les chapelles, les couvents, partout multipliés, loin de se dissimuler, se dressent au milieu des cités, proclamant hautement, par leur ornementation extérieure, la foi des fidèles. En ce moment, au coeur de Londres, à quelques pas de l’abbaye de Westminster, s’élèvent les murs d’une grande cathédrale qui sera l’un des principaux édifices de la ville. Toutes les splendeurs liturgiques dont il avait fallu se priver pendant plusieurs siècles s’épanouissent à l’intérieur de ces églises. Bien plus, le culte déborde au dehors, et, dans les rues des villes ou à travers la campagne, les processions, avec bannières, crucifix, prêtres et acolytes en costumes, se développent librement, comme elles ne pourraient le faire en beaucoup
1. Lettre du cardinal Vaughan au P. Ragey. (L’Anglo-catholicisme, par le P. Ragey, p. 29.)
XVII
de pays catholiques: témoin les imposantes cérémonies dont le treize centième anniversaire du débarquement de saint Augustin a été l’occasion. Sauf quelques survivants de plus en plus rares de l’ancien fanatisme protestant, le publie assiste sans émoi, parfois même avec sympathie et respect, à ces manifestations qui l’eussent autrefois exaspéré. C’est ce que constatait récemment, avec un étonnement douloureux, l’un de ces survivants, le vieil évêque de Liverpool : il se lamentait, dans une allocution à son clergé l, de ne plus trouver autour de lui « cette aversion pour le papisme, générale naguère dans le royaume»; il reprochait à ses coreligionnaires de ne voir dans le «romanisme» qu’une des formes multiples de la religion en Angleterre, ni pire ni meilleure que d’autres, parfois même d’établir entre lui et le protestantisme une comparaison qui n’était pas à l’avantage du dernier; puis, après avoir constaté qu’on trouvait maintenant « de bon goût d’oublier la grande bénédiction » de la Réforme, il dénonçait, avec indignation et alarme, cette «altération du langage et du sentiment publics ». Légalement et socialement, presque plus rien ne subsiste des anciennes séparations entre les catholiques et le reste de la nation. Les deux races se sont réconciliées et fondues. Le papiste est redevenu un Anglais comme un autre, ayant mêmes sentiments et mêmes droits2. D’ailleurs il n’est guère de famille un peu
1. Ce discours a été publié dans le Rock du 12 novembre 1897. 2. Seuls le roi ou la reine, les héritiers directs de la couronne, le lord-chancellor et le vice-roi de l’Irlande doivent encore être protestants.
XVIII
importante qui ne compte un ou plusieurs convertis. Les catholiques ont pied au Parlement, occupent quarante et un sièges à la Chambre des lords et ont presque toujours quelqu’un des leurs au ministère: tel avait été lord Ripou dans le cabinet libéral, et tel est le duc de Norfolk dans le ministère de lord Salisbury. Sur un point particulier, ils avaient persisté à s’exclure, alors que la loi leur ouvrait les portes: par l’effet d’une interdiction de leurs autorités religieuses, ils se privaient d’envoyer leurs fils aux universités d’Oxford et de Cambridge ; cette interdiction a été levée récemment, et les jeunes catholiques commencent à fréquenter les deux grandes universités; le clergé y envoie même quelques-uns de ses sujets; les jésuites ont une maison à Oxford, les bénédictins et les prêtres séculiers à cambridge. Pour qui sait l’influence intellectuelle et sociale d’Oxford et de Cambridge dans la vie anglaise et aussi l’importance des liens de camaraderie qui s’y nouent, un tel fait est gros de conséquences; plus que tout le reste, il contribuera à abaisser ce qui peut encore rester des vieilles barrières et permettra d’atteindre le but que, dès 1867, Manning proposait à ses coreligionnaires, quand il insistait sur la nécessité de « mettre l’Eglise catholique en contact avec l’intelligence et la conscience de la nation ». Ce n’est pas seulement aux catholiques, considérés individuellement, que place a été faite dans la société anglaise, c’est à l’Eglise elle-même. Ses dignitaires, naguère proscrits ou tout au moins ignorés, sont maintenant reconnus comme de hautes autorités morales.
XIX
On a vu le cardinal Manning et, après lui, le cardinal Vaughan, appelés à siéger, à côté des prélats anglicans, dans les cérémonies publiques ou dans les comités des grandes oeuvres philanthropiques et moralisatrices 1. L’étiquette paraît même disposée à reconnaître la préséance due au titre de cardinal. Le « bruit ne courait-il pas, l’an dernier, que le cardina1 Vaughan allait être nommé pair, bruit mal fondé, mais jugé assez vraisemblable pour provoquer, dans les coteries protestantes, des réclamations dont l’opinion, du reste, ne parut pas s’inquiéter? C’est plus qu’une importance officielle, c’est une véritable popularité qu’ont acquise certains grands catholiques anglais. On en put juger à la mort de Newman et de Manning : leurs obsèques eurent le caractère d’une manifestation nationale. Les portraits des cieux illustres convertis ont été mis en place d’honneur dans les collèges d’Oriel et de Balliol, à Oxford, et la statue du premier d’entr’eux s’élève, à Londres, sur le terre-plein de l’église de l’Oratoire. En 1897, les Anglais fêtaient, on sait avec quel retentissement, le Jubilé de la reine, et c’était l’occasion pour eux de repasser les événements accomplis pendant « l’ère victorienne », de se féliciter des résultats obtenus, de s’enorgueillir des progrès réalisés. On conçoit que les catholiques anglais n’aient pas été les derniers à s’associer à ce patriotique Te Deum, et que leur porte-
1. Lors du récent synode des évêques anglicans, l’archevêque de Canterbury, ayant donné un garden party dans son palais de Lambeth, y a invité le cardinal Vaughan, qui s’y est rendu.
XX
parole, le cardinal Vaughan, ait, à ce propos, célébré, comme en un chant de triomphe et de reconnaissance, l’étonnante transformation qui s’était opérée dans son Eglise, « sous la protection de la liberté civile et religieuse », garantie par la législation anglaise; et il ajoutait: « Nous rappelons ces faits, non pour nous vanter sottement, mais par gratitude pour le bon accueil que nous a fait l’Angleterre, et surtout par gratitude envers Dieu qui, seul, rebâtit les murs de Sion1. »
III
Si remarquables qu’aient été, depuis une soixantaine d’années, les progrès de l’Eglise catholique en Angleterre, il est, à la même époque, un phénomène plus extraordinaire encore, c’est la renaissance des idées catholiques au sein de l’Eglise anglicane. Pour bien saisir ce qu’une telle renaissance avait d’inattendu, jetons tout d’abord un rapide coup d’oeil sur les trois premiers siècles de l’histoire de cette Eglise. Nous y verrons dans quelle direction absolument contraire elle s’était jusqu’alors développée, et comment, après avoir été au début un mélange assez disparate de catholicisme et de protestantisme, elle avait paru condamnée à devenir, avec le temps, de plus en plus protestante. Le schisme que le caprice despotique d’Henri VIII imposa à un clergé servile ne tendit d’abord qu’à
1. Lettre pastorale du cardinal Vaughan à l’occasion du Jubilé de la reine.
XXI
substituer la suprématie du roi à celle du Pape. H n’était question de toucher à aucun des autres dogmes de l’antique Eglise dont on se piquait de faire toujours partie. Quelques-uns tentaient-ils de profiter de cette rupture pour propager les nouveautés du protestantisme continental, ils étaient répudiés et châtiés. Presque aucun changement n’était apporté à l’extérieur du culte. On se bornait à supprimer les monastères pour voler leurs biens. Mais la révolte ne put ainsi longtemps se limiter elle-même. Dès le règne suivant, sous Edouard VI, les gouvernants, gagnés aux idées de Zwingle et de Calvin, mutilaient le dogme et la liturgie catholiques: la messe était proscrite, les autels jetés bas et remplacés par des tables 1, les églises dépouillées; les prêtres recevaient licence de se marier. A la vérité, cette révolution fut loin d’être universellement acceptée et, sur le moment, elle n’aboutit guère qu’à créer un état de grande confusion et d’anarchie religieuse. Aussi, quand, après quelques années de ce régime, ha couronne passa à Marie Tudor, ses premières mesures pour rétablir le catholicisme furent-elles plutôt accueillies avec un sentiment de soulagement, et il ne lui eût pas été difficile, avec de la modération et du tact, d’effacer toute trace de la scission. Malheureusement la maladroite violence d’une politique qui paraissait plus espagnole qu’anglaise irrita les esprits, et, après cinq ans de règne, Marie mourait, sans avoir eu le temps
1. L’un des prétendus réformateurs de l’Eglise anglicane au XVIe siècle, l’évêque Ridley, écrivait : « On se sert d’un autel pour y faire un sacrifice; on se sert d’une table pour manger. »
XXII
de mener à fin son entreprise, mais en ayant eu celui de compromettre la cause qu’elle prétendait servir. Sa soeur et héritière, Elisabeth, sembla donc donner satisfaction au sentiment national en reprenant une attitude hostile au Pape. Ce n’est pas que personnellement elle fût portée vers le calvinisme: elle s’en fût tenue volontiers au « catholicisme décapité » de son père Henri VIII; mais on ne le lui permit pas. La pression des puritains (c’est le nom dont on commençait à se servir), avides de prendre leur revanche des persécutions du règne précédent, l’entraînement de la lutte politique où la reine se trouva bientôt engagée contre le Pape et l’Espagne, et aussi la loi même de la situation où la mettait sa rupture avec Rome, l’obligèrent à accentuer le protestantisme de son Eglise plus qu’il n’eût été dans ses goûts. Vainement tâchait-elle de ralentir le mouvement; vers la fin de son règne, le puritanisme prévalait, surtout à Londres et dans les grands centres. L’avènement des Stuarts amena un retour offensif de ceux qui déploraient les destructions protestantes de l’époque précédente. Des théologiens remarquables, les premiers qu’eût produit l’épiscopat anglais depuis la Réforme, s’essayèrent à construire un système religieux qui, tout en se déclarant opposé à Rome et à ses « abus », conservât le plus possible des idées et des formes catholiques : tels, entre tous, Andrews et Laud : le premier, homme de pensée et d’études; le second, homme d’action et de combat. II avaient la faveur de la Couronne, qui voyait, dans cette réaction religieuse, le complément de la réaction politique qu’elle
XXIII
poursuivait. Par contre, le puritanisme, loin de se laisser intimider, attaquait plus âprement que jamais tout ce qu’on prétendait garder ou rétablir de catholicisme dans le dogme, la hiérarchie et le culte. Si ses adversaires s’appuyaient sur la royauté, il liait sa cause à celle de l’opposition libérale et bientôt révolutionnaire. Dans cette lutte, l’école à tendances catholiques suivit la fortune des Stuarts et partagea leur impopularité grandissante. L’archevêque Land fut accusé au même titre que le ministre Strafford, et il devança, de quelques années, Charles 1er sur l’échafaud. Le triomphe de la révolution fut celui des puritains : le calvinisme presbytérien supplanta l’Eglise épiscopale, désorganisée et proscrite. Il est vrai que, si la tempête fut violente, elle fut peu durable. Bientôt la Restauration parut une occasion favorable de rétablir l’Eglise sur les principes d’Andrews et de Laud qui avaient laissé, derrière eux, toute une école de théologiens, les Caroline divines. Alors fut rédigée et promulguée la dernière édition du Prayer Book, celle où le caractère sacramental et sacerdotal de l’Eglise était le plus mis en relief 1. Par ses
1. Le Prayer Book, livre de prières officiel de l’Eglise anglicane, est une compilation tirée de sources catholiques, du bréviaire, du missel, du rituel, du pontifical il contient tout ce qui est nécessaire au culte et au cérémonial. Rédigé pour la première fois en1549, il a été successivement revisé en 4552, 1559 et 1662. Le parti High Church s’est toujours appuyé sur le Prayer Book. Il estime que, grâce à l’autorité qui n’a jamais été absolument méconnue de ce livre, une certaine tradition catholique s’est toujours maintenue dans l’église d’Angleterre. Comme on demandait un jour à m. Gladstone comment il était passé des idées Low Church, dans lesquelles il avait été élevé, aux idées High Church il répondit que c’était en étudiant les Occasional Offices du Prayer Book.
XXIV
excès mêmes, le puritanisme n’avait-il pas contribué à cette réaction?Jusqu’à la Révolution, sa prétention avait été, non de renverser l’Eglise épiscopale, mais de s’en emparer; l’usage qu’il venait de faire de sa victoire momentanée manifestait son incompatibilité avec cette Eglise. Force lui fut donc de s’en séparer ouvertement et de créer, en dehors d’elle, une Eglise rivale : ce fut le commencement des dissidents ou non-conformistes. Cet exode ne laissait pas l’autre école maîtresse de l’anglicanisme; le virus protestant y avait pénétré trop profondément. A côté des puritains résolus qui rompaient avec l’Eglise établie, beaucoup d’autres, plus timides, y demeuraient, avec leurs préventions, et opposaient une résistance passive, mais puissante, aux disciples d’Andrews et de Land. D’ailleurs, l’étrange régime auquel étaient soumises les consciences depuis plus d’un siècle, le spectacle de cette Eglise tant de fois transformée au seul gré des caprices royaux ou des passions populaires, ces Credo contradictoires imposés, les uns après les autres, à un clergé servile, par les gouvernements successifs, n’était-ce pas assez pour désorienter les consciences et enseigner une sorte d’indifférence dogmatique? Ainsi voyait-on poindre un état d’esprit qui allait bientôt dominer dans l’Eglise établie, le latitudinarisme, non moins réfractaire que le puritanisme à renouer la tradition catholique. Ajoutons que, cette fois encore, l’alliance avec les Stuarts fut funeste aux partisans de cette tradition. Vainement ceux-ci avaient-ils fait, sur certains points, opposition à Jacques li, ils se trouvèrent forcément,
XXV
au jour de la chute de ce prince, dans le camp des vaincus, et l’école protestante se crut au contraire fondée à compter sur les sympathies du calviniste Guillaume III. Le coup porté par la Révolution de 1688 au parti qu’on commençait alors à qualifier de High Church se trouva, aussitôt après, singulièrement aggravé par l’espèce de suicide de l’élite de ce parti : je veux parler des non jurors, de ces quatre cents prêtres et huit évêques, dont le primat de Canterbury, qui se crurent tenus de refuser le serment d’allégeance à l’usurpateur, et qui, exclus de leurs postes, furent remplacés par des hommes d’opinion contraire. Vainement les high-churchmen tentèrent-ils un dernier retour offensif sous la reine Anne, qui était de coeur avec eux, ils ne purent reprendre le terrain perdu, et l’avènement de Georges Ier marqua leur défaite définitive. La prédominance appartint dès lors, sans conteste, à un latitudinarisme voyant avec dédain et méfiance tout enthousiasme, se piquant d’une « religion raisonnable », soucieux de maintenir l’organisme ecclésiastique, en étant indifférent aux doctrines, regardant les Credo comme une phraséologie convenue qui n’engageait pas la conscience, ayant pour expression un culte froid, vide, sans vie sacramentelle, sans symbolisme esthétique, dans des temples dépouillés de tout ce qui pouvait rappeler le catholicisme. Il était, à la vérité, des hommes qui souffraient d’un tel état. Cette philosophie satisfaite, qui réduisait le christianisme à la science du bonheur et à la recette de la respectability, ne répondait pas au sentiment
XXVI
qu’ils avaient de leurs péchés à expier et à se faire remettre, de leurs âmes à sauver, de l’idéal de sainteté à réaliser. Ce Christ, devenu une entité abstraite et morte, ne leur suffisait pas; il leur fallait un Christ vivant, saignants qu’ils pussent aimer, qui pût les consoler et leur pardonner. De là naquirent, en plein XVIIIe siècle, deux réactions religieuses qui semblaient en contradiction complète avec l’esprit régnant, le méthodisme et l’evangelicalism. Le premier en date, le méthodisme, fut inauguré, vers 1738, par Wesley et Whitefield. Dans cette société si étrangère aux choses de Dieu, les méthodistes parvinrent, par le seul effort de l’apostolat et de la charité, à réveiller des sentiments religieux: repentir du. péché, terreur de l’enfer, amour du Christ. IIs se répandirent surtout parmi les humbles et les souffrants qu’ignorait la riche Eglise d’Angleterre, dans les mines et les manufactures où commençait à se former la démocratie ouvrière. Ils prêchaient en plein air, parfois devant des foules de vingt et trente mille hommes, interrompus par les sanglots, les cris et même les convulsions des auditeurs. N’était-ce pas à se croire au XIIIe siècle? Les historiens religieux d’outre-Manche aiment à rapprocher Wesley de saint François d’Assise : rapprochement un peu ambitieux. Sans doute, le fondateur du méthodisme avait des qualités qui ont fait dire de lui, à Newman, qu’il était «l’ombre d’un saint catholique, the shadow of a catholic saint; » mais il manquait de la mesure, du bon sens, de l’humilité que la discipline catholique avait ajoutés aux inspirations
XXVII
héroïques du Poverello d’Assise. Livré à lui-même, sans frein, sans guide, son zèle, souvent admirable, n’aboutit qu’à détacher, un peu malgré lui, de l’Eglise établie, une nouvelle secte protestante qui, bientôt, s’est subdivisée elle-même. Au point de vue qui nous occupe, cette secte s’éloignait, plus encore que l’anglicanisme officiel, des formes et des idées catholiques. Sa théologie assez imparfaite, où tout était moins doctrine que sentiment, sensation et même hallucination nerveuse, avait une saveur protestante très prononcée. On s’y attachait au dogme de la justification par la foi seule, et même, dans une partie de la secte, à celui de la prédestination absolue, entendue avec toute la dureté calviniste. Ajoutons qu’en se séparant de l’Eglise établie le méthodisme était conduit naturellement à nier la valeur de la succession apostolique, à contester l’autorité de l’épiscopat et jusqu’au privilège de la prêtrise, en un mot, à rejeter tout ce que l’anglicanisme avait essayé de conserver de l’organisme catholique : le prêcheur devenait ministre, par le seul fait de sa vocation intérieure; il pouvait non seulement enseigner, mais administrer la communion; on se retrouvait en plein puritanisme. Né à la suite du méthodisme, un peu des mêmes inspirations, le mouvement evangelical s’en distingue en ce qu’il a agi dans l’intérieur de l’Eglise établie, sans en sortir. A la fin du XVIII siècle et au commencement du XIXe, il avait triomphé des contradictions et des dédains du début; s’il ne dominait pas l’Eglise entière, il la pénétrait en beaucoup d’endroits et se manifestait
XXVIII
non seulement par un développement de piété individuelle, mais surtout par l’impulsion donnée aux oeuvres philanthropiques telles que l’abolition de la traite. Wilberforce est le grand nom de cette école. Seulement, des evangelicals plus encore peut-être que des méthodistes, on peut dire que, loin de revenir aux idées catholiques, tout chez eux tendait à pousser l’anglicanisme plus avant dans le protestantisme. Ils n’avaient à peu près aucune notion de l’Eglise, corps vivant et visible, de l’épiscopat dépositaire de la succession apostolique, du prêtre ministre des sacrements. Le dogme sacramentel était chose dont ils ne s’inquiétaient guère. La présence réelle objective leur paraissait une superstition grossière. Le fondement de la vie religieuse, à leurs yeux, c’étaient la justification par la foi seule et l’accident personnel de la conversion; ils entendaient cette conversion un peu à la façon des méthodistes; elle était la transformation soudaine de l’âme qui se sentait délivrée du péché par l’assurance intime que Dieu lui en donnait, en dehors de tout secours sacramentel et de toute intervention sacerdotale. Pour l’evangelical, le dissident, de quelque secte qu’il fût, était un frère, tandis que le papiste était l’ennemi détesté et redouté; il voulait avant tout préserver l’anglicanisme de ce qui sentait, de près ou de loin, le catholicisme. Ainsi, depuis la révolte d’Henri VIII jusque dans le premier quart du siècle actuel, une loi se dégage: des deux éléments qu’on avait prétendu d’abord combiner dans l’Eglise anglicane et qui s’y étaient trouvés tout
XXIX
de suite en lutte, l’élément protestant a toujours fini par l’emporter, et, sauf quelques oscillations passagères, cette Eglise s’est sans cesse éloignée davantage non seulement du Pape, avec lequel elle avait rompu dès le premier jour, mais des idées et des formes catholiques qu’elle avait paru soucieuse de garder au début.
1. Considérons-la, en effet, telle qu’elle se montrait, vers 1820 ou 1830, au terme de cette descente continue vers le protestantisme. Elle semblait beaucoup plus occupée de marquer en quoi elle se séparait du catholicisme que de chercher par où elle pourrait encore s’en rapprocher. Sur le dogme fondamental de l’Eucharistie, son ardeur à condamner la transsubstantiation de la théologie romaine lui avait fait perdre toute notion de la présence réelle objective du corps et du sang du Christ dans les espèces consacrées. Le culte de la Vierge, l’intercession des saints, le purgatoire, les prières pour les morts, la confession et le pouvoir sacerdotal d’absoudre étaient répudiés, et on n’eût pu proposer d’y revenir sans faire scandale. Plus rien, en fait, des jeûnes ou abstinences prescrits par l’ancienne discipline. Les vieilles dévotions étaient rejetées avec méfiance, quand elles n’étaient pas absolument oubliées et ignorées. Nulle spiritualité. En dehors du dimanche, presqu’aucune fête observée, pas même l’Ascension qui avait cependant un office spécial dans le Prayer Book. Le vendredi saint, goodfriday, n’était plus qu’un jour de congé (bank holyday), et sauf dans quelques grandes villes, n’était sanctifie par aucun office Seule, la solen-
XXX
nité du 5 novembre, commémoration du complot papiste de Guy Fawkes, était l’objet d’une dévotion dont le temps n’avait pas éteint l’ardeur : alors, avec un mélange de libations et de prêches également patriotiques, on exaltait la victoire du protestantisme anglais sur le catholicisme espagnol ou français, non comme le souvenir d’un passé lointain, mais comme un fait d’hier qui pouvait se reproduire demain, et aux prières officielles du temple répondaient les clameurs de la foule, qui promenait par les rues et finissait par brûler un mannequin figurant le Pape. Ce n’était, du reste, pas seulement pour le populaire que l’évêque de Rome était « l’homme du péché », le « faux prophète », l’ «Antéchrist» ; Newman a raconté combien il lui a fallu de temps pour se défaire de cette croyance 1. Vainement l’anglicanisme, à la différence de la plupart des communions protestantes, conservait-il le décor extérieur d’un épiscopat ; il n’en avait pas moins perdu la notion catholique de l’Eglise, société divine, fondée par le Christ, gouvernée par une hiérarchie qui remontait jusqu’à Lui, distincte et indépendante de tous les gouvernements, ayant par elle-même sa vie propre, le droit de se régir et de fixer sa doctrine; l’Eglise éta-
1. M. Bellasis, converti au catholicisme en 1851, raconte que, chez ses parents, pieux et honnêtes anglicans, on avait eu, jusqu’en 1849, la coutume de réciter, chaque jour, la prière suivante: « Confonds partout, nous t’en supplions, Seigneur, l’hérésie et l’erreur, déjoue les machinations du papisme, soit au dedans, soit au dehors de l’Eglise. Que toutes les inventions de l’évêque de Rome contre la vérité sacrée soient confondues. Seigneur, puisse le papisme subir bientôt sa défaite finale, et puisse Babylone, depuis longtemps condamnée, cesser d’opprimer la terre. » (Memorials of M. Serjeant Bellasis, p. 22.)
XXXI
blie n’apparaissait plus que comme une création de l’Etat, chargée par lui, sous sa suprématie, du département de la religion et de la morale, ayant ses évêques nommés par le prince, ses lois et même ses dogmes fixés par le Parlement, ses contestations intérieures jugées par les tribunaux civils. Rien qui ressemblât à notre clergé, avec son célibat, son idéal de renoncement, d’ascétisme, de mysticisme surnaturel, à nos prêtres, marqués et séparés du monde par le sceau sacerdotal, investis du ministère du sacrifice et de l’absolution. Le clergyman eût été étonné et presque choqué qu’on le qualifiât de « prêtre »; marié, occupé de sa famille, vivant de la vie de tout le monde, soit en scholar, soit en squire, il se regardait comme investi d’une fonction sociale qui ne lui paraissait pas d’une essence différente des autres, mais qui l’obligeait seulement à une tenue un peu plus sévère. De la messe, on avait proscrit le nom, dénaturé et mutilé la liturgie: conséquence logique d’une doctrine qui contestait le sacrifice de l’autel et la présence réelle. Pendant la célébration eucharistique, l’officiant se tenait de profil au petit côté de la table qui remplaçait l’autel, avec l’intention manifeste de ne pas imiter le prêtre catholique qui demeure au milieu, le dos tourné au public, en quelque sorte face à face avec son Dieu; quant aux assistants, ils étaient assis ou debout, presque jamais à genoux. Encore cette « célébration », qu’on appelait Administration of the Lord’s supper, loin d’être l’acte journalier du culte, n’avait-elle plus lieu qu’à de longs intervalles, dans la plupart des églises trois ou quatre
XXXII
fois, ou même une seule fois par an, et souvent avec Si peu de décence qu’au dire de témoins attristés une abstention complète eût été préférable. Presque toujours le service du dimanche se bornait à la récitation des psaumes, des leçons et au sermon, office d’une froideur toute calviniste. Les églises étaient en harmonie avec le culte qui s’y célébrait: fermées d’ordinaire toute la semaine, d’aspect souvent très négligé; des murs blanchis et nus; pas d’autel orné, en évidence au fond du sanctuaire, et vers lequel tout converge, mais, à la place, une simple table en bois, à peine visible, souvent en piteux état et qu’on a pu comparer à une table de cuisine; rien dessus, ni croix, ni cierges, ni tabernacle; devant cette table, parfois la cachant, faisant face aux bancs fermés et à hauts dossiers qui remplissaient la nef et les bas-côtés, le pupitre d’où se faisaient les lectures et la chaire d’où se débitaient les sermons; on sentait que c’était devenu le principal; on ne se trouvait plus dans une église consacrée pour le sacrifice, mais dans une salle de prêche. Fond et forme, tout avait donc un caractère bien protestant. Eût-on demandé d’ailleurs à un anglican de cette époque, clergyman ou laïque, savant ou ignorant, s’il était protestant ou catholique, il eût cru que le questionneur voulait plaisanter. Protestant, il l’était et s’en faisait honneur. Sans doute, il croyait bien avoir un protestantisme à lui, que, comme toute marchandise anglaise, il estimait supérieur aux marchandises de même nom ayant cours sur le continent; mais ce n’était qu’une différence de qualité, non de
XXIII
nature. Le seul mot de catholique évoquait à ses yeux un ensemble de superstitions, dont c’était précisément la gloire de ses pères de s’être dégagés, trois siècles auparavant, et avec lesquelles il ne supposait pas pouvoir jamais avoir rien de commun.
IV
C’est au moment où le protestantisme semblait avoir ainsi définitivement triomphé dans l’Eglise établie, que s’y produisit, vers 1830, plus exactement en 1833, comme une saute de vent qui fit remonter tout d’un coup le courant vers le catholicisme. Et bientôt on vit, non certes tous les anglicans, mais une partie d’entre eux, s’appliquer à retrouver, l’un après l’autre, presque tous les dogmes, presque toutes les pratiques dont leurs pères avaient mis, pendant trois siècles, tant de persévérance à se dépouiller. Manning constatait, en 4866, combien un tel mouvement était « contraire au vent et à la marée des traditions et des préjugés» de son pays. « La polarité de l’Angleterre a été changée, disait-il; les ruisseaux qui coulaient du côté du nord coulent maintenant du côté du midi 1. » Ce revirement a-t-il donc été déterminé et secondé par des circonstances, extérieures, était-il conforme aux tendances régnantes, favorisé par les puissances du jour? On ne peut dire que, dans l’Angleterre de Stuart Mill, de Carlyle, de Darwin, d’Herbert Spencer,
1. England and Christendom, Introduction et Letter on the reunion of Christendom.
XXXIV
de Jowett, d’Arthur Stanley, les courants intellectuels ramenassent les esprits vers une religion plus dogmatique, plus autoritaire, plus traditionnelle et plus surnaturelle. Si le vent soufflait, c’était plutôt dans le sens du positivisme, de l’agnosticisme, de la critique, ou tout au moins d’une religion préoccupée à ce point de n’être pas trop dogmatique qu’elle n’était plus guère qu’un sentiment. Quant aux autorités sociales, les promoteurs de cette transformation n’en ont pas eu une seule avec eux. Ils faisaient partie de l’Université d’Oxford : cette Université les a désavoués et condamnés. Ils étaient membres du clergé : les évêques se sont prononcés contre eux. Des ministres dirigeants, les uns leur ont témoigné du dédain, comme Disraéli; les autres, de l’aversion, comme John Russell ou Palmerston. Les cours de justice, saisies de leur cas, leur ont donné tort. Ont-ils eu l’opinion pour eux? Les journaux et les revues les plus lus leur ont été généralement défavorables. La foule elle-même a donné l’assaut à leurs chapelles, au cri de : No Popery. Encore n’est-ce pas du dehors, mais bien de leurs propres rangs qu’ils ont reçu le coup le plus redoutable, celui qui semblait devoir ruiner à jamais leur cause : je veux parler de la défection de leurs chefs les plus éminents, Newman, Manning, les deux Wilberforce et tant d’autres, qui, en revenant à l’Eglise romaine, ont proclamé eux-mêmes la faillite de l’anglo-catholicisme et ont paru donner raison à ses adversaires. C’est malgré tant de causes contraires que cette réaction catholique est née et s’est développée au sein de l’Eglise établie.
XXXV
Quant au résultat, nous l’avons sous les yeux. Redemandez aujourd’hui aux anglicans dont je parle, s’ils sont protestants ou catholiques: ils se défendront avec indignation d’être protestants, considéreront cette qualification comme une injustice et une injure, revendiqueront le droit de se dire catholiques, se piqueront de n’avoir que des croyances et des pratiques catholiques. Loin d’être, comme leurs devanciers, satisfaits d’avoir une religion tout anglaise, — à la façon des anciens Hébreux qui ne concevaient guère Jéhovah que comme leur appartenant à eux seuls, — ils sentent que la vérité religieuse ne peut être à ce point insulaire; ils tâchent de se persuader qu’en dépit de la scission du XVIe siècle, où ils ne veulent voir qu’un accident malheureux et passager, ils demeurent toujours une branche de l’Eglise catholique; ils affirment que, malgré tout, subsiste une sorte d’unité’ immatérielle. Des prétendus réformateurs qu’ils rencontrent à la naissance de leur Eglise, ils se montrent assez peu fiers; parfois même ils confessent hautement leur crime et, en tout cas, paraissent surtout préoccupés de faire remonter au-delà leur origine, plus curieux de se rattacher à saint Grégoire le Grand et à saint Augustin de Canterbury qu’à Henri VIII et à Cranmer. Entrez dans quelqu’une des églises de plus en plus nombreuses que fréquentent les anglicans de cette école, de celles où l’on applique les idées High Church: l’aspect est celui d’une église catholique. L’autel, en pierre ou en marbre, surélevé de plusieurs marches, richement orné, surmonté d’une croix, parfois même
XXXVI
d’un crucifix, garni de cierges et de fleurs, attire tous les regards et a retrouvé sa prééminence. Par derrière, des retables, souvent d’une rare magnificence, représentent le crucifiement ou la Madone entourée de saints. Dans les bas-côtés, d’autres autels sont dédiés à la Vierge, à saint Joseph, au Sacré-Coeur. Sur divers points, des statues pieuses, l’image de la Sainte-Face; le long des murs, les stations du chemin de la Croix. Des lampes brûlent à l’entrée du sanctuaire ou devant certaines images. Des bannières, suspendues au mur, portent la figure de Marie ou l’emblème du Saint-Sacrement. Des emplacements sont préparés pour la confession. Parfois, à l’entrée, vous apercevez un bénitier. Dans ces églises, la messe, dont le nom ne fait plus peur, est redevenue l’acte principal du culte. Elle est célébrée tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, tantôt en messe basse, tantôt chantée en grand appareil, avec diacres, acolytes et encens, missa cantata; pour le cérémonial, pour l’ordre des prières, pour le vêtement, la position et les gestes du célébrant, on est revenu presque complètement à notre liturgie. Le passant se croirait dans une église catholique, si, en prêtant l’oreille, il n’entendait les prières prononcées en anglais; encore prétend-on que certains ritualistes plus avancés commencent à se servir du latin. Le rétablissement de la messe ne suffit pas à plusieurs qui empruntent en outre au catholicisme la bénédiction du Saint-Sacrement, l’aspersion de l’eau bénite, la récitation publique des litanies ou du chapelet. On recommence à observer des fêtes depuis longtemps
XXXVII
négligées ou même volontairement méconnues, non seulement l’Ascension, mais l’Assomption, le jour des Morts, la Fête-Dieu. On reprend les offices de la semaine sainte, y compris l’adoration de la Croix du vendredi saint. Plus d’un clergyman se met à l’école des Bénédictins de Solesmes pour ressusciter le chant grégorien. Ce changement dans le culte n’est que la conséquence du changement plus important qui s’est fait dans les doctrines. La présence réelle objective, que Pusey, il y a un demi-siècle, ne pouvait prêcher sans se faire anathématiser comme « romanisant », est hautement professée par les high-churchmen, sauf encore quelques subtilités pour la concilier avec celui des XXXIX Articles qui a répudié la transsubstantiation; quant au sacrifice actuel du Christ dans la messe, plusieurs d’entre eux disent l’accepter dans le sens où l’enseigne une partie des théologiens romains. Sur ces deux points capitaux, le langage de la lettre encyclique des archevêques de Canterbury et d’York, écrite, le 19 février 4897, en réponse à la bulle du Pape, est significatif: non qu’il soit dégagé de toute équivoque; mais c’est un fait important et nouveau que les deux primats se soient préoccupés de satisfaire ceux de leurs adeptes qui adoptent, en ces matières, des opinions catholiques. On peut noter beaucoup d’autres changements doctrinaux. Tout en repoussant certaine conception trop matérielle du purgatoire, qui n’est nullement de l’essence de la théologie romaine, il y a tendance dans le High Church à admettre, après la mort, un état expectant et souffrant,
XXXVIII
dont la prière des vivants peut obtenir le soulagement; aussi prier pour les défunts est-il devenu d’usage courant et voit-on souvent annoncer des messes de Requiem. On admet de même l’invocation des saints et le culte de la Vierge. Bien que gêné par l’origine historique et l’organisation politique de l’Eglise établie, on s’efforce de la dégager, en fait, de sa dépendance envers l’Etat, et de rétablir, en théorie, la notion, naguère tout à fait oubliée, de l’Eglise société divine, ayant sa vie propre et son autonomie; on se réclame de la succession apostolique, considérée comme la source et la condition du pouvoir épiscopal et sacerdotal. Le principe, naguère obscurci, de la régénération baptismale est nettement affirmé. Pour le sacrement de pénitence, s’est opérée une révolution encore plus inattendue,: des anglicans sont revenus à la confession auriculaire, si longtemps décriée; ils y procèdent suivant les formes catholiques: le pénitent à genoux devant un crucifix ou une croix; à côté de lui, le ministre assis, revêtu du surplis et de l’étole, et prononçant la formule de l’absolution. D’abord timidement essayé et non sans provoquer une sorte de scandale, cette pratique se répand chaque jour davantage, et maintenant, il n’est pas rare, à la veille des fêtes, de voir certains clergymen passer la nuit entière à entendre les confessions. L’extrême-onction est toujours en désuétude, mais on commence à en demander le rétablissement 1. En somme, à lire certains des caté-
1. Un journal de la haute Eglise, le Church Times, annonçait avec satisfaction, le 20 mai 1898, que l’évêque anglican de Chicago venait de rétablir, dans son diocèse, l’usage de l’onction pour les malades.
XXXIX
chismes en usage dans les paroisses High Church, on les dirait copiés sur les nôtres 1: ce n’est guère que sur l’autorité du Pape que l’on constate une discordance ou du moins une lacune; encore certains théologiens de cette école font-ils effort pour concilier avec les formulaires de leur Eglise l’acceptation d’une certaine primauté de l’évêque de Rome. Ce n’est pas seulement le dogme catholique, ce sont les dévotions catholiques que les anglicans de cette école cherchent à s’approprier. Ils ont entrevu un idéal, nouveau pour la plupart d’entre eux, de piété attendrie, de ferveur mystique, d’ascétisme, et, afin de l’atteindre, ils sentent le besoin de se mettre à l’école de l’Eglise de Rome. Ainsi apprennent-ils d’elle le culte de l’Eucharistie, qu’ils avaient à peu près complètement oublié; ils se remettent à adorer les espèces consacrées où ils croient maintenant Dieu réellement présent. Des confréries du Saint-Sacrement sont établies pour développer cette dévotion et réparer les négligences passées. D’autres associations pieuses s’organisent sous le vocable de la Sainte-Croix et du Saint-Rosaire. Dans certaines paroisses, le mois de Marie et celui du Sacré-Coeur sont marqués par des exercices spéciaux. On s’initie à l’idée de la mortification, et quelques-uns se préoccupent d’observer les jeûnes et les abstinences. C’est le plus souvent dans les livres des théologiens catholiques que les âmes ainsi travaillées cherchent l’aliment
1. L’archevêque d’York disait, en 1897, au congrès de Shrewsbury, « qu’il y avait beaucoup plus d’accord que de différence entre le catéchisme de l’Eglise d’Angleterre et celui du concile de Trente ».
XL
et la direction de leur piété; des ouvrages de saint François de Sales, de Fénelon, du P. Lallemartd, du P. Grou, et beaucoup d’autres du même genre, sont traduits et goûtés. Tel manuel fort répandu qui contient les prières à dire pendant la messe indique, pour le moment de la communion, la célèbre prière de saint Ignace de Loyola, Anima Christi. Les saints du moyen âge sont en faveur, particulièrement saint François d’Assise. Des pèlerinages ont lieu avec les démonstrations extérieures et les processions en usage dans les nôtres, toujours pour célébrer des souvenirs catholiques: ainsi, il y a deux ans, en l’honneur de saint Columba, dans l’île d’Iona, et en l’honneur de saint Augustin, à Ebb’s Fleet. Entre catholiques et anglicans, c’est une sorte d’émulation à qui s’appropriera ces saintes mémoires,
Les clergymen de cette école s’honorent de faire revivre le titre naguère délaissé de « prêtre », avec ce qu’il implique d’aspirations et de privilèges surnaturels; chez plusieurs d’entre eux, le port de la soutane devient habituel, comme une manière ‘de mieux marquer leur séparation d’avec le monde; quelques-uns en viennent à pratiquer et à recommander le célibat. La vie sacerdotale mieux comprise exigeant une préparation plus efficace, on a établi, dans plusieurs diocèses, pour les aspirants aux saints ordres, des écoles théologiques plus ou moins analogues à nos séminaires; et ensuite, afin d’entretenir cette vie, on tâche de répandre la pratique des retraites ecclésiastiques. Un phénomène, plus significatif encore, est le rétablissement de
XLI
ces couvents dont la destruction semblait avoir été l’une des oeuvres principales de la Réforme. L’anglicanisme a maintenant ses moines et ses religieuses, les premiers, il est vrai, encore en petit nombre. Règles et costumes sont copiés sur les modèles catholiques. Dans certains de ces ordres, on prononce des voeux et l’on pratique des austérités. Leur activité se partage entre les diverses oeuvres de prière, d’apostolat et d’assistance. Tel couvent, à Londres, est principalement destiné à recevoir les femmes du monde qui veulent faire une retraite de quelques jours; comme je demandais à la supérieure de quel livre on se servait dans ces retraites : « Des Exercices de saint Ignace », me fut-il répondu. N’est-ce pas là un anglicanisme absolument nouveau, à ce point éloigné de l’anglicanisme du commencement du siècle, qu’on peut se demander s’il ne serait pas plus proche du catholicisme lui-même? On comprend que le cardinal Vaughan se soit écrié récemment, dans un discours prononcé à Ramsgate, à l’occasion du treizième centenaire de saint Augustin : « Il faut le proclamer : à leur grand honneur, des multitudes qui attaquaient autrefois la doctrine catholique sont devenues ses soutiens et ses confesseurs; ceux qui jetaient dehors l’autel et dépouillaient l’église ont relevé l’autel et regarni l’église; ceux qui dénonçaient la confession auriculaire entendent maintenant des confessions; ceux qui blasphémaient la messe essayent de dire la messe; ceux qui niaient les pouvoirs sacerdotaux de Rome prétendent posséder et exercer ces pouvoirs; les icono—
XLII
clastes ont replacé dans leurs niches, pour les honorer, les statues de la Mère de Dieu et des saints... Le changement, la conversion, survenus en Angleterre durant ce siècle, sont sans parallèle dans la chrétienté. Non fecit taliter omni nationi. » Sans doute, — ne nous lassons pas de le répéter, de façon à ne laisser place à aucun malentendu, — cette réaction ne s’est produite que dans une partie de l’anglicanisme. L’autre partie y a été étrangère, indifférente, ou même ouvertement hostile, tels ceux qui ont, en ce moment, entrepris de soulever l’opinion pour faire réprimer les innovations romanistes introduites dans le culte et l’enseignement anglicans. Dans quelle proportion les membres de l’Eglise d’Angleterre se répartissent-ils entre partisans et adversaires de ces innovations? On serait embarrassé de le dire. Les classifications de ce genre sont fort malaisées sur cette terre de l’individualisme, où chacun dose à sa façon sa religion, prenant de telle doctrine ou de telle pratique ce qui convient à son sentiment particulier. Le développement que paraît prendre aujourd’hui l’agitation antiritualiste n’est même pas un indice bien sûr, car, parmi ceux qui y prennent la part la plus bruyante, plusieurs n’appartiennent pas en réalité à l’Eglise établie et sont des dissidents plus ou moins avoués. J’admets cependant que les anglo-catholiques ne sont, dans la masse anglicane, qu’une minorité; seulement, c’est la partie la plus fervente, la plus active, celle qui était, depuis quelque temps, le plus en progrès et qui semblait montrer la voie aux autres. Je ne voudrais d’ailleurs de son
XLIII
importance d’autre preuve que la violence même de la campagne actuellement dirigée contre elle. Par les faits énumérés dans leurs dénonciations et par l’excès même de leur émotion, les meneurs de cette campagne ne sont-ils pas les meilleurs témoins des progrès qu’ont faits, dans l’anglicanisme, les idées et les pratiques catholiques ?
V
Faut-il donc croire que ce mouvement de retour aux vieilLes croyances et aux vieilles pratiques va continuer dans la même direction? Sans doute, le parti Low Church, encore nombreux bien que suranné et déchu, tend plutôt à se confondre avec le pur calvinisme qu’à se joindre à Rome; sans doute aussi, le parti Broad Church, plus jeune, plus vivant, suit sa peine vers le scepticisme, ou tout au moins vers une indifférence dogmatique, qui se concilie avec une pratique toute de convenance extérieure et qui peut-être est déjà, outre-Manche, l’état de beaucoup d’esprits; mais doit-on espérer que le parti High Church ou tout au moins son avant-garde aboutisse tôt ou tard à ce qui paraît être son terme logique, le retour au catholicisme? Même ainsi limitée, la question a un grand intérêt, car il s’agit de l’élite religieuse de l’anglicanisme, et on ne saurait exagérer l’action que cette élite, devenue catholique, exercerait sur son propre pays et sur le catholicisme lui-même. Ne nous faisons pas d’illusion: les obstacles sont
XLIV
considérables. Pour être bien atténuées, les préventions contre Rome sont loin d’avoir entièrement disparu. Si elles n’ont plus la même puissance offensive, si l’élan est maintenant à d’autres idées, elles conservent, dans les masses de l’anglicanisme, une force d’inertie, incapable de rien créer, mais capable d’arrêter un mouvement. Dans le parti High Church lui-même, depuis quelques années, ces préventions semblent s’être avivées. Ce n’est pas seulement l’effet des irritations passagères soulevées par la bulle du Pape. On dirait que, chez certains esprits, l’évolution qui les conduit vers le catholicisme, en le leur montrant plus proche, ait par cela même réveillé les vieilles antipathies, et que plus la conversion s’impose, plus ils se raidissent contre elle. De là l’aigreur croissante de certaines polémiques 1. L’archevêque d’York faisait allusion à ces sentiments, quand il écrivait à un religieux français, le P. Ragey, que « l’Eglise anglicane devenait de jour en jour plus catholique, mais en même temps plus antiromaine ». Peut-on d’ailleurs s’attendre à voir rompre facilement les liens trois fois séculaires, attachant les Anglais à cette Eglise qui est leur oeuvre et qu’ils étaient flattés d’entendre nommer anglicane? De tout temps, ils ont été disposés à croire à l’excellence de tout ce qui appartient à l’Angleterre. Ils en sont encore plus convaincus, après le récent Jubilé de la reine et l’enivre-
1. L’un des livres les plus acrimonieux publiés contre le catholicisme, Plain reasons against joining the Church of Rome, a pour auteur le D’ Littledale, qui avait été jusqu’alors un ritualiste ardent.
XLV
ment d’orgueil national qui en a été la conséquence. Dans leur conception un peu judaïque des choses religieuses, ils considèrent la prospérité de leur pays comme une preuve que leur culte est le plus agréable au Seigneur; leur patriotisme se révolte à la pensée de l’échanger contre celui de nations qu’ils jugent inférieures; ils rendraient plutôt grâces à Dieu, comme le pharisien de L’Evangile, de ce qu’ils ne le prient pas à la façon des publicains de France ou d’Italie. Quelques-uns, sans doute, avaient une vue moins étroite et s’inquiétaient des faiblesses, des lacunes de leur Église. L’effort fait, depuis soixante ans, pour la catholiciser, n’a-t-il pas contribué à dissiper ces troubles, à raffermir ces fidélités ébranlées? Ce que les âmes pieuses souffraient autrefois de ne pas rencontrer dans l’anglicanisme et ce qu’elles étaient tentées de demander à l’Eglise romaine, — vie sacramentelle, éclat du culte, consolante douceur des dévotions, aspirations mystiques et ascétiques, — elles croient le posséder maintenant dans leur communion. Pourquoi dès lors le chercher ailleurs, au prix des sacrifices et des déchirements que comporte un changement de religion? Ajoutons que de grands efforts ont été faits pour justifier historiquement et théologiquement cette via media entre le catholicisme et le protestantisme, où les premiers promoteurs de « l’anglo-catholicisme » avaient eu d’abord tant de peine à prendre pied. Des savants distingués se sont donnés à cette tâche. Ils se flattent d’avoir découvert une réponse aux objections qui avaient désemparé un Newman et un Manning, et
XLVI
d’avoir établi un point d’arrêt solide sur la pente qui semblait aboutir nécessairement à Rome. Ils affectent de dire, surtout quand ils s’adressent à nous, que, grâce à ce travail, leur Eglise a pris mieux conscience de la légitimité de sa position intermédiaire, qu’elle s’y sent plus ferme, plus confiante, plus en paix. Le désir de faire tête à la bulle du Pape n’a pas peu contribué à leur faire affirmer très haut leur droit. II n’est pas jusqu’à une apparence d’universalité, de catholicité, dont ils ne croient maintenant pouvoir faire honneur à leur Eglise, autrefois isolée dans leur île: c’est l’effet de l’extension de l’Empire britannique et de la dissémination de l’anglicanisme qui en a été la conséquence. N’a-t-on pas convoqué, naguère, au palais de Lambeth, sous la présidence de l’archevêque de Canterbury, une sorte de concile où se trouvaient réunis environ deux cents évêques anglicans, venus de toutes les parties du monde? Il est vrai qu’ils furent hors d’état de formuler d’accord aucune doctrine précise et de prendre aucune mesure d’organisation commune. Mais ce qui reste d’inconséquence et de compromis dans cette religion n’est pas pour troubler l’esprit anglais. Et puis, chez plusieurs de ceux qui semblent les plus ardents à catholiciser extérieurement l’anglicanisme, n’est-ce pas un peu affaire de curiosité esthétique, caprice d’imagination? Ils ne paraissent pas aussi sérieusement, aussi douloureusement occupés que les premiers tractarians à chercher la vérité, aussi résolus à tout lui sacrifier. On devine qu’au fond ils sont, eux aussi, quelque peu atteints du mal général qui est l’indiffé-
XLVII
rence dogmatique. N’est-ce pas un évêque anglican, Westcott, qui, parlant de ses coreligionnaires, notait récemment comme «un faible son d’incertitude dans beaucoup des professions de foi qui étaient faites publiquement» ? Enfin, si grands qu’aient été les progrès accomplis depuis soixante ans, si longue que soit la liste des croyances catholiques auxquelles les anglicans sont revenus, il n’en reste pas moins, pour faire le dernier pas, pour arriver au plein catholicisme, un abîme à franchir. Il ne s’agit plus seulement d’ajouter un dogme à tous ceux qu’on a déjà acceptés, il faut, — ce qui est bien autrement difficile, — consentir à établir la vie religieuse sur un fondement nouveau, se soumettre à une autre règle de foi; il faut substituer à la domination jusqu’ici absolue du jugement privé, le principe d’une autorité vivante, ayant droit d’enseigner et de commander. Or rien n’est plus étranger au tempérament de l’esprit anglais, habitué à décider de toutes ces questions à lui seul et à doser sa religion à sa guise. A considérer même d’un peu près le mouvement catholique qui s’est produit au sein de l’anglicanisme, on se rendra compte que, loin d’être un retour au principe d’autorité, il a été une manifestation de cette indépendance individuelle. Tous les clergymen qui ont modifié dans ce sens, et parfois si complètement, le culte et l’enseignement dogmatique de leur Eglise, l’ont fait par leur volonté propre, j’allais dire suivant leur fantaisie, chacun dans la mesure qui lui convenait, sans l’autorisation, souvent contre la volonté de leurs chefs
XLVIII
hiérarchiques: de sorte qu’on peut presque dire qu’ils ne se sont jamais montrés plus protestants que quand ils ont manifesté leurs sympathies pour les idées et les formes catholiques. Voilà bien des raisons de ne pas s’abandonner à l’espoir que les changements déjà accomplis semblaient permettre de concevoir. Je ne méconnais pas la force de ces raisons qui suffisent, en tous cas, à nous rendre très réservés dans nos pronostics. Mais faut-il en conclure que ces obstacles sont insurmontables et que le mouvement commencé est définitivement arrêté à mi-pente? Oui, sans doute, je reconnais qu’il est resté une part de protestantisme même chez les représentants les. plus avancés du High Church, et qu’en particulier leur conduite actuelle est une application du jugement privé en matière religieuse. Mais a-t-on jamais vu une conversion se préparer autrement que par l’usage du jugement privé? Oui, ces « anglo-catholiques » croient s’être construit une théorie solide de la via media entre le catholicisme et le protestantisme; mais ils ne pourront longtemps s’en dissimuler la fragilité et les contradictions. Les faits suffiront à les en instruire; plus ils voudront rendre réelle l’unité de l’Eglise établie, plus ils auront occasion de constater son anarchie doctrinale et disciplinaire; plus ils chercheront à revendiquer son autonomie et son indépendance, plus ils la sentiront, par essence, subordonnée à l’Etat dont elle est la création, impuissante à constituer dans son sein une autorité gouvernante et ensei-
XLIX
gnante; enfin ils auront beau se leurrer par quelques apparences d universalité, ils seront bien obliges de s’avouer qu’ils sont isolés, séparés du corps et de la tête de la chrétienté, et ils ne trouveront pas longtemps une compensation suffisante ‘à cet isolement dans les coquetteries échangées avec quelques évêques russes ou avec des prêtres « vieux-catholiques » en rupture de célibat. Déjà, sous les affirmations confiantes et hautaines qu’une sorte de point d’honneur les conduisait naguère à opposer à la bulle pontificale, on devine plus d’un esprit inquiet, troublé : le temps ne pourra qu’augmenter ces doutes. On peut, du reste, s’en fier aux anglicans demeurés protestants, pour démontrer aux « anglo-catholiques » que leur situation est intenable et pour leur signifier que place ne peut plus leur être faite dans l’Eglise établie. Qui sait si ce ne sera pas le résultat le plus clair de la campagne si bruyamment menée en ce moment, pour obliger les évêques, les pouvoirs politiques et les autorités judiciaires à user de rigueur contre le « ritualisme » ? Il est vrai enfin que ce réveil de vie religieuse au sein de l’anglicanisme satisfait des âmes pieuses qui eussent été, sans cela, tentées d’en sortir. Mais ce n’est vrai que pour un temps. La source à laquelle elles ont pu ainsi se désaltérer sera bientôt tarie, parce qu’elle est artificielle. Aujourd’hui, ces âmes sont tout à la joie des vérités et des grâces qu’elles croient avoir retrouvées; demain, elles seront anxieuses de ne pas les sentir plus assurées. Plus se ranimera en elles la dévotion à l’Eucharistie plus elles voudront être cer-
L
taines que leur Eglise a vraiment volonté et pouvoir de changer le pain et le vin au corps et au sang du Christ. Plus elles auront repris l’habitude de la confession, plus elles voudront être garanties que le ministre auquel elles avouent leurs fautes leur donne une absolution efficace. Ainsi de tout. Et puis, à se proposer, en chaque occasion, l’Eglise romaine comme modèle, tout au moins atténuent-elles les préventions qui les en tenaient éloignées. Si cette imitation de jour en jour plus complète des formes et des idées catholiques a pour résultat momentané de retarder certaines conversions, son effet durable sera de familiariser les esprits avec nos pratiques, avec nos dévotions, avec les dogmes qu’elles supposent, avec les autorités qui y président; elle fait prendre des habitudes, éveille des goûts, des appétits spirituels que seul le vrai catholicisme pourra pleinement satisfaire. Je ne saurais donc partager le sentiment de certains catholiques d’outre-Manche qui, ne voyant dans cette sorte de catholicisation de l’anglicanisme que le retard momentané de quelques conversions, la considéraient naguère de mauvais oeil, y signalaient un danger plus grave que le pur protestantisme, s’en moquaient comme d’un déguisement et d’une mascarade ridicules, s’en indignaient comme d’une contrefaçon malhonnête, s’en méfiaient comme d’un piège diabolique et arrivaient à se demander si ses partisans n’étaient pas, à leur insu, «des marionnettes aux mains de Satan». Parole malheureuse et injuste, qui n’a eu que trop de retentissement et n’a pas peu contribué à rejeter loin de Rome
LI
des âmes qui s’en rapprochaient! Comment donc un mouvement qui est, après tout, un retour partiel à la vérité et dont le cardinal Vaughan se félicitait comme d’une « demi-conversion 1», viendrait-il du démon? D’ailleurs, ne juge-t-on pas de l’arbre à ses fruits? Or ce mouvement a eu pour conséquence manifeste de ranimer la vie religieuse éteinte; il en est résulté, dans plusieurs âmes, un épanouissement de piété, de zèle, d’amour de Dieu, de vertus de toutes sortes que bien des pays catholiques de nom pourraient envier à l’Angleterre protestante et où le cardinal Manning et le cardinal Vaughan n’ont pas hésité à saluer l’action de la grâce divine. Enfin, à ceux qui sont surtout frappés du retard de certaines conversions, ne suffit-il pas de rappeler que presque tous les convertis de ce siècle, en Angleterre, sont venus du High Church, ou tout au moins l’ont traversé; que c’est cette école qui les a amenés à la porte du catholicisme et qui a jeté comme un pont entre deux sociétés religieuses jusqu’alors séparées par un abîme 2? Nous dira-t-on quel intérêt Satan aurait eu à la construction de ce pont? Tous, sans doute, ne l’ont pas franchi. Parmi ceux-là même qui s’étaient le plus approchés, beaucoup se sont obstinés à rester sur l’autre bord; et ce n’étaient pas seulement ceux dont on pouvait attribuer l’arrêt à quelque faute personnelle; c’étaient des hommes de vraie piété, de haute vertu, de grande culture : tels un
1. Lettre pastorale à l’occasion du Jubilé de la reine. 2. Un journal protestant d’Angleterre qualifiait récemment Le High Church de half-way house to Rome.
LII
Pusey, un Keble ou un Church qui, après avoir suivi leur saint et illustre ami Newman jusqu’au seuil de l’Eglise romaine, n’ont pas été un seul moment tentés d’y entrer avec lui. A regarder les choses au point de vue providentiel, on a quelque peine à expliquer ce fait. Rien qui permette de douter de la bonne foi de ces hommes, de la pureté de leurs motifs, de la droiture avec laquelle ils cherchaient la vérité. Que leur a-t-il donc manqué pour franchir la distance si faible qui les séparait du terme? Comment Dieu n’a-t-il pas accordé à des âmes si méritantes, le peu qui leur était encore nécessaire de grâce et de lumière, d’autant qu’à raison de leur renom, leur exemple rassurait beaucoup de consciences qui eussent été sans cela troublées de se sentir dans l’erreur? Je n’ai certes pas la prétention de pénétrer le mystère dont s’enveloppe la distribution de la grâce « L’Esprit souffle où il veut. » Toutefois, ne suffit-il pas de se demander ce qui fût arrivé si Pusey avait suivi Newman, pour discerner une face d’abord inaperçue de la question? Evidemment, sa conversion en eût entraîné, sur le moment, plusieurs autres; presque tous les champions du «Mouvement d’Oxford» fussent venus à l’Eglise romaine. Mais ce mouvement aurait ainsi trouvé sa fin, en même temps que sa conclusion. Il ne serait plus resté personne, dans le sein de l’Eglise établie, pour y opérer l’étonnante transformation qui, depuis lors, sous l’action de Pusey et de ses disciples, l’a tant rapprochée du catholicisme; au contraire, cette défection eût à tout jamais discrédité, aux yeux des an-
LIII
glicans, les idées qui y auraient conduit. Croit-on que la catholicisation graduelle de l’anglicanisme ait ce double avantage d’amener immédiatement des conversions individuelles et de préparer, pour un avenir indéterminé, sinon le retour en corps de toute l’Eglise, du moins celui de groupes plus ou moins nombreux? Si on le croit, on sera conduit à conclure que Pusey et ceux qui sont demeurés avec lui, ont pu être aussi, à leur façon, les instruments du dessein providentiel, et que leur résistance, si déplorable sous certains rapports, a produit cependant des résultats qui n’eussent pas été obtenus par leur conversion immédiate. Ainsi, sous quelque face qu’on considère le mouvement anglo-catholique, l’action de Dieu y est manifeste. Newman déclarait déjà, en 1850, qu’il était « impossible d’imaginer que ce mouvement ne fût pas entré dans le plan divin1 ». Manning, en 1866, y montrait « l’influence et l’impulsion d’une grâce surnaturelle 2». Tout récemment, la même thèse était développée, avec plus de précision encore, par un jésuite anglais 3. « Ce mouvement, se demandait-il, est-il l’oeuvre de Dieu, a-t-il été, non seulement permis par Dieu, mais voulu positivement par Dieu? » Et après en avoir longuement examiné, en théologien et en historien, les conditions et les résultats, il répondait oui sans hésiter 4.
1. Lectures on anglican difficulties. 2 England and Christendom. 3 Article du R. P. Tyrrell, dans le Month de juillet 1897. 4. Le P. Tyrrell affirme que le catholicisme, loin d’être intéressé à voir affaiblir et discréditer l’anglo-catholicisme, a avantage à sa durée et à ses progrès, et il ajoute que, si les catholiques étaient aussi roués et dépourvus de principes qu’on les suppose, leur jeu serait plutôt de retarder les conversions individuelles.
LIV
Le devoir des catholiques est donc de faire bon visage aux hommes de ce mouvement. Au lieu de les railler ou de les blâmer de ce qui leur manque encore, admirons l’effort qu’il leur a fallu faire pour reconquérir, fragment par fragment, quelques-unes des vérités perdues depuis trois siècles. S’ils tâtonnent, s’ils s’arrêtent ou même paraissent reculer, n’en soyons pas surpris. Croit-on que ce soit chose aisée de soulever le poids des préjugés séculaires au milieu desquels l’esprit a été formé sans même soupçonner la vérité contraire, de rompre des liens que les sentiments les plus nobles semblent contribuer à fortifier? Rappelons-nous combien d’années un Newman et un Manning ont lutté dans l’angoisse, en présence de la vérité toute proche qu’ils n’osaient encore embrasser 1. A ceux qui aujourd’hui sont arrêtés par les mêmes hésitations, ne témoignons ni irritation ni dédain; donnons-leur largement, au contraire, la sympathie et le respect auxquels ils ont droit 2. Et puis, ayons confiance dans l’issue plus ou moins lointaine de la crise. Il y a, croyons-nous, chez ces hommes, à la fois beaucoup de droiture dans la recherche de la vérité et beaucoup de préventions : la droiture restera, et les préventions s’useront.
1. Newman a fait le récit immortel de ces tragiques hésitations dans son Apologia. 2. Les catholiques anglais paraissent maintenant mieux comprendre qu’ils ne l’ont fait à d’autres moments que la justice et l’habileté conseillent une telle attitude. Le langage de leurs journaux s’est manifestement modifié dans ce sens. Dans une réunion récente de la Catholic Truth society, les principaux orateurs, dont l’évêque de Liverpool et deux jésuites, le P. Lucas et le P. Huson, ont déclaré hautement que les catholiques devaient témoigner aux ritualistes, dans la crise qu’ils traversent actuellement, une « respectueuse sympathie ». (Voir, dans le Tablet du 29 avril 4899, le compte rendu de cette réunion.)
LV
A une condition, cependant, c’est que nous, catholiques, nous prenions garde de ne pas fournir d’aliments à ces préventions. Parmi celles-ci, il en est qui portent sur l’essence des vérités catholiques; nous ne pouvons y avoir égard, et ce serait une piètre tactique de chercher à les désarmer, en voilant nos dogmes par des équivoques. Mais d’autres préventions s’attachent à des thèses ou à des pratiques qui, loin d’être essentielles à notre foi, souvent la dénaturent, Il dépend de nous de ne pas y fournir de prétexte. C’est ce dont on ne se préoccupe pas assez dans nos rangs. Quand quelques catholiques prennent plaisir à exagérer la portée de certains dogmes; quand ils érigent, de leur propre chef, en articles de foi, des opinions erronées ou douteuses; quand ils préconisent des dévotions tout au moins puériles, sinon suspectes; quand ils donnent le spectacle d’une crédulité ridicule; quand, affublant leur routine et leur ignorance du masque de l’orthodoxie, ils prétendent, au nom de cette dernière, limiter la légitime liberté de la critique et de la science; quand, en tout, ils semblent se donner pour tâche de diminuer dans les âmes la virilité et l’indépendance qui ne sont nullement incompatibles avec le vrai christianisme, je ne sais s’ils se flattent d’être ainsi des catholiques plus complets, mais il leur suffirait d’entendre ce qui se dit, de lire ce qui s’écrit dans le monde anglican, pour se rendre compte du contre-coup fâcheux
LVI
qu’ont, outre-Manche, des imprudences auxquelles ici nous serions parfois tentés de ne pas prêter grande attention. Les catholiques ont donc à s’observer sur ces points. Ce sera, avec la prière, leur façon d’aider à la conversion sinon de l’Angleterre, du moins de la partie de l’Eglise anglicane qui est visiblement en route vers le catholicisme. Cette conversion, il serait téméraire de l’annoncer à date fixe et prochaine. En semblable matière, il faut se garder de ces impatiences, naturelles à notre vie d’un jour. Ne nous attendons pas à voir défaire, en quelques années, l’oeuvre de plusieurs siècles. Je ne sais ni quand ni comment le résultat se produira, mais il me paraît certain que de grandes choses se préparent. La violence même des passions hostiles qui font explosion en ce moment ne ferait qu’affermir ma conviction. Dieu est à l’oeuvre en Angleterre il y a déposé un ferment qui travaille dans les âmes et les institutions. En attendant la manifestation d’un avenir qu’il serait oiseux de chercher à préciser davantage, il est du moins à notre portée d’étudier les événements qui, depuis trois quarts de siècle, ont préparé cet avenir. Le point de départ est nettement marqué c’est cette agitation commencée en 1833, d’abord renfermée aux limites d’une Université, bientôt étendue au pays entier, qu’on a appelée le « Mouvement d’Oxford », l’un des phénomènes les plus extraordinaires et les plus considérables de l’histoire religieuse de ce temps. De là sont venus, outre-Manche, aussi bien le renouveau du catholicisme
LVII
que la transformation de l’anglicanisme. Les fidèles des deux confessions n’en peuvent évoquer le souvenir sans émotion; les uns et les autres s’accordent â honorer les promoteurs de cette évolution et, entre tous, la pure et noble figure qui domine toutes les autres, celle de ce Newman qu’à sa mort les catholiques ont salué comme le « père des âmes » et l’inspirateur des conversions, tandis que les anglicans, oubliant sa défection, le proclamaient « le fondateur de la présente Eglise d’Angleterre ». C’est donc le Mouvement d’Oxford que je veux essayer de raconter, non seulement à l’âge héroïque de ses débuts, mais dans ses suites diverses, parfois même divergentes. De cette histoire, on n’a guère connu, jusqu’ici, en France, que quelques épisodes plus marquants qui avaient frappé notre attention, bientôt après distraite. On n’y avait vu que des accidents isolés et intermittents, et l’on ne s’était pas rendu compte de l’oeuvre continue de transformation qui s’accomplissait. Je voudrais montrer cette suite, cet ensemble, au moins dans les lignes principales. Je ne me dissimule pas ce qui manque à un étranger pour l’accomplissement d’une telle tâche, surtout quand il s’agit d’un état d’esprit aussi particulier, aussi diversement nuancé que celui des Anglais. J’ai tâché d’y suppléer par les informations qu’ont bien voulu me donner, à Londres, à Oxford, à Cambridge, avec une bonne grâce et une sincérité dont je les remercie, des hommes de toutes opinions et de toutes croyances, acteurs ou observateurs de cette transformation, et
LVIII
aussi par la lecture attentive des nombreux livres parus outre-Manche sur ce sujet. Non qu’on y ait écrit déjà l’histoire générale et définitive de cette crise; mais on y a multiplié les monographies, les biographies faites suivant la méthode de nos voisins, avec grande abondance de documents originaux et de renseignements personnels. Il ne me manque pas seulement d’être Anglais pour parler de choses anglaises; il me manque aussi d’être théologien pour traiter de questions qui touchent par tant de côtés à la théologie. Je m’excuse de ce que mon travail aura forcément d’incomplet à ce point de vue. Je ne puis prétendre qu’à faire oeuvre d’historien, mais du moins d’historien ayant l’ambition d’exposer les états d’âme autant que les événements, de faire revivre ces drames de la conscience religieuse, qui ne sont certes pas la partie la moins curieuse ni la moins émouvante de l’histoire générale. Il m’a paru que, même ainsi réduite par cette double incompétence, l’étude que j’entreprends pouvait avoir quelque intérêt pour le public français.
(Mai 1899.)
LIX
Voici la liste des principaux ouvrages que j’ai consultés
Apologia pro vita, par J.-H. Newman, et les autres ouvrages du même, notamment Loss and Gain, Anglican difficulties et le recueil de ses Sermons; Letters and Correspondence of J.-H. Newman during his life in the English Church, édité par Anne Mozley (2 vol.); Cardinal Newman, par Richard-A. Hutton (4 vol.); The Anglican career of Cardinal Newman, par Abbott (2 vol.); Remains of Richard Hurrell Fronde (4 vol.) The Life and Times of Cardinal Wiseman, par Wilfrid Ward (2 vol.); W.-G. Ward and the Oxford Movement, par le même (1 vol.); W.-G. Ward and the Catholic Revival, par le même (1 vol.); Life of Cardinal Manning, par Purcell (2 vol.); England and Christendom, par le cardinal Manning (1 vol.); Life of E.-B. Pusey, par Liddon et ses continuateurs (4 vol.); Spiritual letters of Pusey, éditée par Johnston et Newbolt (1 vol.); J. Keble, par Lock(1 vol.); The Oxford Movement, par Church (1 vol.); Life and Letters of dean Church, édité par Mary Church(1 vol.); Occasional Papers, par Church (2 vol.); Autobiography of Isaac Williams (1 vol.); Letters of Frederick lord Blachford (1 vol.); Notes of my Life, par Archd. Denison (3 vol.); Memoir of C. J. Blomfield (2 vol.); Life of Bishop Wilberforce, par Reginald G. Wilberforce (3 vol.) Life and letters of F.-W. Faber, par J.-E. Bowden (1 vol.); Memoirs of J-R. Hope Scott, par R. Ornsby (2 vol.); Memorials of M. Serjeant Betlasis, par Edw. Bellasis (1 vol.); Historical notes on the Tractarian Movement, par Oakeley (1 vol.); Reminiscences chiefly of Oriel college and the Oxford Movement, par T. Mozley (2 vol.); The Tractarian Movement, par E.-G.-H. Browne (1 vol.); Life and Correspondence of Th. Arnold, par Stanley (2 vol.); Life and Correspondence of A.-P. Stanley, par Rowland E. Prothero (2 vol.) ; Mémoirs of Mark Pattison (1 vol.) Life and letters of Benjamin Jowett, par Abbott et Cawpbell (2 vol.) ;
LX
Life of Frederiek Denison Maurice, par Frederick Maurice (2 vol.); Life and leiters of T.- J. Anthony Hort, par A.-F. Hort (2 vol.); Life and letters of Fred. W. Robertson, par Stopford A. Brooke (2 vol.); Life of Archibald Campbell Tait, par Davidson et Benham (2 vol.); The Nemesis of Faith, par J .A. Froude (1 vol.); Modem Guides of English Thought, par R.-H. Hutton (1 vol.); History of the Church of England, par Wakeman (1 vol.) History of the English Church Union, par Bayfield Roberts (1 vol.); The Catholic Religion, par Rev. Vernon Stanley (1 vol.); Hariet Monsell, a memoir, par Carter (1 vol.) The Anglican Revival, par Canon Overton (1 vol.); Re1igious Thought in England, in the Nineteenth century, par John Hunt (I vol.); The secret History of the Oxford Movement, par Walsh (I vol.); Ten Years in Anglican Orders, par Viator (1 vol.); Catholic England in modem Times, par Rev. J. Morris (I vol.); Rome’s Recruits, etc., etc. En outre, de très nombreux articles dans les revues anglaises, notamment ceux du Dr Fairbairn, dans le Contemporary.
LA RENAISSANCE CATHOLIQUEEN ANGLETERRE AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE
PREMIÈRE PARTIENEWMAN ET LE MOUVEMENT D’OXFORD
CHAPITRE PREMIERAVANT LE MOUVEMENT
I. La pensée anglaise et le problème religieux après Waterloo. En quoi l’Eglise anglicane ne répondait pas aux besoins du moment. Déclin du parti evangelical. L’école « libérale »; Whately et Arnold. — II. Que restait-il du High Church? J. Keble et The Christian Year. Richard Hurrell Froude. — III. La jeunesse de Newman. Il est élu fellow d’Oriel. Ses rapports avec Whately et sa phase « libérale ». Il devient l’ami de Pusey. Son ordination. — IV. Newman est nommé tutor à Oriel, puis vicar de Sainte-Marie. Il commence à devenir un centre. Côtés tendres de sa nature. — V. Newman se dégage du « libéralisme ». Il se lie avec Froude, se laisse gagner à ses idées et, par lui, se rapproche de Keble. Mécontentement de ses amis « libéraux ». Mariage de Pusey. Newman et le ménage de Pusey. Les opinions de Pusey à cette époque. — Vl. Première action publique de Newman lors de la candidature de Robert Peel à Oxford. Contre-coup de la Révolution de 1830 en Angleterre. L’Eglise établie paraît menacée: Newman et Froude sentent qu’elle ne peut être sauvée que par une contre-réforme. — VII. Voyage de Froude et de Newman dans le midi de l’Europe. Leur impression à Rome. Newman a l’idée d’une œuvre à faire en Angleterre. Sa maladie en Sicile. Son retour en Angleterre.
I
Dans les années qui suivirent Waterloo, la pensée anglaise, délivrée du gigantesque et périlleux effort
1
qui l’avait absorbée pendant sa lutte contre Napoléon, trouva le loisir d’accorder plus d’attention aux problèmes religieux. Elle parut alors partagée, sur ce sujet, entre deux tendances contraires. Les uns, — demeurés sous l’empire des traditions du XVIIIe siècle et de la Révolution française, ou ressentant les premiers effets de la contagion, à la vérité encore faible outre-Manche, de la philosophie et de la critique allemandes, ou bien encore gagnés aux prétentions déjà orgueilleuses d’une science qui se sentait sur la voie des grandes découvertes, — se montraient agressifs ou dédaigneux à l’égard de toute religion révélée et surnaturelle. D’autres, comme mûris par la grande crise que le monde venait de traverser, émus des problèmes sociaux que l’avènement de la démocratie et le développement de l’industrie dressaient devant eux, sentaient le besoin d’un retour au christianisme; des écrivains secondaient cette réaction ou en subissaient l’influence, accomplissant en Angleterre une oeuvre analogue à celle de Chateaubriand en France, de Görres en Allemagne tels, à des titres divers, Walter Scott 1, Coleridge, Wordsworth, Southey. L’Eglise établie d’Angleterre était-elle en mesure de faire face à cette hostilité et de satisfaire à ce besoin? Elle le devait pour justifier son existence. Le pourrait-elle? Personne alors ne le croyait. Sans doute, à la voir du dehors, elle avait gardé son importance; les tories, 1. Newman et Pusey insistaient volontiers sur l’influence exercée dans cet ordre d’idées par Walter Scott. Voir notamment une conversation de Pusey, rapportée par son biographe, le chanoine Liddori. (Life of Pusey, t. 1, p. 251.)
3
avec lesquels elle avait partie liée, possédaient le pouvoir depuis le commencement du siècle; mais les historiens anglicans ne font pas difficulté de reconnaître que, dans ses cadres demeurés debout, il n’y avait plus guère aucune vie religieuse. Les évêques, choisis par faveur politique, vivaient somptueusement, presque toujours hors de leurs diocèses où ils ne se montraient que pour présider à quelques rares cérémonies, sans liens avec leur clergé, sans autorité morale sur leurs ouailles, attentifs à voter, à la Chambre des lords, pour le parti qui les avait nommés, assidus au lever du roi, quelques-uns scholars distingués, éditeurs d’une tragédie de Sophocle ou d’un plaidoyer de Démosthène, aucun n’ayant la moindre idée d’une direction spirituelle à donner, d’une action apostolique à exercer. Sous ces évêques, les clergymen, la plupart cadets de bonne famille, attirés vers cette carrière par des vues humaines, sans soupçon d’une vocation d’en haut, se préoccupaient d’obtenir et même de cumuler de fructueux bénéfices. Beaucoup ne résidaient pas dans leurs paroisses et s’y faisaient suppléer par quelque curate famélique, comme l’Amos Bartori de Georges Elliot. Quelques-uns avaient gardé de l’Université le goût des études classiques ; le plus grand nombre vivaient comme les squires leurs voisins, chasseurs hardis, francs buveurs, quand ils ne succombaient pas au vice alors régnant en Angleterre, l’ivrognerie 1. Le dimanche
1. « lntoxication was the most frequent charge against the clergy. » (A Memoir of C.-J. Blomfield, bishop of London, t. I, p. 105.)— Dans un livre intitulé: An Introduction to the history of the Church of England, M. Wakeman écrit, en parlant du commencement du siècle: « It vould not be difficult to find districts of England and Wales, where drunkeness was very common among the clergy » (p. 459).
4
seulement, ils se rappelaient qu’ils étaient ministres du Seigneur et avaient à célébrer le service divin, accomplissaient cette tâche comme ils eussent fait de toute autre fonction administrative, et n’avaient pas idée qu’on pût leur demander autre chose. Les meilleurs s’appliquaient à mener une vie qui fût, — pour user de deux mots courants outre-Manche, — respectable et comfortable. Leur idéal était la prospérité, dans ce monde, pour la nation et l’individu; en cela, vrais citoyens de cette Angleterre qui, suivant l’expression de Sydney Smith, «se détournait de la pauvreté comme du mal 1 ». Ainsi que l’a écrit un des plus nobles esprits de l’anglicanisme, «l’Eglise d’Angleterre avait échangé la religion pour la civilisation 2 .» Elle ne voyait plus dans le christianisme que quelque chose de tranquille, de décent et de froid, une sorte de formalité traditionnelle, nécessaire à une société bien organisée. Rien de surnaturel; aucun souci de l’invisible; peu de piété et de ferveur; encore moins de mysticisme ou d’ascétisme. En ces matières, l’enthousiasme lui paraissait déplacé, un peu ridicule, et surtout suspect comme sentant le méthodisme et le romanisme. Les temples étaient presque constamment fermés, sauf pendant quelques heures, chaque dimanche. Le culte était sans éclat, sans dignité, souvent sans convenance, et M. Gladstone a confessé que, nulle part ailleurs, il n’était à ce point
1 Sydney Smith, par Chevrillon, p. 7. 2 Occasional Papers, par Church, t. 11, p. 412.
5
« abaissé ». Sûr le fondement et l’objet des croyances, rien, d’approfondi ni de réfléchi; Pas d’études théologiques sérieuses. On était admis aux ordres sacrés après un examen dérisoire qui ne témoignait que de l’indifférence doctrinale des évêques. Les symboles officiels n’étaient guère discutés, parce qu’on ne leur reconnaissait qu’une autorité de convention. Au fond, l’Eglise paraissait être moins la gardienne d’un ensemble de croyances qui s’imposaient à la raison et liaient la conscience, qu’un « établissement a lié étroitement à l’Etat et en ayant reçu des privilèges politiques et de grandes richesses. L’important était de maintenir ce lien et les avantages qui en résultaient. De cela, les clergymen étaient bien plus jaloux que de leurs croyances ou de leur indépendance; pourvu qu’ils fussent rassurés sur ce point, ils étaient disposés à faire bon marché du reste. Sans doute, ainsi que j’ai déjà « l’occasion de le dire, un effort avait été tenté pour ranimer la vie religieuse éteinte dans l’anglicanisme : c’était le mouvement evangelical, plus ou moins inspiré du méthodisme. Là où son influence avait pénétré, il avait, en effet, réveillé la piété individuelle, rappelé à chaque âme la question de son salut, rendu le culte plus sérieux, et surtout avait imprimé un grand élan aux oeuvres d’assistance et d’apostolat. Dans la seconde ou la troisième décade du XIXe siècle, ce parti, qu’on appelait proprement le « parti religieux » ou encore le « parti des saints », était assez en faveur, et, bien que demeuré une minorité dans la masse du clergé anglican, il occu-
6
pait plusieurs hauts postes ecclésiastiques. Et cependant, quoique son origine ne remontât guère qu’à cinquante ou soixante ans, il commençait à donner des signes de déclin : sa vertu bienfaisante semblait presque épuisée. La piété, qu’il avait contribué à faire revivre, dégénérait en un purisme formaliste et pharisaïque. Ses prières, qui avaient paru ferventes dans leur nouveauté, n’étaient plus qu’une répétition monotone, ennuyeuse et souvent creuse. Sa préoccupation extrême d’une sorte de cant prêtait au reproche d’hypocrisie. Sa première austérité faisait place, sur plus d’un point, à une mondanité satisfaite qui paradait volontiers dans les tea-meetings et s’y épanchait en phraséologie bigote. Et surtout apparaissaient, chaque jour davantage, l’étroitesse et l’inconsistance de sa hase doctrinale, la nullité de sa philosophie, son mépris de la raison, les lacunes de sa théologie qui se limitait à une conception un peu fataliste de la conversion individuelle, se fondait exclusivement sur l’interprétation arbitraire de quelques textes de l’Ecriture, et ignorait ou méconnaissait tout le reste. Aussi était-il sans prise sur les esprits intelligents, incapable de fournir un terrain solide de résistance-contre la critique moderne et de donner aux âmes religieuses la direction dont elles sentaient le besoin. Après avoir, à ses débuts, compté parmi ses partisans quelques esprits généreux, il paraissait, en grandissant, frappé de stérilité. Aucun leader intellectuel ne s’élevait de ses rangs, et si des jeunes gens de valeur étaient tout d’abord attirés de ce côté, dans l’espoir d’y trouver, au milieu du refroidisse-
7
ment général, un foyer de vie chrétienne, ils s’en détournaient bientôt, désabusés, et cherchaient ailleurs. Où aller? où trouver ce renouveau religieux que les âmes attendaient? Etait-ce auprès de l’école, dite « libérale », qui régnait, vers 1820, à Oriel College, le plus renommé alors des collèges d’Oxford. L’un de ses chefs était Whately. alors fellow 1 de ce collège, plus tard archevêque de Dublin. Esprit ouvert et original, causeur alerte, discuteur implacable, se plaisant à passer au crible de sa dialectique les opinions courantes, aussi dédaigneux des high-churchmen que des evangelicals, il prétendait réagir contre ce que la religion avait alors de superficiel et de routinier, pressait chacun de mettre ses croyances en question, d’en décider par sa propre raison, et répudiait, en cette matière, toute autorité du dehors, fût-ce celle de l’Eglise ou de la tradition. Sous sa plume, les Pères n’étaient plus que « certains vieux théologiens », et il avouait se sentir, à première vue, bien disposé pour un hérétique, parce qu’il voyait en lui un homme qui pensait par lui-même. Non qu’il fût tenté, pour son compte, de sortir de son Eglise, mais il réservait à chacun le droit de reviser les symboles de cette Eglise et d’en écarter, comme secondaires, les croyances qui offusquaient sa raison. Avec lui, la partie dogmatique de la religion était au moins « minimisée »; si bien qu’on a pu appli-
1. Le titre de fellow était une sorte de bénéfice conféré, après un concours jugé par les fellows en exercice. à l’élite des gradés de chaque collège. Le plus souvent, les fellows résidaient dans le collège. A cette époque encore, le mariage faisait perdre le titre de fellow.
8 quer à sa façon de traiter la doctrine anglicane, la phrase de Tacite : Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant. Ses idées trouvaient faveur dans les commonrooms des collèges d’Oxford, et ce n’est pas la moindre preuve de son influence que d’avoir eu, pendant plusieurs années, pour disciple, le jeune Newman. Thomas Arnold, aussi fellow d’Oriel, appartenait à la même école que Whately, mais avec de plus hautes préoccupations morales; il lui était supérieur moins parla science et le talent que par le caractère. En 1827, il était nommé head-master de l’école de Rugby, qui, avec celles d’Eton, de Harrow et de Winchester, préparait la jeunesse des classes riches aux universités d’Oxford et de Cambridge. Dans ces écoles, les moeurs étaient alors fort brutales et dépravées; la religion s’y réduisait à un formalisme vide et méprisé. Arnold, qui avait trente-deux ans et venait de recevoir les ordres, donna le signal d’une grande réforme; il ne s’attacha pas seulement à rétablir la discipline extérieure; il prétendit agir sur les âmes, par son exemple, ses enseignements, son action personnelle; il proposa à la jeunesse un idéal élevé, fit appel à son honneur, s’appliqua à éveiller en elle un sentiment religieux assez profond pour être la règle de ses actes et de ses pensées. L’entreprise était haute; malgré les suspicions et les contradictions du début, il obtint d’importants résultats. Les jeunes gens qui passaient par ses mains gardaient sa marque, et, parmi ceux qu’on appelait, à Oxford ou à Cambridge, les Rugby-men, plusieurs y apportaient un sens plus moral de la vie et se piquaient d’être
9
fidèles à la devise que l’un d’eux, le poète A.-H. Cloug, formulait ainsi : Simpler living, higher thinhing. Malheureusement, dans l’oeuvre d’Arnold, si l’action morale fut souvent bienfaisante, les doctrines contenaient le même germe dissolvant que celles de Whately. Passionnément opposé à ce qu’il appelait le sacramentalism et le sacerdotalism, ne regardant guère comme essentiel, en fait de dogmes révélés, que l’incarnation et la Trinité, professant que la piété envers le Christ suffisait à l’orthodoxie, il rêvait de réunir dans l’Eglise établie toutes les sectes protestantes, sans s’inquiéter des diversités, secondaires à ses yeux, de leurs symboles, et il attendait de l’Etat, dont la suprématie religieuse lui paraissait à ce point de vue chose fort heureuse, qu’il accomplît d’autorité cette fusion et imposât cette tolérance ou plutôt cette indifférence réciproque. Arnold et Whately étaient ainsi les initiateurs d’une école où, pourparler plus justement, d’un état d’esprit qui devait avoir une action considérable dans l’anglicanisme contemporain : c’est ce qu’on appellera le Broad Church, dont le dernier mot sera de permettre au doyen Stanley ou au professeur Jowett de demeurer dignitaires de l’Eglise établie, sans bien savoir s’ils croyaient encore à la divinité de Jésus-Christ. Loin de réagir contre le vieux latitudinarisme du XVIIIe siècle, ces « libéraux» travaillaient à le rajeunir, et, au lieu de fortifier la religion, ils en ouvraient la porte à la libre pensée1.
1. Ne peut-on pas citer, comme illustration de cette vérité, l’histoire d’un homme qui fut un des plus brillants amis et, dans une certaine mesure, l’inspirateur de Whately, le révérend Blanco White? Originaire d’Espagne, où il avait été prêtre catholique. Blanco White était venu en Angleterre ; il y avait été bien accueilli et s’était fait ministre anglican. Il était fort goûté pour son esprit, à Oxford, et exerça une réelle influence sur l’école libérale d’Oriel. Il fut alors assez lié avec Newman. Mais bientôt on le vit, par la logique même de ses principes, abandonner ses croyances l’une après l’autre, faire d’abord profession de socinianisme, puis répudier toute foi chrétienne.
10
II
Ne restait-il donc rien, au commencement du siècle, de l’école qui, au contraire du latitudinarisme, avait cherché à conserver dans l’Eglise anglicane le plus possible du dogme et de l’organisation catholiques? N’y avait-il plus trace de la tradition qui remontait à Andrews et à Laud et s’était continuée par les Caroline divines et les non jurors? Sans doute, alors, plusieurs clergymen se piquaient d’appartenir au High Church : mais cette dénomination désignait chez eux des idées plus politiques que religieuses; c’était une forme de torysme; fort en sollicitude pour défendre les privilèges et les revenus de l’Eglise contre les menaces de réforme qui étaient plus ou moins dans l’air, ils ne s’inquiétaient guère des doctrines et eussent été fort embarrassés de dire quelles étaient les leurs-; secs, hautains, peu accessibles aux petits et aux pauvres, se défendant de toute sensibilité religieuse, disposés à prendre en mauvaise part l’enthousiasme des méthodistes et l’onction des evangelicals, ils étaient peu populaires, et on les qualifiait volontiers de high and dry. Il eût
11
fallu bien chercher, pour trouver, ici ou là. quelques familles où, de génération en génération, s’était transmise, dans une sorte de mystère, la doctrine des non jurors 1. Parfois, quelque chose en apparaissait, plus ou moins atténué, dans l’enseignement de certains théologiens; mais l’action n’en était pas étendue. Ce ne fut pas un livre de théologie qui contribua alors le plus efficacement à ramener les anglicans vers ces conceptions religieuses si oubliées, ce fut un volume de vers. L’auteur en était un curé de village. Né en 1792 d’une famille d’ecclésiastiques où l’on gardait pieusement les traditions des non jurors, John Keble s’était acquis, tout jeune, un grand renom à Oxford. Fellow d’Oriel, avec Whately et Arnold, il semblait appelé à la plus brillante carrière universitaire. Mais on le voit bientôt s’y dérober, comme s’il redoutait la tentation des vanités intellectuelles, et il va s’enfermer dans un presbytère de campagne. D’une piété qui semble le garder en la présence continuelle de Dieu, mortifié, jeûnant tous les vendredis, il est avec cela d’une candeur d’enfant, jouit de tout ce qui est bon et
1. Newman parle dans une de ses lettres (Letters and Correspondence, t. II, p. 435) d’un révérend Fortescue, qui appartenait à une famille non juring, et qui, dès son enfance, avait été élevé secrètement dans les idées et les pratiques de cette école; il avait été ainsi habitué à la confession. — Un autre converti, M. Kegan Paul, raconte que, dans son jeune âge, il avait connu à Bath des personnes qui avaient conservé les principes High Church du temps de la reine Anne; elles s’imposaient notamment des mortifications durant le carême. « Un vieux médecin, très bon pour nous autres enfants, ajoute le narrateur, renonçait pendant ce temps à priser, et c’était la seule époque de l’année où nous pussions l’approcher sans éternuer. » (Confessio viatoris, dans le Month d’août 1891.)
12
beau, aime tendrement les siens, sent vivement leurs joies et leurs peines. Pusey a dit de lui: « Il avait une élévation morale que je n’ai connue chez nul autre. » Il était resté fidèle aux idées de sa première éducation, très High Church, mais nullement dry; toutefois, s’il s’attristait de voir ces idées méconnues, il ne songeait à entreprendre une campagne pour les répandre; il se renfermait dans les devoirs de son ministère pastoral et, en dehors de l’Université qui se souvenait -de ses succès classiques, il demeurait ignoré du public. Dès 4819, il a pris l’habitude d’épancher les sentiments qui débordent de son âme, en composant de courtes hymnes; c’est comme un encens qu’il aime à faire monter vers le ciel. Peu à peu, son recueil s’étend, et il se trouve bientôt avoir écrit des cantiques pour chaque dimanche et chaque fête, ainsi que pour les principaux actes de la vie chrétienne. Les livrer au public, il n’y songe’ pas : cela lui ferait l’effet de trahir un secret qui doit rester entre son âme et Dieu. Des amis, cependant, qui ont eu connaissance de ces petits poèmes, ne se résignent pas à les voir demeurer sous le boisseau: ils font à Keble un devoir de les imprimer. Celui-ci résiste longtemps; il finit par céder aux instances de son vieux père, qui demande à voir cette publication avant sa mort. Le livre paraît en 1827, sans signature, sous ce titre: The Christian Year. Contrairement à l’attente de l’auteur, le succès est tout de suite très grand, et le recueil se répand dans toutes les mains. Chacun est saisi et charmé de cet accent nouveau qui contraste avec le formalisme froid et vide de la littérature ecclé-
13
siastique d’alors. A la musique de ces vers, des émotions, depuis longtemps endormies, se réveillent dans les âmes. Ce ne sont pas seulement les lettrés qui goûtent l’inspiration délicate et fraîche d’un poète né, qui apprécient l’habileté d’un scholar nourri des vers antiques et modernes; les humbles, les ignorants sont touchés. Avant d’être une oeuvre d’art, ces hymnes sont l’expression de sentiments personnels, très vrais, très profonds : on y sent une pureté de coeur exquise, une piété méditative et tendre, l’amour et la crainte de Dieu, la douleur du péché; le Christ n’y est plus une abstraction, mais un ami vivant; la nature y est sentie comme on pouvait l’attendre d’un contemporain et d’un admirateur de Wordsworth, mais elle est le voile brûlant derrière lequel le Créateur parle à l’âme, et, à chaque page, il y a comme des coups d’ailes pour s’élever par toutes les choses visibles vers la beauté infinie 1. Pour n’être en rien didactiques et dogmatiques, ces hymnes ne s’en trouvaient pas moins servir plus effi-
1. Newman a dit du Christian Year : « S’il est possible de trouver des poèmes pour relever dans l’abattement, pour réconforter dans l’angoisse, pour retenir ceux qui s’emportent, pour rafraîchir ceux qui sont las, pour en imposer aux mondains, pour inspirer la résignation aux impatients, le calme aux effrayés et aux agités, ce sont bien ceux-ci. » (Essays, II, p. 441.) Et Pusey: « C’était un enseignement efficace, parce que l’âme de l’auteur était remuée à une grande profondeur; le courant débordait, parce que le coeur d’où il jaillissait était plein; c’était frais, profond, tendre, aimant, parce que lui-même était ainsi. Des secrets inconnus étaient dévoilés aux âmes, et celles-ci ne manquaient pas de se les approprier, parce que lui-même était vrai et pensait tout haut; partout la conscience répondait à la voix de la conscience. » (Sermon at Keble College, 1876.)
14
cacement que bien des prédications et des controverses, les idées High Church. Inspirées des doctrines de l’auteur sur la dignité et l’autorité de l’Eglise, sur le sérieux des croyances, sur les mystères de la foi, sur la sainteté du culte, sur la grâce des sacrements, sur la communion des saints, elles suscitaient une piété qui supposait ces doctrines ou y conduisait; elles créaient, presque sans qu’on s’en doutât et, par suite, sans qu’on s’en méfiât, un état d’âme qui préparait le retour à un christianisme moins incomplet et plus vivant. La tristesse avec laquelle l’état de la religion y était souvent déploré, concourait à faire sentir la nécessité d’une telle transformation, et l’on pouvait entrevoir, presque à chaque page, l’idéal, trop longtemps oublié, auquel le poète désirait si ardemment voir revenir son Eglise. Dans le succès inattendu de ce livre, John Keble ne vit pas une raison de sortir de sa réserve et de se faire le leader d’une évolution religieuse. Pas plus après qu’avant, il ne se croyait destiné à un premier rôle et apte à le tenir. Mais, s’il ne cherchait pas à agir sur le public, son autorité grandissait sur ceux qui l’approchaient, particulièrement sur les quelques jeunes hommes qui aimaient à se dire ses disciples. « Entre nous, a dit l’un d’eux, le nom de Keble coupait court à toute argumentation, tant instinctivement nous reconnaissions son autorité. » Autorité pleine de tendresse, de bonne grâce, qui était faite surtout du prestige de sa vertu. Le plus cher de ces disciples était Richard Hurrell
14
Froude. Né en 1803, fils d’un archidiacre 1, élevé dans les traditions High Church, il avait été, dès 1821, pupille de Keble à Oxford, et l’avait suivi, en 1823, dans sa cure de campagne, pour y compléter, sous sa direction, la préparation de ses examens universitaires. Jeune, il avait, aux yeux de ses camarades, un prestige singulier; tout y contribuait: des manières nobles, engageantes, une taille élancée, un regard fier, ardent et clair, ce je ne sais quoi d’accompli que donne à la beauté d’un jeune homme, l’entière pureté du coeur, une nature vaillante, généreuse, impétueuse, prompte à s’enthousiasmer pour tout ce qui est beau, à détester et à mépriser ce qui lui paraît bas et faux, un esprit hardi, incisif, original, un entrain plein de belle humeur pour tous les exercices du sport. Ajoutez des qualités plus précieuses encore, qui ne devaient être tout à fait révélées qu’après sa mort, par la publication de son journal intime 2 : une âme en recherche anxieuse de la sainteté, constamment occupée à s’examiner devant Dieu avec une sévérité impitoyable, à s’humilier de ses péchés, à les expier par la pénitence, à les combattre par la mortification, tout un ascétisme inconnu, à cette époque, dans l’anglicanisme. A la vérité, dans cet ascétisme, Froude manquait de direction, et par suite de mesure: de là, trop souvent, au lieu de la paix
1. Hurrell Froude eut deux frères : l’un, William, fut un ingénieur éminent, l’autre, James Anthony, fut historien; aucun des deux ne partagea ses idées religieuses. 2. Remains of the late R.-H. Froude, publiés en 1838 et 1839, par Newman et Keble. J’aurai à reparler plus tard de cette publication.
16 et de la lumière auxquelles il aspirait et que sa bonne volonté semblait mériter, un état de trouble, de langueur, de mélancolie qui a pu le faire comparer à Pascal et même à Hamlet 1. Si indompté qu’il fût par nature, Froude s’était soumis, avec une filiale déférence, à la tutelle de Keble, qu’il aimait et vénérait. II acceptait ses idées sur l’Eglise et la religion d’autant plus facilement qu’elles concordaient avec les traditions dans lesquelles il avait été élevé. Disciple très dévoué, mais d’une espèce particulière, il se trouvait réagir sur son maître plus encore qu’il n’en avait subi l’influence; avec la rigueur et la hardiesse de son esprit, il le poussait à préciser, à compléter ses principes dans une direction plus catholique; et surtout son impétuosité refusait de se renfermer dans la réserve contemplative du poète, de Christian Year: il prétendait tirer toutes les conséquences des principes posés. Elu , fellow d’Oriel en 1826, il quitta le presbytère de Keble pour s’établir à Oxford, et se fit alors, dans la jeunesse de l’Université, le propagateur des idées de son maître, ou plutôt de ce que ces idées devenaient en passant par son cerveau et en s’échauffant au feu des controverses qu’il aimait à engager. Loin de craindre d’effaroucher ses interlocuteurs, il y prenait plaisir, donnait volontiers à ses thèses le tour le plus extrême, le plus provocant, le plus agressif, mettait
1. Ces comparaisons sont du doyen Church, The Oxford Movement, p. 55 et 56. Cf. aussi Life and letters of Dean Church, p. 315.
17
une sorte de vaillante coquetterie à s’affubler lui-même des étiquettes impopulaires, se faisait scrupule du moindre tempérament comme d’une lâcheté avec tant de belle humeur, tant de sincérité et de générosité d’accent, un si manifeste amour des âmes, une telle recherche du bien, qua, malgré tout, ses auditeurs étaient généralement plus attirés que rebutés. Longtemps après, ceux qui l’avaient alors approché conservaient le souvenir de l’étonnante fascination qui émanait de lui. Nul n’était donc plus fait pour mettre les esprits en branle; il n’avait pas au même degré ce qu’il fallait pour les guider. Il était un puissant excitateur, non un chef. Ce chef qu’il ne pouvait être, il contribua du moins à le découvrir et à le gagner à ses idées: c’était un tutor 2 du collège d’Oriel que Froude avait trouvé en fonctions et déjà en possession d’une certaine renommée au moment où lui-même avait été élu fellow du même collège; il avait deux ans de plus que lui et s’appelait John Henry Newman.
III
Rien dans le passé de Newman ne semblait l’avoir préparé à servir les mêmes idées que Froude. Né en 1801, fils d’un banquier de Londres3, il avait reçu de sa mère, qui descendait de huguenots français, une
1. Froude disait: « If I do not express my self as strongly as this, I shall be a coward. » 2 Le tutor, choisi parmi les fellows, faisait auprès des étudiants l’office d’un répétiteur. 3. La banque de M. Newman croula dans la crise de 1815.
18
éducation religieuse tout imprégnée de calvinisme. Ces premières impressions avaient été confirmées, vers l’âge de quinze ans, par une sorte de crise intérieure où il crut avoir le sentiment de sa conversion et de sa prédestination à la gloire éternelle, et ensuite par la lecture des théologiens de l’école evangelical. Plein de préventions contre le catholicisme, il croyait fermement que le Pape était l’Antechrist prédit par Daniel, saint Paul et saint Jean; telle était sa passion d’écolier protestant qu’il avait effacé, dans son Gradus ad Parnassum, les épithètes qui accompagnaient le mot Pape, comme vicarius Christi, sacer interpres, et les avait remplacées par des qualifications injurieuses. Et cependant, par une contradiction mystérieuse, dès l’âge de quinze ans, une pensée, fort discordante avec son protestantisme, s’emparait de lui : c’est que Dieu voulait qu’il vécût dans le célibat 1. Écolier précoce, il a seize ans à peine, quand, en décembre 1816, il est admis dans Trinity college, à Oxford. Il s’y montre ardent travailleur, souvent aux dépens de sa santé, qui était délicate, et prend peu de part aux sports en honneur dans la jeunesse anglaise 2;
1. Apologia. — Un biographe très protestant et peu bienveillant de Newman, Abbott, voit dans cette vocation au célibat une des causes de sa « perversion ». « Bacon, ajoute-t-il, appelle une femme et des enfants a discipline of humanity; mais, pour quelques-uns, ils sont aussi a discipline of theology. Certainement, quand l’heure arriva pour Keble de décider s’il irait à Rome avec Newman ou s’il se séparerait de lui pour toujours, ses lettres révèlent que le mariage ne fut pas pour peu dans la décision qui le sépara de son ami. » (The anglican career of cardinal Newman, t. I, p. 20.) 2. Plus tard cependant, pour rétablir sa santé compromise, Newman se livra passagèrement à quelques exercices de corps. Ainsi le voit-on, à vingt-sept ans, quand il commence à devenir un personnage, apprendre à sauter. Il écrit, dans une lettre du 1er avril 1828: « I take most vigorous exercise which does me much good. I have learned to leap (to a certain point), which is a larking thing for a don. The exhilaration of going quickly through the air is for my spirits very good. » (Letters and Correspondence of J-H. Newman, t. I, p. 182.)
19
lecteur dévorant, curieux de toutes les connaissances, il étudie l’histoire en même temps qu’il fait des excursions dans les langues orientales, mène de front la poésie et les mathématiques. Il est vêtu simplement, parfois même avec quelque négligence. Ses goûts sont austères, et certains côtés grossiers de la vie d’étudiant, entre autres les séances de boisson alors fort en usage, le dégoûtent 1. Grand amateur de musique, l’une de ses plus chères distractions est de jouer du violon. Il a peu d’amis, demeure assez isolé, timide, réservé, silencieux. Dès cette époque, il a une vie intérieure intense, s’absorbe volontiers dans la méditation des choses invisibles, cherche, avec ardeur et avec angoisse, à faire le bien et à connaître le vrai. Il souffre des obscurités o,ù il se sent parfois comme enveloppé, et passe alors par des crises de dépression et de découragement; sa mère s’en inquiétait: « Votre faute, lui écrit-elle, est de manquer de confiance en vous-même et d’être mal satisfait de vous 2. » Sur l’emploi à faire de sa vie, il n’a eu que peu d’hésitation : vers dix-huit ans, quelques velléités d’ambition séculière lui traversent un moment l’imagination 3, mais elles ne durent pas, et il se décide pour la carrière ecclésiastique.
1. Letters and Correspondence, t. I, p. 36, 38. 2. ibid., t. I, p. 58. 3. Ibid., t. I, p. 42.
20
Malgré de brillants débuts universitaires, Newman échoue à l’examen final pour les « honneurs ». Loin d’en être abattu, il prend aussitôt le parti de concourir pour le poste alors le plus envié et le plus disputé à Oxford, celui de fellow d’Oriel college 1. Quatre mois seulement lui restent pour se préparer aux épreuves qui doivent avoir lieu en avril 1822. Il s’y met avec une ardeur et aussi une anxiété dont il est le premier à s’étonner et à se faire reproche; il se rappelle à lui-même comment, un an auparavant, il désirait plutôt voir écarter tout événement qui lui eût donné quelque renom, puis il ajoute : « Hélas! combien je suis changé! Je suis perpétuellement à prier pour mon entrée à Oriel... O Seigneur! dispose de moi, comme il vaudra le mieux pour ta gloire; mais accorde-moi la résignation et le contentement. » Il sort victorieux du concours : les juges, préoccupés de réagir contre la routine formaliste des examens, ont compris que, si Newman était moins bon classical scholar que certains de ses concurrents, il leur était au fond bien supérieur. Quand on vint lui annoncer son succès, il jouait du violon dans sa chambre : il laisse aussitôt son instrument, descend quatre à quatre l’escalier et court à Oriel, où il reçoit les cordiales félicitations des hommes déjà célèbres dont il devenait le collègue, tout abasourdi de les entendre l’appeler familièrement Newman
1 Mark Pattison a écrit dans ses Mémoires, p. 103, en faisant allusion à une époque postérieure seulement de quelques années: « We all thought a fellow of Oriel a person or miraculous intellect, only because ha was one. »
21
et d’être invité à les appeler de même par leurs noms 1. Ce succès ne suffit pas à triompher de la timidité de Newman: bien au contraire, elle s’augmente du sentiment qu’il a de répondre si mal aux avances qui lui sont faites. En le voyant, au milieu des brillantes conversations du common room, embarrassé, silencieux ou bredouillant, ceux qui l’ont choisi se demandent s’ils ne se sont pas trompés sur son mérite. Ils ont alors l’idée de le mettre en rapports avec leur ancien collègue, Whately, qui venait de résigner son fellowship pour se marier : avec ce qu’on connaissait à celui-ci de mouvement et de chaleur dans l’esprit, peut-être aurait-il raison de ce qui semblait être l’inertie et la froideur du nouvel élu. L’épreuve réussit. Whately était un de ces causeurs qui ont tant à dire qu’il leur suffit d’être écouté. Et puis, bien qu’ayant quinze ans de plus que le jeune Newman, il sait le mettre à l’aise par la liberté de ses manières, le pique au jeu par l’originalité de ses idées et par le tour saisissant qu’il leur donne. Ainsi l’amène-t-il peu à peu à sortir de sa réserve et à révéler sa valeur. Bientôt il le proclame l’esprit le plus net qu’il connaisse, tho clearest headed man he hnew, prend plaisir à se faire accompagner par lui dans toutes ses promenades et recourt à sa collaboration pour les ouvrages qu’il est en train de composer. De son côté, Newman se sent beaucoup de reconnaissance pour celui qui l’a aidé à sortir d’une fausse position; il lui sait gré de sa cordia-
1. Lett. and Corr., t. I, p. 38 à 74
22
lité; il goûte son esprit, alors même qu’il est effarouché de quelques-unes de ses idées et de l’âpreté avec laquelle il les soutient; il le compare, dans ce cas, « à un brillant soleil de juin tempéré par un nord-est de mars ». Quelques années après, il écrira à Whately : «A nul je ne dois autant qu’à vous: c’est vous qui m’avez donné coeur à regarder autour de moi après mon élection. » Et, plus tard, quand la divergence des idées aura amené une rupture complète et plus d’un mauvais procédé de la part de Whately, Newman tiendra encore à exprimer sa gratitude : « Je lui dois beaucoup, écrira-t-il; quand, en 1822, j’étais encore gauche et timide, il me prit par la main et fut pour moi un maître doux et encourageant. Par lui, mon esprit fut ouvert, dans toute la force du mot. 1 » Whately a pu vite rassurer ses amis d’Oriel sur leur choix; ils en jugent d’ailleurs par eux-mêmes et ne tardent pas à priser fort leur recrue. C’est le cas, entre autres, du Dr Hawkins, avec lequel Newman a alors des relations particulièrement intimes. Esprit exact, fort indépendant, habitué aux libres et hardies spéculations en honneur à Oriel, mais droit, probe, tolérant, il est plus dégagé des préoccupations mondaines qu il a arrive souvent aux hommes de grand renom intellectuel. A l’âge qu’avait Newman, sans convictions encore bien personnelles, il ne pouvait vivre plusieurs années dans la société de tels hommes et respirer une atmo-
1. Lett. and Corr., t. I, p. 104 à 109, et Apologia.
23
sphère comme celle du common room d’Oriel, sans que ses idées s’en ressentissent. Ce qu’il apprit tout d’abord de ses nouveaux maîtres, ce fut, nous a-t-il dit, « à penser par soi-même, à voir par ses yeux et à marcher sans lisière n; il aimait à leur en faire honneur plus tard, alors qu’il s’était servi de cette indépendance pour se séparer d’eux 1. L’influence ne se borna pas là. Son evangeliclism ne tint pas longtemps devant la critique sévère d’Oriel. Mais par quoi allait-il être remplacé? On put croire un moment que, docile à Whately, Newman adopterait son latitudinarisme, et, dans les tâtonnements de sa formation, on discerne à cette époque une phase « libérale ». « La vérité, a-t-il écrit lui-même en rappelant les souvenirs de ce temps, est que j’allais à la dérive vers le libéralisme 2. » Par certains côtés, cependant, il résistait. Très convaincu que le dogme est le fondement premier et nécessaire de la religion, il se sentait en méfiance contre une doctrine qui l’affaiblissait 3. L’attachement que déjà il professait
1. Apologia et Lett. and Corr., t. 1, p. 141. 2. Apologia. — Disons une fois pour toutes que ce mot « libéralisme » avait, dans l’esprit de Newman, un sens particulier; il signifiait le rationalisme antidogmatique, et, comme il l’a défini, « l’erreur par laquelle on soumet au jugement humain ces doctrines révélées qui, par leur nature, le surpassent et en sont indépendantes ». Newman a tenu à bien indiquer qu’il ne se séparait pas ainsi de certains catholiques dont il s’honorait d’être l’ami, notamment de Montalembert et de Lacordaire, qui se proclamaient « libéraux » en employant le mot dans un tout autre sens. (Voir l‘Appendice ajouté par Newman à la traduction qui a paru en France de son Apologia, sous ce titre : Histoire de mes opinions religieuses.) 3. Newman a écrit dans son Apologia: « Même lorsque je me trouvais, sous l’influence du Dr Whately, je ne fus point tenté de laisser refroidir mon zèle pour les grands dogmes de la foi; et, en différentes occasions, je résistai à celles de ses idées dont la tendance, à tort ou à raison, me semblait de nature à les obscurcir. »
24
pour les anciens Pères, l’étude qu’il commençait à en faire 1, lui furent aussi une sauvegarde. Ajoutons qu’avec leur indépendance d’esprit un peu capricieuse les Oriel-men se trouvaient parfois mêler à leurs thèses libérales, quelques autres à tendance catholique; c’étaient celles auxquelles Newman s’attachait de préférence et qu’il retenait le mieux. Ainsi nous a-t-il raconté comment il avait appris d’Hawkins qu’on ne pouvait pas trouver dans la seule Bible toute la vérité religieuse et qu’il était nécessaire de recourir à la tradition; de William James, autre personnage considérable d’Oriel, la doctrine alors fort oubliée de la succession apostolique; enfin, de Whately lui-même, la notion, absolument contraire à l’érastianisme anglican, d’une Église instituée de Dieu, formant un corps visible, indépendante de l’État, ayant ses droits et ses pouvoirs propres. Parmi les amis « libéraux» du jeune fellow, il en était auxquels n’échappait pas cet attrait plus ou moins inconscient qu’il ressentait pour les vérités catholiques. Blanco White, qui le fréquentait à cette époque et qui avait avec lui des séances de violon, interrompues par des conversations théologiques, lui disait sou-vent, en l’entendant soutenir telle ou telle thèse: « Ah! Newman, cela vous conduira à l’erreur catholique 2. »Vers la même époque, amené à s’occuper de l’installation de son jeune frère Francis à Oxford, Newman
1. Lettres and Corr., I, p. 127. 2. Abbott, The anglican career of Card Newman, t. I p 72
25
plaçait dans sa chambre une gravure représentant la Vierge; et, aux plaintes de son frère, il répondait en s’élevant vivement contre les protestants qui oubliaient cette parole sacrée: « Vous êtes bénie entre toutes les femmes 1. » Les enseignements que recevait alors Newman n’étaient pas, du reste, exclusivement « libéraux ». De 1822 à 1824, il se trouva suivre les conférences privées qu’un professor regius de théologie, le Dr Lloyd, faisait à quelques candidats aux ordres. Lloyd, qui devait être promu évêque d’Oxford en 1827, était un des rares tenants des vieilles doctrines High Church; sur divers points, il cherchait à ramener ses élèves à des vues plus catholiques; les relations qu’il avait eues, pendant sa jeunesse, avec des prêtres français émigrés. l’avaient délivré de plusieurs des préjugés protestants. Il serait difficile de préciser dans quelle mesure Newman a pu subir l’influence d’un maître qu’il respectait, mais qui était loin d’avoir à ses yeux le prestige intellectuel de Whately. Les autres auditeurs des conférences étaient généralement de la même école que Lloyd; Hurrell Froude était du nombre. Comment Newman, d’origine si différente, avait-il été mêlé à eux? Lloyd le traitait, en plaisantant, de perverse evangelical, et, quand il l’interrogeait, faisait le geste de se bouclier les oreilles, comme s’il craignait d’entendre quelque réponse hérétique. Cela ne l’empêchait pas, il est vrai, de s’intéresser à cet élève un peu suspect, de
1. Le fait a été rapporté par Francis Newman.
26
rendre justice à son mérite, de parler de lui favorablement et de l’aider à prendre confiance en soi. Newman lui en était reconnaissant. Plus tard, à la mort de Lloyd, il évoquait ces souvenirs avec émotion : « Je désire, écrivait-il, qu’il se soit toujours aperçu combien je sentais sa bonté 1. » Parmi les assistants aux conférences du Dr Lloyd, le seul avec lequel Newman paraît avoir eu, dès cette époque, des relations intimes, est un personnage qui tiendra une place considérable dans l’histoire que j’entreprends de raconter, Edward Bouverie Pusey. Plus âgé d’un an que Newman, il a été nommé, un an après lui, fellow d’Oriel. Il était d’une famille bien posée; son père, tory inflexible, détestait également et confondait quelque peu les whigs et les athées; de sa mère, croyante et pieuse, il tenait ses convictions et ses habitudes religieuses, entre autres, une grande dévotion au Prayer Book et une foi, alors assez rare, en la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie. Ecolier consciencieux, plus travailleur que brillant, fort modeste et ne se croyant pas appelé au premier rang, il avait cependant obtenu, dans ses études, d’honorables succès, que couronna son élection à Oriel. Quand il y arriva, il n’était inféodé proprement à aucun parti religieux, à aucune école théologique, bien que plutôt incliné, par souvenir de l’éducation maternelle, vers les principes High Church. Ce qui le distinguait, c’était une piété sérieuse et douce, la préoccupation
1. Lett. and. Corr., t. I, p. 209.
27
constante des choses divines, un grand zèle pour les à mes, beaucoup de pureté et d’austérité, avec je ne sais quoi de candide et d’un peu naïf. C’est par là qu’il se trouvait rapproché de Newman. A peine celui-ci l’entrevoit-il dans la salle d’Oriel qu’il pressent en lui lin homme de Dieu, étranger au monde; seulement l’evangelical teinté de libéralisme qu’il est alors s’inquiète des idées de Pusey, et il se demande si l’on peut espérer le voir venir « dans la vraie Eglise» Plus il le fréquente, plus sa sympathie et son estime augmentent. Après les conversations qu’il a avec lui dans plusieurs promenades et qui, toutes, ont porté sur des sujets religieux, il s’en veut de s’être arrêté aux divergences d’école qui pouvaient exister entre eux, et il écrit sur son journal : «Que Pusey soit tien, ô Seigneur, comment puis-je en douter?... Tout en lui témoigne de l’opération du Saint-Esprit. Cependant je crains qu’il n’ait des préjugés contre tes enfants. Puissé-je ne jamais m’attacher à le convertir à un parti ou à une forme d’opinion! Conduis-nous tous deux dans la voie de tes commandements. Qui suis-je pour être ainsi béni dans ceux qui sont associés de plus près à ma vie! »Et tin peu plus tard, après une nouvelle conversation et des confidences dont il ne nous révèle pas le secret, il ajoute : «Oh! de quels mots me servir! Mon coeur est plein. Combien je devrais m’humilier jusque dans la poussière! Quelle idée puis-je me faire de mon importance! Mes actes, mes capacités, mes écrits! Au lieu que lui est l’humilité même, et la bonté, et l’amour, et le zèle, et le dévouement. O Dieu! bénis-le, en le
28
comblant de tes dons, et accorde-moi de l’imiter 1. »A peine cette pieuse intimité avait-elle commencé à se nouer que le départ de Pusey pour l’Allemagne vint l’interrompre. Sur le conseil de Lloyd, il avait décidé d’aller étudier sur place la critique biblique d’outre-Rhin, dont il pressentait l’invasion prochaine en Angleterre. A deux reprises, en 1825 d’abord, ensuite en 1826 et 1827, il fit d’assez longs séjours à Göttingen. Newman regretta vivement l’éloignement de son ami : c Il partit, a-t-il écrit plus tard, au moment où j’apprenais à le bien connaître 2. » Par suite de ces voyages en Allemagne, Pusey fut amené à retarder son ordination à laquelle il aspirait depuis l’enfance. Newman n’avait pas les mêmes raisons d’attendre : il reçut les ordres en 1824, dans des sentiments de grande piété et avec une haute idée du ministère qu’il allait remplir. Une heure après avoir été ordonné diacre, il écrivait : « C’est fini. Au premier moment, après que les mains me furent imposées, mon coeur frissonna au-dedans de moi. Les mots pour toujours » sont si terribles! » Et le jour suivant : « Pour toujours! mots sur lesquels on na pourra jamais revenir. J’ai la responsabilité des âmes sur moi, jusqu’au jour de ma mort. » Il sentait que c’était renoncer absolument à toute ambition séculière, et son rêve était de finir comme missionnaire dans quelque pays lointain 3. Il ne voulait même pas chercher la consolation
1. Lett. and Corr., t. I, p. 116, 118. 2. Apologia. 3. Lett. and Corr., t. I, p. 149 à 150.
29
intérieure. «La grande fin, disait-il, c’est la sainteté. Il doit y avoir ici-bas combat et peine. La consolation est un cordial, mais personne ne boit des cordiaux du matin au soir. 1» Pus que jamais, il était poursuivi par son idée de célibat; en revenant de l’enterrement de son père, le 6 octobre 1824, il écrivait dans ses notes intimes : « Quand je mourrai, serai-je conduit au tombeau par mes enfants? Ma mère disait, l’autre jour, qu’elle espérait vivre assez pour me voir marié; mais je pense que je mourrai soit dans les murs d’un collège 2, soit comme missionnaire sur une terre étrangère. Peu importe, pourvu que je meure dans le Christ 3. » Aussitôt ordonné, Newman fut nommé curate 4 de Saint-Clément, l’une des paroisses d’Oxford il se donna avec zèle a ses devoirs pastoraux. L’année suivante, en 1825, Whately, appelé à la tête de l’un des collèges d’Oxford, Alban Hall, le choisit pour vice-principal Ainsi sortait-il peu a peu de son obscurité. Un nouveau pas, plus considérable, fut sa nomination, en 1826, à l’un des quatre postes de tutor dans le collège d’Oriel, position qui lui donnait la direction intellectuelle et-, dans une certaine mesure, morale des undergraduates.
1. Lett. and Corr., t. I, p. 87. 2. A cette époque, par un reste de la vieille organisation catholique, les bénéfices des collèges ne pouvaient être gardés que par ceux qui restaient dans le célibat: 3. Lett. and Corr., t. I, p.91. « Rappelons, une fois pour toutes, que, dans l’Église d’Angleterre, c’est le vicar qui est ce que nous appellerions en France le curé, tandis que celui qui remplit les fonctions de vicaire se nomme curate.
30
IV
L’année 1826 est une date dans la formation de Newman: sa situation et sa manière d’être subissent alors un changement que lui-même a ainsi noté, en évoquant plus tard ses souvenirs : « Durant les premières années de ma résidence à Oriel, bien que fier de mon collège, je ne m’y trouvais point chez moi; je vivais très isolé, et souvent je faisais seul ma promenade de chaque jour... Mais en 1826, les choses changèrent. Je devins alors un des tutors de mon collège, et cela me donna une position. En outre, j’avais écrit un ou deux essais qui avaient été bien accueillis: Je commençai à être connu... C’était pour moi le souffle du printemps succédant à l’hiver, et, si je puis m’exprimer ainsi, je sortais de ma coquille. A dater de ce moment, ma langue fut déliée, pour ainsi dire, et je parlai spontanément et sans effort... De ce temps data mon influence 1. » Et cependant, à voir passer alors, dans les rues d’Oxford, ce jeune clergyman très simple d’allure, revêtu d’un habit à longue queue souvent assez usé, le corps incliné, mince, pâle, avec de larges yeux brillants, l’air un peu frêle et maladif, marchant généralement assez vite, absorbé dans sa méditation ou dans une conversation avec quelque compagnon, un étranger n’aurait pas deviné l’importance qu’il était en train d’acquérir; il eût pu surtout douter qu’un tel homme fût armé pour un rude combat et de force à
1. Apologia.
31
porter de lourdes responsabilités. Lui-même, que pensait-il de son avenir? Quand il s’interrogeait sur ce point avec sa sincérité habituelle, il ne savait pas bien que répondre. Sans doute, il lui arrivait, à la vue des charges pesantes qu’impose le succès, de souhaiter n’avoir jamais qu’une « petite cure de 200 livres, sans ce que le monde appelle l’avancement» Mais il ajoutait aussitôt: «Vous savez que, dans ce désir, il y a une bonne part de paresse, et je crois que je n’aurai pas cette obscurité, parce que je la désire. Et puis, voyez, je parle du comfort de la retraite... Combien de temps pourrais-je le supporter, s’il m’était donné? Je ne me connais pas moi-même 1. » Et un autre jour: « Il est une chose que j’ai depuis longtemps ardemment désirée, en toute sincérité, je crois, c’est de ne devenir jamais riche; et j’ajouterai (bien qu’ici je sois plus sincère à de certains moments qu’à d’autres), de ne jamais m’élever dans l’Eglise. Les hommes les plus utiles n’ont pas été ceux qui sont arrivés aux plus hautes positions 2 » Evidemment, dans cette âme qui fut toujours singulièrement complexe, il y avait conflit entre le désir très humain d’user des dons rares dont il se savait en possession, et la répugnance qu’inspiraient à sa nature délicate et sensitive les risques des hautes situations; il y avait surtout conflit entre une humilité chrétienne très vraie et je ne sais quel sentiment mystérieux qu’il était appelé à exercer une action sur la vie religieuse de son pays.
1. Lett, and Corr., t. I, p. 197. 2. Ibid., p. 231.
32
Newman prit très au sérieux ses fonctions de luter. La renommée même du collège d’Oriel avait fini par y attirer des éléments plus mondains que travailleurs; les études et la discipline en souffraient; Newman s’appliqua à les restaurer. Sa sollicitude ne s’arrêtait pas là; il se sentait charge d’âmes. « Puissé-je, disait-il, me souvenir que je suis un ministre du Christ, que j’ai mission de prêcher l’Evangile ; puissé-je ne pas oublier le prix des âmes, et que j’aurai à répondre de toutes les occasions qui m’auront été données de faire du bien à celles qui sont sous ma garde 1! » Il n’était pas en fonction depuis un mois qu’il écrivait sur son journal: Il y a beaucoup de choses défectueuses dans le régime actuel; j’estime que les tutors voient trop peu de choses des hommes qui leur sont confiés, et qu’il n’y a pas assez d’instruction religieuse directe. C’est mon désir de me considérer comme le ministre du Christ. Si je ne trouve pas occasion de faire du bien spirituel à ceux sur lesquels j’ai autorité, ce sera une grave question pour moi de savoir si je dois rester tutor 2. » En 1828, un terrain plus large encore s’ouvrit au zèle apostolique de Newman. Tout en conservant ses fonctions de tutor à Oriel, il fut appelé à l’important vicarage de Sainte-Marie, l’église de l’Université. Il y prit possession de cette chaire qui devait être sienne pendant quinze années, et commença à y faire entendre la parole d’un accent si nouveau et si pénétrant qui a réveillé la conscience endormie de l’Angleterre. 3»
1. Apologia. 2. Lett. and Corr., t. I, p. 150 à 151.
33
Sans s’étendre encore au dehors, la réputation de Newman grandissait à Oxford. Il y devenait un centre. Dans une pièce de vers de cette époque, où, suivant l’usage de toute sa vie, le poète qui était en lui se plaisait à épancher ses sentiments intimes, il indiquait, au nombre des bienfaits dont il remerciait le Seigneur, la bénédiction des amis venus à sa porte, sans avoir été demandés ni espérés 1 ». Du nombre étaient deux de ses pupilles d’alors qui lui resteront étroitement attachés, Fréderick Rogers qui s’appellera plus tard lord Blachford, et Henri Wilberforce, le plus jeune fils du célèbre philanthrope, nature ardente, primesautière, qui, suivant l’expression de son frère Samuel, avait voué à Newman « une sorte de vénération idolâtrique; tel encore, à un moindre degré, le jeune Gladstone, qui était entré, en 4826, comme étudiant à Christ-Church. Avec ces jeunes gens, Newman était charmant d’aimable familiarité, d’affectueuse sollicitude, s’intéressant à leurs études, les dirigeant dans leur vie morale. «Votre bonté à mon égard, lui écrivait Henry Wilberforce en 1827, a été, je puis le dire sans exagération, celle d’un frère aîné 2.» C’est que, chez Newman, sous des apparences au premier moment un peu réservées, le coeur était singulièrement chaud et tendre. Sa mère, aux jours d’épreuve, avait habitude de s’appuyer avec confiance sur « son cher John Henry ». « Il est comme toujours, écrivait-elle en 1827, mon ange gardien 3. »
1. Apologie. 2. Lett. and Corp., t. l, p. 166. 3. Ibid., p. 170. Mrs Newman ne devait pas suivre son fils dans le Mouvement. Après l’avoir perdue, en 1836, Newman laissait voir, dans une lettre à sa soeur, combien il avait souffert de cette séparation morale.
34
En janvier 1828, une mort soudaine enlève l’une des soeurs de Newman, la charmante Marie. La figure de la morte demeure présente à son coeur endolori. Quelques mois après, en mai, racontant, dans une lettre à une autre de ses soeurs, une promenade aux environs d’Oxford, et comment il y a goûté, « la beauté de la campagne, la fraîcheur des feuilles, les senteurs, les points de vue variés », il ajoute: « Cependant je ne sens jamais si fortement la nature transitoire de ce monde que quand je suis le plus charmé par ces paysages. »Et après avoir cité deux vers de Keble : « Je voudrais qu’il fût possible aux mots d’exprimer ces sentiments indéfinis, vagues et en même temps subtils, qui transpercent entièrement l’âme et la rendent malade. Chère Marie semble incorporée dans chaque arbre, se cache derrière chaque colline. Quel voile, quel rideau est vraiment ce monde! Un beau voile, sans doute, mais un voile1 ».Un peu plus tard, en août, comme il rangeait les lettres reçues depuis deux ans, il reconnaît dans une d’elles la main de sa soeur: « J’en ai été si bouleversé, écrit-il, que j’ai dû les renfermer et m’occuper d’autre chose. Je ne devrais pas parler de cela maintenant, mais comment se retenir 2?» Enfin, dans une lettre du 11 novembre: « Ma promenade du matin est généralement solitaire, mais je préfère presque être seul. Quand l’esprit est en bonne disposition, tout est délice dans le spectacle tranquille de la nature. J’ai appris à aimer les arbres
1. Lett. and Corr., t. 1. p. 184. 2. Ibid., t. I, p. 195.
35
mourants et les prés noircis; les marais ont leur grâce et les brouillards leur douceur. De toutes choses semble sortir une voix solennelle qui chante. Je sais de qui c’est la voix, sa chère voix! Sa figure est, presque toutes les nuits, devant moi, quand j’ai éteint ma lumière et que je me suis couché. N’est-ce pas une bénédiction 1?» C’est ainsi qu’à suivre Newman dans ses heures d’épanchement, quand sa timidité un peu fière et susceptible ne le fait pas se refermer devant les curiosités banales ou malveillantes, on aperçoit en lui une âme aimante et poétiquement mélancolique, ignorée de beaucoup de ceux qui n’ont eu affaire qu’à l’habile controversiste, au subtil théologien ou à l’austère prédicateur.
V
Si grand qu’ait été le changement opéré, après 1826, dans la situation et la manière d’être de Newman, il s’en produit, à cette époque, un plus remarquable encore dans ses conceptions religieuses. C’est alors qu’à la suite de ses premiers tâtonnements entre l’evangelicalism et le latitudinarisine ses idées prennent une direction nouvelle, dans laquelle désormais il ne cessera plus d’avancer. Lui-même a fixé vers 1827 et 1828 le moment où il a commencé, suivant son expression, à «se dégager des ombres du libéralisme », à se rendre compte des conséquences auxquelles le conduisaient les doctrines, au premier abord séduisantes, de Whately,
1. Lett. and Corr., t. I, p. 197.
36
où notamment il s’est aperçu, non sans effroi, qu’il était sur la voie de « mettre la supériorité intellectuelle au-dessus de la supériorité morale 1 ». La mort de sa soeur et les réflexions auxquelles il put se livrer pendant une maladie, aidèrent à cette réaction intime 2. Il eût été à la vérité embarrassé de dire à quel terme devait aboutir le chemin où il s’engageait. Déjà, à cette époque, une sorte d’instinct secret, qui devait persister jusqu’à sa conversion au catholicisme, lui donnait l’impression que « son esprit n’avait pas trouvé son repos définitif et qu’il était en voyage » ; dans une note de ce temps, qu’il a retrouvée plus tard, i1 parlait de lui-même, comme « étant présentement au collège d’Oriel, avançant lentement et conduit en aveugle par la main de Dieu, ne sachant où Celui-ci le mène 3 ». Parmi les faits qui contribuèrent le plus à ce changement dans les idées de Newman, il convient de noter les relations que les circonstances établirent alors entre lui et cet Hurrell Froude dont j’ai déjà tâché d’esquisser la physionomie. Nommé fellow d’Oriel en 1826, Froude avait été placé, pour son année de probation, sous la tutelle de Newman. Ce qu’ils savaient l’un de l’autre était plutôt pour éveiller une méfiance réciproque. Newman traitait Froude de red-hot high churchman; pour Froude, Newman était un evangelical plus ou moins teinté de « libéralisme », double raison d’être suspect. Et cependant, à cette méfiance, se mêla, dès le début,
1. Apologia. 2. Ibid. 3. Apologia.
37
des deux côtés, un vif attrait personnel. Il ne tenait pas seulement à l’idée très haute que Newman se fit tout de suite des dons intellectuels du nouveau fellow qu’il déclarait être un des esprits « les plus pénétrants, les plus nets et les plus profonds » qu’il eût connus 1, ou à l’estime reconnaissante que Froude, de son coté, ressentait pour le talent, la bonté et l’élévation de sentiments de son tutor. Dans ce milieu mondain, les deux jeunes hommes devinèrent, l’un chez l’autre, le même sens profond de la religion, le même besoin d’un christianisme plus sérieux, plus efficace, le même dégoût du formalisme superficiel et routinier, la même soif du vrai, le même généreux et tendre amour des âmes, le même esprit de renoncement et de mortification, le même idéal de sainteté. Avec le temps d’ailleurs se multipliaient les occasions de se rapprocher, et, par suite, de se mieux connaître. En 1828, Froude fut nommé, à son tour, tutor, avec un autre pupille de Keble, Robert Wilberforce, frère aîné d’Henry. Les deux nouveaux tutors entrant tout à fait dans les idées de Newman sur les devoirs de leur fonction, s’appliquèrent à le seconder. Vers la même époque, ce dernier ut l’idée de fonder un dîner périodique (dinner club), où se grouperaient quelques membres des différents collèges, heureux de se voir et d’échanger leurs idées Froude et Robert Wilberforce furent parmi les premiers adhérents 2. « Newman, écrivait Fronde en septembre 1828,
1. Lettre du 31 mars 1826. (Lett. and Corr., t. I. p. 131.) 2. Ibid., t. I, p. 184.
38
est un compagnon que j’aime davantage à mesure que je le connais ; seulement je donnerais beaucoup pour qu’il ne fût pas hérétique 1. » Aussi n’épargnait-il rien pour le ramener aux doctrines qu’il jugeait orthodoxes. Dans de longues conversations, il développait la nécessité d’une Eglise indépendante de l’Etat, ayant une forte hiérarchie et un pouvoir sacerdotal, traitait avec dédain la prétention de fonder la religion sur la seule Bible et en appelait à la tradition, affirmait sa foi dans la présence réelle, proclamait l’excellence de la virginité dont la mère de Dieu lui paraissait le type suprême, préconisait la pénitence, le jeûne, la dévotion aux saints, aimait à évoquer le souvenir des miracles de la primitive Eglise et surtout de celle du moyen âge pour laquelle il ressentait un attrait particulier, proclamait le devoir pour l’Eglise anglicane d’être en communion avec l’Eglise universelle, et lui reprochait de s’être écartée, sur plusieurs points, de l’antiquité, n’hésitait pas à témoigner son admiration pour l’Eglise de Rome et son aversion pour les réformateurs. Exposées sous une forme vive et originale, avec une ardente sincérité, ces idées frappaient et intéressaient Newman. Elles répondaient, sur plus d’un point, aux doutes qui le travaillaient. Quelques-unes mêmes étaient déjà, depuis longtemps, un peu les siennes. D’autres, à la vérité, l’effarouchaient davantage, notamment celles sur l’Eglise de Rome, dans laquelle il avait peine à cesser de voir l’Antéchrist. Toutefois, de jour en jour, son esprit se laissait davantage gagner
1. Froude’s Remains.
39
aux vues de son nouvel ami ; il y trouvait des lumières et des consolations qu’il avait vainement cherchées ailleurs. Sur son conseil, il se mit à étudier les théologiens anglicans du XVIIe siècle, Andrews, Land et les Caroline divines. Et, ce qui devait exercer plus d’action encore sur son esprit, il sentait renaître sa dévotion première pour les anciens Pères et entreprenait de les lire, pendant ses vacances, dans l’ordre chronologique, en débutant par saint Ignace et saint Justin. Tel fut le chemin ainsi fait qu’en 1829, trois ans après le commencement des relations de Froude et de Newman, leur intimité et leur accord étaient devenus complets, sauf que, dans la voie où ils marchaient tous deux, Fronde était toujours en avant 1. La prédication dé Newman se ressentait, de ce changement et sa soeur trouvait que ses sermons devenaient un peu trop High Church pour son goût 2. Plus tard, au lendemain de la mort prématurée de Froude, Newman, dans un langage où l’amitié et la modestie lui faisaient même trop diminuer son propre rôle, s’est plu à témoigner de sa gratitude envers celui qui avait pris si vite une telle place dans son coeur et exercé une telle action sur son intelligence ; il le proclamait l’homme le plus merveilleusement « doué » qu’il eût connu et déclarait « ne pouvoir énumérer tout ce dont il lui était rede-
1. Vers la fin de 1829, Newman, ayant besoin de quelqu’un pour l’aider dans sa paroisse, sollicitait le concours de Robert Wilberforce, puis de Froude, et, sur leur refus, s’en rapportait à eux pour leur désigner quelqu’un. (Lett. and Corr., t. I, p. 213.) Il devait finir par prendre pour curate un autre pupille de Keble, lsaac Williams. 2 Lett. and Corr., t. I, p. 215.
40
vable, comme principes de philosophie, de religion et de morale 1 ». L’un des avantages, et non des moins précieux, que valut à Newman l’amitié de Froude, fut d’être par lui rapproché de Keble. De tout temps, il avait eu de ce dernier la plus haute idée. Quand, tout jeune undergraduate, quelqu’un lui avait dit, dans la rue, en lui montrant un passant: « Voici Keble! » il l’avait contemplé avec des sentiments qu’il qualifiait lui-même de « vénération ». «C’est le premier homme d’Oxford », écrivait-il à son père. Racontant à un de ses amis comment, en 1822, après avoir été élu fellow, il, s’était rendu à Oriel pour recevoir les félicitations de ceux dont il devenait le collègue, il notait ce détail: « Je fis bonne contenance jusqu’au moment où Keble me prit la main; alors je me sentis si confus, si indigne de l’honneur qui m’était fait que j’aurais voulu, en vérité, me cacher sous terre.» Assis à dîner, le jour même, près de Keble, il admirait à quel point il était dépourvu de toute affectation, de toute
1. Lett. and Corr., t. II, p. 174. Peu auparavant, Newman écrivait à Froude Depuis que j’ai conscience que je tiens tout ce que j’ai de meilleur de Keble et de vous, je me sens quelque chose comme la gêne d’un coupable, quand on me loue de mes découvertes... Vous et Keble êtes les philosophes, et moi le rhétoricien. » Il est arrivé, plusieurs fois, à Newman de diminuer ainsi son rôle pour grandir celui des amis dont il reconnaissait avoir reçu ses idées : « Je suis, disait-il, comme un panneau de verre qui transmet la chaleur, en étant froid lui-même. Ce que j’ai, c’est une vive perception des conséquences de certains principes une fois admis, une capacité intellectuelle considérable pour les en déduire, une puissance de rhéteur ou d’acteur (a rhetorical or histrionic power) pour les présenter... » (Ibid., p. 416.) L’avenir devait montrer que Newman avait beaucoup plus d’idées propres, d’originalité de pensée qu’il ne s’en attribuait au moment où il était encore sous l’impression toute vive des influences qu’il venait de subir.
41
prétention. « On eût dit, écrivit-il, plutôt un undergraduate que le premier homme d’Oxord 1. » Malgré l’impression de cette rencontre, Newman était demeuré, depuis lors, sans relations avec l’homme qu’il admirait tant. Tout en continuant à lui vouer de loin un grand respect, il le considérait comme le représentant d’idées absolument étrangères aux siennes. Keble, de son côté, dans ses rares apparitions à Oxford, n’avait pas l’idée de rechercher un homme qu’il ne connaissait que par son renom d’evangelical et par son intimité avec Whately. Aussitôt en rapports avec Newman, Froude s’attacha à détruire ces préventions réciproques. Keble l’écouta avec sa bienveillance accoutumée. Newman goûtait trop l’inspiration du Christian Year 2 pour ne pas être attiré vers son auteur. Toutefois, à la fin de 1827 et au commencement de 1828, le rapprochement n’était pas encore complètement fait. A cette date, la place de prévôt d’Oriel étant devenue vacante, deux candidats se trouvèrent en présence, Keble et Hawkins. Le premier était soutenu par Froude. Newman prit ouvertement parti pour le second, avec lequel il avait été très lié pendant sa phase « libérale ». A Froude, qui lui faisait valoir qu’avec Keble le collège deviendrait comme un monde nouveau, plus pur, plus élevé, plus dégagé des ambitions séculières, Newman répondait en riant que, « si une place d’ange était vacante, il pourrait songer à Keble, mais qu’il s’agissait de nommer un
1. Lett. and Cor., t. 1, p. 72. 2. On se rappelle que le Christian Year fut publié en 1827.
42
prévôt ». II écrivait, en même temps, à Keble, une lettre où il exposait ses raisons de lui préférer Hawkins; il s’y déclarait d’accord avec ce dernier sur les opinions religieuses, la façon de penser et les vues pratiques, « tandis que je n’ai eu, ajoutait-il, que peu d’occasions de jouir de votre société, et je soupçonne plutôt, bien que je puisse me tromper, que, si je vous connaissais mieux, je trouverais que vous n’approuvez pas des opinions, des desseins et des mesures auxquels mon propre tour d’esprit m’a conduit à donner mon assentiment ». Keble répondit, en quelques mots exempts de toute amertume, qu’il retirait sa candidature, et Hawkins fut nommé, Il semblait qu’un tel incident dût retarder le rapprochement tant désiré par Froude. Que se passa-t-il dans les mois qui suivirent? Toujours est-il que, vers le milieu de 1828, Newman était avec Keble sur un pied de correspondance familièrement affectueuse, et que, sur ses instances, il allait lui faire une visite dans sa cure 1. Une fois à même de se connaître, ces deux âmes se donnèrent complètement l’une à l’autre, et entre elles se noua l’amitié si tendre, si religieusement intime que Newman a toujours déclarée avoir été une des bénédictions de sa vie. C’était bien l’oeuvre de Froude. « Connaissez-vous, disait-il un jour, l’histoire du meurtrier qui avait fait une seule bonne action dans sa vie? Eh bien, si l’on me demande quelle bonne action j’ai jamais pu faire, je dirai que j’ai amené Keble et Newman à se comprendre l’un l’autre 2. »
1. Lett. and Corr., t. I, p. 188 à 19!. 2. Froude’s Remains.
43 Ces amitiés nouvelles avaient naturellement pour effet de distendre les liens qui s’étaient formés naguère entre Newman et les « libéraux » d’Oriel. Whately, notamment, avait l’oeil trop perçant pour ne pas discerner l’évolution qui s’accomplissait chez son ancien disciple, et il était de nature trop impérieuse pour la prendre en patience. Ce n’était pas d’ailleurs sans ombrage ni jalousie qu’il voyait une jeune clientèle commencer à se grouper autour de Newman, et il accusait ce dernier de n’avoir changé d’opinion que pour devenir à son tour chef d’un parti. Avec Hawkins lui-même, que Newman avait contribué à faire élire prévôt, les relations, d’abord très cordiales, ne tardèrent pas à s’altérer: Hawkins n’approuvait pas le caractère d’apostolat pastoral que Newman, bientôt imité par Fronde et Robert Wilberforce, entendait donner à ses fonctions de tutor. Peut-être aussi jalousait-il une influence qui tendait à rejeter dans l’ombre celle du prévôt. Le conflit, de jour en jour plus aigu, devait aboutir, en 1832, à la démission forcée des trois tutors; de cette époque datera la décadence d’Oriel, supplanté par Balliol dans la primauté intellectuelle d’Oxford 1. Parmi les anciennes amitiés de Newman, il en était une du moins à laquelle les nouvelles ne portaient pas atteinte: c’était celle qui l’unissait à l’homme dont, déjà à cette époque, une parlait dans ses lettres qu’en l’appelant « le cher Pusey». Celui-ci était revenu d’Allemagne, en 1827, souffrant, déprimé, par suite d’excès de travail. Newman se montra plein de sollicitude pour
1. Memoirs by Mark Pattison, p. 88.
44
la santé de son ami 1. Au milieu de 1828, à peu de jours de distance, Pusey reçut les ordres et se maria; il n’avait jamais entendu la voix mystérieuse qui, au milieu d’un clergé où le mariage était la règle, avait murmuré à l’oreille de Newman un appel si inattendu à la virginité. Son mariage était même la conclusion d’un petit roman, très simple et très pur, mais qu’un lecteur français sera surpris de trouver au seuil de la vie d’un austère théologien 2. A dix-huit ans, ayant rencontré Maria-Catherine Barker, il lui avait donné son amour. Pour des raisons inconnues, son père, qui était fort autoritaire, opposa son veto et interdit les relations. Le fils se soumit, le cœur brisé, mais fidèle. Il attendit, cherchant dans ses travaux d’exégèse et ses exercices de piété une diversion à ses peines amoureuses. Enfin, après neuf années, en 1827, le père se laissa fléchir et permit les fiançailles. Durant ces fiançailles, qui se prolongèrent jusqu’à l’ordination de Pusey, l’année suivante, les deux jeunes gens échangèrent des lettres d’amour d’un caractère peu ordinaire: le fiancé faisait confidence à sa fiancée de ses études théologiques, lui donnait des consultations sur des sujets religieux, et lui indiquait l’aide qu’il attendait d’elle pour ses travaux sur la Bible; la fiancée, par devoir et par affection, acceptait la perspective de cette tâche austère. Elle y sera fidèle, et, plus tard, on la verra à la Bodleian, la célèbre bibliothèque d’Oxford,
1. Lett. and Corr., t. I, 170, 172, 184, 486. 2. Pour ces détails et ceux que j’aurai à donner par la suite sur la vie de Pusey, je renvoie, une fois pour toutes, au grand ouvrage commencé par le chanoine Liddon et continué par d’autres disciples de Pusey : Life of E.-R. Pusey, en quatre volumes.
45 revisant pour son mari le texte de quelque ancien Père. Peur revêtir cette forme inaccoutumée, l’amour de Pusey n’en était pas moins tendre et profond. Ni les années, ni la vieillesse, ni la séparation du tombeau ne devaient l’affaiblir. Un jour, au terme de sa longue vie, quand il était veuf déjà depuis plus d’un demi-siècle, sa fille lui rapporta quelques fleurs de verveine, cueillies dans une visite à l’ancienne résidence de Miss Barker: à cette vue, le vieillard se prit à pleurer et dit à sa fille: « Quand je proposai à votre mère de devenir ma femme, elle me donna une branche de verveine, et, depuis, je ne peux voir cette fleur sans réveiller ce souvenir. » Le mariage de Pusey resserra encore davantage son amitié avec Newman. Celui-ci devint l’ami du ménage. A travers les témoignages discrets parvenus jusqu’à nous, on entrevoit la touchante figure de Mrs Pusey, femme de devoir, épouse dévouée, mais âme plus compliquée, plus chercheuse, plus inquiète que celle de son mari, et par cela même ayant beaucoup d’affinité avec Newman. Les sermons de ce dernier la réconfortaient, tandis que les écrits un peu confus de Pusey la laissaient troublée; elle avouait cette impression à son mari qui lui expliquait alors, avec sa candide humilité, comment Newman valait mieux que lui. Elle fut donc bientôt, avec l’ami de son époux, sur le pied d’une grande intimité; elle le vénérait comme un saint et se regardait comme sa fille spirituelle. Celui-ci, de son côté, s’intéressait à seconder et à diriger la vertu grandissante de cette âme. Que serait-il arrivé si Mrs Pusey ne fût morte avant la conversion de New-
46
man au catholicisme? Lors de la naissance de leur première fille, Pusey et sa femme tinrent à ce qu’elle devînt chrétienne par le ministère de leur ami. Bientôt quatre petits enfants animèrent ce foyer. Newman y avait sa place qu’il venait souvent occuper. Lui, d’ordinaire timide et presque sauvage dans le monde, était plein d’abandon et d’entrain avec les enfants, à la différence de Pusey qui, bien que père très dévoué et très tendre, n’avait jamais pu, de son propre aveu, se mêler aux jeux de ses fils et de ses filles. Un étudiant de Cambridge, venu en visite à Oxford et invité à dîner chez Pusey avec Newman, a raconté sa surprise, lorsque, après une conversation théologique, il vit les enfants de Pusey entrer dans le salon, grimper sur les genoux de Newman, qui s’amusait à leur mettre ses lunettes sur le nez et leur racontait ensuite un beau conte de fées, écouté avec ravissement1. Quand la mort vint frapper, toute jeune encore, l’aînée de ces enfants, Newman fut le confident et le soutien des parents désolés. «Notre chère petite, lui écrivait Pusey, celle qui par vous est devenue membre de l’Eglise de Dieu, a été délivrée de toutes les souffrances de ce monde avant de les avoir connues. Son départ a été soudain; néanmoins nous devons remercier Dieu de ce qu’il a fait. Elle avait tout l’air de promettre d’être douce et gentille ici-bas, mais elle est allée orner la maison de son père.»
1. Cette aimable familiarité avec les enfants était coutumière à Newman. Une lettre de Mrs Rickards, chez laquelle il était en visite pendant les vacances de 1827, rapporte une scène semblable, (Lett. and Corr., t. 1, p. 167.)
47
Pour être intimement lié avec Newman, Pusey n’était pas disposé à s’engager aussi avant que lui dans la voie où Froude les précédait. En dépit de ses origines High Church, il était alors considéré comme plus ou moins teinté de «libéralisme» A son retour d’outre-Rhin, il avait fait paraître une étude sur la critique biblique allemande, et, à la suite de cette publication, il avait été nommé regius professor d’hébreu à l’université d’Oxford. Son livre parut à plusieurs témoigner de quelque complaisance pour le rationalisme germanique, et une polémique s’engagea, à ce sujet, entre lui et H.-J. Rose, de Cambridge, l’un des porte-parole les plus autorisés du High Church. Newman s’attristait de voir ainsi juger son ami et tâchait de le défendre; mais il reconnaissait que le livre était obscur, mal composé, et qu’il prêtait aux malentendus 1. L’impression fut telle que, lors de sa candidature à la chaire d’hébreu, Pusey dut se défendre contre le reproche de latitudinarisme : « Je crois, écrivait-il à son ancien maître, Lloyd, devenu évêque d’Oxford, que pratiquement mes opinions sont celles du High Church; et, tout en respectant les individus, je me sens de plus en plus éloigné de ce qui est appelé Low Church. Je ne sais aucun sujet de controverse entre High, et Low, où je ne sois pas d’accord avec le premier. » Il était, en tous cas, un High un peu froid, votant souvent avec les «libéraux» dans les votes où se classaient les partis universitaires; ainsi avait-il fait, en 1827, avec Newman, lors de l’élection de Hawkins. Il était surtout, en politique, un
1. Lett. and Corr., t. I, p. 186, 189,197, 198,
48
whig, et, de ce chef, allait se trouver, en 1829, au sujet d’une élection qui passionna l’université d’Oxford, dans un camp opposé à celui où combattait Newman. Malgré tout, Fronde n’avait pas mauvaise idée de lui. « J’espère, écrivait-il à Newman en septembre 1829 que Pusey finira, après tout, par tourner au High Church. 1 »
VI
Ce fut en 1829, dans une élection parlementaire, que se manifesta, pour la première fois, avec quelque éclat, l’évolution qui faisait de Newman, l’allié de Keble et de Fronde. A cette époque, le monde politique était fort agité. Contre le torysme, depuis si longtemps au pouvoir, une réaction naissait et grandissait. Un vent de réforme s’était levé, qui semblait battre toutes les vieilles institutions anglaises, y compris l’Eglise d’Etat avec ses privilèges et ses biens. Les high-church-men s’alarmaient fort d’un mouvement qui leur paraissait prendre un caractère d’impiété révolutionnaire. Cette impression les portait à combattre toutes les réformes, sans distinguer celles qui pouvaient être légitimes et bienfaisantes; ainsi repoussaient-ils, comme d’ailleurs presque tout le clergé anglican, l’émancipation des catholiques, que le grand agitateur irlandais, O’Connell, poursuivait depuis longtemps et qu’avec l’appui des wighs il finit par faire voter en 1829. Peu après ce vote, la question se trouva portée devant l’Université
1. Lett. and Corr., t. 1, 214.
49
d’Oxford. Robert Peel, alors ministre dirigeant, représentait cette Université au Parlement; il avait été élu comme adversaire de l’émancipation et l’avait longtemps combattue; mais un jour vint où la raison d’Etat le fit changer d’avis, et ce fut sur sa proposition que la mesure fut votée; il jugea alors loyal de remettre son mandat à ses électeurs et de solliciter à nouveau leurs suffrages. La lutte fut ardente. Tous les «libéraux » de l’Université, anciens amis de Newman, Whately, Hawkins, soutenaient Peel. Pusey se rangea de leur bord. Keble et Froude étaient dans le camp opposé, et Newman fit ouvertement campagne avec eux. Il évitait, à la vérité, de se prononcer contre l’émancipation elle-même; de tous temps, il avait affecté de dire qu’il n’était pas en mesure de se faire une opinion sur cette question ; il avait même, en 182l ou 1828, voté, dans l’assemblée du clergé, contre une pétition tendant à dénier les droits des catholiques; mais il jugeait que Peel avait manqué à l’Université et qu’il « n’était plus digne de représenter un corps religieux et non politique dont il avait plus ou moins trahi les intérêts ». D’ailleurs, s’il persistait à ne pas se prononcer sur l’émancipation, la faveur qu’elle avait rencontrée lui paraissait « un signe des temps, une preuve de l’invasion du philosophisme et de l’indifférentisme » ; il estimait qu’elle avait été soutenue surtout par « hostilité contre l’Eglise établie » et quelle devait conduire au renversement de cette Eglise 1. Peel fut battu : la grande majorité des membres résidents lui fut hostile;
1. Lett. and Corr., t. I, p. 162, 199 à 206.
50
Newman se félicitait notamment que les fellows résidents d’Oriel eussent été unanimement antipeelites. Whately en voulut beaucoup à Newman de son attitude en cette circonstance. Il lui témoigna son ressentiment d’une façon singulière : il l’invita à dîner avec quelques-uns de ces high-churchmen, d’esprit étroit et un peu grossier, qu’on appelait the two bottle orthodox, parce que, prétendait-on, ils se piquaient, pour protester contre les puritains, de boire deux bouteilles de porto par jour, le plaça à table entre deux des plus sots, puis, le repas fini, lui demanda s’il était fier de ses nouveaux amis 1. C’était le début d’une rupture qui, de la part de Whately, fut bientôt complète 2. De cette bataille électorale, Newman sortait singulièrement échauffé. «Nous avons remporté une glorieuse victoire, écrit-il; c’est le premier événement public auquel j’aie été mêlé, et je remercie Dieu de tout mon coeur de la cause que j’ai soutenue et de son succès. Nous avons prouvé l’indépendance de l’Eglise. » Ce dernier point lui paraît capital, étant donnée l’habitude que cette Eglise avait d’être toujours soumise au gouvernement. Et quelques jours après, comme il revenait encore sur ce sujet: « Quel écrivassier je fais ! Mais mon esprit est, par l’effet de cet important événement, si plein d’idées, mes vues en ont été si élargies et étendues, qu’en toute justice je devrais écrire un volume.
1. Le trait est rapporté par Newman dans son Apologia. 2. Newman ne s’en était pas tout d’abord rendu compte. Quand Whately fut nommé, en 1831, archevêque de Dublin, Newman crut qu’il allait lui proposer de venir avec lui, et il s’inquiétait de savoir comment décliner son offre. (Lett. and Corr., t. I, 250.)
51
Il pressent, contre l’Eglise, un grand assaut qui peut aboutir à sa séparation d’avec l’Etat ; il énumère les nombreux et puissants adversaires auxquels elle a affaire; il constate que, pour le moment du moins, le talent est contre elle; mais il constate aussi que cette « pauvre Eglise sans défense » vient, à Oxford, de résister au coup qu’on lui portait, et ce lui est une révélation sur la force que peut avoir le clergé uni. Ne peut-on donc pas s’appuyer sur lui pour combattre les autres dangers? Dès lors il commence à entrevoir l’idée d’une campagne à faire, d’une agitation à créer 1. Froude, naturellement, le pousse dans cette voie. Sur ces entrefaites, éclate, en France, la Révolution de 1830. L’Europe entière en est ébranlée. En Angleterre, une impulsion violente est donnée au mouvement démocratique. Le vent de réforme, qui s’était levé depuis quelques années, souffle désormais en tempête. L’avènement d’un ministère whig n’assure pas seulement le succès à brève échéance de la réforme électorale: il semble présager ce qu’on appelle alors la réforme de l’Eglise. On annonce hautement la volonté de reviser ses revenus, ses dotations, ses privilèges, sa hiérarchie, même sa liturgie, ses symboles et ses dogmes. Et cette besogne doit être faite par un Parlement que la suppression des tests vient d’ouvrir aux dissidents. Pour se défendre, que peut l’Eglise établie? Elle était habituée à s’en remettre de tout à l’Etat, et c’est de l’Etat que venait la menace. Dans l’opinion, elle ne saurait trouver aucun point d’appui. Ses abus
1. Lett. and Corr., t. I, p. 202 à. 207.
52
trop manifestes, la mondanité de son clergé, l’incertitude de ses croyances, son manque à peu près complet de vie religieuse, l’impuissance où elle s’est montrée de répondre aux besoins nouveaux d’une société qui devient démocratique et industrielle, l’ont depuis longtemps discréditée. La campagne qu’elle vient de faire avec les adversaires les pins attardés de toutes les réformes politiques a encore accru son impopularité. Les écrivains, interprètes ou inspirateurs de l’esprit public, sont à peu près unanimes à l’attaquer. Le premier ministre, en pleine Chambre des lords, enjoint, avec une sévérité dédaigneuse et menaçante, à ses évêques de « mettre leur maison en ordre s; ces mêmes prélats sont insultés dans les rues. Il faut se reporter aux témoignages contemporains pour se rendre compte à quel point l’Eglise a alors le sentiment d’une ruine possible et prochaine. Partout un même cri d’alarme et de découragement. Arnold déclare « qu’aucun pouvoir humain ne peut la sauver dans son état actuel 1 », et il ne lui offre d’autre remède que de faire litière de ses Credo et d’ouvrir ses rangs aux dissidents. Beaucoup renoncent à lutter : l’Eglise leur paraît sur «son lit de mort » et n’a plus, suivant l’expression d’un contemporain, qu’à « s’envelopper dans sa robe, pour mourir avec le plus de dignité qu’elle pourra 2»
1. Life of Arnold, par Stanley, t. I, p. 326. 2. Un écrivain High Church, mêlé aux controverses de cette époque, W. Palmer, a écrit en rappelant ses souvenirs : « Nous nous sentions nous-mêmes assaillis par les ennemis du dehors et par les adversaires du dedans. Nos prélats étaient insultés et menacés par les ministres d’Etat. Nous étions submergés de pamphlets sur la réforme de l’Eglise... D’après des rapports, qui semblaient bien fondés, certains des prélats étaient favorables aux altérations dans la liturgie. Des brochures très répandues recommandaient l’abolition des Credo au moins dans le culte public, insistaient surtout pour l’expulsion du symbole d’Athanase, pour la suppression de toute mention de la sainte Trinité, de la doctrine de la régénération baptismale, de la pratique de l’absolution. Nous ne savions où trouver un appui: un épiscopat menacé et qui semblait intimidé; un gouvernement mettant son pouvoir au service des agitateurs qui visaient ouvertement à la destruction de l’Eglise...; et le pis de tout, aucun principe dans l’esprit public auquel nous pussions faire appel; une complète ignorance de tous les fondements rationnels d’attachement à l’Eglise, un oubli de son caractère spirituel et de ce fait qu’elle était une institution de la main de Dieu, non de celle de l’homme; le plus grossier érastianisme prévalant partout, notamment dans les diverses classes de politiciens. Dans tout ceci, il y avait de quoi effrayer le coeur le plus courageux, et ceux qui peuvent évoquer les souvenirs de ces jours se rappelleront la profonde dépression dans laquelle l’Eglise était tombée et les sombres pressentiments qui remplissaient tous les esprits. » (Narrative of events connected with the publication of the Tracts for the times.)
53 Il était cependant, deci delà, quelques membres du clergé qui ne se résignaient pas volontiers à l’idée de succomber sans combattre et qui, contre ces attaques, rêvaient de relever le drapeau du High Church. Newman, confirmé, par ces événements, dans le sentiment qu’il avait déjà des dangers de l’Église, était. de ceux qui ne s’abandonnaient pas. La défaillance du clergé l’indignait. A ses yeux, il ne s’agissait pas simplement de combattre les demandes de réforme et de défendre un statu quo dont il était le premier à reconnaître la caducité. Précisément à cette époque, sur la demande de M. Rose de Cambridge qui recrutait des écrivains pour une bibliothèque théologique, il avait entrepris l’histoire du Concile de Nicée et des Ariens du quatrième
54
siècle 1. Il s’était plongé avec ardeur dans l’étude de cette antiquité qui l’avait toujours attiré et où il commençait à vouloir placer le fondement de l’Eglise d’Angleterre. Plein d’admiration pour la grande Eglise d’Alexandrie, pour ses théologiens et ses philosophes, il sentait, a-t-il dit, « leur enseignement pénétrer dans son âme, ainsi qu’une douce musique, comme s’il eût répondu à des idées qu’il caressait depuis longtemps. » Mais, en considérant ce passé glorieux, il ne pouvait s’empêcher de l’opposer au spectacle que lui offrait son Eglise. Lui-même a résumé ainsi les réflexions que ce contraste lui suggérait : « A cet établissement » si divisé, si menacé, si ignorant de sa force réelle, je comparais cette puissance vivace et énergique dont j’étudiais l’histoire dans les siècles primitifs. Son zèle triomphant pour le mystère fondamental que j’avais tant chéri dès ma jeunesse me lit reconnaître en elle ma mère spirituelle : Incessu patuit dea. L’esprit de renoncement de ses ancêtres, la patience de ses martyrs, la fermeté indomptable de ses évêques, l’élan joyeux de son progrès m’exaltaient et me confondaient à la fois. Je me disais : Regarde ce spectacle, puis cet autre...» Ne vous attendez pas, cependant, à ce que, des révélations que lui apporte ainsi l’histoire, Newman tire dès maintenant la conclusion à laquelle il n’arrivera que quinze ans plus tard. «Je me sentais, ajoute-t-il, pour mon Eglise de l’attachement, mais aucune tendresse; je tremblais pour son avenir; j’éprouvais de la
1. Ce livre, commencé en 1830, terminé en 1832, devait être publié à la fin de 1833, sous ce titre : les Ariens du IVe siècle.
55
colère et du mépris pour ses perplexités impuissantes;... je voyais que les principes de la Réforme étaient impuissants à la secourir. Quant à l’abandonner, l’idée ne s’en présentait pas à mon imagination. Mais j’étais toujours poursuivi par cette pensée qu’il existait quelque chose de plus grand que l’Eglise établie, et que ce quelque chose était l’Eglise catholique et apostolique, instituée dès l’origine; la nôtre n’en était que l’organe et le représentant local; ou elle n’était rien, ou elle était cela; il lui fallait un remède énergique, ou elle était perdue; une seconde Réforme était nécessaire1. » Ainsi surgissait ce qui devait être désormais, pendant plusieurs années, l’idée maîtresse de Newman : l’Eglise d’Angleterre, menacée de périr, ne peut être sauvée qu’à la condition de se transformer, de répudier ce qui, depuis longtemps, l’a faussée et pervertie, de retrouver ses titres surnaturels, de se hausser à l’intelligence de son origine et de sa mission divines. Mêmes idées chez Froude, avec plus d’emportement, La perspective d’une bataille à livrer l’enflamme. Il presse ses compagnons de parler fort et énergiquement. Moins encore que Newman, il entend se renfermer dans la défense d’un statu quo qu’il méprise. « Froude, écrit James Mozley, en 1832, devient chaque jour plus véhément dans ses sentiments, et il tranche autour de lui de tous les côtés. C’est extrêmement beau de l’entendre causer. L’aristocratie de campagne est
1. Apologia.
56
maintenant l’objet principal de ses vitupérations,… et il pense que l’Eglise devra éventuellement s’appuyer sur les classes très pauvres, comme cela lui est déjà arrivé aux époques où elle a eu le plus d’influence. « Le même témoin ajoute un peu plus tard: « Froude porte réellement une haine si excessive au présent état de choses que tout changement lui serait un soulagement » Et encore : «Froude est très enthousiaste dans ses plans. Quelle joie, dit-il, de vivre à une telle époque, et qui pourrait maintenant revenir au temps des vieilles bourdes tories, old tory humbug 1 ! » Aussi qu’on ne s’étonne pas de voir l’ancien « cavalier», devenu démocrate, se laisser séduire par les idées que Lamennais et Lacordaire développaient alors dans l’Avenir. « Il y a en France, écrit-il, un High Church party dont les membres sont républicains 2 et demandent le suffrage universel, dans cette pensée que plus le suffrage descend bas, plus l’influence de l’Eglise se fait sentir... Ne vous étonnez pas si, un de ces jours, vous nous voyez devenir radicaux pour la même raison 3.»
VII
Les esprits s’échauffaient. Toutefois les idées qui fermentaient dans les cerveaux de Froude et de Newman, n’en venaient pas encore à l’exécution : ce n’étaient
1. The Oxford Movement, par Church, p. 49, 50. 2 Sur ce point particulier, Fraude était mal informé, 3. Froude’s Remains.
57
guère jusqu’alors que des réflexions, des rêves, des désirs, des conversations de common rooms. Tout au plus, dans ses sermons de Sainte-Marie, Newman jetait-il parfois au public un cri d’alarme, annonçait-il que l’heure de la grande crise allait sonner pour l’Eglise et la société, et tâchait-il de relever les courages. En réalité, la bataille entrevue n’est pas engagée. Elle ne paraît même pas assez imminente pour que les futurs combattants se fassent scrupule de s’éloigner. Froude avait ressenti, en 1831, les premières atteintes de la maladie de poitrine qui devait l’emporter. Comme les médecins lui conseillaient de passer l’hiver de 1832-1833 dans le midi de l’Europe, il invite Newman à l’accompagner. Celui-ci se trouvait, du fait d’Hawkins, déchargé de ses fonctions de Luter; il vient de terminer son livre sur les Ariens; sa santé ébranlée demande du repos; il accepte la proposition de son ami, et tous deux s’embarquent en décembre 1832. Ils parcourent d’abord la Méditerranée, jusque sur les côtes de Grèce. Ils jouissent de la nature, de l’art, des évocations historiques, littéraires ou religieuses que chaque lieu suscite dans leurs esprits nourris de toutes les antiquités classiques ou chrétiennes. Mais, même en présence des sites les plus imprégnés des souvenirs païens, leur pensée tourne volontiers en une méditation ascétique ou pieuse, en une prière qui ne part des beautés terrestres que pour s’élever à Dieu : telle elle apparaît dans les poésies où les deux voyageurs, — Newman surtout qui est le
58
plus poète des deux, — épanchent presque journellement leurs impressions 1. Arrivés à Rome dans les premiers jours de mars, ils y restent cinq semaines. Ils se tiennent généralement à l’écart du monde catholique et ne cherchent aucunement à pénétrer sa vie intime. Leur seule démarche un peu significative est une visite au recteur du collège catholique anglais: c’était un personnage jouissant déjà d’un certain renom et qui devait exercer une action considérable sur les destinées religieuses de l’Angleterre : il s’appelait Wiseman. Newman et Froude l’interrogent sur les conditions auxquelles un rapprochement pourrait s’opérer entre les deux Eglises; ils sortent de l’entretien, charmés de l’accueil du recteur, ruais convaincus que la doctrine romaine sur l’autorité des conciles en général, et du concile de Trente en particulier, rend tout accord impossible. Quant à Wiseman, il est frappé de la nature d’esprit vraiment catholique et de l’entière sincérité des deux jeunes clergymen; les espérances qu’il en conçoit ont une influence décisive sur la direction qu’il va donner à sa vie 2. Newman ne s’en doute pas, et, peu après cette visite, il écrit à sa soeur : « Oh! si Rome n’était pas Rome! Mais je crois voir, aussi clair que le jour, que
1. Ces pièces diverses ont été publiées, avec un petit nombre d’autres antérieures ou postérieures, et quelques oeuvres de Keble, d’Isaac Williams, de Robert Wilberforce, de Bowden, sous le titre de Lyra apostolica. Cette publication commença, dès le printemps de 1833, dans le British Magazine, revue dirigée par M. Rose, de Cambridge, et destinée à grouper les défenseurs de l’Eglise. L’ensemble fut réuni en volume en 1836. 2. The Life and Times of Cardinal Wiseman, par Wilfrid Ward, t. I, p. 117 à 119.
59
l’union avec elle est impossible. Elle est la cruelle Eglise, demandant de nous des impossibilités, nous excommuniant pour désobéissance; maintenant elle guette notre ruine qui approche, et elle en exulte.» On dirait d’ailleurs que, pendant ce voyage, Newman est incapable de parler de sang-froid de Rome: il est profondément ému des souvenirs sacrés qu’il heurte à chaque pas sur ce sol couvert de la poussière des apôtres, il a le coeur déchiré en le quittant, et, en même temps, ses vieilles préventions lui montrent, dans cette ville, la « grande ennemie de Dieu », la « Bête » maudite de l’Apocalypse. A chaque moment, il semble se débattre entre ces impressions contradictoires. Il en souffre. « Vraiment, c’est un lieu cruel… s’écrie-t-il. Et il revient toujours à cette étrange exclamation : « Ah! Rome, si tu n’étais pas Rome! » Dans les églises catholiques, il ressent le charme de cette poésie sainte qu’il reprochait aux réformateurs d’avoir détruite dans son pays; il rend justice à la dignité du clergé romain, qu’il distingue en cela du clergé napolitain; il reconnaît qu’il y a dans cette société « un profond substratum de christianisme », puis, l’instant d’après, il dénonce avec mépris ce qui lui paraît un « système de superstitions », une « religion demeurée polythéiste, dégradante, idolâtrique », et il conclut ainsi : «Quant au système catholique romain, je l’ai toujours tant détesté que je ne puis le détester davantage; mais, quant au système catholique, je lui suis plus attaché que jamais 1. » En somme, cette vue
1. Lett. and Corr., t. I, p. 336, 338, 342, 359, 360, 369, 370, 375, 378, 379, 380, 383, 385, 388 à 391.
60
tout extérieure d’un pays catholique n’a aucunement rapproché Newman du catholicisme. Ce même effet est plus marqué encore chez Froude qui, jusque-là, a tant de fois étonné ses coreligionnaires par ses sympathies et ses admirations pour l’Eglise de Rome. Il est choqué, scandalisé, irrité par tout ce qu’il voit en Italie. «Je me souviens, écrit-il de Naples, le 17 février 1833, à un de ses amis, que vous m’aviez prédit que je reviendrais meilleur Anglais que je n’étais parti, plus satisfait, non seulement de ce que notre Eglise est théoriquement dans le vrai, mais aussi de ce que, pratiquement, en dépit de ses abus, ses oeuvres sont les meilleures; eh! bien, pour confesser la vérité, votre prophétie est déjà presque réalisée 1. » D’ailleurs, ce n’est pas le catholicisme qui occupe le plus les deux voyageurs: même au loin, leur propre Eglise est l’objet principal de leurs pensées. Les nouvelles qui leur arrivent d’Angleterre, à de rares intervalles, leur persuadent que la situation y est de jour en jour plus menaçante. Pendant leur séjour à Rome, ils apprennent que le gouvernement vient de présenter un bill qui supprime la moitié des évêchés anglicans en Irlande. Sans doute rien de moins justifiable que l’existence de ces évêques sans ouailles, dont les catholiques irlandais devaient payer les opulentes dotations; mais les défenseurs de l’Eglise établie, négligeant ce côté de la question, s’effrayent et s’irritent de voir l’Etat disposer à lui seul, sans même consulter les autorités ecclésiastiques, de l’organisation de cette Eglise.
1. Froude’s Remains. t. I, p. 293.
61
Où s’arrêtera-t-on dans cette voie? Ne va-t-on pas faire de même en Angleterre? Newman, de loin, partage cette indignation contre ce qu’il appelle « l’atroce et sacrilège bill irlandais» — « Bien, mon aveugle premier ministre, s’écrie-t-il, confisquez et volez, jusqu’à ce que, comme Samson, vous renversiez l’édifice politique sur votre propre tête! » Il est alors, sur ces sujets, dans un singulier état d’excitation. « Pour faire ma confession complète, écrit-il, je dois dire que je n’ai, hélas! rien acquis de cette largeur d’esprit qu’au dire d’un de mes amis je devais gagner en voyage. Je ne puis me vanter d’être plus doué de froideur philosophique qu’auparavant, et, en lisant les journaux, je hais les whigs (comme dit R..., d’une façon chrétienne) plus amèrement que jamais.» A la nouvelle que Keble est disposé à sortir de sa réserve pour protester, il se réjouit et en conçoit de grandes espérances pour l’avenir de I’Eglise. « S’il est une fois debout, écrit-il, il se montrera un second saint Ambroise. Et les autres aussi se remuent 1.» Dans la campagne qu’il entrevoit, Newman n’entend pas rester inactif. Déjà, lorsqu’il a dû quitter ses fonctions de tutor et renoncer à l’existence studieuse et paisible qu’il menait depuis six ans, il a eu quelque idée que c’était pour lui le signe d’un appel à une vie nouvelle, et qu’une sphère d’action plus large allait lui être ouverte. Maintenant cette pensée lui revient plus précise, plus persistante. Il sent qu’une oeuvre est à faire et qu’on attend l’ouvrier. Dans ses heures de solitude, il se répète à lui-même
1. Lett. and Corr., t. I, p.. 353, 372, 377.
62
Exoriare aliquis! Ne serait-il pas l’ouvrier attendu? Il laisse voir quelque chose de ces idées dans les lettres à ses amis. Lors de la visite qu’il fait, en compagnie de Froude, à Wiseman, comme celui-ci l’invite gracieusement à revenir à Rome, il lui répond avec beaucoup de gravité : «Nous avons une oeuvre à faire en Angleterre 1.» En quittant Rome, au commencement d’avril 1833, Newman et Froude se séparent. Tandis que ce dernier retourne en Angleterre par l’Allemagne, Newman part pour la Sicile. Au coeur de l’île qu’il traversait pour aller de Syracuse à Palerme, loin de tout secours, n’ayant avec lui que son domestique italien, il tombe gravement malade de la fièvre et demeure plusieurs semaines entre la vie et la mort. Dans la suite, il a toujours regardé cette maladie, placée en quelque sorte à un tournant de sa vie, comme une crise mystérieuse et décisive où il s’était trouvé plus directement sous la main de Dieu; aussi a-t-il mis un soin pieux à évoquer et à recueillir tous les souvenirs qui avaient pu survivre au trouble de la fièvre 2. Il se revoyait sur son lit, en proie au délire, ayant l’impression que « Dieu combattait contre lui a pour « vaincre en lui l’attachement à sa propre volonté (selfwill) »; il lui semblait qu’il avait alors repassé toutes les circonstances de sa vie où il avait pu en effet céder à cette tentation; puis il se rappelait l’impression admirablement consolante, fortifiante, ressentie à la pensée que «Dieu, dans
1. Apologia. 2. Lett. and Corr., t. I, p. 413 à 430, et Apologia.
63
son amour, l’avait élu et l’avait fait sien ». Il se revoyait encore, donnant, en vue de sa mort, les dernières instructions à son domestique, mais ajoutant ces paroles dont il n’avait jamais après coup pu s’expliquer le sens: « Je ne mourrai pas; non je ne mourrai pas, car je n’ai pas péché contre la lumière,.., je n’ai pas péché contre la lumière », ou bien : « Je ne pense pas que je meure, car Dieu a encore de l’ouvrage à me faire faire. » Il se revoyait enfin, lorsque, bien faible encore, il s’était remis en route pour Palerme, s’asseyant sur son lit au moment de quitter l’auberge, fondant en larmes, et à son domestique qui l’interrogeait, ne pouvant répondre que ces mots auxquels le pauvre garçon ne comprenait rien: « J’ai une oeuvre à accomplir en Angleterre. » Arrivé péniblement à Palerme, Newman y reste trois semaines, faute d’un navire où il puisse s’embarquer. « J’avais soif du pays natal »n, a-t-il dit. La seule diversion à son ennui est de visiter les églises. Bien qu’il n’assiste pas aux offices et ignore même la présence du Saint Sacrement, il trouve à ces visites une grande douceur, qu’il compare, dans des vers écrits sur le moment, à l’huile et au vin versés par le Bon Samaritain sur les plaies du voyageur blessé. Enfin, le 10juin 1833, il peut quitter Palerme, traverse la Méditerranée, puis la France, le regard tendu vers l’Angleterre, impatient des retards qu’imposent les vents contraires ou la fatigue, se hâtant vers le sol où la voix mystérieuse lui a fait entendre qu’il a «une oeuvre à accomplir» Son état d’âme pendant cette course, il nous l’a révélé lui-même dans un poème devenu célèbre outre-
64
Manche, Lead kindly light! qu’il composa par une nuit sombre, en se promenant sur le pont du bateau immobilisé par le calme dans les bouches de Bonifacio:
I
Conduis-moi, bienfaisante lumière. Au milieu des ombres qui m’environnent, oh! conduis-moi. La nuit est noire, et je suis loin de mon foyer. Conduis-moi! Garde mes pas. Je ne demande pas à voir la scène lointaine, un seul pas est assez pour moi.
II
Je n’ai pas été toujours ainsi; je n’ai pas toujours prié pour que tu me conduises! J’aimais à voir et à choisir ma voie. Mais, maintenant, conduis-moi. J’aimais le jour brillant, et, en dépit de mes craintes, l’orgueil dirigeait ma volonté. Ne te souviens pas des années passées.
III
Ta puissance m’a si longtemps gardé en sûreté elle me conduira encore, par les rocs et les précipices, les montagnes et les torrents, jusqu’à ce que la nuit finisse, et, avec le matin, souriront ces visages d’anges que j’ai longtemps aimés et que j’ai perdus depuis peu.
Newman débarqua, en Angleterre, le 9 juillet 1833. Quelques jours après, commençait ce qu’on a appelé le « Mouvement d’Oxford ».
CHAPITRE IILES DÉBUTS DU MOUVEMENT (1833-1836)
I. Le sermon de Keble sur « l’Apostasie nationale » donne le signal du Mouvement. Tendances différentes de Newman et Froude d’une part, et de Palmer, Perceval et Rose d’autre part. Publication du premier Tract for the Times. Les Tracts suivants. Etat d’esprit de Newman. Diffusion des Tracts. Palmer voudrait les arrêter. Newman, poussé par Froude, s’y refuse. — II. Adresse à l’archevêque de Canterbury. Succès des Tracts. Leurs doctrines. Newman et l’Eglise de Rome. — III. Accession de Pusey au Mouvement. Modification de la forme des Tracts. La « Bibliothèque des Pères ». Newman se félicite de la position prise par Pusey. Il n’en reste pas moins le chef du Mouvement. — IV. Maladie et mort de Frouée. Que fût-il devenu s’il avait vécu? — V. Newman à Sainte-Marie. Ses efforts pour y développer le culte et la piété. Ses sermons. Caractère de son éloquence. Sujets traités. Action extraordinaire de ces sermons.
I
A son arrivée â Oxford, en juillet 1833, Newman trouve ses amis fort émus du bill qui supprimait une partie des évêchés de l’Eglise anglicane en Irlande. A leurs yeux) c’est l’ouverture d’une ère de persécution: ils sont persuadés que cette première atteinte, portée par l’Etat aux droits de l’Eglise, va être suivie de plusieurs autres. Keble, d’ordinaire peu disposé à se mettre en avant et à batailler, n’est pas le moins excité:
66
le poète tendre et doux du Christian Year lance des vers d’une âpreté toute nouvelle contre « la bande de ruffians, venus pour réformer là où ils ne venaient pas pour prier 1». Appelé, le 14 juillet, à prêcher le sermon des assises devant l’université d’Oxford, il saisit cette occasion de jeter un cri d’alarme. Il applique à ses compatriotes l’avertissement donné par le prophète Samuel aux Israélites qui ne voulaient plus Dieu pour roi. Après avoir rappelé que « l’Angleterre, en tant que nation chrétienne, était une partie de l’Eglise du Christ, et qu’elle était liée, dans toute sa législation et sa politique, par les lois fondamentales de cette Eglise », il déclare que renier ce principe, comme il est fait par le bill en question, c’est répudier la souveraineté de Dieu, et, pour un tel acte, le mot d’ « apostasie » ne lui paraît pas trop fort. « Il y avait autrefois ici, ajoute-t-il, une Eglise glorieuse; mais elle a été livrée aux mains des libertins, pour l’amour réel ou affecté d’une petite paix temporaire et du bon ordre. » Il proclame que, dans une telle crise, tout fidèle churchman doit se dévouer entièrement à la cause de « l’Eglise apostolique» Que les soldats de ce bon combat soient d’abord en petit nombre, que, longtemps encore, ils voient triompher « le désordre et l’irréligion », c’est possible; mais il leur rappelle, en terminant, les promesses faites aux chrétiens, et il leur donne l’assurance que, tôt ou tard, leur cause sera pleinement victorieuse. Aussitôt imprimé sous ce titre: l’Apostasie nationale,
1. Cette pièce fut publiée avec les vers de Newman et d’autres, dans la Lyra apostolica.
67
avec une préface pressant les churchmen de considérer quel devoir leur imposent « l’intrusion » et « l’usurpation » de l’Etat, ce discours a un grand retentissement. Newman a écrit plus tard « qu’il avait toujours regardé et fêté le jour où il avait été prononcé, comme le point de départ du Mouvement 1» Que faire pour donner une suite pratique à cet appel? Quelques clergymen cherchent aussitôt à se concerter. Ce sont, d’abord, Keble, tout échauffé de son discours, Fronde, plus impétueux que jamais, aspirant à la lutte, abhorrant le calme 2, et Newman, auquel la joie de la santé reconquise, de la patrie et des amis retrouvés, de la grande oeuvre à entreprendre, donne une sorte d’exaltation physique et morale qu’on ne lui connaissait pas 3. Ce sont, aussi, trois personnages plus âgés et paraissant avoir une situation plus considérable par leurs fonctions, par leurs travaux, par leurs relations dans le haut monde ecclésiastique : Hugh Rose, de Cambridge, vicar de Hadleigh, esprit élevé, noble caractère, écrivain de talent, très dévoué à la cause de la haute Eglise, et qui, pour grouper ses défenseurs, a fondé, l’année précédente, le British Magazine 4 »
1. Apologie 2. « I deprecate a calm » , écrivait Frouée à Newman. (Letters and Correspondence cf J.-B. Newman, t. I, p. 457.) 3. Parlant lui-même de cette exaltation, Newman dit que ses amis en étaient si surpris qu’ils hésitaient à le reconnaître. (Apologia.) 4. En dédit de quelques divergences d’idées, Newman a toujours eu beaucoup de sympathie et d’estime pour Rose, et, en 1838, au moment où ce dernier se mourait prématurément à l’étranger il lui dédiait un de ses volumes de sermons il s’adressait à lui comme à l’homme « qui, lorsque les coeurs étaient défaillants, les avait appelés à réveiller en eux le don de Dieu et à se ranger autour de leur véritable mère ». (Lett. and Corr., t. II, p. 277.)
68
William Palmer, venu de l’université de Dublin à celle d’Oxford, expert dans les controverses théologiques, quoique sans grande profondeur ni originalité; Arthur Perceval, vicar de East Horsley, type fort respectable du clergyman de noble famille tory. Entre ces deux groupes, venus de milieux différents, mais unis par le sentiment très profond du même péril, des correspondances s’échangent; à la fin de juillet et pendant le mois d’août, plusieurs conférences ont lieu, soit chez Rose, soit à Oxford dans le common room d’Oriel. Tous sont d’accord «qu’il y a quelque chose à faire et qu’il faut le faire très vite» Seulement, quand il s’agit de décider quel est ce « quelque chose », la divergence des vues apparaît. Chez Rose, chez Perceval, et surtout chez Palmer, la préoccupation conservatrice domine : faire échouer les projets de réforme attentatoires aux droits de l’Église leur suffit; c’est dans ce dessein purement défensif qu’ils cherchent à susciter un mouvement d’opinion; de plus, en gens graves et arrivés qui craignent d’être compromis, ils ont le souci que ce mouvement demeure respectable; l’action collective leur paraît la plus efficace et la plus facile à discipliner; ils rêvent donc d’organiser une grande association, et, pour se garantir des excès individuels, ils voudraient que toutes les publications et autres démarches fussent contrôlées par des comités directeurs, composés d’hommes considérables et sages.
69
Une telle prudence n’est pas du goût de Newman et de Froude. Approuvés, sinon guidés, par Keble, ils n’entendent pas se borner à défendre contre les novateurs une Eglise dont l’état ne les satisfait pas; à la réforme « libérale » ils opposent l’idée, encore imparfaitement définie dans leur esprit, mais très profonde, d’une contre-réforme à tendance catholique; ils rêvent de refaire dans les institutions, dans les croyances et dans les âmes, une bonne partie de ce qui a été défait durant les siècles précédents. Ce qui, pour Palmer et ses amis, n’est qu’une campagne cléricale contre les entreprises d’un parti, doit être, dans la pensée de Newman et de Fronde, un mouvement religieux dépassant de beaucoup les accidents contingents de la politique du jour. Loin que ceux-ci se disent « conservateurs» ce mot, dans leur bouche, est presque une injure, et ils se piquent d’être, à leur façon, des « radicaux 1» Pour mettre leurs idées en branle, ils sentent le besoin de parler haut et fort; ils veulent être des «agitateurs »et n’ont pas, comme leurs graves alliés, la peur de se compromettre. « Froude et moi, a écrit plus tard Newman, n’étions personne; nous n’avions point de réputation à perdre, point d’antécédents pour nous enchaîner. « L’enthousiasme leur paraît beaucoup plus nécessaire que la prudence. Ils veulent aller de l’avant, go ahead, au risque de courir quelques aventures et de
1. Newman écrit à son jeune ami Rogers, le 31 août 1833 « Je le confesse, bien que je sois encore tory, théoriquement et historiquement, je commence à être, en pratique, un radical. » Voir dans le même sens une lettre du 8 septembre. (Lett. and Corr. t. I, p. 450, 454.)
70
paraître un peu moins respectable. Avec ces sentiments, est-il surprenant qu’il ne leur plaise guère de voir l’initiative individuelle encadrée dans une grande association, contrôlée par des comités, et qu’aux manifestes collectifs, soigneusement revisés, et par cela même affadis, émoussés, ils préfèrent des écrits personnels, libres et hardis d’allure, où chacun parle sous sa responsabilité? Entre des vues si différentes, l’accord était difficile. L’impétueux Fronde veut faire un éclat et rompre tout de suite avec Rose et ses amis. Newman cherche à le calmer et y emploie l’autorité de Keble 1. Mais, s’il n’entend point répudier légèrement le concours d’hommes considérables et sincères, il n’en agit pas moins de son côté et suivant ses idées. Dès le 9 septembre 1833, avec la vive approbation de Keble et de Froude, et sans avoir consulté ses autres alliés, il lance le premier des Tracts for the Times. C’est un écrit de trois pages, sans signature. Il débute ainsi: «A mes frères dans le sacré ministère, les prêtres et les diacres de l’Eglise du Christ en Angleterre, ordonnés pour cela par le Saint-Esprit et l’imposition des mains. — Compagnons de travail, je ne suis que l’un de vous, — un prêtre; si je vous cache mon nom, c’est de peur de m’arroger trop d’importance, en parlant en mon propre nom. Mais je dois parler ; car les temps sont très mauvais, et personne ne parle contre eux. N’en est-il pas ainsi? Ne sommes-nous pas à nous regarder l’un l’autre, sans rien faire? Ne confessons-nous pas, tous,
1. Lett. and Corr., t. 1, p. 439, 442.
71
le péril dans lequel l’Eglise se trouve, et cependant chacun ne demeure-t-il pas tranquille dans son coin, comme si des montagnes et des mers séparaient le frère de son frère? Souffrez donc que j’essaye de vous tirer de ces plaisantes retraites dont vous avez eu le bonheur de jouir jusqu’à présent, pour considérer d’une façon pratique l’état de notre sainte Mère et l’avenir qui lui paraît réservé; de telle sorte que chacun puisse se défaire de cette mauvaise habitude qui nous a gagnés tous, de reconnaître que l’état de choses est mauvais, tout en ne faisant rien pour y remédier. » L’auteur continue sur ce ton, secouant ceux qu’il veut réveiller de leur léthargie. Mais suffit-il de leur faire bien sentir le péril? Comment rendre courage à une Eglise, désemparée, abattue à la pensée que la menace vient de cet Etat sur lequel elle avait l’habitude de s appuyer? Ici apparaît l’idée maîtresse non seulement de ce tract, mais de toute cette première période du Mouvement, c’est la doctrine de la Succession apostolique. Le tract rappelle en termes vifs, nets, pressants, à ce clergé qui l’avait oublié, que son pouvoir ne dépend pas de l’Etat, qu’il doit y voir un don de Dieu, transmis sans interruption des apôtres aux évêques et des évêques aux prêtres qu’ils ont ordonnés. Et ainsi il s’efforce de lui hausser le coeur, de lui rendre la conscience, depuis trop longtemps perdue, de son autorité, de sa dignité et de sa grandeur, de lui faire entrevoir une conception plus surnaturelle de l’Eglise et de la religion. D’autres tracts suivent, coup sur coup, en septembre et dans les mois suivants. Le second s’attaque au bill
72
irlandais et lui reproche d’avoir été pris sans l’avis de l’Église; le troisième dénonce des altérations dans la liturgie et les services funèbres; le quatrième revient sur la succession apostolique; le cinquième expose la constitution de l’Eglise du Christ et celle de la branche de cette Eglise, établie en Angleterre; les suivants traitent de sujets analogues, insistant de préférence sur l’organisation divine de l’Eglise, ses sacrements, sa liturgie, et s’appliquant à rendre en tout la religion plus haute, plus profonde, plus réelle. Ils ont même aspect, même caractère que le premier, se réduisent à quelques feuillets 1, vont droit et vivement au but, ne craignent pas de surprendre, même de heurter, souvent cris d’alarme, appels de secours, « comme d’un homme qui jette l’annonce d’un incendie ou d’une inondation 2» Pas de signature : on a seulement soin de faire savoir que ces écrits émanent d’Oxford; Newman attache beaucoup d’importance à cette origine; il est convaincu que « les universités sont les centres naturels des mouvements intellectuels 3 », qu’Oxford en particulier a toujours exercé et peut encore exercer une grande influence sur l’Eglise d’Angleterre ; il désirerait, mais n’ose pas, intituler ses publications: Oxford tracts; il compte, non sans raison, que le public leur appliquera de lui-même cette
1. « Un tract est assez long, écrit Newman à Perceval, s’il remplit quatre pages in-8°. » Quelques-uns cependant ont sept, huit et même onze pages. 2. C’est ainsi qu’en 1836 l’avertissement placé par les éditeurs en tête du 3e volume de la collection des Tracts caractérisait les premiers de ces tracts. 3. Apologia.
73
étiquette 1. Pour la rédaction de ces feuilles, quelques amis lui viennent eu aide; ainsi le quatrième tract est de Keble, et le cinquième d’un légiste, ancien camarade d’université de Newman, ami très fidèle et très cher de la première heure, John William Bowden 2. Fronde, empêché par la maladie, ne peut donner le concours attendu de lui : il est réduit à stimuler l’ardeur des autres. Le plus grand nombre des Tracts (neuf sur les dix-sept premiers) et aussi les plus brillants, les plus saisissants, sont de Newman. Sans aucune recherche d’effet littéraire, avec le seul souci d’imprimer fortement dans les esprits les idées dont il est possédé et dont il croit la diffusion nécessaire au bien de l’Eglise, il révèle, dans ces feuilles courtes et rapides, des qualités d’écrivain, jusqu’alors ignorées du public et peut-être de lui-même : il s’y montre surtout avec ce don incomparable qui lui faisait pénétrer plus avant que personne au point sensible des âmes. Son activité, du reste, est alors prodigieuse : en même temps que les tracts, il écrit des articles dans le British Magazine et dans d’autres recueils, médite la fondation d’une revue trimestrielle, publie ses vers de la Lyra apostolica, fait imprimer son livre sur les Ariens, poursuit ses études sur les Pères de l’Eglise et sur les théologiens anglicans du XVIIe siècle. L’ardeur que Newman apportait à toutes ces oeuvres n’allait pas sans une certaine excitation fièvreuse. Lui-
1. Lett. and Corr., t. T, p. 440, 483; t. II, p. 8. 2. Au moment de la mort de M. Bowden, en 1844, Newman a parlé dans les termes les plus émus de ce qu’avait été pour lui cette intimité de vingt-sept ans. (Lett. and Corr., t. II, 435-8.)
74
même a raconté plus tard quelle était, à ces débuts du Mouvement, son exubérance d’énergie batailleuse; la plume à la main ou dans la conversation, sa discussion devenait parfois agressive; il ne lui déplaisait pas d’affronter les gens, de les effaroucher ou de s’en jouer avec une ironie un peu dédaigneuse; c’est ce qu’il a appelé, en s’en confessant, sa « période de fierceness ». Toutefois on se ferait une idée bien incomplète et bien fausse, si on ne voyait en lui, qu’un agitateur absorbé par la lutte extérieure. Ce qui domine, au contraire, chez Newman, même à ces heures d’excitation, c’est l’homme intérieur, non seulement celui dont l’intelligence toujours en travail est altérée des vérités divines, mais celui dont l’âme aspire à un idéal de sainteté et cherche à s’élever le plus près possible de Dieu. Au milieu du combat, sa vie spirituelle demeure intense. Il a fait d’un cabinet de débarras situé près de sa chambre, à Oriel, un oratoire où il passe souvent la nuit à réciter des prières, les prononçant si haut que ceux qui rentraient au collège l’entendaient 1. Ses démarches, ses écrits, ses polémiques, il les rapporte à Dieu. « J’ai la conscience, écrit-il à une de ses soeurs, que, malgré mes fautes, je désire vivre et mourir pour sa gloire, me livrer entièrement à lui, comme son instrument, quelque ouvrage qu’il me demande, quelque sacrifice personnel qu’il m’impose 2. » Ce qu’en dépit de son humilité et de sa réserve un peu farouche le public entrevoyait de sa piété si fervente et si profonde, de son absence com-
1. Mozley, Reminiscences, t. I, p. 396. 2. Lett. and Corr., t. II p., 170.
75
plète de toute ambition mondaine, de la discipline qu’il exerçait sur lui-même, de son austérité, n’était pas la moindre raison de son autorité morale. Écrire les tracts ne suffisait pas; il fallait faire en sorte qu’ils arrivassent au public. La difficulté, au début, fut assez grande. Aucun nom d’auteur n’attirait l’attention. Les libraires étaient peu empressés à se charger du placement d’une marchandise trop minime pour les payer de leur peine; la poste d’alors, encore coûteuse, n’offrait pas les facilités d’aujourd’hui. Des amis zélés entreprirent de distribuer eux-mêmes ces feuilles et passèrent des journées à courir, à cheval, d’un presbytère à l’autre, munis d’instructions de propagande rédigées par Newman 1. Lui-même donnait l’exemple et allait, par la campagne, visiter des clergymen qu’il ne connaissait pas, pour leur porter ses publications 2. L’effet fut tout de suite considérable. Sous l’impression de cette parole nouvelle, le monde ecclésiastique, qui paraissait si éteint, si déprimé, eut comme un tressaillement inattendu. Jusqu’alors, sous l’étiquette de tracts, on n’avait guère connu que les fadeurs édifiantes des sociétés bibliques : voilà, certes, qui y ressemblait peu. On lisait avec curiosité; on était surpris, saisi, remué. Parmi les clergymen, plusieurs se sentaient flattés, consolés, fortifiés, d’apprendre qu’ils avaient des titres surnaturels qui les distinguaient du ministre dissident et contre lesquels l’Etat ne pouvait rien. Leur horizon, naguère abaissé et rétréci, s’élevait
1 Lett. and Corr., t. II, p. 4. 2 Apologia.
76
et s’élargissait. On eût dit même, à voir l’empressement reconnaissant de leur adhésion, que cette vue plus haute, plus profonde de la religion, répondait à un besoin depuis longtemps vaguement ressenti, à une attente de leurs âmes4. Beaucoup d’autres, il est vrai, effarouchés dans leurs préjugés protestants, inquiétés dans leur routine, déclaraient les idées suspectes, la forme choquante. Les évêques, entre autres, goûtaient peu ces gens incommodes qui venaient troubler leur quiétude : comment n’eussent-ils pas trouvé étrange et malsonnant un écrit où, comme dans le premier tract, après avoir exalté leur office, on déclarait « ne pouvoir leur souhaiter une fin plus bénie que la spoliation de leurs biens et le martyre » ? Ils n’étaient pas, d’ailleurs, les moins étonnés ni surtout les moins embarrassés de s’entendre dire qu’ils étaient les successeurs des apôtres, eux qui ne s’étaient considérés jusqu’alors que comme des dignified gentlemen, choisis par la couronne pour administrer le département ecclésiastique. La plupart ne s’étaient jamais demandé ce qu’ils pensaient de cette doctrine, et l’un d’eux, en lisant le tract qui en parlait pour la première fois, ne pouvait parvenir à se rendre compte s’il l’admettait ou non 2. Palmer et Perceval, en dehors desquels Newman avait commencé les tracts, étaient fort troublés du tour qu’ils prenaient, du bruit qu’ils faisaient, des
1. Manning a affirmé que la majorité du clergé anglican était prédisposé à recevoir les principes et l’esprit du Mouvement d’Oxford. » (England and Christendom, Introduction, p. 38.) 2. Apologia.
77
émotions qu’ils suscitaient 1. Ce n’était plus du tout la campagne prudente qu’ils avaient rêvée. Non qu’ils n’adhérassent à beaucoup des doctrines soutenues, notamment à celle de la succession apostolique, mais ils trouvaient le ton mauvais; ils s’inquiétaient de l’effet produit sur les hauts dignitaires ecclésiastiques, dont ils recevaient journellement les plaintes, et ils craignaient de se trouver compromis. Dès le milieu de septembre 1833, à peine les premiers tracts parus, Palmer émit la prétention qu’aucune publication de ce genre n’eût lieu désormais sans l’autorisation d’un comité directeur 2. Newman sentait bien que ce serait ôter toute efficacité à ces écrits. « Si, disait-il, vous les corrigez suivant les désirs d’un comité, vous n’aurez plus que des compositions adoucies, émoussées, qui n’auront de prise sur personne 3. » On avait été violent, il le reconnaissait; c’était nécessaire pour saisir et agiter l’opinion; de cette agitation, il ne fallait pas s’effaroucher. « On ne gagne rien, disait-il, en se tenant tranquille. Je suis sûr que les apôtres ne se tenaient pas tranquilles 4 ».
1. Rose, au contraire, paraissait content des premiers tracts. (Lett. and Corr., t. I, p. 434, 463; t. II, p. 7.) 2. il était, à la vérité, facile à influencer dans un sens opposé. (Ibid., t. II, p. 34, 36.) Lett. and Corr., t. I, p, 457. 3. Ibid., t. I, p. 463. 4. Ibid., t. 1, p. 449. — Newman, quelques mois plus tard, revenait sur la même idée, dans une lettre à Perceval: « Pour ce qui est des tracts, lui écrivait-il, chacun a son goût. Vous faites des objections à ceci, d’autres en font à cela. Si nous changions pour plaire à chacun, l’effet serait gâté. Les tracts n’ont jamais eu la prétention d’être des symboles ex cathedra, mais l’expression d’opinions individuelles. Des individus à convictions énergiques peuvent d’ailleurs se tromper fortuitement dans la forme ou dans les termes, ils n’en auront pas moins une action particulièrement efficace. Aucune grande oeuvre n’a été faite par un système. tandis que les systèmes sortent des efforts individuels. Luther était un individu. Les fautes d’un individu elles-mêmes éveillent l’attention. Il perd, mais sa cause (si elle est bonne et s’il a, lui, l’esprit puissant) gagne. Telle est la marche des choses : nous faisons avancer la vérité en nous sacrifiant nous-mêmes. » (Ibid.,t. II, p. 57.)
78
Cependant, avec le temps, loin de s’apaiser, l’émoi et le mécontentement de Palmer augmentaient. II parla de faire une circulaire qui désavouât les tracts et pesa sur Newman pour obtenir qu’il en suspendît la publication; il annonça même à ses amis du High Church cette suspension comme faite. Sous cette pression, la nature nerveuse et sensitive de Newman passait par des impressions contraires. Tantôt il était tout feu pour résister; il énumérait avec confiance les amis sur la collaboration desquels il croyait pouvoir compter, les sympathies qui faisaient sur tant de points éclosion, et il déclarait s’inquiéter peu des mécontents : « Nous les battrons 1! » écrivait-il. D’autres fois, il paraissait ébranlé; il se faisait scrupule d’être trop attaché à son sentiment personnel et de heurter des hommes qu’il honorait; il se demandait s’il ne risquait pas de se trouver seul, sans les concours nécessaires : un moment même, il fut sur le point de céder 2. Dans cette anxiété, qui lui était douloureuse, il écrivit à son cher Froude, que la maladie avait obligé à s’éloigner, et implora de lui un conseil qui fît la lumière 3. La réponse ne se fit pas attendre; elle fut nette. «Quant à abandonner les tracts,
1. Lett. and Cor., t. I, p. 482. 2. Ibid., t. I, p. 478, 479; t. II, p. 32, et Apologia. 3. Ibid., t. I, p. 479.
79
écrivit Froude, le 17 novembre 1833, l’idée seule en est odieuse. Nous devons jeter par-dessus bord les Z’s 1. » Keble, aussi, encouragea Newman: « J’aime de plus en plus vos feuilles », lui manda-t-il le 19 novembre 2. Ainsi réconforté, Newman ne fut plus tenté de céder. Il maintint résolument les tracts et n’hésita pas à en justifier le ton. Un de ses amis, le révérend Rickards, ayant jugé à propos de lui adresser une protestation contre « l’esprit irrité et irritant » dans lequel ces feuilles étaient écrites, il lui répondit, le 22 novembre 1833 : «Vos lettres sont toujours bien reçues, et je n’imagine pas que celle qui censure le soit moins bien. Fidèles sont les coups d’un ami, et je suis d’avance certain que je les ai mérités sous plus d’un rapport. Pour ce qui est de nos oeuvres actuelles, nous sommes lancés et, avec l’aide de Dieu, nous irons eu avant, à travers les bons ou les mauvais rapports qu’on fera de nous, à travers les fautes vraies ou supposées. Nous sommes comme des hommes escaladant un rocher; ils y déchirent leurs vêtements et leur chair, glissent ici et là, avancent cependant (puisse-t-il en être ainsi!) et ne s’inquiètent pas des critiques des spectateurs, pourvu que leur cause gagne tandis qu’ils perdent... Notre position est celle-ci sans lien avec aucune association, sans responsabilité envers personne, sauf envers Dieu et son Eglise, n’engageant la responsabilité de personne,. portant le blâme, faisant
1. Lett. and Corr., t. I, p. 184. Froude avait coutume d’appeler Z’s les old fashioned High-Churchmen. 2. Ibid., t. I, p. 485.
80
l’ouvrage. J’ai conscience de parler sincèrement, en déclarant consentir de bon coeur qu’on dise de moi que je vais trop loin, pourvu que je fasse faire un peu de chemin à la cause de la vérité. Certainement, c’est l’énergie qui donne du tranchant à tout dessein, et l’énergie est toujours imprévoyante et exagérée. Je ne le dis pas pour excuser de tels défauts, ou parce que j’ai conscience de les avoir moi-même; je le dis comme consolation et explication à ceux qui m’aiment et sont tristes de certaines choses que je fais. Qu’il en soit ainsi. Il est bien de tomber, si vous tuez votre adversaire, et je ne peux souhaiter à personne un sort plus heureux que d’être soi-même malheureux et cependant de hâter le triomphe de sa cause; ainsi, dans leur temps, Land et Ken laissèrent un nom que les âges suivants censurent ou prennent en compassion, mais leurs oeuvres leur survivent... » Plus loin, il justifiait le ton des tracts, en disant qu’il était « nécessaire d’éveiller le clergé ». « Je consens volontiers, dit-il, qu’on dise de moi que j’écris d’une façon irritée et irritante, si par là je réveille les gens. Or je maintiens que, par ce moyen seul, on peut les remuer. » Puis, après avoir répondu aux autres critiques, il ajouta ces lignes où se trahissent les impressions de cette âme si complexe, et ce qu’à l’heure même de ses plus fermes résolutions, elle gardait de sensibilité douloureuse : « Nous prendrons volontiers vos avis; nous vous remercierons de vos coups, mais nous suivrons notre ligne d’après les lumières que nous donnent le Seigneur tout-puissant et sa sainte Eglise. Nous avons la confiance d’être
81
indépendants de tous les hommes, de n’être exposés à être arrêtés par personne, et quant à la faiblesse d’être peiné des critiques, j’espère m’en être débarrassé. Il fut un temps où de savoir la plus grande partie d’Oxford contre moi m’eût chagriné; qu’il n’en soit plus ainsi, je le crois ; mais je souffre encore quand je suis critiqué par mes amis. Ne supposez pas que je sois trop loué; je n’entends parler que de mes fautes. Cela est bon pour moi, mais quelquefois je suis disposé à désespérer, et c’est avec difficulté que je demeure à mon ouvrage. Je suis aussi disposé à aller à l’autre extrême; je me figure hargneusement que les hommes sont mes ennemis, et je vais au-devant de leur opposition, comme si elle devait naturellement se produire. Mais assez de ceci 1.»
II
Le projet de grande association, cher à Palmer et à ses amis, n’avait pu aboutir: en n’était parvenu qu’à fonder, sur divers points, des sociétés locales 2. On se rabattit sur l’idée, mise en avant par Newman 3, d’une adresse dans laquelle les membres du clergé affirmeraient à l’archevêque de Canterbury leur attachement à l’Eglise et à ses droits. Bien que la rédaction de cette adresse eût été successivement atténuée pour plaire aux uns et aux autres, et qu’elle ne fût plus guère, à la
1. Lett. and Corr., t. 1, p. 485-91. 2. Ibid., t. I, p. 450.454. 3. Ibid., t. 1, p. 467-9.
82
fin, comme disait l’archidiacre Froude, le père de Richard Hurrell, qu’un « produit lait et eau » (milk-and-water production)1, il n’était pas sans intérêt d’avoir mis en mouvement les sept mille clergymen dont on avait réuni les signatures : on donnait ainsi aux défenseurs de l’Eglise, jusqu’alors dispersés et isolés, conscience de leur nombre et de leur cohésion; on avertissait les évêques qu’ils avaient à compter avec les sentiments de leur clergé. L’adresse fut présentée au primat, en février 1834, et suivie, peu après, d’une adresse de laïques, rédigée dans le même esprit et signée par deux cent trente mille chefs de famille. Pour importantes qu’elles fussent, ces adresses n’étaient qu’un épisode sans suite. L’action permanente se manifeste toujours par les tracts. En 1834, personne ne songe plus à les arrêter. Plus n’est besoin de les répandre de la main à la main; leur notoriété aide à leur diffusion, sans cependant supprimer les tracas financiers qui pèsent lourdement sur Newman. Quelques-uns sont tellement demandés qu’il faut en publier une seconde édition. Ce n’est pas qu’ils pénètrent également partout. Dans le peuple, dans la petite bourgeoisie, ils sont ignorés ou suspects. C’est dans le monde cultivé, dans le clergé, chez les laïques ayant passé par les universités, qu’ils sont lus avec curiosité, discutés avec passion. Les contradictions sont nombreuses et deviennent plus vives avec le succès; les evangelicals dénoncent avec horreur les tendances papistes des tractarians; les two bottle ortho-
1. Lett. and Corr., t. I, p. 492.
83
dox raillent leur ascétisme; les « libéraux » dénoncent leur rigueur dogmatique; ceux qui se piquent de sagesse les accusent de témérité, d’exagération et de violence; la masse des esprits frivoles leur en veulent de les obliger à réfléchir sur certains sujets gênants et d’ajouter ainsi à leur responsabilité. Mais, si les critiques augmentent, il en est de même des sympathies; elles éclatent sur tous les points à la fois, souvent là où on n’a nulle raison de les attendre. « Elles font leur chemin d’une façon si subtile, dit Newman, qu’on ne trouve aucune trace apparente de leur passage 1. » En tous cas, favorables ou hostiles, les esprits sont remués. C’est ce que voulait Newman. « Notre besogne, écrit-il, est de donner aux gens, de temps en temps, un coup pour les pousser en avant 2. » Une autre fois, il compare « le stimulant des tracts à l’application de sels volatils à une personne pâmée; c’est piquant, mais fortifiant 3 ». Il ne compte pas, du reste, sur des résultats immédiats. « Nos temps ne sont pas encore venus, » écrit-il, et il ajoute : « Je n’attends rien de favorable avant quinze ou vingt ans 4. » Pour affirmer et justifier le franc et hardi parler qui continue à être le caractère des tracts, Newman a décidé d’y ajouter cet épigraphe : « Si la trompette rend un son incertain, qui se préparera à la bataille 5? » Il n’est
1. Article inséré dans le British Critic d’avril 1839 sur l’Etat des partis religieux. 2. Lett. and Corr., t. II, p. 48. 3. Ibid., t. II, p. 92. 4. Ibid., t. II, p.48, 124. 5. Ibid., t. II, p. 48.
84
pas plus disposé que par le passé à donner raison à ceux qui lui reprochent d’avoir été trop loin. «Je ne puis me repentir, dit-il, d’aucun passage des tracts. S’ils étaient à refaire, — je ne dis pas que j’aurais le courage, car les attaques rendent timide, — mais j’aurais le désir de les faire exactement de même 1. »C’est toujours lui qui en écrit le plus grand nombre, mais il se fait davantage aider. A Keble et aux quelques collaborateurs de la première heure, d’autres se joignent. II n’est pas jusqu’à Perceval, et même à Palmer, qui, malgré leurs griefs, ne consentent à donner leur concours. Quant à Froude, l’aggravation de sa maladie l’a obligé à partir pour les Barbades; il n’est pas pour cela étranger à ce qui se fait. Newman est en correspondance avec lui, l’informe, le consulte, se déclare malheureux de publier quoi que ce soit sans son imprimatur, et, en dépit de l’éloignement, s’appuie tendrement sur lui aux heures d’ennui ou de difficultés. « Où que vous soyez, lui écrit-il, vous ne pouvez être séparé de nous 2. » Froude, de son côté, tout en se dévorant du regret d’être retenu loin du champ de bataille, encourage, excite les combattants, les met en garde contre toute velléité de concession, leur souffle sa passion. Il s’applique notamment à tenir en haleine son cher maître Keble et, comme il dit plaisamment, à« exciter sa rage . — « Il est mon feu, ajoute-t-il, mais je suis son poker 3. »
1. Lett. and Corr., t. II, p. 41. 2. Ibid., t. II p. 87. 3. Ibid., t. I, p. 475.
Les sujets de chaque tract sont ceux que, suivant l’inspiration du moment, les rédacteurs jugent utiles à la renaissance religieuse qu’ils poursuivent. Ainsi continue-t-il à y être beaucoup question de l’Eglise, de son autorité, de son gouvernement, des objections couramment faites à ses droits; on y parle aussi de la prière publique, de la liturgie, du relâchement de la discipline, de la mortification, du jeûne, de la communion fréquente, etc. Les vérités sont vivement affirmées, mises en lumière, plutôt que discutées et prouvées. Entre ces fascicules qui se suivent à intervalles irréguliers, aucun ordre logique; rien d’un enseignement didactique; nulle prétention de présenter un système complet. Ce système, d’ailleurs, les rédacteurs eussent-ils pu le formuler? Ils étaient partis en campagne avec le sentiment du danger que courait l’Eglise et de la direction dans laquelle devait être cherché le salut; mais, comme l’a confessé plus tard Newman, «ils eussent été fort embarrassés de dire quel était leur but positif; ils énonçaient certains principes pour eux-mêmes, parce que ceux-ci étaient vrais, parce qu’ils se sentaient comme forcés de les proclamer...; mais, s’il leur avait fallu déterminer l’application pratique de leurs prédications, rien ne leur eût été plus difficile... Il semblait, en vérité, qu’on proclamât les principes au hasard, tant le but était incertain, tant aussi on les adoptait Dieu sait comment » 1. Cette incertitude ne
1. Lectures on Anglican difficulties. Ces lectures furent données à Londres, par Newman, peu après sa conversion au catholicisme.
86
tenait pas seulement à ce que, suivant un autre aveu de Newman, «on aurait eu peine à trouver deux des rédacteurs qui fussent d’accord sur la limite à laquelle leurs principes généraux pouvaient être portés 1 »; elle tenait à ce que, chez chacun d’eux, les idées, loin d’être fixées, étaient en formation. Cela était vrai de Newman plus que de tout autre. Il se piquait de revenir à la doctrine des théologiens anglicans du XVIIe siècle et des anciens Pères; or il n’en avait, au début, qu’une connaissance superficielle et de seconde main; il les étudiait, tout en combattant, et y cherchait, au jour le jour, sa direction, comme un voyageur qui, se lançant en pays inconnu, consulterait à chaque pas sa carte. N’avait-il pas toujours eu «l’instinct que son esprit était en route 2» vers un but qu’il n’apercevait pas clairement? Dans les stances fameuses qu’il écrivait en revenant de Sicile et où il demandait à la «bienfaisante lumière» de guider sa marche, il ne souhaitait pas de «voir la scène lointaine». — «Un seul pas, disait-il, c’est assez pour moi.» …I do not wish to sec The distant scene, one step enough for me 3 .
Toutefois, on peut discerner chez Newman, dès cette première période des tracts, quelques doctrines principales sur lesquelles il est bien fixé et qu’il met tout de suite en relief. D’abord, comme direction géné-
1. Apologia. 2. Ibid. 3. J’ai déjà eu occasion de citer en entier ces stances : cf. plus haut, p. 64.
87
rale, il prétend revenir à un anglicanisme idéal qui aurait été celui des théologiens du XVIIe siècle et du Prayer-book interprété dans un sens catholique, et qui se rattacherait au christianisme primitif des Pères: il veut défaire ce qui a été fait depuis cent cinquante ans pour protestantiser l’Eglise d’Angleterre, et par contre veut y revivifier certaines doctrines qu’on y a laissées mourir; du protestantisme, il répudie le mot et la chose1. En second lieu, pour réagir contre les tendances latitudinaires de l’école «libérale», il professe que le dogme est le fondement nécessaire de la religion; il réprouve la tendance qu’ont des esprits, même religieux, à ne pas attacher d’importance aux dissidences doctrinales; il se plaint que le clergé n’ait plus aucune éducation théologique, et, tout en tâchant de refaire la sienne, il travaille à refaire celle des autres. Il soutient encore le principe d’une Eglise visible, instituée par Dieu, se perpétuant et se gouvernant par des évêques qui tiennent leur pouvoir de la succession apostolique, ayant autorité pour enseigner et administrer les sacrements. Enfin, en opposition avec l’érastianisme de fait ou de droit alors dominant dans l’anglicanisme, il proclame que cette Eglise, par son origine divine, est indépendante de l’Etat, avec lequel elle a pu être unie, mais auquel elle’ ne doit plus être subordonnée comme elle l’a été depuis la Réforme; indépendance jugée par lui si essentielle ,qu’au besoin, pour la garantir, il ne pas reculerait pas devant la séparation, le disestablishment.
1. Lett. and Corr., t. II, p. 59.
88
Quant à déduire et à préciser., sur tels points particuliers, les conséquences de ces principes généraux, Newman ne le faisait que suivant le progrès de ses propres convictions et aussi suivant ce que les esprits de son temps lui paraissaient pouvoir porter de vérités nouvelles. De là, par exemple, ses tâtonnements en ce qui touche l’Eucharistie. Il avait été amené par Froude, avant le commencement des tracts, à la croyance dans la présence réelle; mais, à la différence de son ami, il était demeuré opposé à la transsubstantiation. Ayant parlé, dans un des premiers traces, du pouvoir qu’avaient les ministres «de faire du pain et du vin le corps et le sang du Christ», il fut blâmé par son ami, le « révérend Rickards, et avouait, en réponse, avoir peut-être commis une «imprudence» en heurtant « les idées terriblement basses (low)» qui avaient cours autour de lui sur le Saint Sacrement. Un peu plus tard, il reproduisait en tract un écrit de l’évêque Cosin contre la transsubstantiation; ce fut au tour de Froude de se plaindre : « Y avait-il donc à craindre, demandait ce dernier, que les membres de l’Eglise d’Angleterre ne surfissent le miracle de l’Eucharistie?» Pour se justifier, Newman expliquait que, sous couleur d’attaque contre la transsubstantiation, il avait voulu habituer les esprits à s’exercer sur le sujet, absolument nouveau pour eux, de la présence réelle; il entendait ainsi les préparer à un tract où Keble devait exposer une high eucharistie doctrine 1. Une autre fois, non dans un tract, mais dans un article du British Magazine, il
1. Lett. and Corr., t. I, p. 490 ; t. II, p. 31, 82.
89
prenait la défense du monachisme que Froude et lui avaient fort à coeur; les représentations qui lui furent faites lui firent craindre d’avoir été trop hardi. « Je vais rentrer mes cornes », écrivait-il 1. Ce ne fut pas le seul cas où il crut devoir « rentrer ses cornes»: il était d’autres doctrines, institutions, pratiques qu’il enviait au catholicisme et qu’il aurait voulu lui reprendre, mais au sujet desquelles il ne jugeait pas encore possible de passer outre aux préventions de ses coreligionnaires. Le mouvement religieux que Newman cherchait à provoquer était-il donc, dans sa pensée, une façon de s’acheminer vers Rome ? Beaucoup l’en accusaient. II ne s’en étonnait pas. « Je m’attends, écrivait-il dès le 22 novembre 1833, à être appelé papiste 2 » Mais il ne croyait pas mériter ce reproche. Si, sous l’influence de Froude, ses préjugés contre Rome s’étaient atténués, ils n’avaient pas entièrement disparu. Par plus d’un côté, l’Eglise catholique, mieux connue de lui, plaisait à son imagination, touchait son coeur; mais sa raison lui demeurait aussi contraire que jamais; il se sentait tenté de l’admirer, de l’aimer, et contraint de la condamner. Quant à devenir personnellement romanist, écrivait-il, cela semble de plus en. plus impossible. » Dans les premiers tracts, les attaques contre l’Eglise romaine abondent: elle y est déclarée incurable, malicieuse, cruelle, pestilentielle, hérétique, monstrueuse, blasphématoire » ; elle a apostasié au Concile de Trente,
1 Lett. Corr., t. II, p. 112. 2. Ibid., t. 1, p. 490.
90
et il est à craindre qu’alors toute la communion romaine ne se soit liée par un pacte perpétuel à cause de l’Antéchris 1» Froude, dans ses lettres, blâmait ces violences 2. Newman ne méconnaissait pas qu’un tel langage était au moins vulgaire et déclamatoire, mais il se disait qu’après tout il pensait du romanisme ce qu’il en écrivait, que ces protestations étaient nécessaires à la situation de son Eglise, conforme à la tradition de tous ses théologiens, y compris ceux du XVIIe siècle, et qu’enfin c’était une façon de se couvrir personnellement contre le reproche de papisme. Il ne pensait pas se. mettre en opposition avec ces sentiments, en cherchant à réintroduire dans l’anglicanisme tant de doctrines et de pratiques catholiques bien au contraire, il voyait là une façon de raffermir les fidélités ébranlées de ses coreligionnaires. Fait remarquable, à une époque où, en Angleterre, les catholiques, abattus par tant de siècles de persécution, semblaient avoir perdu toute espérance, Newman avait l’intuition et la préoccupation des progrès possibles du catholicisme dans son pays. Il s’en expliquait ouvertement dans l’Avertissement du premier volume des Tracts, publié à la fin de 1834. Il y montrait comment les âmes, déçues par le vide de l’anglicanisme, étaient conduites à chercher un «refuge » dans le méthodisme et le papisme, devenus ainsi « les mères nourricières d’enfants délaissés ». Et il ajoutait : « L’abandon du service quotidien, la profanation des fêtes, l’Eucharistie
1. Cf. passim, Tracts, n” 3, 7, 8, 15, 20, 38, 40, 41, 48. 2. Voir, par exemple, Lett. and Corr., t. II, p. 141.
91
rarement administrée, l’insubordination permise dans tous les rangs de l’Eglise, les ordres et les offices imparfaitement développés, le manque d’associations pour des objets religieux particuliers, et d’autres lacunes semblables conduisent l’esprit fiévreux, désireux d’une issue pour ses sentiments et d’une règle de vie plus stricte, d’un côté aux petites communautés religieuses, aux prières et aux meetings du parti biblique, d’autre part aux services solennels et captivants par lesquels le papisme gagne ses prosélytes. » C’était pour « arrêter cette extension du papisme » à laquelle les divisions croissantes du monde religieux préparaient trop clairement la voie », qu’il tentait de restituer à l’anglicanisme les vérités et les pratiques qui attiraient les âmes à l’Eglise romaine. Seulement, dans cette réaction, où s’arrêter, pour demeurer toujours séparé de Rome? Ce point d’arrêt, il s’appliquait à l’établir dans les tracts n° 38 et 40, écrits vers la fin de 1834: sous forme d’un dialogue entre un clergyman et un catholique, il y exposait ses vues d’une façon plus systématique qu’il ne l’avait fait jusqu’alors et s’essayait à fixer ce qu’il appelait, d’un nom déjà employé avant lui, la via media, c’est-à-dire la direction intermédiaire à suivre par l’Eglise d’Angleterre entre Rome et le protestantisme. Que de fois, dans les années qui allaient venir, Newman devait reprendre sur d’autres bases cette via media! Pour le moment il croyait l’avoir solidement établie, et il était tout à la confiance qu’elle lui inspirait 1.
1. Lett. and Corr., t. II, p. 66.
92
III
A la fin de 1834, quarante-six tracts avaient été publiés. Ce fut la matière d’un premier volume. Ils continuèrent en 1835, et, pendant le premier semestre, on en compta encore une vingtaine. Toutefois, vers le milieu de cette année, apparurent quelques signes de fatigue. Newman, sur qui retombait presque toute la charge, commençait à la trouver un peu lourde ; il désirait se réserver le temps de travaux de plus longue haleine. Parmi les collaborateurs dont il lui fallait accepter le concours, tous n’avaient pas également réussi; il avouait que quelques-uns des fascicules publiés n’avaient guère été que des « bouche-trou» N’était-il pas à craindre que l’effet général n’en fût affaibli? Et puis, le tract, sous la forme qu’on lui avait donnée jusqu’alors, sorte de cri d’appel ou d’alarme, n’était-il pas surtout utile pour ouvrir la campagne? A le trop prolonger, ne risquait-il pas de s’user? Ces réflexions travaillaient l’esprit de Newman. Il en était venu à envisager sérieusement l’idée d’interrompre ces publications. «Les tracts sont morts, ou in extremis », écrivait-il à Froude, le 9 août 1835 2, C’est à ce moment critique que l’accession d’un collaborateur considérable vint leur redonner une impulsion nouvelle. Pusey, malgré l’amitié qui l’unissait à Newman, n’avait pas fait partie, à l’origine, de ceux qu’on appe-
1. Lett. and Corr., t. 11, 137, 138. 2. Ibid., t. II, p. 124.
93
lait les tractarians. Etait-ce sa gravité de professor regius qui hésitait à se compromettre dans une guerre de partisans? N’était-ce pas aussi qu’il trouvait qu’on allait un peu loin 1? Son attitude n’était cependant pas d’un adversaire; il s’intéressait à l’oeuvre où son ami était si engagé, s’occupait de la diffusion des tracts, s’indignait quand on dénaturait les intentions de leurs auteurs. Newman notait avec joie les témoignages de cette sympathie, tout en souhaitant vivement qu’elle devînt plus active. Comme il énumérait, en novembre 1833, les « amis » du Mouvement, il croyait pouvoir y compter Pusey, mais il ajoutait « qu’il ne fallait pas le mentionner comme étant de leur parti 2». Un peu plus tard, à la fin de 1833, il obtenait que Pusey, tout en protestant « ne vouloir pas être un des leurs 3 », donnât, pour être inséré dans les tracts; un travail sur le jeûne, où il s’attaquait à ceux qui ne voulaient pas s’astreindre aux jeûnes ou abstinences indiqués dans le Prayer-Boock, spécialement à l’abstinence du vendredi. Pour bien marquer qu’il n’acceptait que la responsabilité de son propre écrit et qu’il ne se confondait pas avec les autres rédacteurs, Pusey avait exigé que son tract, à la différence des autres, fût signé de ses initiales. Peu après, en mars 1834, Newman lui dédiait le premier volume de ses sermons
1. J’ai déjà eu occasion de noter que, dans les années qui avaient précédé l’éclosion du Mouvement, les opinions de Pusey étaient demeurées en-deçà de celles de Newman, et surtout de celles de Froude. 2. Lett. and Corr., t. 1, p. 482. 3. Autobiography of Isaac Williams, p. 71.
94
« en reconnaissance affectueuse de la bénédiction de sa longue amitié et de son exemple » il avait rédigé d’abord une dédicace plus élogieuse encore; Pusey avait insisté pour qu’elle fût atténuée. « J’ai beaucoup appris de vous, écrivait-il à Newman, et je compte apprendre de vous, s’il plaît à Dieu, pendant toute ma vie; car, par vous, j’ai appris ce que nous enseigne notre commun Maître; mais je ne sais pas ce que vous avez appris de moi 1. » Après avoir donné ce premier tract, Pusey, absorbé par ses études ou empêché par la maladie, était demeuré dix-huit mois sans en publier d’autres. Ce n’était pas que ses sympathies diminuassent; bien au contraire, sous l’influence de son amitié pour Newman et des idées qui fermentaient dans le monde ecclésiastique, il se rapprochait chaque jour davantage des auteurs du Mouvement. Enfin, au milieu de 1835, au moment où les premier combattants, fatigués, songeaient à désarmer, il se décida à entrer à son tour dans la bataille : il apporta à Newman, pour être publiée en tracts, un étude sur le baptême à laquelle il travaillait depuis plus d’une année. Son but était de rétablir la notion de ce sacrement, singulièrement obscurcie autour de lui. Beaucoup de membres de l’Eglise anglicane, en effet, avaient fini par voir dans le baptême seulement un signe et non la réalité de l’action régénératrice de Dieu; de là l’indifférence et la négligence avec laquelle ils l’administraient : ils s’inquiétaient peu que l’eau n’atteignît que les vêtements de l’enfant
1. Life of Pusey, par Liddon, t. I, p. 284, 285.
95
parfois le clergyman se contentait d’asperger de loin tout un groupe. Par l’importance de sa situation, l’estime générale dont il jouissait, la dignité de sa vie, la notoriété de ses vertus, Pusey était, pour le Mouvement, une précieuse recrue. Du coup, il assurait la continuation des tracts, mais, en même temps, il en modifiait sensiblement le caractère. Son étude sur le baptême n’était pas renfermée en quelques pages, comme les tracts précédents; la nature de son esprit ne se fût pas prêtée à ce mode de combat alerte et rapide; c’était un traité complet, un peu pesant, mais solide, grave, qui forma trois tracts d’environ cent pages chacun 1. L’effet en a été comparé à «la venue d’une batterie de grosse artillerie sur un champ de bataille où il n’y avait eu jusqu’alors que des escarmouches de mousqueterie 2» Les tracts, désormais, se modelèrent sur ce type nouveau; Aux feuilles légères dans lesquelles on s’était préoccupé moins de démontrer des thèses et d’argumenter contre des adversaires, que d’éveiller et de saisir vivement les esprits, on substituait des dissertations théologiques, étendues et savantes; le ton devenait plus grave, moins agressif; l’esprit posé, calme, serein de Pusey succédait à l’excitation un peu nerveuse de Newman. Celui-ci, d’ailleurs, était le premier à approuver ce changement; il estimait que les tracts du début avaient fait leur oeuvre et fini leur temps. « Autant, écrivait-il le 10 octobre 1835, j’étais
1. Tracts, n° 67, 68 et 69, parus le 24 août, le 29 septembre et le 18octobre 1835. 2. Church, The Oxford Movement, p.136.
96
décidé au début pour les tracts courts, autant je le suis maintenant pour des tracts plus longs 1. » Pusey se donna de tout coeur à cette tâche nouvelle. Pour provoquer et aider les études qui devaient désormais faire le fond des tracts, il institua une « société théologique » qui tenait ses séances chez lui : la première eut lieu le 12 novembre 1835; dans ces réunions, on devait lire et discuter des travaux qui formeraient ensuite des tracts ou des articles du British Magazine. Il décida, en outre, d’entreprendre, sous sa direction et sous celle de Keble et de Newman, la publication d’une « Bibliothèque des Pères de la sainte Eglise catholique avant. la division de l’Orient et de l’Occident, traduite en anglais ». Depuis cent cinquante ans, l’Eglise d’Angleterre avait à peu près complètement perdu de vue les Pères; elle les tenait même en suspicion. Les écrivains du Mouvement étaient au contraire tenus de les étudier, puisque l’un de leurs principes était d’en appeler à l’Eglise primitive. Dès l’origine, ils en avaient réimprimé quelques extraits, sous le titre de: Records of the Church. La même idée, développée, présida à la Bibliothèque des Pères. Pusey, donnant l’exemple, se mit aussitôt à l’oeuvre et entreprit une traduction des Confessions de saint Augustin. D’autres devaient suivre; on désirait en faire paraître quatre par an 2. « Ces publications,
1. Lett. and Corr., t. II, p. 138. 2. Ces publications ont continué assez activement pendant les années qui suivirent. Trente-huit volumes parurent de 1838 à 1854, dus à la collaboration de Pusey, Newman, Reble, Marriott, Church, Morris, etc. Après 1854, on fit paraître encore, à des intervalles plus éloignés, une dizaine de volumes.
97
expliquait Pusey, feront sentir aux adhérents réfléchis du Mouvement, que les Pères sont derrière eux, et, avec les Pères, cette Eglise ancienne, non divisée, dont les Pères sont les représentants. « Mais n’y avait-il pas à craindre qu’elles ne leur fissent sentir en même temps la faiblesse, l’inconséquence de toute Eglise séparée de Rome ? Pusey ne croyait pas à ce danger; il se persuadait que, si les Pères témoignaient, sur plusieurs points, contre l’état actuel de l’anglicanisme, ils ne témoignaient pas moins contre le papisme. Newman, lui aussi, tout en ayant l’intuition plus ou moins nette que cet appel à l’antiquité conduirait beaucoup plus loin qu’on ne l’entrevoyait sur le moment, s’imaginait pouvoir, sans risque pour son Eglise, mettre en pleine lumière les écrits des Pères. «De toute façon, disait-il, il ne saurait y avoir danger à courber en sens contraire le bâton tordu, afin de le redresser; il est impossible de le briser. S’il se trouvait dans les Pères quelque chose qui pût surprendre, ce ne serait que pour un temps; l’explication serait facile à trouver; en tous cas, cela ne pourrait conduire à Rome 1. » Par cette activité, Pusey prenait rang comme l’un des leaders du Mouvement. Pour le public, il en devenait même, à raison de sa situation officielle, le représentant le plus imposant. Jusqu’alors, ceux qui cherchaient à rapetisser ce Mouvement, en affectant d’y voir l’entreprise personnelle d’un chef de parti, l’appelaient newmanism ou, par malice, newmania. Désormais on dira de préférence puseyism. Newman voyait, sans
1. Apologia.
98
aucune jalousie, l’importance prise par un ami pour lequel il avait la plus absolue vénération. » Je ressentais pour le Dr Pusey, a-t-il écrit plus tard en évoquant les souvenirs de cette époque, une admiration enthousiaste; j’avais coutume de l’appeler o megas (le grand). Son savoir étendu, sa puissance de travail, son esprit classique, son dévouement plein de simplicité à la cause de la religion, me subjuguaient 1. »Newman ne souffrait pas qu’on attaquât son ami. A des personnes que le tract sur le baptême avait effarouchées, il écrivait : « Si vous connaissiez mon ami, le Dr Pusey, vous conviendriez, j’en suis sûr, qu’il n’y a jamais eu, en ce monde, d’homme auquel on fût plus tenté de donner un nom qui appartient seulement aux serviteurs de Dieu après leur mort, le nom de saint... Cela étant, je combattrai pour lui, si on attaque son traité, d’où que viennent ces attaques 2. » Il prenait l’habitude, très douce pour lui, de ne rien décider sans Pusey 3 qui, de son côté, tenait toujours à ne marcher que d’accord avec lui et Keble 4. Loin de prendre ombrage de ce que le public personnifiait le Mouvement dans Pusey, Newman s’en félicitait. « En se joignant à nous, a-t-il dit, le Dr Pusey nous donnait aussitôt un nom et une position. Sans lui, nous n’aurions eu aucune chance, surtout à cette date, de faire une résistance sérieuse à l’oppression du libéralisme. Mais le Dr Pusey était professeur et chanoine de
1. Apologia. 2. Lett. and Corr., t. II, p. 192. 3. Ibid., t. II, p. 138. 4. Life of Pusey, t. I, p. 425.
99
Christ-Church il avait une vaste influence, grâce au caractère profondément sérieux de ses convictions religieuses, à la munificence de sa charité, à son professorat, à ses relations de famille, à ses rapports faciles avec les autorités de l’Université... Nous avions désormais un homme qui pouvait devenir la tête, le centre des gens zélés de toutes les parties du pays qui adoptaient les opinions nouvelles; un homme qui donnait au Mouvement un front à opposer au monde et contraignait les autres partis de l’Université à le reconnaître... Pour employer une expression vulgaire, il était, à lui seul, une armée 1. » Ajoutons toutefois un correctif: c’est qu’en dépit de l’importance officielle de Pusey Newman demeurait toujours, ainsi qu’on le verra par la suite, le centre et le véritable propulseur du Mouvement 2. Non seulement il était supérieur à son ami, par l’étendue, la spontanéité et la souplesse de son génie, mais il savait s’approcher beaucoup plus des âmes et exercer sur elles une action bien autrement pénétrante. Pusey, par son austérité grave, imposait le respect, la vénération, mais d’un peu loin; il ne se mêlait pas, comme Newman, aux conversations des common rooms; il vivait retiré, absorbé dans ses travaux; malgré une très réelle bonté, il n’encourageait pas d’affectueuse familiarité chez les jeunes
1. Apologia. 2. Sir F. Doyle a écrit dans ses Reminiscences: « Certainement, en dépit du nom de Puseyisme donné à l’essai de renaissance catholique tenté à Oxford, Pusey n’était pas le Colomb de ce voyage de découverte, entrepris en vue de trouver un port plus sûr pour l’Eglise d’Angleterre » (p. 145). .
100
gens. Un de leurs amis communs constatait que la présence de Pusey en imposait à Newman lui-même et contenait sa vive et libre humeur. « J’étais, moi aussi, ajoutait ce témoin réduit au silence par un personnage si effrayant (silenced by so awful a person) 1. »
IV
La grande joie éprouvée par Newman à voir Pusey se joindre au Mouvement eut, presque aussitôt après, pour contre-partie, une grande douleur, la mort de l’ami avec lequel il avait une intimité d’âme et d’intelligence plus complète encore, Richard Hurrell Froude. Froude était revenu des Barbades, au printemps de 1835, toujours bien malade, mais heureux de revoir ses amis. « Fratres desideratissimi, écrivait-il à Newman en débarquant à Bristol le 17 mai, me voici; benedictum sit nomen Dei 2! » Le 18, il est à Oxford. Un témoin fortuit de son arrivée nous le dépeint, au bureau du coach, « entouré de tous ceux qui lui souhaitaient la bienvenue, terriblement maigre, le visage bruni et ravagé, mais avec un brillant dans l’expression et une grâce dans les lignes qui justifiaient tout ce qu’avaient dit de lui ses amis 3» Si malade qu’il soit, il est toujours aussi ardent; dès le lendemain, dans la Convocation 1,
1. Autobiography of Isaac Williams, p. 70. 2. Lett. and Corr., t. II, p. 106. 3. Ibid., t. II, p. 106.
La Convocation, assemblée de tous les maîtres et docteurs de l’Université, résidents ou non, se réunissait pour trancher des questions réglementaires ou pour faire certaines élections, comme celle du Chancelier.
101
il se passionne aux incidents de la séance, et, entouré de ses partisans, il crie : Non placet, à une proposition d’origine « libérale» Obligé, par sa santé, de se retirer à la campagne, il est en correspondance avec ses amis, s’intéresse à leurs luttes. Vers la fin de l’été, Newman va passer quelques jours avec lui : il le trouve avec la même vivacité d’esprit, ayant encore, malgré la maladie, l’énergie de travailler, « C’est merveilleux, presque mystérieux, écrit-il, qu’il puisse rester si longtemps à flot... On dirait vraiment qu’il est conservé en vie par les mains levées de Moïse; c’est un encouragement à continuer 1.» Avec l’hiver, le mal implacable gagne du terrain. La dernière lettre de Froude est du 27 janvier 1836. Le 18 février, son père écrit à Newman : « Ses pensées se tournent toujours vers Oxford, vers vous et vers Keble 2. » Les nouvelles ne permettent bientôt plus aucun espoir : la tristesse est générale. « Qui peut retenir ses larmes, écrit l’une des soeurs de Newman, à la pensée de ce brillant et beau Froude!» Le 28, tout est fini. Chacun a le sentiment du vide produit par la disparition de cet homme qui, pourtant, a pu si peu faire par lui-même. C’est un souvenir plein de douceur que laisse derrière lui ce rude et véhément champion. « Nul, écrit T. Mozley, ne m’a dit des choses plus sévères et plus piquantes, et cependant l’impression constante qui me reste de lui est une
1. Lett. and Corr., t. II, p. 138. 2. Ibid., t. II p. 171.
102
impression de bonté et de suavité 2. » Quant à Newman, sa douleur est profonde. Il se lamente de n’avoir pu redire, une dernière fois, à son ami tout ce qu’il lui devait. Volontiers, il se diminuerait pour le grandir. Il se plaît à rappeler combien celui qu’il pleure était admirablement doué. « Je ne pouvais faire une plus grande perte, répète-t-il sous toutes les formes. C’est pour moi un véritable veuvage. » Néanmoins, il n’est pas abattu; il est soutenu par l’ouvrage à faire et par l’aide de Dieu qu’il n’a jamais senti plus proche que dans ces heures de chagrin et de solitude.» Après tout, ajoute-t-il, cette vie est très courte, et mieux vaut l’employer à poursuivre ce qu’on croit être la volonté de Dieu que de chercher des consolations. J’apprends, plus que je ne l’ai fait jusqu’ici, à vivre en la présence des morts 2.» Comme dans toutes ses grandes émotions, les sentiments qui remplissent son âme s’épanchent en poésie : il avait écrit, en 1833, un petit poème d’un charme exquis et pénétrant, sur la « séparation des amis n; sous le coup de cette « séparation », plus douloureuse que toute autre, il ajoute à son poème quelques vers touchants, où il rappelle ce qu’a été pour lui le «très cher » ami qui « dissipait ses doutes, élevait son coeur au ravissement, lui soufflait à l’oreille tout ce qui était bien et tournait sa prière en louange». Quand on pense où devait aboutir Newman en suivant la voie dans laquelle l’avait poussé Froude, une question se pose naturellement: que serait-il advenu
1. Lett. and Corr., t. II,p. 172. 2. Ibid., t. II, p. 170-4, 196-7.
103
de Fronde lui-même s’il avait vécu? En dépit de l’impression défavorable que lui avait faite, en 1833, le catholicisme italien, les dernières années de sa vie avaient développé son attrait pour tout ce qui était catholique, sa répulsion pour tout ce qui était protestant: il ne parlait qu’avec colère des idées fausses répandues par cet «odieux protestantisme » ; il écrivait à Newman qu’il « haïssait la Réforme et les Reformers », et à Keble : « Vous serez choqué, si je vous avoue que je deviens, chaque jour, un fils de moins en moins loyal de la Réforme. » Il blâmait, chez ses amis, les attaques contre l’Église romaine, et, par plus d’un trait, perçait dans ses paroles quelque doute sur la solidité de la situation que les docteurs de la via media croyaient pouvoir faire à l’Eglise anglicane. En même temps, il s’astreignait à suivre de plus en plus généreusement les conseils de la perfection évangélique, à pratiquer le renoncement, le jeûne, la pénitence, l’oraison; il disait régulièrement le Bréviaire romain; attentif à s’examiner sévèrement soi-même, il notait, jour par jour, les résultats de la discipline à laquelle il soumettait son âme. Cette voie suivie avec vaillance lui était souvent douloureuse: par moments, faute d’une direction, il sortait de la lutte qu’il soutenait contre lui même, trouble, meurtri, presque découragé 1. On a raconté qu’un jour, en 1835, — était-ce sous la pression de quelqu’une de ces anxiétés secrètes — il se fit annoncer sans préambule chez Wiseman, qu il avait connu a Rome, et qui, a cette époque,
1. Froude’s remains, passim.
104
commençait son apostolat en Angleterre. Que se passa-t-il entre eux? Wiseman ne l’a jamais révélé. Peu après, Froude n’était plus. Il serait téméraire et oiseux de chercher à pénétrer plus avant un secret que la mort a scellé. Notons seulement, pour terminer, que l’influence catholique exercée par Froude s’est prolongée après sa mort. Suivant ses dernières volontés, chacun de ses amis avait été invité à choisir, comme souvenir, un de ses livres: Newman avait d’abord jeté son dévolu sur un ouvrage de théologie anglicane; informé que cet ouvrage était déjà pris, il parcourait du regard, avec quelque embarras, les rayons de la bibliothèque, quand un ami lui dit, en lui montrant un livre : « Prenez ceci. » C’était le Bréviaire romain dont Hurrell se servait. « Je le pris, a raconté plus tard Newman devenu catholique, je l’étudiai, et, depuis ce jour, je l’ai sur ma table et m’en sers constamment 1. » Ce fait devait avoir une action considérable sur son évolution intérieure et sur sa formation catholique. Aussi, indiquant ultérieurement que le mois de mars 1836 marquait une date importante de sa vie, il notait, parmi les événements qui, en ce mois, avaient ainsi contribué à «ouvrir devant lui une scène nouvelle », la connaissance qu’il avait eue du Bréviaire et l’habitude qu’il avait prise de le réciter 2.
1. Apologia. 2. Lett. and Corr. , t. II, p. 177.
105
V
Jusqu’à présent, il n’a guère été parlé que des tracts. Par eux, en effet, s’est tout d’abord manifesté un Mouvement que l’histoire a pu appeler le tractarian movement. Ce serait cependant une erreur de croire qu’il n’y eût pas d’autre moyen d’action. Newman et ses amis ne visaient pas seulement à faire prévaloir des thèses doctrinales; ils voulaient aussi agir sur la conduite des hommes. S’ils se préoccupaient de donner aux esprits une idée plus exacte et plus haute de la religion, ils ne tenaient pas moins à ce que cette religion fût vivante dans les âmes, à ce qu’elle se traduisît par des actes, par des vertus, par un progrès vers la sainteté. Ils étaient apôtres autant et plus que docteurs. Sur ce terrain, Newman est encore celui qui a le plus fait. Il était demeuré vicar de Sainte-Marie et, loin que les tracts lui fissent négliger ses devoirs pastoraux, il voyait dans l’accomplissement de ces devoirs le moyen le plus efficace de donner au Mouvement son complément pratique. Son premier soin fut de relever le culte paroissial de l’espèce de léthargie où il était tombé. Non qu’il jugeât possible de brusquer les changements : ses lettres nous le montrent, à chaque innovation, inquiet de la façon dont elle sera prise. Il commença par ajouter au service du dimanche, d’autres services, qui avaient lieu le mercredi soir et à certaines fêtes de saints. En 1834, il fit un pas de plus et
106
rétablit le service quotidien (daily service), prescrit par le Prayer-book, mais absolument tombé en désuétude; ne prévoyant qu’une assistance très restreinte, il faisait cette fonction dans le sanctuaire qui était séparé du reste de l’église par une barrière en pierre et formait ainsi comme une petite chapelle 1. Il importait davantage encore de rendre plus fréquente l’administration de l’Eucharistie. Combien n’y avait-il pas à faire sous ce rapport? On en jugera par ce seul fait que Newman lui-même, si pieux qu’il fût, avait attendu trois mois, après son ordination, avant de célébrer et de distribuer la communion. Changer un tel état de choses avait été, dans les dernières années de sa vie, l’ardent désir de Froude. Dans les lettres qu’il écrivait des Barbades, il pressait ses amis de réagir contre l’idée toute protestante qui avait fait donner à la prédication le pas sur la célébration eucharistique. « C’est le contraire qui doit être, disait-il; la prédication peut être faite par des laïques. Est-il étonnant que les fidèles oublient ce qui distingue les prêtres ordonnés, si ceux-ci ne font rien autre que ce qu’ils auraient pu faire sans ordination? » Aussi recommandait-il de mettre la chaire à l’extrémité ouest de l’église, de façon à ne pas masquer l’autel qui « doit être plus sacré que le saint des saints dans le temple juif ». Il insistait pour qu’on fournît aux fidèles l’occasion de communier aussi souvent que possible; il eût désiré que ce fût tous les jours; à tout le moins, demandait-il que ce fût chaque semaine. A ceux qui hésitaient devant les
1. Lett. and Corr., t. II, p. 50 à 54.
107
habitudes contraires, il déclarait que ces habitudes étaient détestables et qu’il ne fallait pas y avoir égard 1. Newman eût aimé à faire ce que demandait Froude; mais il y trouvait des difficultés. «Voilà un an, écrivait-il, le 21 juin 1834, que je suis préoccupé de commencer la célébration hebdomadaire du Lord’s supper; et cependant je n’ai pas encore fait le premier pas 2. »Ce sera seulement en 1837, qu’il jugera possible de faire cette célébration tous les dimanches matins, à sept heures 3. Ces développements du culte n’eussent été que de vaines cérémonies, si, préalablement, une piété sérieuse et fervente n’avait été réveillée dans les âmes. Ce réveil a été proprement l’oeuvre des sermons de Newman. Depuis 1828, où ils avaient commencé dans la chaire de Sainte-Marie, le renom en était allé grandissant. IIs se succédaient régulièrement, de dimanche en dimanche, à quatre heures du soir, et étaient devenus l’un des événements de la vie intellectuelle d’Oxford. Avant l’heure fixée, l’église se remplissait. Dans l’assistance, moins de bourgeois de la paroisse que d’étudiants de l’Université, bien que l’heure fût pour ceux-ci fort incommode; elle coïncidait avec l’heure de leur repas. Les souvenirs des témoins permettent de reconstituer la scène 4 : à gauche de la chaire, un bec de gaz à demi baissé pour ne pas éblouir le prédicateur; l’heure venue, celui-ci sort de la sacristie, mince, pâle, courbé,
1. Froude’s Remains. 2. Lett. and Corr., t. H, p. 50. 3. Ibid., t. II, p. 227. 4. Voir notamment un article du Dublin Review, avril 1869.
108
avec de grands yeux dont le regard semble percer l’enveloppe des hommes et des choses; on dirait d’une apparition qui, dans la demi-obscurité du jour tombant, descend doucement par les bas-côtés, monte dans la chaire; et alors, au milieu d’un silence religieux, une voix s’élève, d’un accent unique, doucement musicale, qui pénètre au plus profond des âmes et les transporte, comme par une puissance surnaturelle, dans le monde des choses invisibles. Et cependant celui qui parle n’a rien de ce que nous sommes habitués à considérer comme les conditions de l’éloquence. Absolument différent de nos grands sermonnaires français, on a pu dire de lui « qu’il était aussi loin de l’orateur que pouvait l’être un grand prédicateur 1». Lui-même écrivait en 1834 : « Je parle avec fluidité, mais je ne serai jamais éloquent 2. » Nulle action : suivant l’usage de la chaire anglaise à cette époque, il lit ses sermons; ses yeux demeurent fixés sur son manuscrit; pas une fois il ne regarde l’auditoire; ses bras sont immobiles, ses mains cachées; tout au plus, par instant, remue-t-il un peu la tête. Il commence d’une voix tranquille, nette, et continue sans inflexion. Chaque paragraphe est débité rapidement et suivi d’une courte pause, comme pour laisser le temps de le méditer. Pas un éclat d’intonation, pas une effusion de sensibilité, pas un cri de passion. Cette réserve semble trahir le scrupule d’un homme trop respecteux de l’indépendance des consciences, trop
1. Occasional Papers, par Church, t. II, p 442. 2. Lett. and Corr., t. II, p. 50.
109
soucieux du sérieux de la religion pour vouloir agir sur ses auditeurs par des surprises oratoires; il tient à ce que rien d’extérieur ne s’interpose entre Dieu et l’âme. L’effort qu’il fait pour se contenir, quand une émotion plus grande le gagne, donne à sa parole une vibration que son calme rend plus saisissante. Parfois alors il s’interrompt quelques minutes, durant lesquelles l’auditoire demeure en suspens; puis, d’un accent plus grave, plus solennel, il prononce une ou deux phrases où il met comme une force concentrée; au dire d’un témoin, les sons qu’on entend, en ces instants, sortir de ses sèvres, semblent quelque chose de plus que sa propre voix l. A l’impression produite par ce débit, concourait l’aspect même du prédicateur, avec ce je ne sais quoi qui, comme sur le visage de Moïse, révélait le colloque avec Dieu. « Sur lui, disait un de ses auditeurs d’alors, le jeune Gladstone, il y avait une empreinte et un sceau 2. » La forme du sermon est en harmonie avec le débit et diffère absolument de la rhétorique habituelle de la
1. Article précité du Dublin Review. 2. La diction de Newman n’était pas moins remarquable dans la lecture des leçons qui précédaient le sermon. A cette portion du service anglican, qui n’est trop souvent qu’une récitation insipide ou pompeuse, il savait donner un charme touchant ou grandiose et une efficacité singulièrement expressive. Debout devant le livre sacré, on eût dit qu’il en pénétrait le fond. Son attitude, ses inflexions de voix et jusqu’à ses pauses contribuaient à donner au Verbe divin toute sa valeur. C’était une prédication où Dieu semblait parler directement. Sur l’impression de ces lectures, les témoignages ne sont pas moins concordants que sur celle des sermons ; telle personne qui les avait entendues, étant encore enfant, en avait été a ce point saisie que l’intonation lui en était demeurée, depuis lors, ineffaçable dans l’oreille. (Art. précité du Dublin Review.)
110
chaire. D’ordinaire, les prédicateurs faisaient effort pour se guinder; leur parole avait quelque chose de factice, de cérémonieux; on eût dit qu’ils se croyaient tenus de n’aborder leur sujet qu’avec des circonlocutions oratoires et de ne le développer qu’avec un certain apparat. La parole de Newman a, au contraire, la simplicité et le naturel d’un homme qui traite en conversation ou par lettre une affaire grave; il va droit au fait; rien de convenu, tout est vrai, réel; nulle déclamation, nulle onction de commande. Au premier abord, l’auditeur est presque déçu de voir que l’orateur ne s’est pas mis plus en frais pour lui parler; mais il sent bientôt la force persuasive et le charme de cette simplicité. D’ailleurs, pour être dégagée de toute recherche littéraire, la langue est d’une correction élégante, souple et subtile, pleine de nerf et de grâce, parfois avec une fleur de poésie ou un pathétique d’autant plus poignant qu’il est plus contenu. Le sujet est plutôt pratique que technique. Newman tient pour admises les grandes vérités dogmatiques et s’applique à montrer la conduite à suivre pour en faire la règle de la vie. Il ne juge pas qu’il convienne de porter dans la chaire les controverses théologiques qu’il soutenait si ardemment ailleurs, et on peut l’écouter pendant assez longtemps, sans l’entendre parler une seule fois de la succession apostolique ou des autres thèses qui remplissaient les tracts. Est-ce donc que ses sermons ne concouraient pas à faire prévaloir les doctrines auxquelles il a entrepris de ramener son Eglise? Non certes. La morale qu’il
111
prêche implique ces doctrines; elle en est la conséquence pratique et l’expression vivante. Ceux sur qui elle a prise acquièrent de la religion une idée qui leur rend facile et naturelle l’acceptation de tout le système tractarien. Aussi l’un des hommes qui ont le mieux connu et jugé cette époque, le doyen Church, a-t-il pu écrire : « Sans les sermons, le Mouvement ne se fût jamais développé, ou tout au moins il n’eût pas été ce qu’il a été 1.» A la différence de nos sermonnaires français qui se plaisent à développer des idées générales et abstraites, Newman s’attache plus volontiers à un aspect particulier de ces idées, à un sujet limité et concret 2 Aux grandes vues d’ensemble, il préfère les analyses précises et profondes, faites non d’imagination, d’après les lieux communs de la littérature religieuse, mais sur ses observations directes et personnelles. Il a regardé, autour de lui, les hommes de son temps et de son pays; il s’est étudié lui-même, à travers des épreuves parfois douloureuses. Jamais romancier psychologue n’a davantage pénétré tous les dessous de la conscience humaine, ses complexités, ses subtilités, ses sophismes, ses contradictions, ses faiblesses. Telle est. sa perspicacité qu’elle s’exerce sur les natures d’esprit, les états de vie, les genres de tentation qui sembleraient devoir lui être le plus étrangers. Dans la peinture qu’il fait
1. The Oxford Movement, p. 129. 2. Cette différence avec la prédication française, signalée par le doyen Church (Occasional Papers, t. II), a été mise en lumière par le P. Brémond, dans un article intéressant sur les Sermons de Newman. (Etudes religieuses, 5 août 1897.)
112
du mal, jamais de ces exagérations un peu déclamatoires, trop fréquentes dans la chaire; s’il ne dissimule rien, il ne force pas la note et garde la mesure. Rien non plus de la malice du satiriste; on sent, au contraire, derrière la sévérité du moraliste, une charité compatissante et tendre. C’est que cette analyse n’est pas pour lui un jeu d’esprit, la satisfaction d’une sorte de curiosité. Son dessein principal, unique, est d’amener ceux qui l’écoutent, à regarder en eux-mêmes, à s’interroger, à se juger; il veut les rendre anxieux pour leurs âmes. La parole du prédicateur sonne à leurs oreilles, comme l’écho d’une conscience qui se réveille. En présence de généralités, ils eussent pu se dérober en se persuadant qu’ils n’étaient pas visés; ils ne le peuvent, lorsqu’ils retrouvent dans le sermon tous les détails de leur état particulier et jusqu’à leurs plus secrètes pensées. Newman a, du reste, ce don extraordinaire que chaque auditeur peut croire qu’il s’adresse spécialement à lui : ainsi de ces portraits qui semblent regarder individuellement toutes les personnes qui sont dans une chambre. « Je crois, a dit un témoin, qu’aucun jeune homme n’a pu l’entendre prêcher sans s’imaginer qu’un indiscret lui avait livré le secret de sa propre histoire et que le sermon était fait pour lui seul 1. » Newman n’a pas seulement le don de pénétrer les consciences humaines, il a, plus que nul autre, l’intuition et comme la présence continuelle des vérités divines. On sent qu’il voit le monde invi-
1. Ce témoin était J.-A. Froude, l’un des frères d’Hurrell. (The Nemesis of faith, p. 144.)
113
sible, que ce monde, avec ses profondeurs infinies, est, pour lui, le plus réel des mondes, et il donne le sentiment de cette réalité à des esprits qui, jusqu’alors, y ont été étrangers; il les transporte avec lui dans ces régions si nouvelles pour eux, les place en face de ces mystères à la fois redoutables et consolants, et leur fait comprendre la nécessité de régler, d’après ces vérités éternelles et supérieures, leur vie d’un jour. Newman choisit ses sujets suivant les besoins de son temps et de son pays. Il voit, autour de lui, dans l’Eglise d’Angleterre, la pensée religieuse abaissée, rétrécie, refroidie, desséchée. Sa prédication est un persévérant effort pour la relever, l’élargir, y faire pénétrer un peu de chaleur. Il est sans merci pour la piété superficielle, médiocre, faite de vaines coutumes, de formalités vides, d’onction banale. Il n’admet pas qu’on « minimise» le dogme, qu’on expurge l’Evangile, pour les rendre plus acceptables au monde. Voyez le portrait qu’il fait de ceux de ses compatriotes, fort nombreux alors, qui s’imaginaient être chrétiens parce qu’ils menaient une vie décente et régulière: « Il y a des personnes très respectables dont la religion est sèche et froide. Leur coeur et leur pensée n’ont jamais franchi le seuil du monde à venir. Bon sens robuste, habitudes régulières, nulle violence dans les passions, imagination trop calme pour entraîner à des idées inquiétantes. Rien chez eux qui ne soit de cette terre, aucune difficulté religieuse pour eux, aucun mystère dans l’Ecriture, rien qui réponde à de secrets besoins de
114
leur coeur 1. » Il se plaît à dénoncer le mensonge de cette religion convenable, courtoise, facile à vivre, « dans laquelle il n’y a ni crainte véritable de Dieu, ni zèle fervent pour son bonheur, ni haine profonde du péché, ni horreur à la vue des pécheurs, ni indignation ni pitié en présence des blasphèmes des hérétiques, ni adhésion jalouse à la vérité doctrinale,.., ni loyauté envers la sainte Église apostolique,.., en un mot, qui n’a pas de sérieux et qui, à causé de cela, n’est ni chaude ni froide, mais, suivant le mot de l’Ecriture, tiède» Et pour donner à sa pensée une forme plus saisissante, il ajoute : « Ce serait un gain pour ce pays, s’il était réellement plus superstitieux, plus bigot, plus sombre, plus féroce dans sa religion. Non, sans doute, que je suppose cet état d’esprit désirable, ce qui serait une évidente absurdité, mais je pense qu’il est infiniment plus désirable, plus plein de promesses, qu’un endurcissement païen et une tranquillité froide, suffisante et présomptueuse... Si misérables que soient les superstitions des siècles d’ignorance, si révoltantes que soient les tortures maintenant en usage chez les païens de l’Est, il vaut mieux, beaucoup mieux, torturer son corps tous les jours et faire de la vie un enfer sur la terre, que de demeurer ici dans une courte tranquillité, jusqu’à ce qu’à la fin la fosse s’ouvre sous nos pieds et éveille en nous une conscience de notre état et un remords qui seront éternellement sans fruit 2 . »
1. Parochial and plain sermons, t. IV, Sermon on the State of grace. 2. Sermon on the religion of the day, Ibid. , t. 1.
115
Cette tranquillité, un peu pharisaïque, si générale alors, Newman ne se lasse pas d’en montrer le péril. « To be at ease, is to be unsafe, disait-il. Qui est à l’aise n’est pas en sûreté 1. » Il a de brusques interrogations pour secouer les endormis, les satisfaits, pour les forcer à réfléchir et à s’inquiéter. «A quoi bon être chrétiens? demande-t-il un jour en commençant son sermon. Eu sommes-nous meilleurs pour autant? Quelle raison avons-nous de croire que nos vies soient bien différentes de ce qu’elles seraient si nous étions païens 2? » C’est la même question à laquelle il revient dans un sermon célèbre, qui, de l’aveu de tous les contemporains, remua singulièrement les âmes, et où il traitait de ce qu’il appelait d’un mot difficile à traduire: The Ventures of faith. Avons-nous risqué, aventuré quelque chose, sur la foi dans la parole du Christ? Que perdrions-nous si, par impossible, cette foi était déçue? « Vraiment, j’en ai peur, ajoutait-il, la plupart des hommes appelés chrétiens auraient exactement la même conduite, s’ils étaient persuadés que le christianisme est un mythe. Jeunes, ils se livrent à leurs passions; l’âge venu, si leurs affaires ont prospéré, ils se marient, s’établissent, et, leur intérêt coïncidant avec leur devoir, ils se mettent à faire du zèle contre le vice et l’erreur... Honorable conduite, sans doute. Je dis seulement qu’elle n’a rien à voir avec la religion. Rien, chez ces hommes, n’est une conséquence des principes religieux;
1. Sermon, on the secret faults, Parochial and plain sermons t. I. 2. Sermon on the spiritual mind, Ibid., t. I.
116
ils ne risquent, ils ne sacrifient rien sur la foi de la parole de Jésus-Christ 1.» Newman ne craint pas de heurter les habitudes d’esprit des Anglais, sur un point plus sensible encore, en leur prêchant cette mortification, ce détachement, qu’ils n’avaient pas seulement tout à fait oubliés, mais qui leur paraissaient absurdes et méprisables. Il leur déclare que les comforts of life sont la cause ordinaire de leur manque d’amour de Dieu, et que, si l’Eglise anglicane n’est pas plus vivante, c’est pour avoir répudié l’ascétisme. Il affirme que « le christianisme n’est pas compatible avec cette ardente immersion dans les occupations extérieures (that eager immersion in external pursuits) qui semble être la tentation spéciale du génie et du tempérament anglais ». En face de ce clergé comfortable qui jouit de son opulence, de sa considération mondaine, de sa faveur politique, en face de cette nation qui s’enorgueillit de sa prospérité et y voit volontiers le signe qu’elle est agréable à Dieu, il ose douter que cette faveur et cette prospérité soient réellement une bénédiction divine. Il rappelle la loi d’humilité et d’épreuves, écrite à toutes les pages de l’Evangile, la promesse faite par Notre-Seigneur et par ses apôtres, aux chrétiens, qu’ils souffriraient dans ce monde, et il lui semble qu’il y a plutôt lieu de trembler quand cette promesse ne se réalise pas. Ceux qui mènent une vie parfaitement tranquille et heureuse, en bonne intelligence avec le monde, ne doivent-ils pas se demander si ce n’est pas la preuve qu’ils ne conforment
1. Parochial and plain sermons, t. IV.
117
pas leur conduite à la vérité révélée? L’Eglise qui n’a pas sa part d’affliction, de peine, de détresse, d’injustice, de calomnie, n’est-elle pas hors de sa voie? N’est-ce pas, par leur désobéissance, que les chrétiens, prospères en ce monde, ont perdu le «privilège d’adversité» que le Christ leur avait assuré? « Chez les Hébreux, ajoutait Newman, la félicité temporelle était une récompense de Dieu, une preuve que Dieu était content. Qui sait si les choses ne vont pas tout au contraire chez nous? Quand les Juifs se voyaient dans l’adversité, ils concluaient que Dieu voulait les punir; nous autres, quand nous nageons dans toutes les joies de ce monde, ne serait-ce pas que Dieu nous châtie 1? » Si étrangement que certains de ces enseignements sonnassent à des oreilles anglaises, ils n’en exerçaient pas moins une grande action. Les témoignages contemporains sont unanimes à constater la merveilleuse autorité morale du prédicateur, l’attrait fascinateur qu’il exerçait. Qui était venu une fois, par curiosité, pour l’entendre, ne manquait pas de revenir. Et surtout que d’âmes remuées, transformées, conquises! Un témoin affirme, de tel de ces sermons, « qu’il a été, pour plusieurs, l’une des principales influences qui ont gouverné leur vie ». Ceux mêmes qui demeuraient réfractaires aux conclusions dogmatiques de Newman n’échappaient pas pour cela à son influence morale; ils reconnaissaient s’être pénétrés de ses sentiments religieux et lui « devoir leur vie spirituelle ». De l’effet extraordinaire produit par ces sermons, il est,
1. Paroch. serm., passim, notamment t. V.
118
du reste, un signe remarquable : c’est la mémoire qui en est demeurée si profonde et si vive chez tous ceux qui les avaient entendus. Après tant d’années écoulées, ils ne peuvent en parler sans une émotion singulière. Tous, quels qu’aient été, depuis, leurs rapports avec Newman, quelque abîme qui se soit creusé entre eux et lui, s’attendrissent en évoquant les échos de Sainte-Marie d’Oxford et proclament « n’avoir jamais entendu de parole qui pût être comparée à celle-là ». Combien l’émotion de cette évocation est plus profonde encore chez ceux qui ont suivi le maître jusqu’au bout, qui sont arrivés, avec lui ou après lui, à la pleine vérité catholique, et pour qui cette prédication a été le premier appel de la grâce, la première lueur sur le chemin de la conversion! Ils comparent leurs sentiments à ceux des enfants d’Israël, lorsque, parvenus en possession de la terre où « coulaient le lait et le miel o, ils se souvenaient de ces matinées où, dans le désert, à la lueur de l’aube enflammant l’horizon, ils sortaient du camp pour ramasser la provision de manne de la journée 1. L’action de ces sermons ne se limita pas à l’auditoire de Sainte-Marie. Après bien des hésitations et malgré ses premières répugnances, Newman se décida à les
1. Cf. les Souvenirs du professeur Shairp et de sir F. Doyle, cités par Church (The Oxford Movement, 141, 143), le témoignage recueilli par l’éditeur des Letters and Correspondence of Newman, I. Il, p. 219, ceux qu’a réunis Abbott dans son livre, pourtant si malveillant, The anglican career of Cardinal Newman. enfin un article publié dans le Dublin Review d’avril 1869 sur les Parochial Sermons de Newman. Voir aussi Hutton, Cardinal Newman, p. 102.
119 publier. Le premier volume parut en mars 1834. Le succès fut tout de suite très vif. Au rapport des éditeurs, « ce volume écartait du marché tous les autres recueils de sermons, comme Waverley et Gay Mannering avaient naguère écarté tous les autres romans 1 ». Les volumes suivants furent publiés à intervalles rapprochés 2. Sur tous les points de l’Angleterre, des âmes y découvraient avec joie l’aliment dont elles avaient besoin, dont elles étaient affamées, et que personne ne leur avait encore présenté. Au moins autant que les tracts, les sermons contribuèrent à gagner des adhérents au Mouvement; ils eurent même une action plus profonde. Les historiens s’en sont rendu compte depuis, mieux encore que les contemporains ne pouvaient le faire sur le morflent « Ces sermons, a dit l’un d eux, ont fait plus qu’aucune autre chose, pour modeler, vivifier et brasser le tempérament religieux de notre temps... Ils ont changé toute la manière de sentir en matière religieuse 3.» Faut-il ajouter que l’auteur, sans avoir eu aucune préoccupation littéraire, s’y montrait, de l’aveu de tous les juges, l’un des premiers écrivains de langue anglaise 4, et que le modèle ainsi donné par lui a complètement transformé la prédica- l. Reminiscences, par T. Mozley, t. I, p. 316. 2. L’ensemble des sermons de Newman devait former douze volumes. 3. Etude du doyen Church publiée d’abord, en 1869, dans le Saturday Review et reproduite dans ses Occasional Papers, t. II, p. 441. 4. Comme on demandait à M. Gladstone, vers la fin de sa vie, quels avaient été, de son temps, les premiers prosateurs anglais, il désignait le cardinal Newman et Ruskin.
120
lion outre-Manche. Aujourd’hui encore, les sermons de Newman sont réimprimés en Angleterre, comme, en France, ceux de Bossuet ou de Bourdaloue. S’ils semblent moins nouveaux qu’au jour où ils furent prononcés, c’est que le succès même a fini par faire prévaloir, dans le monde religieux, plusieurs des façons de penser et d’agir qu’ils avaient entrepris de restaurer; mais ils ne sont ni usés ni vieillis; et, — fait unique, croyons-nous, — dans ces enseignements d’un ministre anglican, les catholiques ne trouvent pas moins à puiser que les membres de l’Eglise d’Angleterre. Newman n’était sans doute pas seul, parmi les tractarians, à user de la chaire; mais il était le seul dont les sermons eussent un tel retentissement et une telle action. Pusey, par exemple, prêchait de temps à autre, soit qu’il remplaçât son ami Newman à Sainte-Marie, soit pour quelque autre circonstance particulière; mais ce n’était qu’un fait accidentel; par fonction, il était professeur, non pasteur de paroisse; et puis, si la gravité de son caractère, le sérieux de ses convictions, le prestige de sa vertu donnaient une réelle autorité à sa parole, elle manquait d’attrait; ses dis, cours étaient d’ordinaire ternes, un peu pesants; on les trouvait longs et, pour tout dire, ennuyeux. En somme, dans la chaire, autant que dans les tracts, Newman était incontestablement le premier; il y était même vraiment unique; c’est bien lui qui donnait ainsi à la réforme religieuse sa voix, cette voix d’un accent si nouveau et si pénétrant, qui allait au coeur des jeunes générations. Du reste, loin de rapporter à lui-même le
124
mérite de ce succès, il y trouvait le signe d’une intervention supérieure et y reconnaissait la présence d’un « agitateur invisible ». «Je crois vraiment, ajoutait-il, qu’un esprit est à l’oeuvre au dehors et que nous ne sommes que d’aveugles instruments, ne sachant pas où nous allons. Il est trop d’endroits différents où une flamme s’élève, pour ne pas en conclure que ce n’est l’oeuvre d’aucun incendiaire mortel 1 .»
1. Lett. and Corr., t. II, p. 92, 112.
CHAPITRE IIIL’APOGÉE DU MOUVEMENT (1836-1839)
I. Polémiques soulevées par la nomination du Dr Hampden. Attaques contre les tractarians. Newman et la question du romanisme. — II. Wiseman. Son origine. Ses débuts à Rome. Comment il est amené à s’occuper de la situation religieuse de l’Angleterre. Ses lectures à Londres en 1835 et 1836. Grand effet produit. — III. Newman croit nécessaire de faire paraître un nouveau livre sur la Via media et contre le romanisme. Certains tracts paraissent au contraire suspects de papisme. Publication des Remains de Froude. Irritation des protestants. Blâme inattendu de l’évêque d’Oxford contre les tracts. Après négociations, l’accord se fait entre cet évêque et Newman. Premiers indices de l’hostilité de l’épiscopat. — VI. Wiseman suit, de Rome, le Mouvement. Ses rapports avec les voyageurs anglais, notamment avec Gladstone et Macaulay. — V. Le Mouvement grandit. Ses principaux adhérents. Bien que disciple d’Arnold, Stanley est un moment tenté de suivre Newman. W. G. Ward, son origine, ses évolutions, son caractère. Ses discussions avec Tait. Changement dans l’état moral de la jeunesse universitaire. Amitié de Pusey et de Newman. Newman demeure le vrai chef du Mouvement. Credo in Newmanum. — VI. Premier doute de Newman sur l’Anglicanisme, à propos de l’histoire des Monophysites et des Donatistes. Il en fait confidence à deux amis. Raisons par lesquelles il essaye de se rassurer. Son sermon sur les Appels divins. Le doute s’éloigne, mais non sans laisser de trace.
I
Oxford ou, pour mieux dire, l’Université en qui se résumait toute la vie d’Oxford, demeurait, au milieu de l’Angleterre moderne, comme une cité d’un autre
123
âge et d’un caractère à part, peu nombreuse, mais considérable; ses agitations, ses divisions, ses luttes, pour se renfermer dans l’enceinte de ses vieux et pittoresques collèges, et pour ne porter guère que sur des sujets scolastiques ou théologiques, n’en avaient pas moins un retentissement dans le pays entier. L’importance croissante des tractarians les amenait à jouer un rôle plus en vue dans ces luttes. Ainsi firent-ils, en 1836, à propos d’une affaire qui agita beaucoup l’Université, l’affaire Hampden. La chaire de professor regius de théologie, à Oxford, étant devenue vacante, le gouvernement y avait appelé le Dr Hampden, suspect de latitudinarisme antidogmatique. L’émoi fut grand chez ceux des membres de l’Université qui avaient souci de l’orthodoxie de son enseignement. Une polémique très vive s’engagea entre adversaires et défenseurs du nouveau professeur. De tous les écrits dirigés contre ce dernier, nul ne fit autant d’effet qu’une brochure de Newman 1. Les tractarians n’étaient sans doute pas les seuls à protester; ils avaient avec eux, en cette circonstance, les evangelicals; mais, par leur ardeur comme par leur talent, ils se trouvaient au premier rang des combattants; aussi était-ce surtout à eux qu’on s’en prenait dans l’autre camp. Leur contradicteur le plus redoutable fut Arnold, le célèbre Head-master de l’école de Rugby 2 dès l’origine du Mouvement, il l’avait regardé de mauvais oeil; non seulement il y rencontrait des doctrines absolument opposées aux siennes, mais,
1. Elucidations of Dr Hampden’s theological statements. 2 Sur Arnold, voir plus haut, p. 8.
124
de plus, il avait été fort désappointé de voir, au moment où il croyait avoir prise sur l’élite de la jeunesse, une influence rivale grandir à Oxford, contrecarrer et primer la sienne. Son antipathie s’était exprimée sans ménagement, dans ses propos et dans sa correspondance 1. Il n’était donc pas surprenant qu’il saisît l’occasion de l’affaire Hampden, pour attaquer les Newmanists; il publiait contre eux, dans la Revue d’Edimbourg d’avril 1836, sous ce titre: The Oxford malignants, un réquisitoire d’une violence et d’une amertume extrêmes : il y dénonçait Newman et ses amis, comme une «petite bande d’obscurs fanatiques »; il les qualifiait « d’idolâtres, pires que les catholiques romains »; à ses yeux, leur attaque contre le nouveau professeur « ne portait pas le caractère d’une erreur, mais d’une méchanceté morale» Les adversaires d’Hampden obtinrent que la question fût soumise à la Convocation, assemblée de tous les maîtres
1. Life and Correspondence of Th. Arnold, par Stanley, t. Ier, passim. — Dès le 23 octobre 1833, Arnold écrivait à un ami l’ennui que lui causaient les s extravagances d’Oxford », et il se demandait ce qu’allait devenir l’Eglise, « si le clergé commençait à faire montre des pires superstitions des catholiques romains, en les aggravant et en les dépouillent seulement de cette consistance qui marque d’un certain caractère de grandeur jusqu’aux erreurs du système romain».Il saisissait toutes les occasions de déclarer que la thèse de la Succession apostolique était une « superstition pernicieuse », et d’insister dédaigneusement sur les inconséquences de la doctrine tractarienne. « C’est, disait-il, la superstition de la prêtrise sans son pouvoir, la forme d’un gouvernement épiscopal sans sa substance. » Un diplomate prussien, ami d’Arnold, le baron de Bunsen, s’inspirait d’une idée semblable, quand, vers la même époque, il reprochait à cette école de vouloir introduire en Angleterre « un papisme sans autorité, un protestantisme sans liberté, un catholicisme sans universalité, un évangélisme sans spiritualité ». Ce propos est rapporté par Newman, dans une lettre à Froude. (Letters and Correspondence of J.-H. Newman, t. II, p. 143.)
125
et docteurs de l’Université; après une première tentative qui échoua devant le veto des proctors 1, ils firent voter, le 5 mai 1836, par trois cent trente voix contre quatre-vingt-quatorze, une motion qui témoignait de la désapprobation du corps universitaire 2. C’était un succès pour les tractarians qui avaient mené la campagne; leur importance en était accrue et aussi leur crédit auprès des esprits religieux effrayés du latitudinarisme; Pusey le constatait et s’en félicitait 3. Mais, du même coup, ils s’étaient exposés à de redoutables ressentiments. Certains spectateurs eurent, d’ores et déjà, le pressentiment que cette victoire n’était pas sans péril pour les vainqueurs, et que l’arme avec laquelle ceux-ci avaient frappé le professeur suspect se retournerait un jour contre eux. Dans la séance de la Convocation, un partisan de Hampden disait à Manning, en voyant passer Newman: «Avant longtemps, nous serons convoqués ici pour voter contre Neander 4. »
1. Les Proctors, chargés particulièrement de la police académique, avaient un droit de veto dans les délibérations de la Convocation. 2. Ne pouvant arracher le nouveau professeur de la chaire où l’avait placé la nomination royale, la Convocation décida qu’il serait privé du droit, jusqu’alors attaché à ses fonctions, de prendre part à la désignation des select preachers, appelés à prêcher devant l’Université, et de donner son avis au cas où un prédicateur serait déféré au chancelier, à raison de ses doctrines. 3. Lettre à un ami d’Allemagne du 6 mars 1837. (Life of Pusey, t. II.) 4. Cette façon de gréciser le nom de Newman était assez en usage alors dans les conversations d’Oxford. Le propos que je viens de citer a été rapporté par Manning lui-même. (England and Christendom, Introd., p. 47.) — Voir une autre version du même propos dans Purcell, Life of Card. Manning, t. I, p. 114, 115.
126
Contre les tractarians, l’arme principale des amis de Hampden avait été l’accusation de romanisme; quelques-uns, pour alarmer plus sûrement le vulgaire, employaient des procédés d’une habileté un peu grossière: tel ce Dr Dickinson, plus tard évêque, qui affectait de donner la traduction fidèle » d’une prétendue lettre pastorale où le Pape félicitait les auteurs du Mouvement 1. Pusey protesta sévèrement contre ce genre de polémique 2. C’était de la meilleure foi du monde que les tractarians se jugeaient calomniés, quand on les accusait de tendre à Rome. Depuis les premiers tracts où Newman avait, en passant, lancé plus d’un trait contre l’Eglise romaine 3, il avait encore accentué son opposition; en 1835, il fut amené, avec un de ses amis, à soutenir contre un prêtre français, l’abbé Jager, sur les titres respectifs de l’anglicanisme et du catholicisme romain, une controverse épistolaire, publiée au fur et à mesure dans un journal de Paris 4 à la nième époque, il traita ce sujet dans, les lectures théologiques qu’il entreprit de donner dans la chapelle dite d’Adam de Brome, dépendance de l’église Sainte-Marie. Cette sorte d’étude prélimi-
1. A pastoral epistle from his Holiness the Pope to some members of the University of Oxford, faithfully translated from the original latin. 2. An earniest remonstrance to the author of the Pope’s pastoral letter. 3. Voir plus haut, p. 89. 4. Les lettres ainsi échangées, après avoir été publiées dans l’Univers, furent, en 1836, réunies eu volume par l’abbé Jager, sous ce titre: le Protestantisme aux prises avec la doctrine catholique, ou controverses avec plusieurs ministres anglicans, membres de l’Université d’Oxford.
127
naire le conduisit à déclarer, vers la fin de 1835, avec la vive approbation de Pusey et de Keble, que le moment était venu d’aborder de face et de traiter à fond, dans les tracts, la question du romanisme 1. Tel fut, en effet, l’objet du tract 71 qu’il fit paraître le 1er janvier 1836, quelques semaines avant la nomination de Hampden. Peu après, en mars et avril 1836, c’est-à-dire au plus vif des polémiques sur cette nomination, il publia, dans le British Magazine, sous ce titre: Rome thoughts abroad, une sorte de dialogue où il mettait aux prises un anglican et un catholique romain. A la vérité, même dans ces écrits où il se flattait de donner des gages de sa fidélité à l’Église d’Angleterre et d’établir les raisons de sa séparation d’avec Rome, Newman n’échappait pas aux critiques et aux suspicions de ses adversaires. Il se refusait, en effet, à employer, pour justifier cette séparation, les arguments jusqu’alors en cours parmi ses coreligionnaires et qui avaient, à ses yeux, le tort de s’attaquer au principe de toute Eglise. Il reconnaissait que, sur beaucoup de points, l’Eglise romaine avait raison contre le protestantisme; il lui faisait honneur d’avoir, mieux que l’Eglise d’Angleterre, gardé le dépôt de certaines vérités et d’avoir, plus qu’elle, l’une des « notes » de la véritable Eglise, celle de catholicité. Pour trouver où se séparer, il lui fallait en venir aux nouveautés qu’il accusait Rome d’avoir ajoutées au symbole primitif et qui lui avaient fait perdre une autre « note », celle
1. Lett. and Corr. of J.-H. Newman, t. II, p. 136, 138, 143, 153.
128
d’antiquité ou d’apostolicité. C’était cette « corruption romaine », comme il disait, et non le fond premier de la doctrine de l’Eglise de Rome, qui empêchait de se joindre à elle. Il ne niait pas, du reste, que son Eglise, elle aussi, n’eût pêché; elle avait sa corruption, la corruption protestante, dont elle était tenue de se dégager, ce qui, sur plusieurs points, la ramènerait aux doctrines conservées par Rome. Un tel langage sonnait mal aux oreilles des « libéraux » ou des evangelicals. Parmi les High Churchmen eux-mêmes, plusieurs trouvaient que l’auteur se montrait trop pessimiste sur l’état de son Eglise, qu’il faisait trop de concessions à l’Eglise de Rome. « Vous devez, lui écrivait Rose, me faire, non pas supporter, mais aimer, — et aimer chaudement et passionnément, — l’Eglise ma mère1. »
II
Dans le tract 71, Newman indiquait, parmi les rai-sons qui le conduisaient à aborder la controverse avec les « romanistes », une sorte de réveil de ces derniers qu’il montrait s’agitant sur les flancs de l’anglicalisme, fiers de grandir et raillant les partisans de l’Eglise établie de leur impuissance à argumenter contre eux. Ce réveil était un fait tout nouveau. J’ai déjà eu occasion de dire à quel état de dépression une longue existence de parias avait réduit les catholiques anglais, au commencement du siècle. L’émancipation, votée
1. Lives of twelve good men, par Burgon, t. 1er , p. 214.
129
en 1829, n’avait pas paru, tout d’abord, les relever de cette dépression; c’est qu’elle n’était pas leur oeuvre, le fruit de leurs efforts, mais avait été conquise, en dehors d’eux, par O’Connell, à la tête de ses Irlandais et avec le concours tout politique des whigs. Sortis des catacombes, on eût dit que le grand jour les éblouissait. IIs demeuraient timides et méfiants. Des droits politiques qu’on leur avait restitués, ils étaient, plus embarrassés qu’empressés de faire usage. Tel de leurs évêques, loin de les pousser à entrer dans la carrière publique qui leur était ouverte, se montrait plutôt inquiet des dangers que pouvait y courir leur foi 1. Que, dans le domaine purement religieux, le catholicisme pût, grâce à cette liberté nouvelle, reprendre, en Angle-terre, quelque chose du terrain perdu, c’était une pensée qui ne venait à l’esprit de presque aucun des anciens catholiques; ils étaient depuis trop longtemps désaccoutumés d’espérer. Rien ne paraissait pénétrer chez eux du souffle qui enflait alors les voiles du catholicisme, en Allemagne, en France surtout. A plus forte raison n’avaient-ils pas idée que leur cause eût quelque chose à gagner au mouvement qui se produisait parmi quelques clergymen d’Oxford; ils ignoraient ce mouvement ou s’en défiaient, comme ils étaient habitués à faire de toute chose anglicane. D’où venait donc le réveil de romanisme que Newman signalait avec inquiétude, en janvier 1836? Un catholique, un prêtre, s’était trouvé, assez anglais
1. Lettre pastorale écrite, le 1er janvier 1830, par l’évêque Bramston..
130
pour comprendre ses compatriotes et s’en faire comprendre, et cependant assez dégagé, par sa formation personnelle, des habitudes d’esprit des catholiques d’outre-Manche, pour n’avoir ni leur timidité, ni leurs courtes vues : c’était Nicolas Wiseman 1. Il était né à Séville, en 1802 ; sa famille, d’origine anglaise et irlandaise, avait émigré depuis longtemps en Espagne, pour y faire le commerce. Ayant perdu son père à trois ans, il fut ramené par sa mère en Angleterre et placé, peu après, au collège catholique d’Ushaw, fondé en 1793, lors de la suppression de ce collège de Douai où, pendant si longtemps, avaient été élevés les enfants des catholiques anglais. Ce fut, sans doute, en passant ainsi les premières années de sa jeunesse en terre anglaise, au milieu de camarades anglais, que Wiseman acquit ce qui faisait dire plus tard, par ses compatriotes protestants, qu’après tout « il était proprement un Anglais» Seulement le collège d’Ushaw avait hérité de celui de Douai la tradition de cette éducation austère qui, pendant plus de deux siècles, s’était donné pour tâche d’affermir les jeunes âmes dans leur foi, de les armer en vue de l’inévitable persécution, mais qui les laissait un peu repliées sur elles-mêmes, en méfiance à l’égard d’un public hostile, plus prêtes à endurer qu’à entreprendre. Si Wiseman fût demeuré sous les influences qui régnaient dans ce collège, se fût-il dégagé de l’inertie passive et craintive où s’enfermaient ses core-
1. La vie de Wiseman vient d’être racontée dans l’excellent ouvrage de M. Wilfrid Ward, The Life and Times of Cardinal Wiseman. .
134
ligionnaires? La Providence y mit ordre. En 1818, lors de la réouverture du collège anglais, à Rome, il fit partie de la première colonie de jeunes élèves, envoyés d’Angleterre pour le peupler. Ce fut là qu’il poursuivit ses études ecclésiastiques, fut reçu docteur en théologie en 1824 et ordonné prêtre en 1825. Nul mieux que lui n’a compris et goûté ce charme de Rome, que les esprits cultivés sentaient alors si vivement, et que des altérations, barbarement et systématiquement poursuivies, tendent aujourd’hui à détruire. A l’époque où il y arrivait, la ville papale, après les terribles crises de la Révolution et de la conquête impériale, jouissait de renaître à la paix, à la sécurité. Elle s’y laissait vivre doucement et un peu mollement, sans songer aux dangers de l’avenir, heureuse de voir revenir dans ses murs les artistes, les penseurs et les savants, fière du prestige que retrouvait au dehors le Saint-Siège, naguère si rudement humilié et maltraité, et des signes de renaissance catholique qui se produisaient sur tant de points, notamment en Allemagne et en France. Dans cette atmosphère sereine et lumineuse, l’imagination naturellement romantique de Wiseman, naguère comprimée dans le milieu sévère et embrumé d’Ushaw, s’épanouissait librement; elle s’ouvrait à toutes les curiosités pittoresques, artistiques, archéologiques, religieuses, auxquelles Rome fournissait aliment. Le jeune prêtre commença par s’attacher plus particulièrement aux études orientales et bibliques; quelques publications le mirent en vue et le firent nommer, en 1827, quand il n’avait encore que vingt-cinq ans,
132
vice-recteur, puis, l’année suivante, recteur du collège anglais. Jusqu’alors, dans la vie de Wiseman, sa patrie semblait ne tenir à peu près aucune place. Sans doute, sur la demande du Pape, il donnait, dans une église du Corso, des sermons destinés aux résidents anglais. Sans doute aussi sa situation de recteur lui attirait la visite des touristes, ses compatriotes, qui cherchaient d’autres informations .que celles des ciceroni d’hôtel. Tout cela néanmoins ne le sortait pas de son existence principalement romaine. Un premier appel lui vint d’un jeune converti de noble race, le dernier fils de lord Spencer, qui s’était fait catholique en 1830 et était venu passer deux ans à Rome, au collège anglais, pour se préparer aux saints ordres 1. Né en 1799, écolier à Eton, étudiant à Cambridge, George Spencer avait été dirigé par sa famille vers l’état ecclésiastique, et chargé, à vingt-trois ans, d’une paroisse de campagne; après quelques années d’un ministère très charitablement rempli, il s’était trouvé conduit à la vraie foi par le seul travail intime d’une conscience très droite et d’une âme très pieuse : nulle influence extérieure n’avait déterminé sa conversion; il était sans rapport avec les hommes qui devaient susciter le Mouvement d’Oxford. Devenu catholique, bientôt prêtre, plus tard même
1. Depuis le commencement du siècle, il y avait toujours eu un certain courant de conversions; mais celles-ci étaient peu nombreuses, isolées et sans grand retentissement. Celle de Spencer, ainsi que celle de M. Ambrose de Lisle, riche gentleman du Leicestershire, survenue l’année précédente, avaient fait, à raison de la situation sociale des personnages, un peu plus de bruit que les autres.
133
religieux passionniste, il n’eut qu’une pensée: la conversion de l’Angleterre; seulement il professait que cette conversion ne pouvait être obtenue que par la prière, et l’oeuvre de toute sa vie devait être de susciter partout cette croisade de la prière. Pendant son séjour au collège anglais, il avait pu apprécier la haute valeur du jeune recteur, son cadet de deux ans; il le voyait à regret employer son talent à étudier des manuscrits orientaux; un jour, il ne put se retenir de lui en faire l’observation et de lui indiquer une besogne plus pratique et plus efficace : ce serait, lui disait-il, « de prendre en main, comme il convenait à un prêtre, l’oeuvre de la mission anglaise ». Wiseman, qui faisait grand cas de la sainteté de son élève et augurait beaucoup de son action, dut prendre l’avis en considération. Dans les années qui suivirent, il parut plus occupé de l’Angleterre que par le passé, plus désireux d’y seconder le mouvement catholique. Ce ne fut pas toutefois l’appel d’un converti, ce fut un entretien avec deux clergymen anglicans qui agit d’une façon vraiment décisive sur la direction donnée à la vie de Wiseman. J’ai raconté déjà comment, au commencement de 1833, il avait reçu la visite de Newman et de Froude 2, et combien il avait été frappé de leur nature d’esprit catholique. Ce fut pour lui une révélation; une espérance inattendue s’ouvrait devant lui. « A partir de ce jour, a-t-il écrit plus
1. Life and Times of Card. Wiseman, t. 1er , p. 401. 2. Voir plus haut, p. 58.
135
tard1, je n’ai plus hésité à croire qu’une ère nouvelle commençait pour l’Angleterre ;je me dévouai à ce grand objet, et, pour m’y donner exclusivement, j’abandonnai mes études favorites des années précédentes 2». Désormais, en effet, il a les yeux fixés sur l’Angleterre. Il suit la campagne des tracts, avec une attention émue. Non, qu’il entrevoie, au terme de cette campagne, des conversions nombreuses au catholicisme. Ce rêve d’une Angleterre catholique, qui hantait la pieuse imagination de Spencer, lui paraît une utopie. Ce qu’il espère seulement, — mais la chose lui semble d’un grand intérêt, — c’est la «déprotestantisation» de l’Eglise établie et de l’esprit anglais. Des événements qui s’accomplissent ou se préparent lui paraissent résulter, pour ses compatriotes catholiques, des chances nouvelles et aussi des .devoirs nouveaux. A son tour, il répéterait volontiers de lui-même, ce que lui a dit Newman, lors de sa visite : «J’ai une oeuvre à faire en Angleterre. » Convaincu que, pour l’accomplir, il lui faut d’abord voir sur place hommes et choses, il se décide, vers la fin de 1835, à partir pour ce pays avec l’intention d’y séjourner plusieurs mois. Wiseman débarque en Angleterre, au mois de septembre 1835. Il est tout feu et tout flamme pour l’oeuvre qu’il veut entreprendre. A son passage par Paris, il a pu constater l’étonnant succès avec lequel, dans un milieu presque aussi hostile au catholicisme qu’une terre protestante, son ami Lacordaire vient d’inau-
1. En 1847. 2. Life and Times of Card. Wiseman, t. 1er p. 119.
135
gurer les conférences de Notre-Dame: sa confiance et son ardeur en sont accrues. Et cependant ce qu’il peut constater tout d’abord, par lui-même, de l’état d’esprit des catholiques anglais, de l’isolement craintif et rancuneux où ils se renferment, de leur manque de préparation à toute action publique, serait fait pour décourager tout autre que lui. «Leurs chaînes, a-t-il écrit, étaient enlevées; non la crampe et l’engourdissement qu’elles avaient produits 1.» Aller ouvertement à l’opinion anglaise, faire à haute voix appel à son bon sens, à sa clairvoyance, à sa loyauté, par l’exposé sincère d’une foi religieuse qu’elle n’a connue jusqu’ici que défigurée, l’idée n’en serait jamais venue à ces catholiques; elle supposait une aisance d’allure, une hardiesse, une confiance dans ses moyens d’action et aussi dans la justice de ceux auxquels il fallait s’adresser, qui leur manquaient complètement. C’est pourtant cette entreprise que va tenter seul, avec ses propres forces, ce nouveau venu, presque étranger dans sa patrie, Il a deviné que l’heure était favorable, que des causes diverses et même contraires, — idées de tolérance religieuse et de curiosité philosophique propagées par l’école libérale, retour de justice rétrospective né du progrès des études historiques, discrédit de l’anglicanisme officiel et des sectes ses rivales, aspirations plus ou moins conscientes vers une religion plus sérieuse et plus vivante, — concouraient à assurer tout au moins un auditoire à celui qui viendrait annoncer à cette Angleterre, depuis plusieurs siècles étroitement renfermée dans
1. Life and Times of Card. Wiseman, t. Ier , p. 216.
136
son protestantisme insulaire, le Dieu, inconnu pour elle, de l’Eglise romaine. Invité par le desservant de la chapelle sarde 1, à Londres, à prêcher en italien devant la petite congrégation qui s’y réunissait, Wiseman entreprend de joindre, pendant l’Avent, à cette prédication paroissiale, des lectures faites en anglais, à l’adresse des protestants aussi bien que de ses coreligionnaires, sur « les principales doctrines de l’Eglise catholique». Le renom qu’il s’est acquis à Rome attire des auditeurs de toute croyance, que retiennent le charme de son talent et l’intérêt qu’il sait donner au sujet. « J’ai deux lectures par semaine, écrit-il, en décembre 1835, à un de ses amis romains. L’effet a été mille fois plus considérable que je ne m’y attendais. La chapelle est pleine à suffoquer : fût-elle trois fois plus grande, elle serait remplie; chaque siège est occupé une demi-heure avant les complies. J’ai parlé rarement moins d’une heure et demie, généralement une heure trois quarts; personne, cependant, ne trouve cela trop long, et l’attention ne faiblit pas un moment 2. » Wiseman est à la fois heureux et un peu troublé de son succès. « Il m’arrivait souvent, a-t-il raconté plus tard, de verser des larmes dans la sacristie; je craignais que, tout en faisant du bien aux autres, mes lectures ne fussent en train de me remplir de vaine gloire 3.» 1. C’était un reste de ces chapelles d’ambassade qui avaient été, pendant longtemps, les seules autorisées pour le culte catholique, à Londres. 2. Life and Times of Card. Wiseman, t. Ier, p. 233, 231. 3. Ibid., p. 233.
137
Le résultat de cette première expérience encourage Wiseman à donner une nouvelle série de lectures, pendant le Carême de 1836. Le succès en est plus grand encore. La spacieuse église de Moorfields, où l’orateur s’est transporté, n’est pas moins comble que n’était la chapelle sarde, « De mémoire d’homme, constate un contemporain, aucune lecture de ce genre n’a éveillé un si vif intérêt. » Les protestants continuent à former une partie notable de l’assistance : lord Brougham est parmi les auditeurs les plus assidus. Les sujets choisis par l’orateur sont tels qu’il convient aux préventions du public anglais: plusieurs conférences sont consacrées à établir le principe d’autorité, en opposition avec celui du jugement privé, et à montrer, dans l’Eglise catholique, l’autorité vivante dont manque toute communion séparée; ce point capital bien fixé, l’orateur s’attache à expliquer les doctrines depuis longtemps défigurées par le protestantisme, la pénitence, le purgatoire, les indulgences, l’invocation des saints, la vénération des images et des reliques, la transsubstantiation. Le ton simple, courtois témoigne que l’orateur a confiance dans la loyauté de l’auditeur. Rien de la controverse : le mot lui-même est répudié par Wiseman : « Ce n’est pas, dit-il, pour attaquer les autres, pour chercher à remporter sur eux une victoire, que je viens m’adresser à vous. » Il a souci d’éclairer, sans irriter. Il se borne à exposer la vérité catholique, à la mettre en pleine lumière, à l’appuyer de preuves ingénieusement appropriées à l’état d’esprit et aux besoins moraux de ses compatriotes. Cette méthode
138
tranche complètement sur l’apologétique courante. Les protestants sont surpris et charmés de rencontrer cette politesse et cette bonne grâce, cette pénétration et cette ouverture d’esprit, chez un de ces prêtres romains dont ils étaient habitués à se faire une idée si sombre ou si grossière. Wiseman ne sait pas seulement leur plaire; il a ce qui vaut mieux, le don de persuasion. A sa parole, plusieurs anglicans de marque se convertissent, entre autres le célèbre architecte Pugin, apôtre ardent et quelque peu intolérant du revival gothique outre-Manche. D’autres, sans aller jusqu’à la conversion, sentent leurs préventions détruites ou diminuées, et confessent que la position du catholicisme est beaucoup plus forte, plus raisonnable qu’ils ne se le figuraient. Enfin ceux qui demeurent opposés sont du moins obligés de discuter ces lectures; leur succès s’impose à eux; les journaux en parlent à plusieurs reprises et longuement, comme d’un événement considérable. L’opinion est saisie de la question; cela seul est un fait absolument nouveau. L’effet n’est pas moins considérable sur les catholiques. Tout est pour les surprendre, et qu’un prêtre parle sur ce ton, et qu’il soit ainsi écouté. Certains, sans doute, hochent la tête, comme s’il y avait là quelque chose de suspect et de dangereux. Mais la plupart sont flattés de voir leur religion, jusqu’alors maltraitée et dédaignée, faire si bonne figure et prendre tant d’importance auprès du public anglais. Rien n’est mieux fait pour leur rendre courage et confiance. En vue de témoigner leur gratitude à l’auteur d’une telle transformation, ils ouvrent
139
une souscription et font frapper une médaille d’or, portant sur une face l’image de Wiseman, sur l’autre cette inscription : Nicholao Wiseman, avitâ religione forti suavique eloquio vindicatâ, Catholici Londinenses, MDCCCXXX VI.
Wiseman ne se contente pas d’une prédication forcément passagère; il se préoccupe d’assurer à ses coreligionnaires un moyen d’action durable. Réalisant donc un projet qui l’occupait depuis deux ou trois ans, il fonde, d’accord avec O’Connell, la Revue de Dublin, qui se publie à Londres et dont le premier numéro paraît en mai 1836. Son dessein est de poursuivre par là, l’oeuvre commencée dans ses lectures, de faire connaître au public anglais, dont la curiosité vient d’être éveillée sur ces questions, « le génie du christianisme, sous sa forme catholique e, de mettre en lumière sa grandeur, sa beauté, et aussi sa variété et sa souplesse;. Il a stipulé, en termes exprès, que la revue «appartiendrait au jour présent, c’est-à-dire qu’elle traiterait de questions vivantes ». Et tout d’abord, pour mettre cette méthode en pratique, il entend que l’un des premiers objets du recueil soit de suivre, de surveiller, de seconder, en essayant de le redresser, ce Mouvement d’Oxford, sur lequel il fonde de grandes espérances et auquel, à son avis, les catholiques ne peuvent rester plus longtemps inattentifs ou hostiles. Il donne l’exemple, en insérant, dans la première livraison, un article sur la controverse soulevée par la nomination du Dr Hampden : il s’y montre sympathique aux
1. Life and Times of Card. Wiseman, t. Ier, p. 252.
140
sentiments et aux aspirations de Newman et de ses amis, mais fait sentir l’inconsistance de leur situation, la vanité de leur effort, et comment ils revendiquent, pour leur Eglise, une autorité, une unité doctrinale et disciplinaire qu’elle ne peut avoir à raison de son origine, de sa constitution et de son principe; il n’en témoigne pas moins sa satisfaction de les voir s’engager dans cette voie et les engage à poursuivre . « Un jour viendra, dit-il, où ils passeront des rêves de la théorie à une réalité qui répondra à leurs plus ardentes attentes et remplira pleinement leurs justes désirs. » Quand, en août 1836, Wiseman reprend le chemin de Rome, où le rappellent ses devoirs de recteur, il est bien décidé à ne plus perdre de vue la crise religieuse d’Angleterre. L’année qu’il vient de passer dans sa patrie, marque le début d’une ère nouvelle dans l’histoire du catholicisme outre-Manche. Il a donné le signal d’une évolution qui ne s’arrêtera plus. Il a décidé les catholiques anglais à sortir de leurs catacombes. Tout ce qu’ils vont aussitôt entreprendre pour se faire une place dans la vie publique et pour ranimer leur vie religieuse, — fondation de journaux 1, d’asssociations de défense 2, d’oeuvres de zèle ou de charité, constructions d’églises, restauration du culte, multiplication du clergé, — a son origine dans l’exemple et l’impulsion donnés par le jeune prêtre qui était arrivé de Rome,
1. Fondation, en 1837, du London and Dublin weekly orthodox Journal et du Catholic Magazine, recueil mensuel; en 1840, du Tablet. 2. Fondation, en 1838, du Catholic Institute of Great Britain.
141
à la fin de 1835, seulement pour un séjour de quelques mois. On sera sans doute frappé de ce fait que l’initiative de Wiseman ait ainsi coïncidé avec le Mouvement suscité par Newman à Oxford. Pas le moindre lien entre ces deux hommes: leurs points de départs étaient absolument distincts et même opposés. Et cependant, dans le dessein providentiel, ils concouraient, l’un et l’autre, au succès de la même cause, si bien qu’on serait embarrassé de dire lequel l’a mieux servie. Seulement, il y avait, en 1836, entre Wiseman et Newman, cette différence, que le premier entrevoyait dès lors la convergence des deux mouvements, tandis que le second ne s’en doutait pas, et au besoin la répudiait.
III
Le bruit fait par les lectures de Wiseman, les controverses qu’elles suscitaient et qui se prolongèrent même après son départ pour Rome, amenèrent Newman à s’expliquer, une fois de plus, sur la délicate question de la situation de I’Eglise anglicane en face de l’Eglise de Rome. Le problème pesait visiblement sur son esprit. II se décida donc à publier, au commencement de 1837, sous ce titre: The prophetical office of the Church, viewed relatively to romanism and popular protestantism, un livre auquel il travaillait depuis longtemps, qu’il avait plus d’une fois remanié 1, et dans lequel il reprenait et développait les idées déjà émises dans ses lettres à l’abbé Jager et dans ses lectures de la chapelle d’Adam
1. Lett. and Corr. of J.-H. Newman, t. II, p. 215.
142
de Brome. Il n’était pas sans anxiété sur la façon dont sa thèse serait accueillie 1, Son dessein était de former, avec les matériaux jusqu’alors épars et mal assortis des docteurs anglicans, un corps de théologie qui lui paraissait faire défaut à son Eglise; il s’agissait toujours, bien entendu, d’aboutir à cette via media qui permettait d’échapper à la fois au protestantisme et au catholicisme; contre le premier, il revendiquait le principe dogmatique et sacramentel; du second, il repoussait ce qu’il appelait la corruption romaine; chez l’un, il condamnait l’abus du jugement privé, chez l’autre, la prétention à l’infaillibilité doctrinale. Ces idées avaient été, sans doute, déjà indiquées dans ses précédents écrits; mais il les présentait, cette fois, sous une forme plus complète, et surtout le ton avec lequel il parlait de l’Eglise romaine était plus âpre et plus rude. Est-ce donc que ce livre laissait au lecteur l’impression d’une doctrine, définitive et bien sûre d’elle-même? Non, on y sentait une incertitude inquiète ou tout au moins un tâtonnement, comme d’un pilote réduit dans la brume, à chercher sa route à coups de sonde répétés. Qu’il fût dans la bonne direction, Newman voulait l’espérer, mais eût-il osé l’affirmer? C’était une expérience qu’il tentait et dont l’avenir seul ferait connaître le résultat. Lui-même écrivait dans l’introduction : « On peut dire que le protestantisme et le papisme sont des religions réelles; personne ne saurait avoir de doute à leur sujet; elles ont fourni le moulé
1. Lett. and, Corr., t. II, p. 220, 229; — Purcell, t. Ier , p. 224.
143
dans lequel les nations ont été jetées; mais la via media n’a jamais existé, sauf sur le papier; elle n’a jamais été mise en pratique; elle est connue non positivement, mais négativement, dans ses différences avec les symboles rivaux, non dans ses propriétés à elle; et elle ne peut être décrite que comme un tiers système qui n’est ni l’un ni l’autre, qui est partiellement tous les deux... Qu’est-ce, sinon s’imaginer, à travers monts et rivières, une route qui n’a jamais été percée?» Et il ajoutait : « Il reste à essayer si ce qu’on appelle l’anglo-catholicisme est susceptible d’être professé, de servir de règle de conduite, et d’être maintenu dans une vaste sphère d’action, ou, si c’est une simple modification, un état transitoire soit du romanisme, soit du protestantisme populaire. » A la fin de son livre, quand il s’agissait de conclure, le même doute, la même défiance, le reprenaient: «A cette heure où nos discussions tirent à leur fin, où la fièvre des recherches a cessé et fait place à la lassitude, nous sentons, de loin en loin, revenir la pensée qui pesait déjà sur nous quand nous avons abordé ce sujet; cette pensée, c’est que tout ce que nous venons de dire n’est qu’un rêve, exercice capricieux plutôt que conclusion pratique de notre intelligence. » Ansi nous apparaît Newman, en 1837, tel qu’il devait rester encore pendant plusieurs années, cherchant laborieusement, anxieusement, douloureusement, un fondement solide à ses croyances Est-il surprenant que des observateurs avisés, comme J.-B. Mozley, crussent entrevoir tout au fond de cet esprit « une incrédulité latente au sujet de l’existence même de l’Eglise d’An-
144
gleterre 1? Toutefois, marquons bien sur quel point, à cette date, Newman pouvait avoir quelque incertitude: ce n’était pas sur la nécessité de suivre une via media qui fût séparée de Rome; c’était uniquement sur le choix des principes d’après lesquels devait s’opérer et se justifier cette séparation; il se demandait si, à l’épreuve, ces principes seraient jugés bien solides; dût cette épreuve ne pas leur être favorable, la conséquence, dans sa pensée, n’en devrait jamais être d’aller à Rome, mais seulement de se mettre en quête d’un autre système. Si, pour répondre à certaines accusations, Newman avait jugé un moment nécessaire d’insister sur les points où il se séparait de Rome, sa tendance naturelle et préférée n’en était pas moins de montrer plutôt en quoi il se rapprochait du catholicisme et s’éloignait du protestantisme. Ainsi consacrait-il le tract 75 à l’éloge du Bréviaire romain, trouvé parmi les reliques de Froude; à la suite de cette publication, plusieurs de ses disciples se mettaient à dire, chaque jour, ce bréviaire et en entreprenaient la traduction, bientôt interrompue devant les réclamations des autorités religieuses. Plus significatif, bien qu’au premier aspect moins explicite, était le tract 85, paru en 1838, et qui reproduisait des lectures faites sur « la Sainte Ecriture dans ses rapports avec le Credo catholique »; Newman s’y attaquait à la thèse protestante, qui prétend n’admettre comme vérité religieuse que ce que chacun juge être explicitement établi par les Ecritures; il démon-
1. Cité par Overton, The Anglican Revival, p. 78. ,
145 trait qu’à cette épreuve ne pourraient résister beaucoup des vérités les plus essentielles du christianisme, à commencer par l’inspiration même de ces Ecritures; sa conclusion était que, sans doute, toutes les vérités sont implicitement dans l’Ecriture, mais qu’elles ne peuvent en être dégagées que par l’interprétation d’une Eglise divinement instituée pour cette oeuvre; sans cette foi humble dans l’Eglise, ajoutait-il, l’Ecriture seule nous trompera ; elle sera la source d’idées incohérentes ou capricieuses, variant suivant l’esprit de ceux qui prétendront l’interpréter. De tels écrits n’étaient pas pour diminuer les méfiances dont les tractarians étaient l’objet dans le monde protestant. Au printemps de 1838, elles furent encore avivées par l’apparition de la première partie des Remains de Richard Hurrell Froude. Quand Newman et Keble se décidèrent, après avoir pris l’avis de leurs amis 1, à réunir, pour les publier, quelques-uns des papiers laissés par Froude, — le journal intime de ses crises d’âme, sa correspondance, quelques sermons, des fragments d’études diverses, — ils pensaient surtout à faire un acte de justice et à proposer un exemple salutaire : ils estimaient devoir à une mémoire si chère de révéler au monde religieux qui l’ignorait la part décisive qu’avait eue, dans les débuts de leur campagne, celui que la maladie semblait en avoir tenu à l’écart; il leur paraissait d’une utile leçon de montrer à une Eglise où l’ascétisme était oublié et méconnu ce qu’il y avait eu, en cet homme, de sévérité envers soi-même, de mortifica-
1. Lett. and Corr. of J.-H. Newman, t. II, p. 236 à 242.
146
tion héroïque, de montée souvent laborieuse, douloureuse même, vers la sainteté; et puis, en découvrant quelque chose des généreuses ardeurs de cette âme de feu, n’y avait-il pas chance que les générations nouvelles ressentissent quelque peu la contagion d’un enthousiasme que Newman jugeait nécessaire au succès du Mouvement 1 ? Mais les deux éditeurs, depuis longtemps familiarisés avec le franc parler, les saillies, les hardiesses provocantes, les emportements auxquels Froude s’abandonnait volontiers dans l’intimité, avaient-ils bien mesuré l’effet qu’un tel langage produirait sur le public, au plein jour d’un livre imprimé? Dans leur préface, ils se bornèrent à prévenir le soupçon de papisme, en appelant l’attention sur les passages où leur ami parlait durement de l’Eglise de Rome. Les deux premiers volumes, publiés en 1838, contenaient les documents les plus significatifs, entre autres le journal intime et la correspondance. Là, presque à chaque page, se rencontraient des propositions hardiment catholiques, des condamnations prononcées d’un ton tranchant et méprisant contre le protestantisme, des hommages rendus à l’Eglise de Rome et surtout des malédictions irritées contre les Reformers anglais du XVIe siècle. Dans le monde protestant, l’émoi fut grand et prit le caractère d’un scandale. Pendant qu’Arnold s’élevait contre ce qu’il appelait un acte « d’extraor-
1. Newman écrivait à Keble, le 16 juillet 1837, précisément à propos de la publication des Remains: « Nous avons souvent dit que le Mouvement, pour qu’il en sorte quelque chose, doit être enthusiastic. Eh bien, voici un homme, fait plus que tout autre, pour allumer l’enthousiasme. » (Lett. and Corr., t. II, p. 240.)
147
dinaire impudence », le Dr Faussett, professeur de théologie à Oxford, dénonçait ce qu’il appelait le Revival of Popery, dans un sermon prêché, le 20 mai 1838, devant l’Université, et aussitôt publié avec dédicace aux junior students; c’était le premier symptôme de l’hostilité étroite que les dignitaires de l’Université allaient désormais témoigner aux tractarians 2. Sur le conseil de ses amis, Newman crut devoir répondre à l’attaque de ce professeur. La presse s’empara de la question et la débattit avec passion 3. Le Parlement lui-même en fut saisi par lord Morpeth 4. Pour protester avec plus d’éclat contre l’injure faite aux fondateurs de l’Eglise anglicane, des membres de l’Université d’Oxford ouvrirent une souscription pour élever, dans leur ville, un monument en l’honneur de ceux qu’on appelait les «martyrs de la Réforme », Latimer, Cranmer et Ridley. Au fond, c’était moins un acte de piété qu’une manoeuvre de parti : il ne s’agissait pas. tant d’honorer les « martyrs » que d’embarrasser les
1. Lettre du 5 août 1838. (Life of Arnold, par Stanley.) 2. Telle était l’émotion provoquée que nombre de parents décidaient d’envoyer de préférence leurs fils à Cambridge, par crainte du papisme qui se manifestait à Oxford. (Life of Bishop Wilberforce, par Ashwell, t. Ier , p. 129.) 3. A propos de ces articles de journaux, Newman écrivait: « Ils n’ont plus qu’un pas à faire, c’est de dire que je suis le Pape ipsissimus sous un déguisement. » (Lett. and Corr., t. II, p. 271.) 4. Dans une de ses lettres, Newman citait cet article publié dans le Dublin Record, à l’occasion du débat soulevé au Parlement par lord Morpeth: « Le débat mérite l’attention parce que lord Morpeth y a fait connaître une secte de damnables hérétiques, née récemment à Oxford, qui tend manifestement au papisme... Nous avons observé avec soin ces gens et, par la grâce de Dieu, nous les dévoilerons et prouverons que tous les fidèles doivent les abhorrer. Non hésitons pas à dire qu’ils sont criminellement hétérodoxes. » ibid., t. II, p. 256, 257.)
148
tractarians; si ceux-ci souscrivaient, ils faisaient une sorte d’amende honorable; s’ils ne souscrivaient pas, ils donnaient raison à ceux qui les accusaient d’être des fils déloyaux de leur Eglise. En dépit des instances de quelques high-churchmen conciliants, Newman et Keble n’hésitèrent pas à refuser leur adhésion. « Je ne suis pas du tout préparé, écrivait Keble, à me séparer publiquement de Froude dans l’opinion qu’il a exprimée sur les réformateurs en tant que parti 1. » Pusey, après quelques hésitations, fit de même, et les disciples suivirent généralement l’exemple de leurs chefs 2. Peu après, en 1839, la seconde partie des Remains paraissait, avec une assez longue préface de Keble qui expliquait et justifiait la première partie tant attaquée, sans en rien désavouer. En août 1838, au plus vif des polémiques soulevées par la publication des Froude’s Remains, un incident s’était produit qui avait beaucoup plus ému et troublé Newman que les plus bruyantes invectives de ses contradicteurs habituels. L’évêque d’Oxford, le Dr Bagot, avait cru devoir parler des tracts dans son mandement 3 : tout en constatant qu’ils contenaient d’excellentes choses, il déclarait y avoir rencontré avec regret
1. Life of Pusey, t. II, p. 71. 2. Le Martyr’s Memorial n’eut pas, en fin de compte, les proportions monumentales rêvées au début. On se borna à élever, en 1841, devant le collège de Balliol, une croix gothique. 3. Je traduis par le mot « mandement » le terme anglais charge; cette traduction est imparfaite. « Mandement s éveille l’idée d’un document écrit, d’une lettre pastorale. Ce qu’on appelle outre-Manche charge est prononcé oralement, avant d’être imprimé; c’est quelque chose comme la mercuriale qui était en usage dans notre ancienne magistrature.
149
quelques expressions de nature à jeter les esprits dans l’erreur; à son avis, le danger existait moins pour les maîtres que pour les disciples, et il mettait en garde ceux qui avaient la charge de ces derniers. Pour être enveloppées de ménagements et de compliments, les paroles épiscopales n’en contenaient pas moins un blâme. Ce blâme était fort inattendu pour Newman, qui croyait pouvoir compter sur la bienveillance amicale du Dr Bagot 1. Au début du Mouvement, Newman eût désiré voir les évêques en prendre la direction, et il se fût bien volontiers effacé derrière eux 2. Ne devaient-ils pas, se disait-il, être les premiers intéressés au triomphe d’une doctrine qui surnaturalisait leur origine et magnifiait leur autorité? Force lui avait été bientôt de se rendre compte qu’il n’avait rien à attendre d’eux; la plupart paraissaient ignorer ce qui se passait; ceux qui en savaient quelque chose se montraient plus embarrassés que flattés de la hauteur où l’on prétendait les placer; ils trouvaient gênants, sinon dangereux, ces jeunes fellows d’Oxford qui venaient réveiller, en y jetant brusquement tant d’idées nouvelles, leur Eglise doucement sommeillante. De les aider, ils n’avaient donc aucune envie. Mais voici que l’abstention indifférente ou chagrine ne leur suffisait plus; l’un d’eux en sortait pour exprimer un blâme; et c’était l’évêque même de Newman, ce qui, aux yeux-de ce dernier, rendait la chose beaucoup plus grave. Il avait, en effet, une
1. Lett. and Corr. of J.-H. Newman, t. II, p. 255. 2. Ibid., Ier , p. 441, 448.
150
grande idée de l’autorité de chaque évêque dans son diocèse. Il professait que, «depuis la séparation d’avec le Pape, l’autorité de celui-ci était revenue à l’évêque de chaque diocèse ». « Notre évêque est notre pape, ajoutait-il; notre théorie est que chaque diocèse forme une Eglise intégrale. » Et plus tard, après sa conversion, il écrivait : « Mon devoir envers mon évêque était mon point d’honneur, sa désapprobation la seule chose que je ne pusse pas supporter 1. » A ceux qui lui faisaient remarquer que, dans le cas particulier, le blâme était très léger « Le moindre mot d’un évêque parlant ex cathedrâ, répondait-il, est d’un grand poids 2» Pusey s’étonnait d’une déférence qu’il ne partageait pas au même degré. Newman, néanmoins, y persista. Peut-être s’y mêlait-il quelque lassitude, quelque découragement de n’avoir encore rencontré dans son Eglise aucune autorité qui le soutint. « Voilà bien des années, écrivait-il à Pusey, que je lutte contre toutes sortes d’oppositions, et avec à peine une voix amie. Considérez combien peu de personnes ont dit un mot en ma faveur. Croyez-vous que la pensée que je me mets hors de ma place ne me traverse jamais l’esprit ? Qui ai-je pour me garantir que je fais bien en m’avançant tellement contre tout le monde? Suis-je un évêque, un professeur, ou occupé-je quelque situation me donnant le droit de parler 3? » Résolu à mettre ses principes en pratique, Newman
1. Apologia. 2. Lett. and Cor. of J.-H. Newman, t. II, p. 259. 3. Life of Pusey, t. II, p. 58.
151
fit donc aussitôt savoir à son évêque que, si les tracts étaient blâmés par lui, il allait en arrêter la publication, ou tout au moins supprimer la partie blâmée; il déclarait, d’ailleurs, éprouver un plaisir plus vif dans la conscience de sa soumission qu’il n’en éprouverait à voir répandre ces écrits. L’évêque ne fut pas le moins ému des deux, quand il vit quelle portée menaçait d’avoir une phrase insérée dans son mandement, un peu à la légère, sous la pression d’une partie de son entourage. Il n’entendait pas avoir la responsabilité de l’interruption des tracts, se défendait d’avoir jamais rien voulu de semblable et protestait de son estime pour leurs auteurs. Il finit, après des pourparlers et des correspondances dans lesquels Pusey s’interposa, par promettre d’adoucir le blâme, lorsqu’il ferait imprimer son mandement. Newman, touché des sentiments du prélat, et prenant son trouble en compassion, ne chicana pas sur les termes de cet adoucissement et se déclara satisfait 1. Un peu plus tard, dans les premiers jours de 1839, Pusey et lui, pour donner, à leur tour, une satisfaction à leur évêque, publiaient, l’un un nouvel exposé de la doctrine de la via media et des points par où elle se séparait de Rome; l’autre une aorte de résumé de tout ce que les tracts avaient dit contre l’Eglise romaine. Cette première intervention épiscopale ne finissait donc pas mal pour Newman, à cause surtout des sentiments personnels du Dr Bagot. Ce n’en était pas moins un symptôme de nature à inquiéter les hommes du
1 Apologia, et Lett. and Corr., t. II, p. 255 à 265.
152 Mouvement sur les dispositions des chefs de leur Eglise. Si un ami parlait ainsi, qu’attendre des autres? En cette même année 1838, l’évêque de Chester dénonçait « la mine creusée sous les fondations de l’Eglise protestante par des hommes qui habitent dans ses murailles »; et il s’indignait de la conduite de ceux qui s’assoient dans le siège des réformateurs et qui décrient la Réforme ». En 1839, l’un des membres les plus considérables de l’épiscopat, le Dr Blomfield, évêque de Londres, félicitait l’évêque de Calcutta des critiques que son mandement contenait à l’adresse des tractarians; pour son compte, tout en reconnaissant que ces écrivains avaient relevé dans les esprits la notion de l’autorité de l’Eglise, il leur reprochait « d’avoir altéré la simplicité de l’Evangile de Jésus-Christ et le caractère scriptural de l’Eglise d’Angleterre 1 » Ajoutons que presque tous les évêques apportaient une adhésion publique au projet de monument commémoratif des « martyrs » de la Réforme, s’associant ainsi à une manifestation visiblement dirigée contre Newman et ses amis. Entre ceux-ci et l’épiscopat, le fossé se creusait. Le temps ne fera que l’élargir.
IV
De loin, Wiseman continuait à suivre attentivement les vicissitudes du Mouvement d’Oxford. Rentré à
1. A Memoir of C.-J. Blomfield, t. II, p. 15.
153
Rome, dans les derniers mois de 1836, il y avait repris la direction de son collège, mais son coeur était demeuré en Angleterre. Il s’intéressait aux efforts que les catholiques, si longtemps abaissés, y faisaient pour se relever, il les conseillait, les stimulait, insistait, par exemple, sur la nécessité de réformer l’éducation de leur clergé et de lui souffler un esprit nouveau 1. Il était surtout de plus en plus convaincu, à la différence de beaucoup de ses coreligionnaires, de l’importance qu’avait, pour l’avenir du catholicisme outre-Manche, l’évolution qui s’accomplissait au sein de l’anglicanisme. Dès 1837, il s’appliquait à ouvrir sur ce sujet les esprits du monde romain; dans un travail lu devant l’Académie de la religion catholique, à Rome, il relevait, avec satisfaction, dans le protestantisme anglais, tous les signes de rapprochement vers les idées catholiques. Il attachait plus de prix encore à agir sur le public d’Angleterre; dans une série d’articles publiés par la Revue de Dublin, il suivait pas à pas les manifestations de l’école tractarienne, en parlait avec sympathie, l’encourageait dans la voie où elle s’engageait, mais en même temps s’efforçait de lui faire comprendre l’impossibilité de rester à mi-chemin du catholicisme 2. Les hommes du Mouvement étaient surpris de sentir, d’un côté où ils n’étaient pas habitués à beaucoup regarder,
1. The Life and Times of Card. Wiseman, par W. Ward, t. Ier , p. 266, 267. 2. Ainsi trouve-t-on, en 1837, dans la Revue de Dublin, un article sur The High Church theory of dogmatical authority; en 1838, deux articles sur les Tracts for the Times: en mai 1839, un article sur les Froude’s Remains.
154
cet oeil fixé sur eux, si attentif, si perspicace, et qui pénétrait jusqu’à leur plus intime faiblesse. Ce n’était pas que Wiseman se flattât plus qu’il ne l’avait fait tout d’abord, que le mouvement d’Oxford amenât prochainement de nombreux retours à Rome: comme il l’a confessé plus tard, il ne prévoyait pas alors les retentissantes conversions de 1845 et de 1850. Mais il estimait que, même en dehors de tout gain immédiat pour la Papauté, le progrès des idées catholiques au sein de l’Eglise d’Angleterre était un fait heureux; la via media ne lui paraissait pas pouvoir être un terme définitif; il n’y voyait qu’un état transitoire où séjourneraient, plus ou moins longtemps, les âmes qui, de l’anglicanisme, se dirigeaient vers le plein catholicisme. Un fait, du reste, le frappait et lui donnait bon espoir: les conversations des Anglais notables qui venaient le voir, en passant par Rome, lui permettaient de constater combien les vieilles préventions contre le catholicisme tendaient à s’affaiblir chez ses compatriotes. Ainsi, en 1838, se trouva-t-il en relations avec deux hommes qui personnifiaient brillamment la pensée anglaise dans les tendances les plus contraires, Gladstone et Macaulay, l’un, alors conservateur, anglican fervent, dévoué aux idées High Church, se piquant de culture théologique ; l’autre, libéral, uniquement occupé de politique et de littérature, assez étranger aux choses religieuses, en tous cas sans aucune tendance catholique. N’était-il pas remarquable et absolument nouveau qu’ils s’accordassent l’un et l’autre à témoigner, à l’endroit du catholicisme, une curiosité
155
sympathique? Gladstone expliquait lui-même son voyage à Rome, par « le désir de connaître la pratique de l’Eglise romaine, l’efficacité de son action morale et spirituelle sur ses membres »; il ajoutait que cette constatation « importait beaucoup au développement de ses propres convictions, relativement à la doctrine de la visibilité de l’Eglise et à la nécessité de cette doctrine pour contre-balancer la tendance vers une infinie subdivision et vers l’infidélité finale, qui naît d’un jugement privé illimité 1 ». Il eut, à ce sujet, plusieurs entrevues avec Wiseman, dont il goûta fort l’ouverture et l’élévation d’esprit. Quant à Macaulay, venu en curieux et en historien, il subit la séduction de la Rome papale: il eut comme une révélation inattendue de sa grandeur passée, présente et future, révélation dont l’écho devait se retrouver, deux ans plus tard, dans le fameux préambule de son essai sur l’Histoire des Papes, de Ranke 2. Tous ces indices du travail qui s’accomplissait dans
1. Lettre à M. Rio, du 5 août 1838. (Life and Times of Card. Wiseman, t. Ier, p. 275.) 2. Dans cet essai, après avoir magnifiquement peint la grandeur passée de l’Eglise romaine et sa grandeur présente, Macaulay ajoutait: « Je ne vois aucun signe qui indique le terme prochain de sa longue domination. Elle a vu le commencement de tous les gouvernements ecclésiastiques qui existent aujourd’hui dans le monde, et je ne suis pas convaincu qu’elle ne soit pas destinée à en voir la fin. Elle était grande et respectée, avant que les Francs eussent passé le Rhin, quand l’éloquence grecque fleurissait encore à Antioche, quand on adorait encore les idoles dans le temple de La Mecque ; et elle conservera peut-être encore toute sa vigueur première, lorsque je ne sais quel voyageur de la Nouvelle-Zélande viendra, au milieu d’une vaste solitude, se placer sur une arche brisée du pont de Londres, pour esquisser les ruines de Saint-Paul. » Combien, en 1840, un tel langage était chose nouvelle sous une plume anglaise!
156
l’esprit de ses compatriotes, confirmaient Wiseman dans la pensée qu’il y avait une oeuvre à faire en Angleterre. Il aspirait à y retourner, non plus pour y passer plus ou moins rapidement, mais pour y résider. Il avait l’intuition que là était sa tâche, et il attendait, non sans quelque impatience, que ses supérieurs l’appelassent à s’y consacrer.
V
En dépit de toutes les oppositions auxquelles il s’est heurté, — préventions éveillées dans la masse protestante, malveillance des autorités universitaires et épiscopales, dédain ou méfiance des pouvoirs politiques, —le Mouvement d’Oxford avance et grandit toujours. En 1839, il est à son apogée. Les sermons de Newman attirent autour de la chaire de Sainte-Marie un auditoire chaque jour plus nombreux, plus ému, plus conquis. Imprimés en volumes, ils ont un succès de vente que leur auteur constate avec une surprise modeste. Les tracts sont partout demandés, et, dans la seule année 1838, on en a vendu plus de soixante mille 1. Une édition en est publiée aux Etats-Unis 2. Aux livres et aux brochures s’ajoutent les articles de revue, généralement insérés dans le British Critic dont Newman a pris la direction. Chaque année, paraissent plusieurs
1. Lett. and Corr. of J.-H. Newman, t. II, p. 278, 279, 283. 2. Life of Pusey, t. II, p. 124. — Au cours de la crise qui devait l’amener au catholicisme, le P. Hecker a été un moment tenté de devenir anglican, par sympathie pour le Mouvement d’Oxford (Le P. Hecker, p. 123 à 126.)
157
volumes de la Bibliothèque des Pères. C’est sous toutes les formes que les publications à tendance catholique se multiplient et trouvent accueil dans le monde religieux. Sur plusieurs points de l’Angleterre, les clergymen se réunissent en meetings pour discuter ces idées nouvelles, et quelques-uns font le voyage d’Oxford pour juger par leurs yeux de ce qu’il en est: De Londres, Rogers écrit à Newman: « On ne peut aller nulle part sans entendre parler de l’Oxford Tract party, etc. Je pouvais à peine écrire une lettre, dans la salle du club, tant mon attention était distraite par deux hommes qui discutaient à votre sujet. Vous semblez même par degré prendre possession des rues : au moins, la dernière fois que je traversai Saint-Paul’s Churchyard, j’entendis les mots Newmanist et Puseyist prononcés par deux passants qui causaient avec beaucoup de vivacité 1. » Il n’est pas jusqu’à l’Université rivale de Cambridge où le Mouvement n’éveille les esprits et ne rencontre des sympathies; de cette ville, plusieurs jeunes étudiants viennent, comme en pèlerinage, à Oxford, et s’en retournent joyeux et émus d’avoir pu approcher Newman et Pusey 2 . Le petit groupe qui a commencé le Mouvement, il y a quelques années, s’est notablement grossi. Aux compagnons d’armes que Newman a groupés à la première heure, — Bowden, Frédéric Rogers, Isaac Williams, les deux Wilberforce, — d’autres sont venus se joindre.
1. Letters of lord Blachford, p. 52. 2. Voir la lettre où l’un de ces jeunes Cambridgemen , M. J.-F. Russell, raconte sa visite à Oxford. (Life of Pusey, t. 1er . p. 404 à 408.)
158
Parmi eux, nul homme qui soit plus âgé que le jeune chef; quelques-uns sont ses contemporains, comme Oakeley, fellow de Balliol, écrivain élégant, nature artiste, âme douce et pieuse. La plupart sont plus jeunes, représentant de ces générations nouvelles, rising generations, dans lesquelles les promoteurs de cette évolution religieuse déclarent placer tout leur espoir 1. Tel est Charles Marriott 2, l’un des principaux collaborateurs de la Bibliothèque des Pères, grand travailleur malgré une santé frêle, esprit métaphysique, un peu embarrassé dans les abstractions, n’en ayant pas moins acquis quelque autorité par son érudition consciencieuse et surtout par sa bonté et sa vertu, très modeste, désintéressé de son succès personnel, âme de disciple, heureuse de se dévouer à un maître, surtout quand ce maître est un Newman. A côté de lui, Richard-William Church 3, un des hommes que Newman ale plus aimés. Ce n’est pas seulement un lettré distingué qui écrira plus tard la meilleure histoire de l’Oxford Movement; c’est une à me d’une rare beauté morale, pratiquant à un degré peu commun le détachement de soi, apportant, dans le jugement des hommes et des choses, beaucoup de bonne foi, de justice et de largeur, très ferme dans ses convictions, en étant aussi dégagé que possible de l’esprit de parti et de secte. Eloigné d’abord du Mouvement par son origine
1. Lettre de Fred. Rogers du 21 janvier 1839. (Letters of lord Blachford, p. 52.) 2. Né en 1811. 3. Né en 1815. Voy. Life and letters of Dean Church, par Mary Church.
159
evangelical, il en a été peu à peu rapproché par l’entremise de Marriott et est devenu un auditeur assidu des sermons de Sainte-Marie; ce n’est toutefois qu’en 1838, lorsqu’il est élu fellow d’Oriel, qu’il entre dans l’intimité de Newman. Il arrivait trop tard dans la nouvelle école pour prendre part à la rédaction des tracts; il collabore surtout à la Bibliothèque des Pères et aux Vies de saints anglais qui sont bientôt entreprises. Ni Marriott, ni Church, malgré leur attachement à Newman, ne devaient le suivre lors de sa conversion au catholicisme; tel n’est pas le cas de cet autre disciple qui deviendra plus tard le P. Faber. Tous les contemporains s’accordent à constater le charme séducteur qu’exerçait autour de lui, lors de ses débuts à Oxford, le jeune Frédéric-William Faber 1. C’était un causeur brillant, un lettré délicat, un poète d’une inspiration suave. Son esprit, naturellement religieux et mystique, est d’abord ballotté entre l’enthousiasme qu’éveillent en lui les sermons de Newman et les idées contraires qu’il tient d’une éducation tout evangelical; ce n’est que vers 1837, après une longue résistance, qu’il entre définitivement dans le Mouvement et collabore, lui aussi, à la Bibliothèque des Pères. Plus porté, du reste, à la piété qu’à la controverse, il s’applique surtout à faire pénétrer ses nouvelles convictions catholiques dans sa vie spirituelle et aussi dans l’action qu’il a bientôt à exercer en qualité de ministre de paroisse; comme à Froude et à Newman, une grâce particulière
1. Né en 1814, futur Oratorien. Voy. Life and letters of F.- W. Faber, par Bowden.
160
lui a révélé le prix et la beauté de la virginité sacerdotale. Nommons encore A.-J. Christie 1, fellow d’Oriel, qui traduisait, à la demande de Newman, les premiers volumes de l’Histoire ecclésiastique de Fleury; J. Dalgairns 2, esprit subtil et puissant, très doué pour tous les problèmes de théologie et de philosophie religieuse; S. Wood 3, jeune laïque plein d’ardeur, sans cesse occupé de gagner des adhérents; J.-R. Hope Scott 4, ancien fellow de Merton college, en rapports intimes avec Newman depuis 1837, collaborateur du British Critic, devenu légiste à Londres, et pratiquant dans le monde une piété ascétique que la lecture des Remains de Froude n’a pas peu contribué à développer; enfin, un personnage destiné à un rôle plus considérable que les autres et sur les débuts duquel il y aura lieu de revenir plus en détail, Henry-Edward Manning, fellow de Balliol : il a, depuis 183e, quitté l’Université pour se consacrer au ministère pastoral; dès 1837, il commence à se dégager de l’evangelicalism pour se rapprocher des tractarians, n’hésite pas, en plus d’une circonstance, à les soutenir de sa plume et de son action, mais le fait un peu du dehors, plutôt en allié qu’en disciple. Ces jeunes hommes viennent de tous les points de l’horizon religieux; plusieurs, à l’exemple de Keble et de Pusey, tiennent, par leur origine et leur formation,
1. Né en 4817. futur Jésuite. 2. Né en 1818, futur Oratorien. 3. Il devait mourir prématurément en 1843. Lord Halifax, le président actuel de l’English Church Union, est son neveu. 4. Né en 1812, se convertira au catholicisme avec Manning.
Au High Church; beaucoup, et non de ceux qui doivent le moins marquer, ont eu d’abord, comme Newman, leur phase evangelical, mais n’y ont pas trouvé la satisfaction de leurs besoins spirituels : c’est, on l’a vu, le cas d’Oakeley, de Faber, de Church, de Wood, de Manning. De l’école libérale, le Mouvement a tiré moins de recrues. Il en est cependant quelques-unes, témoin un homme qui devait être l’un des scholars les plus renommés d’Oxford, Mark Pattison 1 après avoir paru d’abord absorbé par ses études littéraires et ne s’intéresser aux questions ecclésiastiques qu’en prenant parti pour Hampden, il se trouve, vers 1838, entraîné dans le tractarianisme, en devient un ardent partisan, collabore à ses publications et s’enflamme d’une ferveur religieuse qui devait être passagère, car il sera du petit nombre de ceux que la conversion de Newman rejettera dans le scepticisme. Il n’est pas jusqu’à Benjamin Jowett 2, le plus avancé des broad churchmen, qui, vers 1839 et 1840, quand il était fellow de Balliol, timide encore de manières, déjà hardi de pensée, n’ait eu son heure, bien courte, il est vrai, de tentation newmanist; c’est en faisant allusion à cette crise qu’il a écrit plus tard « Je pense quelquefois que, sans l’action de la Providence, j’aurais pu devenir un catholique romain 3. » De tous les « libéraux », les plus réfractaires au newmanism sont les disciples d’Arnold; ils n’en
1. Né en 1813. Voy. Memoirs by Mark Pattison. 2 Né en 1817. Voy. Life and letters of B. Jowett. 3. Ibid., t. Ier , p. 74.
162
sentent pas le besoin, croyant avoir trouvé ailleurs une source de vie religieuse; on sait d’ailleurs avec quelle véhémente âpreté leur maître a attaqué Newman. « Ce que je crains, écrit ce dernier en 1838, c’est la génération qui s’élève maintenant à Oxford, les jeunes gens d’Arnold (Arnold’s youths); bien des choses dépendent de la façon dont ils tourneront 1. » Cependant, même de ce côté, plus d’une âme est ébranlée par le mouvement: du nombre, est le disciple le plus aimé d’Arnold, Arthur Penrhyn Stanley, le futur doyen de Westminster 2. Issu d’une branche cadette de la famille des comtes de Derby, d’un esprit aimable et distingué, le jeune Stanley avait passé cinq ans à l’école de Rugby; les sentiments qu’il y avait conçus pour le directeur de cette école étaient ceux d’une vénération enthousiaste; on eût dit une sorte de dévotion; il le regardait comme «inspiré », le proclamait son « oracle et son idole 3 ». Quand donc il arrive à Oxford, en 1834, au début du Mouvement, il y apporte les préventions de son maître contre tout dogmatisme et rêve d’une Eglise assez large, assez indéterminée pour embrasser les sectes les plus diverses; c’est le contre-pied de la thèse des tracts. La doctrine de la Succession apostolique lui paraît « monstrueuse », et il est stupéfait qu’on puisse la professer. Son coeur, du reste, est toujours à Rugby; il ne se sent jamais plus heureux que quand il peut y
1. Lett. and Corr., t. II, p. 252. 2. Né en 1815. Voy. Life and Correspondence of Arthur Penrhyn Stanley, par Rolwand E. Prothero, with the cooperation and sanction of G-G. Bradley. 2 vol. 3. Ibid., t. Ier, p. 139.
163
retourner, pour causer avec Arnold et entendre un de ses sermons. « Être à Rugby, dit-il, c’est être au troisième ciel. » C’est pourtant le même homme dont on voit bientôt la curiosité s’éveiller au sujet de tout ce qu’il entend raconter de Newman : un jour, se trouvant chez un de ses camarades, on lui dit que Newman passe devant la porte, il court à la fenêtre pour l’apercevoir. « Newman m’intéresse beaucoup », écrit-il, et il ajoute, dans une autre Lettre : « Ce qui occupe le plus mon esprit ,en ce moment, c’est Newman 1 .» Des chefs du Mouvement, Pusey est le premier qu’il entend prêcher; il le trouve long et un peu ennuyeux. Très différente est son impression, quand il assiste à un sermon de Newman. Tout rebelle qu’il se déclare à certaines de ses idées, il est touché, charmé; il se plaît à rendre hommage à son amour des âmes, à son désintéressement; il le compare à Arnold, et, dans sa bouche, il n’est pas de plus grand éloge. Cette sympathie croissante lui rend fort pénible l’antagonisme existant entre son cher maître de Rugby et le chef des tractarians. « Ils semblent à présent, dit-il, des puissances ennemies, tandis qu’ils sont, en réalité, de la même essence 2. » Il ne cache pas son regret de l’attaque violente qu’à l’occasion- de l’affaire Hampden, Arnold a dirigée contre les Oxford malignants. Bientôt même, il semble pencher du côté de ces malignants. « Stanley, maintenant, reçoit le sacrement à Sainte Marie », lit-on dans une lettre de Newman, datée de
1. Life and Corr. of A.-P. Stanley, t. ler, p. 134. 2 Ibid., t. 1er , p. 134.
164
juillet 1837 1. Quelques mois plus tard, en février 1838, il avoue la crise que traversent ses convictions: le système de Newman lui apparaît « magnifique, consistant, grandissant de tous côtés », tandis que tout ce qu’il voit d’autre, à Oxford, est « faible et rampant à terre» Toutefois, il doute encore et surtout il sent « que devenir newmanist bouleverserait toute son existence, renverserait toutes les relations dans lesquelles il a vécu et comptait vivre ». « Penser à un tel changement comme à une chose possible me fait peur, ajoute-t-il, mais j’ai. peur aussi de demeurer longtemps et tristement en suspens entre les deux opinions 2. » Beaucoup de ses contemporains le croient alors conquis à l’école tractarienne. Mais il ne tarde pas à se reprendre. Dès le mois de mars suivant, il déclare avoir découvert contre le newmanism des objections décisives 2. Il se retrouve alors ce qu’il doit rester jusqu’à la fin, esprit brillant et ouvert, unissant une piété vague, bien que sincère, à un détachement de plus en plus complet des croyances dogmatiques, se piquant de tout comprendre, de tout embrasser, au besoin de tout concilier, dans une libérale impartialité, sans se défendre, au fond, d’une certaine préférence pour les hérétiques ou même pour les infidèles. Toutefois, de ces émotions de sa jeunesses il gardera, pour Newman lui-même, un sentiment d’admiration et de respect, et il aimera à répéter que lui et Arnold étaient « les
1. Lett. and Corr., of J-H. Newman, t. II, p. 240. 2. Life and Corr., of. A.-P. Stanley, t. Ier, p. 195. 3. Ibid., t. Ier, p. 196.
165
deux grands hommes de l’Eglise d’Angleterre 1 ». Si réfractaires que soient les adeptes d’Arnold, il en est un cependant que Newman a pleinement conquis c’est un fellow de Balliol, qui a nom William-George Ward 2. Esprit original, inégal, un peu extravagant, mais d’une rare puissance, il a eu, de très bonne heure, une réelle influence sur les hommes de sa génération. Avant tout et presque uniquement dialecticien redoutable, il faisait profession d’ignorer l’histoire, de mépriser les faits, vivait dans les idées abstraites et ne voyait rien en dehors de la logique, dont il poussait les déductions aux conséquences les plus extrêmes, sans craindre d’effaroucher ainsi les timides, y trouvant même une sorte de plaisir. Par nature, il était un ultra et aimait à se dire incapable d’être jamais un modéré. Il apportait, du reste, dans la discussion de ses idées, un mouvement étonnant; sa verve était communicative; partout où il était, s’engageait un débat dont il devenait le centre et qu’il dominait de sa voix retentissante. Ne croyez pas que ce batailleur parût aux autres d’une compagnie irritante ou fatigante : nullement; il était recherché, goûté, et, parmi ses adversaires les plus déclarés, il s’attirait des amitiés qui devaient lui demeurer fidèles. C’est qu’à son intransigeance d’idées, à son ardeur disputante, se mêlaient beaucoup de générosité, de sincérité, de candeur même, d’amour
1. Life and Corr. of. A.-P. Stanley, p. 333. 2. Sur Ward, voy. l’excellente biographie écrite par son fils, Wilfrid Ward: W-G. Ward and the Oxford Movement. C’est surtout d’après ce livre, en le complétant parfois par la biographie de Stanley, que j’ai raconté ces débuts de Ward.
166
courageux de la vérité. Au milieu de ses emportements, rien de maussade, d’amer; au contraire, une aimable bonhomie, mieux encore, de la bonté, une constante belle humeur, et parfois comme un débordement de gaieté. Son bon gros rire était renommé à Oxford et s’entendait au loin 1. Il s’interrompait d’une discussion métaphysique pour chanter à pleine voix un air d’opera buffa, ou pour mimer un ballet où il parodiait les plus graves personnages de l’Université. Chez cet homme qui se plaisait à argumenter comme un Socrate, il y avait un fond de Falstaff. « Je ne puis, disait Jowett, résister au charme de ce gros garçon, toutes les fois que je me trouve en sa compagnie. On l’aime comme on aime un chien Terre-Neuve: avec ses longs poils, c’est une si puissante et si joyeuse créature 2! » Quand Ward était arrivé à Oxford, en 1830, à peine âgé de dix-huit ans, il était, en politique, tory et, en philosophie, plutôt radical, disciple de Bentham et de Mill. Ces dernières influences eussent pu le conduire au rationalisme; mais il sentait, en même temps, le besoin d’une religion vraie, logique, efficace. A ce point de vue, il ne laissait pas que de souffrir de ce que l’anglicanisme avait d’insuffisant, d’inconsistant, et il était en quête d’un christianisme qui le satisfit. Séduit d’abord par les idées de Whately, qui lui semblaient se concilier avec son libéralisme philosophique, il fut bientôt plus encore attiré par Arnold : il n’était
1. On disait plaisamment, à Oxford, que, quand Ward et un de ses camarades, Johnson, riaient ensemble dans l’Observatoire, le bruit en était entendu à Saint-Gilles. (Ward, p. 44.) 2. Life and Letters of B. Jowett, t. Ier, p. 80.
167
pas élève de Rugby, mais les sermons du réformateur de cette école l’avaient frappé par leur élévation morale; il croyait trouver en leur auteur la sainteté nécessaire, à son avis, pour donner crédit à un enseignement religieux; quant à leur doctrine, elle lui paraissait une réaction heureuse contre cette religion tout extérieure de la respectability, qu’il avait en particulière antipathie, contre le protestantisme formaliste, conventionnel, sans vie, aussi prompt à se louer soi-même qu’à censurer les autres ou à s’en scandaliser. Lorsqu’en 1834 le disciple préféré d’Arnold, Stanley, vint à Oxford, Ward se lia aussitôt avec lui, comme pour se rapprocher davantage de son maître. Surprenante amitié que celle qui se nouait ainsi étroitement entre deux jeunes hommes de natures si diverses: d’une part, un gentleman distingué de manières, délicat, discret, curieux des nuances, un peu indécis et dilettante, lettré raffiné; de l’autre, un homme aux formes massives, à la figure large et colorée (large moonfaced, dit un contemporain), mal vêtu, gauche dans ses allures, logicien brutal, rebelle à toute poésie. Et pourtant, telle était leur intimité qu’à Oxford où on les appelait Oreste et Pylade. « Je l’aime excessivement », écrivait Stanley de Ward, en 1836. Il n’était pas dans la nature de Ward de garder pour soi ses convictions : il se fit donc, dans la jeunesse d’Oxford, et non sans succès, l’apôtre de l’arnoldisme. Avec les idées du maître de Rugby, il avait pris naturellement ses préventions contre le tractarianisme, ses débuts. Le pressait-on d’insister aux ser-
168
mons de Newman : «A quoi bon, répondait-il, aller entendre de tels mythes? » Il fallut user de ruse pour l’y conduire. Un de ses amis dirigea, un jour, la promenade de telle sorte que Ward se trouva devant la porte de l’église, au coup de cinq heures. « Newman va monter en chaire, lui dit-il; pourquoi n’entreriez-vous pas pour l’entendre une fois? Cela ne vous fera pas de mal. S’il ne vous plaît pas, vous n’aurez pas besoin d’y retourner.» Ward entra et subit cet ascendant mystérieux auquel presque personne ne résistait. Dès lors, il devint un auditeur assidu. Son état d’esprit était singulier ; il se sentait aux prises avec une autorité morale, supérieure encore à celle qu’il avait cru rencontrer chez Arnold, et cependant il se défendait. On eût dit qu’il n’écoutait les sermons que pour chercher des objections à y opposer. Quand, en 1836, Newman fit, dans la chapelle d’Adam de Brome, une série de lectures sur la via media, Ward n’en manqua pas une. A la première, il s’assit au premier rang, avec son inséparable Stanley, juste en face de l’orateur qu’il fixait et dévorait du regard. Le plus démonstratif des hommes, l’admiration et la répulsion qu’il éprouvait tour à tour, éclataient, au vu de tous les assistants, dans ses gestes, dans les exclamations qu’il murmurait à l’oreille de son compagnon : « Qu’est-ce qu’Arnold dirait à cela? » etc... Aux conférences suivantes, Newman dut faire placer les bancs de côté, de telle sorte que les auditeurs ne pussent plus le regarder en face. Souvent, au sortir d’un sermon, Ward abordait quelqu’un des tractarians, Rogers
169
entre autres, et lui présentait des objections; celles-ci étaient aussitôt transmises à Newman afin qu’il y pût répondre, car on attachait grand prix à satisfaire un esprit de cette valeur. Peu à peu, du reste, son opposition désarmait. En même temps qu’il se laissait gagner au newmanisme, il se détachait de l’arnoldisme et se rendait mieux compte de son insuffisance dogmatique et spirituelle. Dans son anxiété, il alla, à Rugby, soumettre ses doutes à Arnold; il en revint mal satisfait, mais ayant à ce point fatigué le maître par la véhémence de son argumentation que celui-ci dut garder le lit toute la journée du lendemain. La publication des Remains de Froude eut un effet considérable sur l’évolution de Ward : tout lui plaisait dans ce livre, le haut idéal de sainteté et de mortification, les attaques contre les Reformers qu’il n’avait jamais goûtés, l’admiration du catholicisme pour lequel il ressentait un attrait inconscient, et surtout ce dédain des compromis, cette façon d’aller sans crainte au bout des idées, si conformes à sa propre nature. « Voilà bien ce que j’attendais, disait-il; voilà quelqu’un qui sait ce qu’il pense et qui le dit. C’est mon homme. » Et il écrivait à Pusey: « Ce ne serait pas assez de dire de ce livre qu’il m’a charmé plus que tout autre de ce genre. » Rogers constatait que cette publication faisait tant de plaisir à Ward que « littéralement il en sautait de joie ». Les lectures où Newman démontra la nécessité d’une Eglise pour interpréter les saintes Ecritures, achevèrent la conversion. Au commencement de mai 1839, Newman écrivait à Bowden « La seule
170
vraie nouvelle est l’accession de Ward de Balliol aux bons principes. C’est une accession très importante. Je le connais fort peu, mais je ne puis pas ne pas l’aimer beaucoup, bien qu’il professe encore être un radical en politique 1. Une fois passé au tractarianisme, Ward met à son service, sa fougue de propagande et sa puissance de discussion. Partout où il va, il livre bataille pour ses convictions nouvelles. S’il ne convertit pas tous ses interlocuteurs, du moins suscite-t-il autour de ces idées une singulière agitation. On ne parle plus d’autre chose à Oxford. Dans le common room de Balliol, il a pour principal contradicteur un jeune homme de son âge, qui a été élu fellow le même jour que lui et qui restera son ami jusqu’à la fin, malgré la divergence croissante des opinions et des destinées : c’est Archibald Campbell Tait, le futur archevêque de Canterbury 2. Issu d’une famille presbytérienne de Glasgow, grand travailleur, esprit très net, très avisé, mais un peu terre à terre, se proclamant lui-même incapable d’enthousiasme 3, ayant, avec un sentiment sérieux de la religion, plus les qualités d’un homme d’Etat que d’un clergyman, Tait était à peu près le seul des jeunes universitaires curieux des choses intellectuelles et soucieux du progrès moral, qui fût toujours demeuré absolument réfractaire à l’action de Newman. Il suivait
1. Lett. and Corr. of .J.-H. Newman, t. II, p. 282. 2. Voy. Life of A.-C. Tait, par Davidson et Benham 3. « Je respecte un enthousiaste, avait-il coutume de dire, parce que je ne pourrais jamais en être un moi-même. » (Ibid., t. Ier, p. 139.)
171
ses sermons, mais pour y trouver les points à critiquer. il était donc armé pour tenir tête à Ward. Aux charges impétueuses de ce dernier, il opposait l’adresse froide et subtile de l’Ecossais. il n’apportait pas au combat moins d’acharnement; entre eux, c’était à qui aurait le dernier mot. Un jour, impatienté de ne pouvoir réduire Ward au silence, Tait lui lance brusquement une dernière volée et court hors de la chambre, en fermant la porte avec fracas. Un autre jour, surpris en pleine discussion par l’heure de l’office, il quitte la salle pour aller revêtir son surplis: tout en s’habillant, lui vient l’idée d’une réplique; il retourne au salon en surplis et décharge son argument avec un air de triomphe; mais Ward riposte et lui crie, au milieu des éclats de rire « Si c’est tout ce que vous aviez trouvé, ce n’était pas la peine de nous revenir en surplis. » La transformation de Ward ne se manifestait pas seulement par la direction nouvelle de son argumentation : on le voit dès lors s’appliquer à mener une vie plus pieuse, plus austère. C’est, du reste, l’effet général produit par l’action de Newman sur la jeunesse d’Oxford. Il y avait, sous ce rapport, beaucoup à faire. Sans doute, l’Université avait gardé de son origine certaines habitudes religieuses; mais celles-ci étaient tout extérieures et allaient de front avec des moeurs très profanes et souvent très grossières, notamment avec les excès de table; les exercices de piété les plus graves n’étaient plus qu’une parade de convention : si, par exemple, les undergraduates étaient obligés, à certains jours, de participer à la communion, il était
172
d’usage que la réception du sacrement fût aussitôt suivie d’un déjeuner où l’on se grisait avec du vin de Champagne. Ces moeurs se modifièrent sous l’influence du Mouvement : les jeunes gens se firent un idéal plus haut de moralité et de religion et s’efforcèrent d’y conformer leur vie. Newman se félicitait, en 1839, de voir augmenter le nombre de ceux qui prenaient part à la communion hebdomadaire: « C’est mon plus grand encouragement », écrivait-il 1 . On assistait à ce spectacle assez singulier : les hommes d’un certain âge, les dignitaires de l’Université, persistant dans l’ancienne mondanité, alors que la nouvelle génération leur donnait l’exemple d’une vie plus sérieusement chrétienne, plus sévère. Un contemporain rapportait que les vieux étaient à peu près les seuls à boire encore du vin dans les common rooms; il ajoutait que les chefs de collège continuaient à choisir de préférence les vendredis de carême pour les parties auxquelles ils invitaient leurs amis, tandis que plusieurs jeunes gens renonçaient, par mortification, à venir, ces jours-là, dîner à leur collège 2. Derrière cette jeunesse où fermentait une vie intellectuelle et morale si intense, on retrouvait toujours, dans une région plus haute, et entourés d’un respect croissant, les trois personnages qu’elle reconnaissait comme ses chefs : Newman, Keble et Pusey. Keble se tient un peu à l’écart, dans son presbytère de campagne. Pusey et Newman sont, au contraire, au centre
1. Lett. and Corr., t. II, p. 292. 2. Autobiography of Isaac Williams, p. 80, 81.
173
même de l’agitation, à Oxford. Entre eux, rien n’apparaît encore des tendances divergentes qui se manifesteront plus tard. Newman ne se lasse pas de témoigner de sa vénération pour Pusey, dans lequel il salue une sorte de Père de l’Eglise1. Pusey, de son côté, professe une tendre admiration pour Newman. Il ne fait pas une démarche sans prendre son avis et ne peut le voir attaquer sans le défendre. Au fond, sans doute, il serait moins dégagé que lui des préjugés protestants, et, par exemple, il eût probablement hésité davantage à publier les Remains de Froude, à raison de leurs attaques contre les hommes de la Réforme; mais, la publication faite, la bataille engagée, il n’en soutient pas moins son ami et revendique sa part des coups dirigés contre lui. Amitié touchante à laquelle la douleur va imprimer un sceau plus fort encore. Dès 1835, M. Pusey a subi les premières atteintes d’une maladie de poitrine 2. Depuis lors, elle n’a cessé de décliner, gardant une âme vaillante dans un corps ruiné. En 1838, les médecins déclarent tout espoir perdu. Combien cruelle était, pour ce mari si tendre, la pensée de perdre une femme qu’il avait attendue si longtemps et possédée pendant si peu d’années! Son attitude en une telle épreuve témoigne de la hauteur chrétienne à laquelle ces âmes se sont élevées. « Je lui ai tout dit ce matin, écrit-il à Newman en parlant de sa chère malade. Aussitôt qu’elle eut compris, elle dit avec un calme sou-
1. Lett. and. Corr., t. II, p. 290. 2. Sur la maladie et la mort de Mrs Purey, voy. the Life of Pusey, par Liddon, t. II.
174
rire : « Alors me voilà bénie! Pour vous, Dieu peut vous rendre heureux.» Puis, sans effort ni réflexion, elle fut si calme qu’il était clair que cela venait immédiatement de Dieu. » L’agonie se prolonge pendant huit mois. Tous les jours, Mrs Pusey reçoit la visite de Newman ou une lettre de lui. Quant aux sentiments du mari, ils se montrent admirablement touchants dans cette lettre à Keble : «J’ai surtout peur de ne pas profiter autant que possible de cette visite de Dieu… J’ai peur de redevenir ce que j’étais avant; et encore je ne le redoute pas assez. En un mot, je me trouve en face d’une grande grâce de Dieu, qui devrait porter en moi des fruits abondants, et J’ai peur de rester court... Je vous en dis tant, parce que vous et Newman avez trop bonne opinion de moi. » Enfin la dernière heure est sur le point de sonner. Le 26 mai 1839, Pusey écrit à son ami ce court billet: « Ma chère femme approche de la fin de sa vie terrestre; quand le soleil se lèvera demain, elle sera par la miséricorde de Dieu dans le Christ, là où il n’y a plus besoin de soleil. Voulez-vous prier pour qu’elle ait, dès cette vie, un avant-goût de la joie et de la paix du ciel? » Malgré tout, au premier moment, en face de la séparation accomplie, le pauvre veuf est accablé : c’est Newman qui le console et le relève. « Votre première visite, lui écrira plus tard Pusey, fut pour moi, comme celle d’un ange envoyé par Dieu. « Sur la tombe de sa chère morte, il ose inscrire, après avoir pris l’avis de Keble et de Newman, une prière toute catholique, découverte dans ce bréviaire romain que l’exemple de Froude a remis en honneur chez les
175
tractarians : Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Paroles familières à nos oreilles, mais qui sonnaient alors étrangement sur cette terre protestante qui les avait oubliées depuis trois siècles! Convaincu qu’il a été frappé en punition de ses péchés, Pusey s’applique désormais à mener une vie de plus en plus austère, pénitente et pieuse. Déjà, du vivant de sa femme, et d’accord avec elle, il avait renoncé à toute habitude mondaine; ainsi notamment, en 1837, avait-il vendu chevaux et voitures, afin de pouvoir faire des aumônes plus larges pour la construction d’églises à Londres. Le veuvage le pousse plus avant encore dans cette voie de renoncement. Quel que fût le respect inspiré par une vertu si haute, l’influence de Pusey sur la jeunesse tractarienne était loin d’égaler celle de Newman. Ce dernier demeurait le vrai chef du Mouvement. Ce n’était pas seulement qu’il eût, avec une vertu égale à celle de Pusey, un génie supérieur, qu’il eût plus d’idées et plus de ressources pour les exprimer, c’était qu’il possédait un don rare de séduction, s’exerçant par son action publique comme par son action privée, par le sermon adressé aux foules, par la direction particulière de chaque âme, jusque par la grâce de son accueil, le charme de sa conversation, la tendre familiarité de son amitié. Il avait cet autre don que, par sa parole, presque par sa seule vue, les jeunes âmes étaient transportées en un monde plus haut, où passaient des souffles de générosité, d’abnégation et d’héroïsme; elles s’enflammaient par cela seul qu’elles approchaient de son foyer; sous l’action d’une
176
sympathie qui réveillait en elles ce qu’elles avaient de meilleur et de plus noble, elles se sentaient pressées de réaliser en elles ce premier épanouissement de la vertu dans un jeune coeur, dont Newman a parlé en homme qui l’avait vu souvent se produire sous son souffle : « Cette vertu, dit-il, éclot chez les jeunes gens, comme quelque riche fleur merveilleusement délicate et éblouissante. Générosité et promptitude du coeur, amabilité, esprit de confiance, loyauté de caractère, enjouement plein de ressort, main ouverte, affection pure, nobles aspirations, résolutions héroïques, entreprises romanesques, amour où l’égoïsme n’a aucune part, toutes ces choses ne sont-elles pas belles 1? » Ajoutez enfin, chez Newman, pour compléter l’extraordinaire fascination qu’il exerçait, un je ne sais quoi de mystérieux, comme d’un esprit qui n’avait pas dit son dernier mot et qui portait en lui le secret d’un avenir caché, d’une vérité non encore manifestée. Telle a été cette surprenante action d’un seul homme, que tous ceux qui ont vécu alors de la vie d’Oxford n’ont pu évoquer leurs souvenirs sans la rappeler et la proclamer. Ainsi ont fait, non seulement ses disciples, mais ceux qui étaient personnellement le plus opposés à ses idées. Voici, par exemple, un ami d’Arnold, le doyen Lake, qui déclare que, pendant des années, « Oxford a été gouverné et inspiré par Newman et que rien de comparable ne s’est jamais vu, soit avant, soit depuis 2 ». Tait reconnaît que « Newman régnait
1. Sermons on various occasions, p. 265. 2. Lettre écrite à l’auteur de la vie de Tait. (Life of A.-C. Tait, par Davidson, t. Ier, p. 105.)
177
souverainement dans l’Université et captivait le meilleur de la jeunesse.1 » Un ami de Tait, le principal Shairp, après avoir rappelé la transformation opérée dans Oxford par le Mouvement, se demande où était « le centre, l’âme d’où émanait une telle puissance » Cette puissance, répond-il reposait dans un seul homme, un homme sous plusieurs rapports, le plus remarquable que l’Angleterre ait vu durant ce siècle, peut-être le plus remarquable que l’Eglise anglicane ait produit en aucun siècle, John-Henry Newman. « Et il ajoute : « L’influence qu’il avait acquise, sans avoir parti la chercher, était un fait sans pareil de notre temps. Une mystérieuse vénération avait peu à peu grandi autour de lui, à ce point qu’on pouvait croire à la réapparition de quelque Ambroise ou Augustin des vieux âges. Dans la ruelle d’Oriel, les étudiants en gaieté baissaient la voix et chuchotaient Voilà Newman! lorsqu’ils le voyaient glisser d’un pas rapide et silencieux, la tête portée en avant, le regard fixé sur une vision qu’il était seul à percevoir, et, pour un moment, ils sentaient descendre sur eux une crainte respectueuse, comme au passage de quelque apparition 2. » Newman tenait une telle place dans l’esprit de ces jeunes gens qu’on pouvait se demander parfois si leur participation au Mouvement n’était pas fondée plus encore sur le culte d’un. homme que sur l’adhésion à
1. Ce passage est reproduit dans le livre de Wilfrid Ward sur W-G. Ward and the Oxford Movement, p. 105. 2. Studies in Poetry and Philosophy, par le principal Sharp, p. 244, 245.
178
une doctrine. Antony Froude, frère d’Hurrell, a écrit, en évoquant le souvenir de la phase tractarienne par laquelle il avait passé, avant de tomber dans le scepticisme : « Tandis qu’en fait nous étions seulement newmanistes, nous nous imaginions que nous devenions catholiques... Nous avions surtout une foi profonde dans un grand homme... Newman nous avait pris tous, tous, c’est-à-dire ceux qui n’étaient pas Arnoldized 1.»Et, sur le moment même, Ward n’hésitait pas à répondre à qui l’interrogeait sur ses croyances : « Mon Credo sera extrêmement simple : Credo in Newmanum! « Le maître, s’il en avait été informé, eût été le premier à blâmer et à répudier cette sorte d’idolâtrie. A une dame chez laquelle il avait entrevu, non sans en être un peu agacé, une tendance à des exagérations de ce genre, il adressait cette leçon : « Je ne suis pas vénérable, et rien ne peut me rendre tel. Je suis ce que je suis; je suis beaucoup comme les autres gens... Je ne puis parler les paroles de sagesse... Ne souffrez pas qu’aucune notion illusoire à mon sujet prenne naissance dans votre esprit. Personne qui me connaît ne me traite avec déférence et respect, et, de tout mon coeur, je désire et je prie que personne ne le fasse jamais. Je n’ai jamais occupé de place ni de haut rang; les gens ne se sont jamais inclinés devant moi, et je ne le supporterais pas. Je le dis franchement, ma faiblesse est, je crois, d’être toujours rude envers ceux qui affectent de la révérence dans leurs rapports avec moi 2.»
1. The Nemesis of faith, par Anth. Froude, p. 126, 136. 2. Lett. and Corr., t. II, p. 313.
179
Plus tard, dans son Apologia, il a écrit : « Je n’eus jamais conscience de l’empire que j’exerçais sur les jeunes gens. Dans ces dernières années, j’ai lu et entendu dire qu’ils allaient jusqu’à me copier en diverses choses. Je l’ignorais absolument, et mes amis intimes savaient trop, je pense, combien ces nouvelles m’inspireraient de dégoût, pour avoir le courage de me les dire. » Toutefois, en dépit de sa modestie, Newman n’en avait pas moins conscience des progrès de sa cause et de l’importance croissante de sa situation. « Au printemps de 1839, a-t-il écrit encore dans son Apologia, ma situation dans l’Eglise anglicane était à son apogée. J’avais une souveraine confiance dans la position de ma controverse, et je réussissais pleinement et de plus en plus, en la recommandant à d’autres... Ce fut, à un point de vue humain, l’époque la plus heureuse de ma carrière... Je supposais bien qu’un temps si radieux ne pourrait durer, mais je ne savais pas comment il finirait. Quelque chose de cette « souveraine confiance » était apparue dans l’article qu’en avril 1839 il publiait, dans le British Critic, sur « l’Etat des partis religieux»: après y avoir montré, par les témoignages même de ses adversaires, le succès du Mouvement, il mettait dédaigneusement en lumière l’inconsistance et la faiblesse des partis qui s’étaient partagé jusqu’alors l’Eglise anglicane; entre ces partis et Rome dont il faisait une sorte d’épouvantail, il indiquait, comme la seule issue possible, sa via media, et c’était en guide qui paraissait tout à fait sûr de lui, qu’il s’offrait à y conduire les générations nouvelles.
180
VI
Précisément à l’heure où les disciples témoignent d’une foi enthousiaste dans leur maître, à l’heure où celui-ci témoigne de sa confiance dans son système, tout à coup, sans que rien l’ait fait prévoir, — comme un de ces nuages qui se forment dans un ciel pur et l’assombrissent en quelques instants, — un doute se lève, dans l’esprit de Newman, sur la situation de son Eglise par rapport à celle de Rome. Jusqu’alors, il avait pu hésiter sur les meilleurs arguments à employer pour résister à Rome; il s’était toujours cru certain du droit et du devoir de résister. Lui-même a raconté comment ce doute lui est venu. Depuis longtemps, il étudiait les Pères des premiers siècles; il avait commencé, dès avant le Mouvement, lorsqu’il écrivait son livre sur les ariens; il ne faisait donc que se conformer à une vieille habitude, quand, vers la fin de juin 1839, il profitait des vacances pour reprendre ces études; elles portaient, cette fois, sur l’histoire des monophysites. Au cours de cet examen, une question se présente soudainement à son esprit: les anglicans ne sont-ils pas, par rapport à l’Eglise universelle et au siège de Rome, dans la situation où avaient été autrefois ces hérétiques d’Orient? La réflexion ne fait qu’augmenter son trouble. Comment prouver que les eutychéens étaient des hérétiques, sans prouver que les anglicans le sont aussi? Nulle différence entre les principes et les actes de l’Eglise de Rome aujourd’hui, et ceux de l’Eglise
181
d’alors, entre les principes et les actes des hérétiques d’alors, et- ceux des protestants d’aujourd’hui. « Voilà, a raconté plus tard Newman, ce que je découvrais, sous une forme presque effrayante; il y avait une similitude terrible, d’autant plus terrible qu’elle était muette et impassible, entre les annales mortes du passé et la chronique fiévreuse du présent... Ma forteresse était l’antiquité où, en plein milieu du Ve siècle, je croyais trouver, réfléchie comme dans un miroir, la chrétienté du XVIe et du XIXe siècle. Dans ce miroir, je regardai mon visage; j’étais un monophysite... A quoi bon continuer la controverse et défendre ma position, si, après tout, je forgeais des arguments pour Anus ou Eutychès, si je devenais l’avocat du diable contre l’incomparable Athanase ou le majestueux Léon? Que mon âme soit avec les saints! Irai-je lever mon bras contre eux? Que ma main droite devienne inutile, qu’elle se dessèche complètement comme celle de l’homme qui l’étendit jadis sur un prophète de Dieu 1 !» Un incident vient bientôt aggraver encore le trouble de Newman. Au cours du mois d’août, un de ses amis lui met entre les mains un article que Wiseman a publié dans la Revue de Dublin, sous ce titre : The Anglican claim. C’était la continuation de ces écrits où le recteur du collège anglais suivait pas à pas le Mouvement d’Oxford et tâchait de l’incliner vers Rome. Dans cet article, il faisait un rapprochement entre les donatistes et les anglicans et croyait pouvoir appliquer aux seconds, l’argument que saint Augustin opposait
1. Apologia.
182
aux premiers. Pour reconnaître, entre les deux épiscopats qui se disputaient l’Afrique, quel était le légitime, l’évêque d’Hippone avait indiqué ce criterium : voir quel était celui avec lequel l’ensemble de l’Eglise était en communion ; une phrase servait au grand docteur à formuler sa pensée : Securus judicat orbis terrarum. Newman n’est pas tout d’abord ému du rapprochement avec les donatistes; il croit y avoir réponse. Cependant son ami insiste et lui répète, à plusieurs reprises, la parole de saint Augustin : Securus judicat orbis terrarum. « Quand mon ami fut parti, a raconté plus tard Newman, cette parole continua de résonner à mon oreille : Securus judicat orbis terrarum. Elle allait plus loin que la question des donatistes; elle s’appliquait à celle des monophysites; elle donnait à l’article une force qui m’avait échappé... Qui peut rendre compte des impressions qu’il reçoit? Cette simple phrase de saint Augustin me frappait avec une puissance que je n’avais jamais trouvée dans aucune autre. Pour prendre un exemple familier, elle était comme le Turn again, Whittington des carillons de Londres, où, pour prendre un exemple plus sérieux, comme le Tolle, lege; tolle, lege de l’enfant, qui convertit saint Augustin lui-même 1. » Ce trouble de Newman n’est pas, sur le moment, connu du public. Tout au plus en laisse-t-il entrevoir quelque chose à deux de ses jeunes amis. A Rogers, d’abord, l’un de ses confidents les plus aimés, il écrit,
1. Apologia.
183
le 22 septembre, qu’il vient de « subir le premier véritable coup qu’il ait reçu du romanisme »; puis, après lui avoir parlé de l’article de Wiseman, dont la lecture, confesse-t-il, lui a « procuré une crise d’estomac », il ajoute : « Maintenant, nous avons fait une voie d’eau, et le pis est que Ward, Stanley et les autres ne permettront pas qu’on s’endorme là-dessus. Je n’en ai dit autant à personne... Adieu, carissime. Ce n’est pas matière à rire. Je veux y voir clair. Mais ne me croyez pas assez écervelé pour me faire une opinion soudaine. Seulement il y a là l’ouverture d’une perspective désagréable qui était auparavant fermée. Je vous écris d’après mes premières impressions 1. » Quelques jours plus tard, au cours d’une série de visites faites chez divers amis, se promenant avec Henry Wilberforce dans la New-Forest, il se laisse entraîner à lui faire aussi confidence de ses doutes et des causes qui les ont fait naître. « Je ne puis me cacher, lui dit-il, que, pour la première fois depuis que je fais de la théologie, une perspective s’est ouverte devant moi, dont je ne vois pas la fin. » Le jeune interlocuteur à qui cette révélation produit « l’effet d’un coup de tonnerre » exprime l’espoir que son maître mourra plutôt que de faire une démarche comme celle qu’il laisse entrevoir. « J’ai pensé, répond
1. Lett. and Corr., t. II, p. 284. — Peu auparavant, en janvier 1839, Newman avait écrit au même Rogers « Il me vient quelquefois à l’esprit, comme une chose inquiétante, presque comme une tentation coupable, que je doute que je fusse affligé si tout ce qui a été fait se fondait comme un palais de glace. »(Ibid., t. II, p. 279.)
184
Newman avec une grande énergie, que, si jamais je me sentais en danger de faire cette démarche, je demanderais à mes amis de prier pour que, si elle n’était pas dans la volonté de Dieu, je fusse enlevé avant d’avoir agi... Une chose, d’ailleurs, dont je suis sûr, c’est que je ne prendrai jamais un tel parti sans que Keble et Pusey ne soient d’avis avec moi que c’est un devoir. » Il déclare, en outre, se refuser à l’idée que ses jeunes amis puissent se croire obligés de le suivre en masse 1. Par une coïncidence singulière, au plus fort de son trouble, Newman reçoit une lettre de Manning qui le consulte sur les moyens de retenir une dame de ses amies, tentée de se faire catholique romaine. Il ne refuse pas la consultation et s’applique à chercher ces moyens, mais sa réponse trahit une sorte de découragement au sujet des titres que l’anglicanisme peut opposer à l’Eglise de Rouie. Voici cette lettre, datée du 1er septembre 1839; elle est caractéristique de l’état d’âme de Newman à cette date
MON CHER MANNING,
Je suis très anxieux du cas que vous mentionnez; car j’ai conscience que notre Eglise n’a pas les moyens et les méthodes par lesquelles on pourrait retenir, mettre en sûreté, assagir et diriger vers le ciel les aspirations catholiques. Notre couverture est trop petite pour notre lit. Je dis -ceci, étant du reste dans l’obscurité sur l’état particulier
1. Henry Wilberforce, devenu catholique, a raconté lui-même plus tard cette conversation, dans la Revue de Dublin d’avril 1869.
185
d’esprit de votre amie et, le comment elle y est arrivée. Pour nous-mêmes, j’ai conscience que nous développons des désirs et des goûts qu’il ne nous est pas permis de satisfaire, et jusqu’à ce que nos évêques et d’autres donnent libre carrière au développement extérieur et sage du catholicisme, nous tendons en vérité à faire que les esprits impatients cherchent la satisfaction de ces aspirations, là où on l’a toujours trouvée, à Rome. Je pense que, lorsque viendra le temps de la sécession vers Rome, — sécession à laquelle nous ne devons pas être non préparés, — nous devrons hardiment dire à la section protestante de notre Eglise: « Vous êtes cause de tout ceci; vous devez faire des concessions, être conciliants; vous devez rendre l’Eglise plus efficace, plus conforme aux besoins du coeur, plus appropriée aux besoins extérieurs. Donnez-nous plus de services divins, plus de vêtements et d’ornements religieux ; donnez-nous des monastères ; donnez-nous les signes d’un caractère apostolique, les gages que l’Epouse du Christ est parmi nous. Jusque-là, vous aurez de continuelles sécessions vers Rome. » Ceci est, je l’avoue, ma vue personnelle ; je pense que rien ne peut nous retenir dans l’Eglise d’Angleterre, sinon la patience et le devoir, et d’y rester est un témoignage que nous possédons de telles grâces. Si donc votre amie est attirée à Rome par les exercices de dévotion que Rome nous procure, je la presserais sur le devoir de rester dans la vocation dans laquelle Dieu l’a trouvée; et, lui développant la doctrine de la Ire aux Cor., VII, je pense que vous pouvez la presser par la perspective de faire bénéficier la pauvre Eglise par laquelle elle a reçu le baptême, en s’y arrêtant. N’est-elle pas en sollicitude pour les âmes qui l’entourent, infusées et raidies dans le protestantisme? Comment peut-elle prendre soin de ces âmes ? en donnant satisfaction à ses propres sentiments dans la communion de Rome, ou en se renonçant elle-même et en restant dans
186
le sac et la cendre pour leur faire du bien? Aura-t-elle plus d’influence sur ses frères en les abandonnant, ou en restant avec eux ?... Si cependant elle prend le parti de nier l’Eglise anglaise, doutant de sa catholicité et autres choses semblables, alors je suppose que vous lui rétorquerez avec le refus du calice la doctrine du purgatoire comme elle est pratiquée, l’absence de preuves de l’infaillibilité de l’Eglise, les anathèmes, etc., avec cette réflexion supplémentaire qu’elle fait un pas, et que, par conséquent, il doit y avoir une surabondante évidence du côté de ce pas... Ou ce pas est un devoir clair et impérieux, ou il est un péché. D’un autre côté, peut-elle nier que la main de Dieu soit avec notre Eglise, même en lui accordant, par manière d’argument, que Rome ait certaines choses que nous n’avons pas? Cette Eglise est-elle morte? A-t-elle les signes de la mort? A-t-elle plus que les signes de la maladie ? N’a-t-elle pas duré, à travers des temps très troublés? Ne s’est-elle pas, de temps en temps, merveilleusement ranimée, quand elle semblait perdre toute foi dans la sainteté? Doit-elle être abandonnée ? Car ce pas en avant serait un abandon, ce serait dire : « Je souhaite qu’elle soit balayée et que l’Eglise romaine se développe sur son territoire. » Et non : « Je la souhaite réformée, — je la désire corrigée, — je désire que Rome et elle ne fassent qu’un 1.»
Toutes ces raisons, que Newman avait eu visiblement quelque peine à rassembler et qu’il ne présentait pas sans un certain accent de tristesse et de désillusion, étaient évidemment celles par lesquelles il tâchait de répondre aux doutes de sa propre conscience. C’est ainsi que lui-même parvenait à se faire un devoir de rester dans son Eglise, en dépit des fai-.
1. Life of Card. Manning, par Purcell, t. Ier, p. 233, 234.
blesses qu’il y découvrait. D’ailleurs, avec les jours, avec les semaines qui s’écoulaient, la vive impression du premier moment de doute s’affaiblissait; son trouble s’apaisait. II s’était convaincu après réflexion, disait-il, qu’en pareil cas il devait se méfier des émotions et s’appliquer à suivre sa raison plus que son imagination. Ne lui fallait-il pas s’assurer d’abord que ce doute n’était pas une tentation coupable, une suggestion d’en bas? Le temps seul, lui semblait-il, ferait sur ce point la lumière. Si la suggestion venait d’en haut, elle se reproduirait et d’une façon plus significative. Il songeait alors à ce qui était arrivé au jeune Samuel, quand avait été appelé par le Seigneur, durant son sommeil, et qu’il s’était recouché sans avoir discerné d’où venait la voix. Le Seigneur ne savait-il pas appelé de nouveau, à plusieurs reprises, jusqu’à ce que sa voix eût été reconnue par le futur prophète? Newman pouvait donc, comme Samuel, se rendormir; si Dieu était là, il le rappellerait. II prenait même texte de cet épisode biblique, pour prêcher, en octobre 1839, un sermon sur les appels divins, the divine calls. Evidemment, à l’insu du public qui l’écoutait, il pensait à la crise que traversait son âme, quand il analysait avec tant de pénétration les formes diverses de ces appels, leur soudaineté, leur mystère, leur obscurité, et aussi quand il exprimait, avec une émotion si vibrante, la joie d’y reconnaître la voix de Dieu et d’y répondre. « Qu’est-ce, s’écriait-il, que de plaire au monde, plaire aux puissants, plaire même à ceux que nous aimons, comparé à cela? Qu’est-ce qu’être applaudi, admiré, courtisé, suivi,
188
comparé à ce soin unique de ne pas méconnaître une vision du ciel? Que peut nous offrir le monde de comparable à cette connaissance complète des choses spirituelles, à cette foi vive, à cette paix céleste, à cette haute sainteté, à cette éternelle justice, à cette espérance de gloire que possèdent ceux qui, sincèrement, aiment et suivent Notre-Seigneur Jésus-Christ? Prions-le, supplions-le, chaque jour, de se révéler plus complètement à nos âmes, d’aviver nos sens, de nous donner l’ouïe et la vue, le goût et le toucher du monde à venir, de travailler au dedans de nous, de telle sorte que nous puissions dire avec sincérité « Vous me guiderez par vos conseils, et puis vous me recevrez dans la gloire. Qu’ai-je au ciel, si ce n’est Vous? Et, sur la terre, il n’est personne que je désire autant que Vous. Ma chair et mon coeur fléchissent; mais Dieu est la force de mon coeur et mon partage pour l’éternité 1. » Certes, un tel langage est bien d’un homme prêt à obéir joyeusement et généreusement à tout appel divin. Mais, pour le moment, Newman n’a pas acquis la certitude que la voix qui l’a un instant troublé venait de Dieu. La crainte, qui a traversé son esprit, d’être obligé de reconnaître le droit de l’Eglise de Rome, s’est éloignée, et, après quelques semaines de trouble, il croit se retrouver en possession de ses anciennes convictions. Toutefois, peut-on affirmer qu’il en reste rien de cet ébranlement? Depuis longtemps, Newman se sentait comme en voyage, conduit par une main mystérieuse vers
1. Plain Sermons.
189
un but qu’il ne connaissait pas; cette impression le dominera désormais plus encore. Il tâche de se persuader qu’il a toujours la même confiance dans son Eglise; il n’a plus la même confiance en lui-même. « J’avais vu, a-t-il écrit plus tard, l’ombre d’une main sur la muraille... Celui qui a vu un esprit ne peut être comme s’il ne l’avait pas vu 1. » Chez lui, d’ailleurs, le doute n’a pas aussi complètement disparu qu’il s’en flatte. Une fissure reste, inaperçue en ce moment, mais que le temps élargira jusqu’à en faire un abîme, Une période nouvelle commence dans sa vie; jusqu’alors, il a surtout lutté contre les autres: désormais, c’est avec lui-même qu’il aura à soutenir un combat bien autrement difficile et douloureux.
1. Apologia.
190 CHAPITRE IVLA CRISE (1839-I843)
I. Newman obligé de chercher un autre fondement pour sa via media. Ses préventions contre les catholiques, à raison de leur alliance avec O’Connell. il fait mauvais accueil à Spencer. —II. Parmi les jeunes disciples de Newman, plusieurs sont moins attachés à l’anglicanisme et plus attirés vers Rome. Opinions de Ward. Embarras et inquiétudes de Newman en présence de cet état d’esprit. II songe à résigner sa cure. — III. Le tract 90 cherche à établir que les XXXIX Articles peuvent être entendus dans un sens catholique. Newman ne s’attend pas à un orage. — IV. Soulèvement contre le tract 90. La censure des chefs de Collèges. Calme de Newman. Violence des attaques dirigées contre lui. Ses pourparlers avec l’évêque d’Oxford. Il refuse de désavouer le tract 90, mais consent à interrompre la publication des tracts. — V. Les polémiques continuent sur le tract 90. Arnold professeur à Oxford. Les évêques se mettent à censurer le tract. L’évêché de Jérusalem. — VI. Wiseman à Oscott. Ses efforts pour entrer en relations avec les tractarians. Il est blâmé par beaucoup de catholiques. Il s’explique publiquement sur la conduite à suivre à l’égard du Mouvement d’Oxford. —VII. Newman est très blessé des censures épiscopales. Il répudie néanmoins toute idée de conversion au catholicisme romain. Sa théorie sur l’anglicanisme et Samarie. Raideur avec laquelle il repousse l’intervention des prêtres catholiques. Le doute traverse de nouveau son esprit. — VIII. Ward et ses amis se montrent de plus en plus favorables à Rome. Leurs relations avec les catholiques. Alarmes de Pusey. Il essaye vainement de retenir Ward. Sa lettre à l’archevêque de Canterbury. Embarras de Newman sollicité par Pusey de désavouer Ward. Il se retire à Littlemore. — IX. Newman à Littlemore. Il y offre asile à ses amis. Le projet de monastère. La vie à Littlemore. Les dénonciations contre le prétendu monastère. Impatience de Newman. — X. Pusey ne peut obtenir de Newman qu’il désavoue Ward. Attitude de Keble. Williams et Rogers s’éloignent. Sermon de Pusey sur l’Eucharistie, dénoncé (191) au vice-chancelier. Une commission prononce contre lui la suspension du droit de prêcher pendant deux ans dans l’Université. — XI. Etat d’esprit de Newman. Il désavoue ses anciennes attaques contre Rome. Si ébranlée que soit sa foi dans l’Anglicanisme, il continue à détourner ses disciples d’aller à l’Eglise Romaine. C’est lui qui retient Ward et Faber. Wiseman n’admet pas la légitimité de ces retards. Conversion de Smith. — XI. Lockhart à Littlemore. Son abjuration. Elle détermine Newman à résigner sa cure. Comment il répond à ceux qui cherchent à l’en détourner. Son sermon d’adieu à Littlemore.
I
Remis tant bien que mal du doute qui l’avait ébranlé dans l’été de 1839, Newman ne se dissimulait pas cependant que le système sur lequel il avait cru jusqu’alors pouvoir fonder sa via media était en partie ruiné. Il lui fallait trouver d’autres arguments pour justifier la position de l’anglicanisme en face de Rome. C’est ce qu’il essaye de faire dans un article publié, en janvier 1840, sur la « Catholicité de l’Eglise d’Angleterre ». S’il trouve maintenant difficile de revendiquer, pour son Eglise, la note d’unité, d’universalité, il juge possible de soutenir qu’elle possède les autres notes de la véritable Eglise. Il espère, d’ailleurs, qu’elle pourra sortir de son isolement et s’unir à Rouie réformée et purifiée, union qu’il appelle de tous ses voeux, et pour laquelle il recommande de prier. En attendant, il estime que le devoir des enfants de cette Eglise est d’être patients et confiants : quelles que soient ses faiblesses, quelles qu’aient été ses fautes, elle est leur mère; ils font mieux d’aider son retour, en restant dans son sein, que de l’abandonner. Alors même qu’il semble presque admettre qu’elle est schismatique, il ne voit
192
pas là une raison suffisante de la quitter et de passer à l’Eglise romaine qui, elle aussi, a ses faiblesses et ses fautes. Il rassure sa conscience, raffermit sa fidélité, moins encore par la conviction des titres de son Eglise que par celle des torts de l’Eglise rivale. Son argument principal en faveur de l’anglicanisme consiste dans les accusations qu’il croit toujours pouvoir porter contre les « corruptions » du romanisme 1. Argument négatif, vue toute protestante, mais qui, à raison des préjugés originaires de Newman, ont encore beaucoup d’action sur son esprit. Par moments, cependant, Newman semble avoir comme un remords de ces attaques contre l’Eglise romaine; il commence à se rendre compte que tout ce qu’il dit contre elle il le dit principalement sur la foi des théologiens anglicans. Ceux-ci ne l’ont-ils pas abusé? Et il rappelle alors comment Froude mourant a protesté contre des attaques qu’il déclarait n’être ni justes ni charitables. Toutefois, s’il éprouve alors quelque gène et une sorte de répugnance à insister sur les erreurs doctrinales de Rome, il se sent plus à l’aise pour critiquer sa conduite politique et sociale et ce qu’il appelle « son esprit d’ambition et d’intrigue ». C’est sur « ce terrain moral » qu’il se croit le plus fort contre elle. De cette immoralité du romanisme, il pense précisément avoir un témoignage sous les yeux : c’est l’alliance de ses compatriotes catholiques avec O’Connell. En sa qualité de conservateur anglais, il ne voit
1. Article du British Critic de janvier 1840 . – Lettres du commencement de 1840. (Lett. and Corr., t. II, passim.) – Apologia.
193
dans l’agitateur irlandais qu’un artisan de violence et de révolution qui ameute contre l’Eglise anglicane des hommes de toutes religions ou sans religion. La participation des catholiques à une telle campagne lui paraît justifier et confirmer toutes les vieilles accusations contre la politique sans scrupule du clergé romain. C’est, à ses yeux, pour les âmes ébranlées dans leur foi anglicane, un avertissement d’une opportunité providentielle, et il ne croit pas qu’il puisse y avoir un meilleur préservatif contre le papisme 1. Cet état d’esprit, qu’on a aujourd’hui quelque peine à s’imaginer, explique l’accueil peu courtois que Newman fit, vers cette époque, en janvier 1840, au meilleur et au plus inoffensif des hommes, le converti George Spencer 2. On sait que Spencer, ordonné prêtre en 1832, s’était principalement voué à susciter une croisade de prières pour le retour de l’Angleterre à l’unité. En France, en Italie, en Allemagne, son appel avait été entendu. Il eut l’idée généreuse d’intéresser à son entreprise ces anglicans qu’on disait être si sincèrement préoccupés de ramener leur Eglise à la vérité catholique. Il vint donc à Oxford et chercha à se rencontrer avec Newman. Ces deux
1. Déjà, en 1835, Newman, ayant reçu chez lui un prêtre catholique, M. Maguire, que lui avait recommandé Wiseman, avait été choqué, « dégoûté », disait-il, de l’entendre défendre O’Connell et Hume. Il avait vu là une preuve que c’était bien toujours la « cruelle Eglise », décidée à faire à l’Eglise d’Angleterre une guerre sans merci et sans scrupule. (Lett. and Corr. of J.-H Newman, t. II, p. 115, 124, 131, 132.) 2. Sur Spencer, voy. plus haut, p. 132 Devenu passionniste en 1846, il devait mourir en 1864, laissant la mémoire d’un saint religieux.
194
hommes n’étaient-ils pas faits pour s’entendre ?Newman, d’ailleurs, à cette époque même, ne s’occupait-il pas à établir, lui aussi, des prières pour le rétablissement de l’unité religieuse’? Cependant il reçut froidement la visite de Spencer et, à la différence de plusieurs de ses amis, entre autres d’Oakeley et de Ward, il refusa de dîner avec lui chez un des membres de l’Université. Ce n’était pas seulement, comme il l’écrivait à un ami, qu’il se faisait scrupule d’avoir des « relations sociales et familières » avec un homme qu’il considérait être in loco apostatae 2, c’était surtout qu’il lui en voulait de la conduite politique du clergé dont il faisait partie. Il lui écrivait à lui-même, quelques jours plus tard, pour excuser ou plutôt expliquer son procédé : « Rien de plus touchant que d’apprendre que vous priez pour nous... Pourquoi donc ai-je refusé d’entretenir avec vous des rapports conformes à ces sentiments ? Par cette simple raison si je puis me permettre de le dire, que vos actes sont en opposition avec vos paroles. Vous nous invitez à l’union des coeurs, au moment même où vous employez tous vos efforts, non à restaurer, ni à réformer, ni à réunir, mais à détruire notre Eglise... Vous êtes ligué avec nos ennemis. La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d’Esaü. » A l’appui de cette accusation, Newman reproche aux catholiques de s’être unis, en Angleterre, « aux infidèles, aux railleurs, aux sceptiques, aux rebelles »,
1. Un petit livre de Prières pour l’union était alors en vente à Oxford. Plusieurs de ces prières étaient empruntées à un livre catholique, publié peu auparavant à Londres. 2. Lett. and Corr., t. II, p. 295.
195
contre les anglicans, de « s’être alliés à ceux qui ne croient à rien, contre ceux qui croient à quelque chose. » Et il conclut en ces termes : « C’est là ce qui cause à mon esprit une douleur si grande, que, sauf des restrictions qu’il n’est pas besoin de mentionner ici, je ne puis avoir de rapports familiers avec aucune personne influente appartenant à la communion romaine, et encore moins quand une mission religieuse la conduit près de nous. Rompez, vous dirai-je, rompez avec M. O’Connell en Irlande, avec le parti libéral en Angle-terre, ou ne venez pas à nous, avec des offres de prières mutuelles et de sympathie religieuse 1 ». A cette lettre si rude, le doux Spencer ne répondit rien. Quant à Newman, il ne se contentait pas de ces duretés à huis clos : sous l’empire des mêmes préventions, il écrivait dans le British Critic, à l’adresse des controversistes de Rome:
A leurs fruits, vous les connaîtrez... Nous voyons l’Eglise romaine s’efforcer de faire des prosélytes au milieu de nous, à l’aide de faux exposés de ses doctrines, d’affirmations plausibles, d’assertions hardies, d’appels faits à la faiblesse de la nature humaine, à nos revers, à nos excentricités, à nos craintes, à nos frivolités, à nos fausses philosophies. Nous voyons ses agents sourire, s’agiter, faire le plongeon pour attirer l’attention, comme les bohémiens qui captivent les écoliers vagabonds en leur présentant des contes de nourrice, de belles images, du pain d’épice doré, des drogues cachées dans des confitures et des sucreries pour les bons petits enfants. Qui pourrait voir, sans rougir, la religion de Ximenès, de Borromée et de Pascal, travestie de la sorte?
1. Apologia
196
Nous autres Anglais, nous aimons la noblesse, la franchise, la constance, la vérité. Rome ne nous gagnera point, qu’elle n’ait appris à connaître et à pratiquer ces vertus... Jusqu’à ce qu’elle cesse d’être ce qu’elle est en pratique, une union est impossible entre elle et l’Angleterre.
La violence même de ce langage ne témoigne-t-elle pas d’un défaut de sang-froid, et n’y a-t-il pas là comme un ressentiment du trouble où l’auteur avait été un moment jeté, à la pensée d’être obligé de confesser les droits de cette Rome si longtemps maudite ? Newman, toutefois, ne pouvait pas finir sur des paroles de haine, et il ajoutait : Si Rome se réforme (et qui peut prédire qu’une si vaste partie de la chrétienté ne se réformera jamais?), alors ce sera le devoir de notre Eglise d’entrer en communion avec es Eglises du continent... Et, bien que nous puissions ne pas vivre assez pour voir ce jour-là, nous sommes tenus de prier pour qu’il arrive... Rien de plus touchant assurément que d’apprendre, comme nous l’avons appris récemment, que des chrétiens, sur le continent, prient ensemble pour le bien spirituel de l’Angleterre. Puissent-ils arriver à la lumière, en aspirant à l’unité, et croître dans la foi, en manifestant leur amour! Nous aussi, nous avons nos devoirs envers eux; nous devons, non outrager, calomnier, haïr, quoique les intérêts politiques le demandent, mais aimer avec plus d’ardeur encore, selon l’esprit, des frères dont, pour nos péchés et les leurs, il ne nous est pas donné de voir les visages.
197
II
Parmi les jeunes hommes entrés si nombreux, si ardents dans le Mouvement, plusieurs y avaient apporté des idées, des tendances fort différentes de celles des tractarians de l’origine. Ceux-ci, fils dévoués de l’Eglise d’Angleterre à laquelle tout leur passé les liait étroitement, n’avaient eu d’autre dessein que de la ramener à ce qu’avaient voulu en faire ses théologiens du XVIIe siècle; loin de songer à l’ébranler, ils croyaient ainsi la vivifier, la rendre plus forte contre ses rivales, notamment contre l’Eglise de Rome, et il ne leur venait même pas à l’esprit que les droits de cette dernière pussent être reconnus Les nouveaux adhérents, au contraire, par leur âge, par leur formation, n’étaient pas aussi profondément attachés à leur Eglise. Au moment où ils étaient venus au Mouvement, la controverse avait déjà singulièrement ébranlé plusieurs des thèses anglicanes : tout en persistant à combattre l’Eglise romaine, Newman avait été contraint de reconnaître que, par plus d’un point, la situation de cette Eglise était beaucoup plus forte qu’il ne l’avait d’abord supposé; quoique le doute où l’avait un moment jeté l’histoire des vieilles hérésies n’ eût pas été connu, chacun avait eu le sentiment que l’étude des Pères des premiers siècles conduisait à des conclusions différentes de celles auxquelles on s’était attendu; enfin les Remains de Froude, récemment publiés et si bien faits pour agir
198
sur de jeunes âmes, pouvaient être pris comme un encouragement à détester les hommes de la Réforme, à admirer, à envier l’Eglise romaine. Etait-il donc surprenant que ces nouveaux venus ne parussent pas aussi enracinés dans l’anglicanisme, aussi prévenus contre Rouie, que l’avaient été les premiers tractarians? Il était d’ailleurs de leur âge de se montrer plus ardents, plus absolus, plus dédaigneux des précautions devant lesquelles les chefs du Mouvement s’étaient souvent arrêtés, plus impatients d’aller vite, plus ambitieux d’aller loin. Ceux qui pensaient ainsi n’étaient pas les moindres des disciples de Newman; nommons entre autres: Oakeley, Faber, Dalgairns, et le plus agissant de tous, celui qui donnait aux autres le ton, l’impulsion, et qui apportait à cette campagne son impétuosité accoutumée, par goût des solutions extrêmes, son mépris de tout compromis et de toute prudence, ses excentricités d’enfant terrible, W.-G. Ward. De lui, plus que de tout autre, on pouvait dire qu’il n’avait jamais eu de tendresse particulière pour l’Eglise d’Angleterre : elle n’était pas pour lui un être aimé dont il ne se séparerait pas sans déchirement; ce n’était qu’un système à garder ou à rejeter, suivant les conclusions auxquelles le conduirait le raisonnement. A considérer cette Eglise dans le présent, son esprit logique était rebuté par ce qu’elle avait d’inconséquent; de son passé, il ne se piquait pas de savoir grand chose, faisait profession d’ignorer et de dédaigner l’histoire, et n’avait pas étudié les théologiens anglicans
199
du XVIIe siècle. « Votre père ne fut jamais un high-churchman », a écrit plus tard, à son fils, le cardinal Newman 1 . S’il était ardemment dévoué à Newman, s’il se proclamait son disciple et croyait n’avoir pas d’autres idées que les siennes, il ne se faisait pas faute de le pousser, de le compromettre, de tirer les conséquences les plus extrêmes de ses principes. Il était le premier à souligner la divergence qui commençait à poindre entre lui et Pusey, et, au scandale des anciens tractarians, il semblait plus pressé d’en prendre acte que soucieux de la voiler. Il était sincère, sans doute, en déclarant alors n’avoir jamais envisagé comme une éventualité possible sa soumission à l’Eglise de Rome, mais il était visiblement séduit par la consistance dogmatique de cette Eglise, par son principe d’autorité, par son idéal de sainteté, par ses habitudes de piété; à tous ces points de vue, il lui reconnaissait des avantages qui manquaient à l’anglicanisme; il étudiait de préférence, et avec une sorte de passion, les grands docteurs scolastiques du moyen-âge, saint Thomas d’Aquin et saint Bonaventure, les théologiens jésuites du XVIe siècle, Suarez et Vasquez, les maîtres de la dévotion mystique et ascétique, entre autres les Exercices spirituels de saint Ignace. Il avait beau répudier pour lui-même toute pensée de conversion au romanisme, cette conclusion semblait sortir des idées qui fermentaient dans son intelligence toujours bouillonnante, qui débordaient dans ses conversations d’une verve si
1. W.-G. Ward and the Oxford Movement, par Wilfrid Ward, p. 136.
200
étonnante, dans ses ardentes et interminables argumentations. « Quand je me promène avec Ward, racontait un de ses amis, il commence par établir un certain nombre de principes si simples qu’on dirait des truismes; je les accepte l’un après l’autre, quand soudain la porte s’ouvre et me voilà sur le chemin de Rome 1. » Déjà, au commencement de 1839, dans son article sur l’Etat des partis religieux, Newman avait reconnu les exagérations de quelques-uns de ses partisans. « Il y aura toujours, disait-il, parmi ceux qui professent les opinions d’un parti de Mouvement, nombre de gens qui parleront à voix haute et d’une façon étrange,… gens trop jeunes pour être sages, trop généreux pour être prudents, trop chaleureux pour être modérés. » Toutefois, à cette époque, ces dissonances ne lui avaient pas semblé bien dangereuses, et il n’y avait attaché que peu d’importance. C’est plus tard, sous l’impression du trouble où le jettent ses propres doutes, que le péril lui apparaît. Si lui-même a pu entrevoir, un moment, Rouie comme le terme où il serait forcé d’aboutir, que ne doit-on pas craindre pour des esprits plus jeunes, plus ardents, plus aventureux? « Depuis que j’ai lu l’article du Dr Wiseman, écrit-il à Pusey, le 15 janvier 1840, j’ai été fort découragé; car, si je me sens moi-même péniblement pressé, que sera-ce pour d’autres qui n’ont pas autant réfléchi sur le sujet, ou qui ont moins de motifs
1. W-G. Ward and the Oxford Movement, p. 34.
20l
de se retenir l? » Pour la première fois, il envisage comme possibles des conversions au catholicisme. Cette inquiétude l’obsède tellement qu’il y revient sans cesse dans ses lettres. Il écrit à sa soeur, le 17 novembre 1839: « La question des Pères devient de plus en plus troublante... Je ne saurais être surpris de voir des individus passer au, romanisme. » Il écrit encore à son ami Bowden, le 10 janvier 1840: « Les choses avancent rapidement. Mais gare les écueils! Le danger d’une chute dans le romanisme devient plus grand chaque jour. Je m’attends à entendre parler de victimes.» Quatre jours plus tard, il exprime la même crainte à soeur. Le 21 février, il revient sur le danger de voir « les meilleurs de ses partisans se faire catholiques romains ». Enfin, le 25, il écrit: « Sans doute, les bons principes ont fait de merveilleux progrès, mais je ne suis pas certain qu’ils ne tendent pas vers Rome 2». Newman ne se dissimule pas que ses écrits, ses sermons, les idées qu’il a répandues autour de lui, sont la cause principale de cette tendance au romanisme. Dans le danger que courent ces jeunes âmes, il se sent donc une particulière responsabilité. C’est à lui de les préserver, de les retenir, de les diriger. Mais comment? Le rôle de chef de parti lui avait toujours répugné, et
1. Life of Pusey, t. Ier, p.154. 2. Lett. and Corr., t. II. p. 292, 293, 297, 298, 299, 300. — Pusey n’est pas moins préoccupé des sécessions possibles. A un ami qui lui demande s’il est vrai que quelques-unes se soient déjà produites, il répond que, jusqu’à présent, il n’y a eu, grâce à Dieu, rien de pareil, mais, ajoute-t-il, « personne ne sait ce qui arrivera, et nous ne pouvons nous vanter. » (Life of Pusey, t. II, p. 167.)
202
il était loin d’en posséder toutes les qualités. Pour imposer aux autres une direction ferme, il avait lui-même l’esprit trop chercheur, trop inquiet, trop subtil, trop prompt à considérer toutes les faces des questions, il avait la conscience trop délicate et trop perplexe, il avait trop le scrupule de l’indépendance des autres, trop le respect du travail intime de chaque âme. Faut-il ajouter aussi une sorte d’indolence dont il s’est confessé? « Mon grand principe, a-t-il dit, fut toujours vivre et laisser vivre. Je n’étais pas homme à prendre le gouvernement d’un parti. Je ne fus jamais qu’un écrivain influent dans une école, et je n’ai jamais désiré autre chose... J’étais, non le chef d’un pouvoir, mais le promoteur d’une opinion flottante 1. » Or si, de tout temps, Newman avait été peu propre à imposer sa direction, il l’était moins encore après l’ébranlement que venaient de subir ses idées. Comment commander aux autres, s’il n’avait plus confiance en soi? « Je n’avais jamais eu le poignet vigoureux, a-t-il écrit, mais précisément, au moment où j’en aurais eu le plus besoin, les rênes s’étaient rompues entre mes mains. Mon esprit pressentait avec inquiétude le résultat définitif de toutes ces recherches, et ce pressentiment, il m’était presque impossible de le cacher à des hommes qui me voyaient chaque jour, entendaient mes conversations familières et venaient peut-être avec le dessein formel de me sonder et d’obtenir à leurs questions un oui ou un non catégorique; dans ces conditions, comment pouvais-je espérer donner, sur ma croyance réelle, 1. Apologia.
203
positive, présente, aucune explication propre à soutenir ou à consoler ceux que poursuivaient déjà des doutes personnels à 1? » Le sentiment que Newman a de sa responsabilité et de son impuissance pèse à ce point sur lui, qu’il en vient à se demander si son devoir n’est pas de résigner la cure de Sainte-Marie. Il s’en ouvre, en octobre 1840, à l’ami qui lui paraît devoir être du meilleur conseil en une telle affaire, à Keble : il lui expose, comment, par ses sermons, il s’est trouvé, sans le vouloir, agir beaucoup plus sur les jeunes membres de l’Université que sur ses paroissiens, comment les autorités universitaires, mécontentes de cette action, ont cherché par tous les moyens à la contrarier, puis il continue ainsi:
Je ne puis me dissimuler que mes prédications ne se proposent pas la défense de ce système religieux, reçu depuis trois cents ans, et dont les chefs de Collèges sont ici les soutiens légitimes... Ce n’est pas tout : je crains d’être obligé de reconnaître que, volontairement ou non, je les tourne vers Rome... La plupart des doctrines soutenues par moi s’appuient principalement ou uniquement sur le système romain. Les arguments que j’ai formulés contre le romanisme me paraissent aussi forts qu’ils l’ont jamais été, mais les hommes se laissent guider par des sympathies, non par des arguments; et, si je sens moi-même la force de cette influence, moi qui m’incline devant les arguments, pourquoi d’autres, qui n’ont jamais eu la même déférence pour les arguments, ne pourraient-ils subir cette influence bien plus encore? Je ne puis non plus conjurer le danger, en
1. Apologia.
204
prêchant ou en écrivant contre Rome. Je crois avoir tiré ma dernière flèche, dans l’article sur la « Catholicité de l’Eglise d’Angleterre». Il faut ajouter que le fait même de m’être compromis, en attaquant Rome, a pour effet d’endormir les gens qui pourraient avoir des , soupçons contre moi, ce qui m’est pénible, maintenant que je commence à avoir des soupçons contre moi-même 1.
Keble, fort ému du conseil qui lui est demandé, estime que la retraite de Newman serait une sorte de scandale et troublerait encore plus les esprits. il lui conseille donc de rester: « Puisque votre avis est que je puis continuer, répond Newman, il semble en résulter que, dans les circonstances actuelles, je dois le faire. » Et il résume ainsi les considérations principales qui le décident à se conformer à l’avis de son ami:
1° Je ne crois pas que nous ayons encore éprouvé tout ce que l’Eglise d’Angleterre peut supporter. C’est une expérience hasardeuse, je le sais, comme l’épreuve d’un canon. Cependant, nous ne devons pas regarder comme prouvé que le métal doive éclater dans l’opération. Elle a supporté, sans accident, plus d’une fois déjà, pour ne point parler d’aujourd’hui, une forte charge de vérité catholique. Quant au résultat, quant à savoir si ce procédé ne rapprochera pas l’Eglise d’Angleterre, tout entière comme corps, de I’Eglise romaine, cela n’importe pas. Qui sait si ce n’est pas là le moyen providentiel pour ramener l’Eglise entière à l’unité, sans nouveau schisme et sans autre action du jugement privé? 2° Je fais naître, dit-on, des sympathies pour Rome. Mais n’est-ce pas dans le même sens qu’agissent Hooker, Taylor,
1. Apologia.
205
Bull, etc.1? Leurs arguments peuvent être contre Rome, mais les sympathies qu’ils font naître doivent être en faveur de Rome. Je puis, si vous le voulez, aller plus loin qu’eux, je puis exciter les sympathies davantage, mais je ne fais que pousser les esprits dans la même direction qu’eux. 3° Le rationalisme est le grand mal du jour. Ne puis-je me considérer, dans mon poste de Sainte-Marie, comme appelé à protester contre ce rationalisme ? Il n’est pas douteux pour moi que l’esprit protestant, auquel je m’oppose, ne conduise à l’incrédulité, bien plus sûrement que l’esprit dont ,je suis le champion ne conduit à Rome 2.
Les considérations par lesquelles Newman se décide à garder sa cure et à poursuivre sa tâche ont pour effet, sur le moment, de le remonter un peu. Il écrit à Rogers, en lui rendant compte de la consultation qu’il vient de prendre auprès de Keble: « Je me sens beaucoup plus comfortable que je n’étais auparavant. Je ne crains plus qu’un certain nombre de personnes soient sur le point d’aller à Rome, si je suis rassuré pour ce qui me touche moi-même. Que je puisse avoir confiance en moi, et je pourrai avoir confiance dans les autres»! Seulement, du moment qu’il demeure à son poste, il en résulte pour lui des devoirs auxquels il ne se dérobe pas. Il lui faut faire de son mieux pour calmer, chez ses jeunes disciples, les esprits troublés, donner une direction à ceux qui sont désorientés, retenir ceux qui menacent de se dévoyer. C’est la raison d’une publication dont le retentissement va être immense, et qui se
1. Théologiens anglicans du XVIe ou du XVIIe siècle, dont se réclame l’école High Church. 2. Apologia. 3. Lett. and Corr., t. II, p. 319.
206
trouvera produire un effet bien différent de celui que l’auteur en attendait: je veux parler du dernier des tracts, le fameux tract 90, paru le 27 février 1841, sous ce titre: Remarques sur certains passages des XXXIX Articles.
III
Les « XXXIX Articles de religion », approuvés et promulgués par Elisabeth en 1571, ne renfermaient pas un corps de doctrine, un credo complet. Amalgame assez disparate, ils avaient eu seulement pour objet de remédier quelque peu à l’anarchie religieuse de l’époque, en imposant une croyance uniforme sur certains points alors très discutés, et ils l’avaient fait moins encore en affirmant des vérités positives qu’en répudiant ce qu’on prétendait être des erreurs. Si la forme en était parfois violente et agressive, surtout quand ils s’attaquaient à certains dogmes de l’Eglise romaine, s’ils traitaient ces dogmes de « choses vaines, en contradiction avec la parole de Dieu », et s’ils déclaraient la messe une « fable blasphématoire », le texte était loin d’être tou,jours précis; il semblait que les rédacteurs eussent eu peur de s’aliéner tel ou tel parti, en s’exprimant trop nettement. De là les commentaires parfois assez divergents qui avaient été faits, par la suite, pour établir le vrai sens des Articles. Avec le temps, l’interprétation protestante et anti-catholique, qui paraissait en effet la plus naturelle, avait prévalu. Tous les clercs étaient tenus, en recevant les ordres,
207
de souscrire ces Articles. L’usage avait longtemps été de le faire sans y attacher grande importance, et les autorités ecclésiastiques étaient souvent les premières à ne voir là qu’une sorte de formalité’. Mais, depuis que, sous l’influence du Mouvement, les idées religieuses devenaient plus sérieuses et plus profondes, il fallait s’attendre à ce qu’on regardât de plus près à cette souscription, et à ce qu’elle parât incompatible avec les principes catholiques qu’on prétendait restaurer dans l’Eglise anglicane. Newman savait, par divers indices, que ce doute commençait à s’élever autour de lui, chez les plus avancés de ses disciples. « Qu’allez-vous faire des Articles? » lui demandaient-ils. N’était-il pas à craindre que des consciences déjà ébranlées ne vissent là une raison de sortir de l’Eglise? Ce fut pour écarter ce danger qu’il écrivit le tract 90. Il entreprend d’y démontrer que les Articles, en dépit de leur origine et de leur apparence protestantes, sont susceptibles d’une interprétation catholique. A qui lui oppose qu’ils ont été dirigés contre la doctrine romaine, il répond par une distinction. A son avis, par doctrine romaine, on peut entendre trois choses fort différentes: 1° l’enseignement catholique des premiers siècles : 2° les dogmes formels de Rome tels qu’ils sont définis dans les derniers conciles, notamment dans le concile de Trente; 3° certaines croyances ou coutumes
1. Stanley, au moment de son ordination, avait été fort troublé de souscrire celui des Articles qui imposait comme règle de foi le symbole d’Athanase. Il passa outre, sur la déclaration de son archidiacre qui lui expliqua que cette adhésion ne l’engageait pas à grand’chose.
208
actuellement sanctionnées par Rome, qu’il appelle les erreurs dominantes. Or il soutient que les Articles ne condamnent rien de l’enseignement catholique, qu’ils sont compatibles avec une partie des dogmes formels, et qu’ils ne repoussent entièrement que les erreurs dominantes. Ils ne portent donc aucune atteinte à ce qui est de l’essence de la vérité catholique. Entrant ensuite dans le détail, Newman cherche à établir que cette interprétation peut s’appliquer aux Articles qui semblent le plus y répugner, à ceux où il est question de l’Ecriture, de l’Eglise, des conciles généraux, de la justification, du purgatoire, de l’invocation des saints, des messes, du célibat des prêtres, etc. La tâche est parfois malaisée, et il n’en vient à bout que par des arguments singulièrement subtils. Son dessein avoué est d’aller, pour chaque Article, aussi loin que possible dans la direction romaine. Il se défend de forcer le sens des mots, mais le sollicite de son mieux pour l’élargir. Ce qu’il cherche, c’est moins ce que le souscripteur des Articles doit croire que ce qu’il peut croire. Il ne veut pas prouver que la doctrine catholique y est imposée; il lui suffit d’établir qu’elle y est tolérée. Que son interprétation soit contraire aux opinions connues des rédacteurs des Articles, peu importe ; il ne s’agit pas de savoir ce qu’ils pensaient. « C’est pour nous, dit Newman, un devoir à la fois envers l’Eglise catholique et envers notre propre Eglise de prendre nos confessions protestantes dans le sens le plus catholique qu’elles pourront admettre; nous n’avons point de devoir envers ceux qui les ont rédigées.» A son avis, d’ailleurs, cette inter-
209
prétation n’est pas aussi contraire qu’on veut bien dire aux intentions des rédacteurs. Si ceux-ci répudiaient le papisme, ils cherchaient à gagner les papistes, et le moyen n’était-il pas de rester dans une équivoque qui rassurât leurs consciences, d’user d’expressions qui « mordissent en réalité moins fort qu’elles n’aboyaient »? L’auteur conclut donc que les Articles, « quoique produit d’une époque anticatholique, sont, par la providence de Dieu, tout au moins non anticatholiques, etqu’ils peuvent être souscrits par ceux qui aspirent à être catholiques de coeur et de doctrine». Newman se rendait compte de la gravité de sa tentative : l’issue déciderait de ce que l’anglicanisme pouvait porter de catholicisme ; c’était l’épreuve du canon dont il parlait, peu auparavant, dans une lettre à Keble. Si la réponse était négative, des résolutions extrêmes pouvaient s’imposer aux consciences. « La question, a-t-il écrit depuis, était pour nous une question de vie ou de mort... Je reconnaissais que j’étais engagé dans un experimentum crucis 1.» Et cependant, s’il avait conscience de poser un problème redoutable, il ne s’attendait nullement à l’orage qu’il allait soulever. Il avait soumis son travail à Keble, qui n’y avait trouvé rien à redire. Ward, à la vérité, l’avait prévenu que ce tract mettrait le feu aux poudres ; il ne l’avait pas cru, et, comme les premiers jours après la publication s’étaient passés sans explosion, il lui disait: « Vous le voyez, vous êtes un faux prophète. » Il ne se doutait pas qu’à ce moment même, la mine était chargée et sur le point d’éclater.
1. Apologia.
210
IV
Le matin du 27 février, jour de la publication du tract 90, Ward était entré en coup de vent chez son ami Tait et avait jeté la nouvelle brochure sur la table, en lui criant : « Voici qui vaut la peine d’être lu! » Tait avait commencé la lecture, à demi éveillé; mais, bientôt heurté, blessé dans ses préventions protestantes, il se levait et courait répandre l’alarme chez ses amis. Un autre membre de l’Université était plus animé encore : c’était Golightly, autrefois partisan dévoué, maintenant adversaire acharné du Mouvement, à ce point aveuglé par sa passion qu’il se croyait exposé à être assailli et maltraité, à quelque coin de rue, par une bande de tractarians 1. Ce fut lui surtout qui mit les autres en branle. Sous son impulsion, les choses allèrent vite. Dès le 8 mars, quatre senior tutors de divers collèges, dont Tait, publiaient une lettre adressée à l’éditeur des Tracts for the times, où ils dénonçaient le dernier tract comme « suggérant et ouvrant, au moins à ceux qui avaient des tendances romaines un moyen de violer leurs engagements solennels envers l’Université» Deux jours après, le conseil des chefs de Collèges (heads of houses) s’emparait de la question et nommait un comité pour l’examiner. Vainement Newman, se proclamant l’auteur du tract qui, comme tous les autres, avait paru sans signature, fit-il savoir qu’il allait faire parvenir sa défense au conseil; celui-
1. Lett. and Corr. of J.- H. Newman, t. II, p. 444.
211
ci, avec une précipitation inconvenante, se refusa à attendre cette défense et, dès le 15 mars, prononça sa sentence. Elle portait « que les modes d’interprétation suggérés par ledit tract, esquivant (evading) plutôt qu’expliquant le sens des XXXIX Articles, et conciliant la souscription de ces Articles avec l’admission des erreurs qu’ils avaient dessein de contredire, en annulaient l’objet et étaient incompatibles avec l’obéissance due aux statuts de l’Université» C’était reprocher à l’auteur du tract, non seulement une opinion incorrecte, mais une sorte d’escamotage sans loyauté. Pour aggraver encore la mesure, le vice-chancelier fit aussitôt placarder la censure sur la porte du réfectoire de tous les collèges: c’était là où l’on affichait le nom des marchands malhonnêtes auxquels les étudiants ne devaient plus s’adresser. Le lendemain, 16 mars, Newman publia, sous forme de lettre au Dr Jelf, chanoine de Christ-Church, la défense que l’impatience de ses juges n’avait, pas voulu attendre : il y maintenait la nécessité d’interpréter les Articles dans un sens catholique, tout en répudiant les « erreurs romaines », et rappelait, en ces termes, le motif qui l’avait déterminé à écrire Son tract:
Le siècle est en mouvement vers quelque chose, et, très malheureusement, la seule communion religieuse parmi nous qui, dans ces dernières années, a été pratiquement en possession de ce quelque chose, est l’Eglise de Rome. Elle seule, au milieu de toutes les erreurs et de tous les vices de son système pratique, a donné libre place aux sentiments de crainte, de mystère, de tendresse, de véné-
212
ration, de dévotion, et aux autres sentiments qui peuvent être appelés spécialement catholiques. La question es de savoir si nous devons abandonner ces sentiments à l’Eglise romaine, ou les réclamer pour nous-mêmes, comme nous pouvons le faire, en revenant à ce vieux système qui, à la vérité, a été répudié dans ces dernières années, mais qui a été et qui est tout à fait concordant avec notre Eglise, je pourrais plutôt dire qui lui est propre et naturel, ou même nécessaire. Mais, si nous les abandonnons, nous devons abandonner en même temps les hommes qui y sont attachés. Nous devons consentir ou à abandonner les hommes, ou à admettre leurs principes... Le tract est fondé sur la croyance que les Articles n’ont pas besoin d’être aussi fermés qu’ils le sont dans l’enseignement généralement admis, et il soutient qu’ils ne doivent pas l’être par égard pour beaucoup de personnes. Si nous les fermons, nous courons le risque de soumettre les personnes que nous aimerions le moins à perdre, à la tentation de se joindre à l’Eglise de Rome.
Quel fut, sur Newman, l’effet des procédés si violents et si soudains des heads of houses? « Je n’étais nullement préparé à l’explosion, a-t-il raconté plus tard, et sa violence me fit tressaillir; je crois cependant n’avoir pas eu du tout peur. » C’est bien, en effet, l’état d’esprit que révèlent ses lettres du moment. Dès les premières menaces, il proteste « ne pas se repentir » et « ne pas craindre pour sa cause» « Que cela tourne au bien, écrit-il le 13 mars, je n’en doute pas. Nous avions été trop heureux. Je suis seulement chagrin que mes amis soient exposés à souffrir par moi. » Le 15 mars, pendant que les chefs de Collèges délibèrent : « Je m’efforce à me préparer au pis. Pour le moment, je suis aussi tranquille et aussi heureux que
213
je peux le désirer. » Le même jour, à la première nouvelle de la censure : « Les chefs de Collèges, je crois, viennent de faire un acte de violence; ils ont dit que mon interprétation des Articles était une évasion. Ne croyez pas que cela m’afflige. Vous le voyez, aucune doctrine n’est censurée, et mes épaules s’arrangeront pour porter le fardeau. Si vous saviez tout, ou si vous étiez ici, vous verriez que j’ai proclamé un grand principe pour lequel il est juste que je souffre. » Le lendemain: « J’ai de quoi, grâce à Dieu, me garder du trouble intérieur; personne n’a jamais fait une grande chose, sans souffrir. » Le 21 mars : « Je suis maintenant dans ma vraie place, celle où j’ai longtemps désiré être, que je ne savais comment atteindre et à laquelle j’ai été porté, sans le vouloir, providentiellement, je l’espère, bien que je me rende très bien compte, en même temps, que c’est une humiliation et un châtiment pour mon secret orgueil et ma nonchalance... Je ne puis pas prévoir ce qui résultera de tout cela, ici ou ailleurs, en ce qui me regarde. En tout cas, je ne crains pas pour la cause. » Enfin, le 25 mars : « Je me trouve bien, dans une paix complète, mais nous ne sommes pas encore sortis de la forêt 1. » Pusey, de son côté, écrit le 17 mars : « Newman est très calme. » L’auteur du tract 90 sent, du reste, autour de lui, chez ses disciples, chez ses amis connus ou inconnus, des sympathies d’autant plus émues, plus empressées à se manifester, qu’il a été plus indignement traité. Keble écrit au vice-chancelier de l’Université, pour se
1. Apologia et Lett. and Corr., t. II, p. 326 à 336.
214 solidariser avec Newman. Pusey a pu être un peu contrarié d’une publication qui dépassait sur quelques points ses vues d’alors 1; mais il s’indigne des procédés dont on a usé envers son ami et il n’hésite pas à prendre sa défense; il est plein d’admiration pour son attitude. « Newman, écrit-il, peut supporter seul la chaleur du jour. Celui à qui il se confie fera éclater son innocence, tôt ou tard. Pendant que la tempête est sur lui, les gens qui peuvent l’apprécier, n’auront que plus de respect pour lui.» Newman a même la surprise d’être chaudement approuvé par certains high-churchmen qui s’étaient séparés de lui en plus d’une circonstance, par exemple lors de la publication des Remains de Froude: tels Hook, Perceval, Moberly, Palmer. C’est ce qui lui faisait écrire, le 4 avril: « Il m’est très doux d’avoir, de la solide vérité et de l’importance du tract 90, un témoignage pareil à celui que j’ai reçu de tant d’amis, de ceux mêmes en qui j’espérais le moins, à cause de l’extrême prudence de leur esprit 2 » Mais, si les amis de Newman sont révoltés des procédés dont ont usé à son égard les autorités universitaires, ses adversaires se sentent encouragés. Dans la masse protestante, il y a comme une explosion de fanatisme, sentiment mêlé de colère et de panique. Sous la censure qui vient de le frapper, le tract 90 apparaît comme la preuve et la manifestation du complot
1. Plus tard, après la conversion de Newman, Pusey adoptera pleinement les idées du tract O, et, pour manifester avec plus d’éclat son adhésion, il entreprendra de le rééditer. 2. Apologia. — Lett. and Corr. of J.-H. Newrnan, t. II, p. 326 à 344. — Life of Pusey, t. II, passim.
215
romaniste que les polémiques des années précédentes ont fini par faire soupçonner derrière le Mouvement tractarien. et qu’au même moment lord Morpeth dénonçait de nouveau à la Chambre des communes. Parmi ceux qui s’en effrayent ou s’en indignent, peu se donnent la peine d’étudier et de discuter l’argumentation historique et théologique du tract; ils y voient, sur la foi des chefs de Collèges, une sorte de subtilité ambiguë et perfide, la manoeuvre d’un traître masqué qui cherche à livrer l’Eglise qu’il feint de défendre. Les Anglais aiment à faire grand état de la franchise, ils se piquent de fair play et s’en attribuent même volontiers le monopole. L’accusation portée contre Newman était donc de celles qui pouvaient lui faire 1€ plus de tort à leurs yeux. Du tract 90, date cette note de dishonesty et, comme plusieurs disaient alors, de « jésuitisme 1 », qui devait longtemps peser sur le plus sincère et le plus délicat des hommes, jusqu’au jour où, en 1864, cédant enfin à un mouvement d’éloquente et vengeresse indignation, il s’en débarrassera victorieusement par son immortelle Apologia. Si injurieuses que fussent ces accusations, elles n’auraient pas suffi à détruire chez Newman cette tranquillité, cette confiance qu’on a vues demeurer si entières, sous le coup de la censure. Une question le touche et l’inquiète bien autrement. Que vont faire
1. Pusey exprimait la « crainte » qu’il ne restât, dans les esprits, l’impression du « jésuitisme » des tractarians. (Lett. and Corr. of Newman, t. II, p. 334.) Ward, de son côté, constatait que beaucoup considéraient le tract comme a jesuitical play upon words. (W.-G. Ward and the Oxford Movement, p. l67.)
216
les évêques? Les meneurs hostiles, Golightly entre autres, les ont fort excités à intervenir. L’évêque d’Oxford, que la chose regarde plus particulièrement, est très embarrassé. Il ne cache pas sa désapprobation du tract, mais il voudrait ménager l’auteur qu’il estime et n’entend pas s’associer à ceux qui mettent en doute sa loyauté envers l’Eglise. Il consulte l’archevêque de Canterbury, qui lui recommande surtout d’arrêter une controverse dangereuse, d’éviter ce qui fournirait à Newman et à ses amis occasion de la prolonger; à ses yeux, l’apaisement vaut mieux que toutes les explications. Dès le 17 mars, au lendemain de la censure, des négociations se sont engagées, principalement par l’entremise de Pusey, entre l’évêque d’Oxford et Newman; elles se prolongent péniblement pendant près de deux semaines. L’évêque, poussé par la cabale hostile, voudrait obtenir la suppression et le désaveu du tract; Newman résiste: il cédera sans doute devant un ordre formel, mais alors il résignera sa cure. Cette menace effraye l’évêque. On aboutit à une sorte de compromis : Newman consent à ne pas continuer les tracts, mais le tract 90 n’est ni supprimé ni condamné, et, pour le mieux marquer, une nouvelle édition avec notes justificatives est mise en vente 1. Le 31 mars, Newman publie une longue lettre adressée à son évêque et dont le texte a été approuvé d’avance. Il y explique les doctrines du tract, sans en rien retirer, mais en insistant sur ce qu’il a dit contre Rome. Dans sa sou-
1. Sur ces négociations, voir Life of Pusey, t. II, p. 183 et sq., et Lett. and Corr. of J.- H. Newman, t. II, p. 337, 338.
217
mission au désir exprimé par le chef du diocèse de voir cesser les tracts, il croit pouvoir montrer une preuve de la haute idée qu’il se fait de l’autorité des évêques et de son attachement à l’Eglise. « Je n’ai rien à regretter, dit-il en terminant, si ce n’est d’avoir causé de l’inquiétude à Votre Seigneurie et à d’autres personnes que je suis tenu de révérer. Je n’ai rien à regretter, mais tout, au contraire, m’invite à la joie et à la reconnaissance. Je n’ai jamais pris plaisir à paraître capable de mener un parti, et, quelque influence que j’aie eue, je l’ai trouvée et je ne l’ai point cherchée. J’ai agi, parce que d’autres n’agissaient pas, et j’ai sacrifié un repos qui m’était cher. Que Dieu soit avec moi dans l’avenir, comme il l’a été jusqu’à ce jour! Et il sera avec moi, si seulement ma main peut demeurer sans tache et mon coeur sans souillure. Je crois pouvoir supporter, ou, tout au moins, je ferai mes efforts pour supporter toute humiliation personnelle, pourvu que je sois préservé de trahir les intérêts sacrés que le Dieu de grâce et de force a remis en mes mains. » L’évêque écrit à Newman pour le remercier et le féliciter. « Ce m’est une consolation, ajoute-t-il, maintenant que le calme, je l’espère, a succédé à la tempête redoutée, — de me sentir assuré que, si j’ai fait peut-être de la peine à un homme auquel je porte grand intérêt et pour lequel j’ai beaucoup de considération, vous n’aurez jamais lieu de regretter de m’avoir écrit cette lettre. » Newman, de son côté, reconnaît que l’évêque a été « toute bonté »avec lui 1.
1. Lett. and Corr. of J.-H. Newman, t. II, p. 337 à 343.
218
Newman se rend compte qu’il vient d’abdiquer. « Je compris clairement, a-t-il raconté plus tard, que ma place dans le Mouvement était perdue; mon rôle était fini. » A un certain point de vue, il n’en est pas fâché. La défiance de soi-même et de ses idées qu’il a gardée de ses récentes crises intimes, lui fait ressentir une sorte de soulagement à être forcé de s’éloigner du champ de bataille. Comme il l’a dit encore, il lui semble « qu’une Providence secourable le tire d’une position qui menaçait de devenir impossible 1» Ce n’est pas qu’il se désintéresse des idées qu’il a tant travaillé à faire prévaloir: mais il se flatte d’avoir, par sa résistance même, sauvé son tract d’une condamnation épiscopale, d’avoir assuré aux doctrines qu’il y soutenait, sinon l’approbation, du moins la tolérance des chefs de l’Eglise. Et puis, par le silence auquel il se condamne, il croit avoir acheté celui de ses adversaires; c’est un traité de paix, tout au moins une trêve qu’il s’imagine avoir conclue 2.
V
Newman ne garde pas longtemps l’espérance qui lui a fait consentir à cesser les tracts. Au lieu de la paix qu’il attendait, la guerre continue plus violente que jamais. En avril, en mai, dans les mois qui suivent, les publications des deux partis se succèdent et se heurtent. Le tutor Nilson, le professeur Faussett,
1. Apologia. 2. Lett. and Corr. of J.-H. Newman, t. II, p. 341, 342.
219
Robert Lowe qui devait marquer dans la politique, les écrivains « libéraux » de la Revue d’Edimbourg s’acharnent contre le tract 90, insistant sur le reproche de dishonesty. Tous développent plus ou moins l’idée qu’Arnold exprimait alors en ces termes : « Mes sentiments vis-à-vis d’un catholique romain sont tout différents de mes sentiments envers un newmaniste, parce que j’estime le premier un ennemi loyal et l’autre un traître. L’un est un Français dans son propre uniforme et dans sa garnison; l’autre, un Français déguisé en uniforme rouge et tenant un poste dans nos domaines, avec le dessein de nous tromper. J’honorerais le premier et je pendrais le second 1. » A défaut de Newman qui se tient à l’écart, Keble, Pusey, Palmer, Hook, Ward, Oakeley prennent, tour à tour, la défense du tract attaqué. Ils ne le font pas tous, il est vrai, par les mêmes arguments. Pusey justifie l’interprétation donnée aux Articles, par les sentiments catholiques qu’il prête aux reformers; il aime à se couvrir de l’autorité des théologiens anglicans du XVIIe siècle et insiste sur ce qui le sépare de Rome. Ward, au contraire, étale nettement, presque brutalement, ce que le tract a voilé par prudence ou ménagement; il admet que les reformera avaient des sentiments anticatholiques et proclame qu’il prend les Articles « dans un sens qui n’est pas le sens naturel » ; sans nier les « corruptions pratiques » reprochées par Newman à l’Eglise de Rome, il tend à atténuer, à effa-
1. Lettre du 30 octobre 1841. (Life of Th. Arnold, par Stanley, t. II, p. 245.)
220
cer la distinction faite entre l’erreur romaine et la vérité catholique; il ne cache pas que cette Eglise lui paraît, par plus d’un point, supérieure à l’Eglise d’Angleterre, dont il confesse l’état misérable et le péché de rébellion. Pusey et Ward, en cette circonstance, prétendaient, de très bonne foi, ne faire qu’exposer les idées de Newman ; seulement l’un s’attachait à les « minimiser» pour ne pas donner prise aux préventions protestantes; l’autre s’appliquait à les pousser à leurs conséquences les plus extrêmes pour répondre au reproche de subtilité, d’inconséquence et de duplicité. Naturellement les autorités universitaires continuent à peser de tout leur poids dans le sens des adversaires du tract. Elles traitent en suspects les jeunes gens qui leur paraissent « teintés de tractarianisme ». Ward est obligé de se démettre des fonctions de lecturer en mathématiques et en logique qu’il occupait à Balliol college. Le prévôt d’ Oriel college avertit Church qu’il ne peut le maintenir dans la position de tutor. Avis est ainsi donné aux undergradua tes qu’en demeurant attachés à Newman ils ne pourront obtenir les situations enviées dans les collèges. Plus d’un, — ambitieux ou timide, — s’éloigne d’un parti devenu suspect. D’ailleurs, comme pour notifier avec plus d’éclat, à cette jeunesse, que la faveur et l’influence ne sont plus du côté de Newman, au moment où celui-ci abdique, son plus passionné adversaire fait une entrée triomphale à Oxford: Thomas Arnold y est nommé, à la fin de 1841, professor regius d’histoire moderne; à sa leçon d’ouverture, le 2 décembre 1841, l’affluence est telle qu’on
221
est obligé de se transporter dans la salle du théâtre. «Le lion du jour, écrit Church à Rogers, est Arnold avec ses lectures qui ont fait grand tapage dans le monde exalté, littéraire et fashionable d’Oxford 1. » Ce succès semblait marquer l’avènement d’une influence nouvelle sur la jeunesse universitaire. A la vérité, elle ne devait pas durer longtemps: peu après, en juin 1842, Arnold mourait presque subitement d’une angine de poitrine. Quelque pénible que dût être à Newman le revirement d’Oxford, il attachait toujours beaucoup plus d’importance à l’attitude des évêques. S’il avait consenti, dans la transaction conclue avec l’évêque d’Oxford, à suspendre les tracts, c’était surtout pour écarter le danger des condamnations épiscopales, et il avait cru obtenir à ce sujet des assurances plus ou moins formelles. Or voici que, dans des mandements publiés au cours de l’automne de 1841, plusieurs évêques censurent le tract 90. Le signal une fois donné, d’autres suivent; c’est comme une traînée de poudre. En août 1842, on en comptera quarante-deux, et ce ne sera pas encore la fin. Tous, sans doute, ne vont pas jusqu’à déclarer, comme l’un d’eux, que le tract 90 est le « chef-d’oeuvre de Satan» Mais tous répudient sévèrement une interprétation des Articles qui leur paraît entachée de romanisme, déloyale envers l’Eglise, propre à susciter le schisme ou l’apostasie. L’évêque de Londres et l’archevêque de Canterbury qui, au début, tout en n’admettant pas la
1. Life and letters of Dean Church, p. 34.
222
doctrine du tract, se refusaient à frapper les tractarians et paraissaient soucieux d’étouffer la polémique, cèdent à l’entraînement général. Le Dr Phillpots, évêque d’Exeter, le plus High Church de l’épiscopat, déclare le tract « offensant et indécent à l’égard de l’Eglise, malséant et injuste à l’égard des reformers» Enfin l’évêque d’Oxford lui-même, au mépris des engagements que Newman croyait avoir été pris envers lui, n’estime pas pouvoir garder le silence; son mandement contient, au milieu de quelques compliments à l’adresse des tractarians, une répudiation de l’interprétation donnée aux Articles. De la part de ces prélats, ce n’était pas une censure en l’air, sans portée pratique. L’évêque de Londres, qui était cependant des plus modérés, disait en présence de plusieurs jeunes clergymen: « Après avoir lu le tract 90, aucun pouvoir sur la terre ne me déterminerait à ordonner une personne qui en soutiendrait systématiquement les opinions. » Et il repoussait, en effet, de l’ordination, des clercs suspects de penser comme la nouvelle école sur le sacrifice eucharistique et sur d’autres points 1. L’évêque de Winchester refusait d’admettre à la prêtrise le révérend Young, curate de Keble, parce qu’il avait, sur la présence réelle, les idées de ce dernier et de Pusey; Keble, si pacifique qu’il fût, protestait et songeait sérieusement à résigner sa cure 2. Aucun doute n’était donc plus possible : c’était bien l’interprétation catholique des Articles, c’était toute la doctrine catho-
1. Lett. and Corr. of J.- H. Newman, t. II, p. 377. 2 Ibid., p. 350 à 390.
223
lique des tractarians que les évêques répudiaient avec éclat, et ils déclaraient qu’il n’y avait plus place dans leur Eglise pour qui pensait ainsi. A la même époque, et comme pour ne plus permettre aucune illusion sur son véritable caractère, l’Eglise d’Angleterre se déclarait, par un acte public, en communion avec les luthériens et les calvinistes. Sous l’inspiration du ministre de Prusse, le baron de Bunsen, et avec l’approbation de l’archevêque de Canterbury et de l’évêque de Londres, le gouvernement faisait voter, dans les derniers mois de 1841, un bill établissant un évêque anglican à Jérusalem : cet évêque, choisi alternativement par l’Angleterre et par la Prusse, consacré par les évêques anglais, devait exercer sa juridiction sur les protestants d’autres confessions qui désireraient se placer sous son autorité, sans que ceux-ci fussent pour cela tenus de répudier leurs symboles particuliers et d’adhérer à celui de l’Eglise d’Angleterre. On ne pouvait afficher plus ouvertement la volonté de se confondre avec les hérésies continentales et de n’attacher aucune importance aux divergences dogmatiques. Arnold le comprit ainsi et triompha de voir admise et pratiquée par l’épiscopat l’idée, depuis longtemps soutenue par lui, « qu’une Eglise nationale pouvait réunir des personnes professant des articles de foi différents 1 ». Newman, par contre, ne tarissait pas, dans ses lettres, sur ce qu’il appelait « cette atroce affaire de l’évêché de Jérusalem». « Je suis persuadé, écrivait-il, que cette mesure aura plus
1. Lettre du 21 septembre 1841. (Life of Th. Arnold, t. II.)
224
fait pour nous ôter le caractère d’une Eglise, to unchurch us, que tous les événements qui se sont produits depuis trois cents ans. » Si désireux qu’il fût de rester à l’écart, il crut de son devoir d’adresser à son évêque, une protestation solennelle contre cette compromission avec l’hérésie qui « privait son Eglise du droit d’être considérée comme une branche de l’Eglise universelle » et lui enlevait ainsi tout titre à « l’allégeance des catholiques ».
VI
La crise, de jour en jour plus grave, que traversait le Mouvement tractarien, était faite pour fixer l’attention des catholiques clairvoyants, de celui surtout qui, dès le premier jour, en avait eu, presque seul entre tous ses coreligionnaires, l’intelligence sympathique. Wiseman se trouvait précisément, depuis quelque temps, en mesure d’observer les événements de plus près et d’y intervenir plus efficacement. En 1840, par suite d’une décision pontificale ayant porté de quatre à huit le nombre des vicaires apostoliques en Angleterre, il avait été nommé, avec le titre d’évêque de Melopotamus, coadjuteur du vicaire apostolique du district central de l’Angleterre et président du collège d’Oscott, près de Birmingham. « Bénissez, ô Seigneur, s’était-il écrié en mettant le pied sur le sol anglais, bénissez mon entrée dans cette terre de mes désirs 1» Tout le
1. Life and Times of Card. Wiseman, par Wilfrid Ward, t. 1er , p.341.
225
préparait au rôle qu’il allait avoir à remplir, le prestige d’une réputation devenue européenne, ses relations étendues, son esprit ouvert, généreux et brillant, le point de vue élevé d’où il avait observé jusqu’alors le problème religieux dans les pays étrangers comme dans sa patrie. Il avait tout de suite manifesté son intention de ne pas s’absorber dans la direction scolaire d’Oscott et de porter ses regards au dehors, surtout vers Oxford. «Non, se disait-il en se promenant devant son collège, ces bâtiments n’ont pas été élevés pour faire l’éducation de quelques jeunes garçons, mais pour être le centre de ralliement du mouvement vers l’Eglise catholique, mouvement encore silencieux, mais vaste, qui a commencé et qui doit aboutir 1. » Vivement intéressé par le tract 90 et par les polémiques qui suivirent, Wiseman jugea qu’il convenait aux catholiques d’y prendre position. Il le fit par une lettre adressée à Newman; avec beaucoup d’égards et de marques de sympathie, il y protestait contre la distinction que ce tract prétendait établir entre la doctrine officielle de l’Eglise romaine et certaines corruptions tolérées par elle. Newman laissa à Palmer le soin de répondre. En même temps, Wiseman cherchait, par l’entremise de deux récents convertis, M. Lisle Phillips et l’architecte Pugin, à entrer en relations avec les tractarians romanisants, Ward, Oakeley, Bloxam; il ne désespérait pas d’atteindre Newman lui-même. Il écrivait à M. Phillips des lettres destinées à être montrées à Oxford, où il s’efforçait
1. Life and Times of Card. Wiseman, t. I, p. 348.
226
d’éclaircir les malentendus, de désarmer les préventions; ainsi tâchait-il de s’expliquer sur l’alliance des catholiques avec O’Connell; ainsi encore disait-il à l’adresse des tractarians qui conseillaient aux catholiques romains de commencer par se réformer eux-même à : « Notre réforme est entre vos mains... Puissions-nous compter parmi nous un nombre, si petit qu’il soit, d’hommes tels que ceux qui écrivent les tracts! Que quelques-uns seulement de ces hommes, avec le haut caractère ecclésiastique que je crois qu’ils possèdent, entrent pleinement dans l’esprit de la religion catholique, et nous serons bientôt réformés et l’Angleterre vite convertie. Je suis prêt à reconnaître qu’en toutes choses, sauf le bonheur de posséder la vérité et d’être en communion avec la vraie Eglise de Dieu, nous sommes leurs inférieurs. Ce n’est pas à vous que je dis cela pour la première fois. J’ai dit, depuis longtemps, à ceux qui m’entourent, que si les théologiens d’Oxford entraient dans l’Eglise nous devrions être prêts à retomber dans l’ombre et à passer au second 1. » Avec quelle anxiété Wiseman attendait le résultat de ses démarches! Grande était sa joie, quand il recevait, à Oscott, la visite de quelques-uns des jeunes tractarians. Grande, au contraire, sa tristesse, quand une lettre, directement adressée à Newman, recevait une réponse qu’il qualifiait de distressing 2, Ainsi passait-il par des alternatives d’espérance et de découragement, poussé par l’ardeur généreuse et un peu
1. Life and Times of Card. Wiseman, t. I, p. 384 à 386, 2 Ibid., t. Ier, p. 392.
227
impatiente de sa nature, à se mettre en avant, assez clairvoyant cependant pour se rendre compte qu’à trop se montrer il risquait d’effaroucher et de compromettre ceux qu’il voulait gagner, d’autant plus ému qu’il sentait que les événements se passaient en un monde où il avait peine à atteindre, mais comprenant qu’à défaut de son action personnelle une force mystérieuse agissait sûrement et puissamment au plus intime des âmes. « Ce qui apparaît à la surface, écrivait-il, n’est rien à côté du travail qui se fait au fond. Les tractarians deviennent de jour en jour plus dégoûtés de l’anglicanisme, de sa stérilité, de son défaut de solidité, de son enseignement bégayant... Ils s’avancent d’un pas si constant, si régulier, qu’il doit forcément en résulter ou qu’ils amèneront et pousseront leur Eglise avec eux ou qu’ils la laisseront derrière eux 1.» Les difficultés auxquelles se heurtait Wiseman n’étaient pas toutes du côté des anglicans. La plupart des catholiques anglais, sous l’empire de méfiances et de ressentiments séculaires, ne parvenaient toujours pas à comprendre qu’il pût leur venir quelque chose de bon de leurs anciens persécuteurs. Les espérances de Wiseman leur paraissaient chimériques, ses démarches compromettantes. On ne pensait pas autrement, même tout près de lui, à Oscott. Ses meilleurs amis croyaient devoir lui crier gare, tel l’historien Lingard qui lui rappelait quelle avait été, du temps de Land, la déception de ceux qui s’étaient laissés gagner à une semblable espérance. D’autres ne se gênaient pas pour le blâmer
1. Life and Times of Card. Wiseman, t. Ier, p. 387, 388.
228
et le dénonçaient à Rome. Ces sentiments dominaient dans les journaux catholiques. Dans une brochure intitulée : Les Puseyistes sont-ils sincères ? un prêtre déclarait que le baiser de Newman était une trahison. Wiseman déplorait une attitude qui semblait faite pour empêcher tout rapprochement. Dans ses lettres, dans ses conversations, il ne se lassait pas d’affirmer, à l’encontre des doutes et des méfiances de ses coreligionnaires, la sincérité, la pureté d’intention, la hauteur de vertus de Newman et de ses amis. Conformément à ses habitudes, Wiseman estima que le meilleur moyen de faire face aux difficultés qu’il rencontrait, aussi bien chez les anglicans que chez les catholiques, était de s’en expliquer publiquement. En septembre 1841, sous forme de lettre au comte de Shrewsbury, catholique notable, il fait paraître une brochure où il examine les diverses questions soulevées par la crise religieuse de l’Angleterre. Il s’y défend contre ceux qui le traitent de « visionnaire », parce qu’il attache de l’importance au mouvement de rapprochement qui s’est produit chez les « théologiens d’Oxford»; il s’autorise de l’exemple de Bossuet qui avait « regardé comme un devoir d’entamer avec Leibnitz une discussion sérieuse sur la possibilité de réunir l’Allemagne à l’Eglise romaine ». Il insiste sur tous les faits qui témoignent que non seulement les individus se rapprochent des doctrines et des pratiques catholiques, mais qu’il y a tendance vers « l’union en corps» A ceux qui prétendent que c’est une manoeuvre intéressée, que les anglicans « désirent prendre aux catho-
229
liques assez pour affermir leur Eglise, sans avoir l’idée d’aller plus avant », il répond que « ce soupçon est injuste et repose sur l’ignorance du caractère et des vrais sentiments de ces écrivains ». A l’appui, il fait de longues citations de Newman et de Ward. Il y constate à quel point ces esprits sont mécontents du système de l’Eglise anglicane; ce n’est pas un blâme sur tel point, « c’est, dit-il, un dégoût absolu de tout; c’est l’accablement du bûcheron chargé de ramée celui-ci ne se plaint en particulier d’aucune des branches qui composent son fardeau, c’est le faix entier qui le fatigue et l’accable. » Puis, après avoir mis ainsi en lumière cette attitude toute nouvelle des anglicans, Wiseman ajoute:
Je n’ai pas besoin de vous demander avec quels sentiments nous devons les accueillir; n’est-ce pas avec ceux de la sympathie et de la charité, avec les efforts d’une cordiale coopération? Quoi ! tandis que de semblables regrets sont exprimés autour de nous, resterons-nous froidement assis, au lieu de nous lever, en criant à nos frères désolés: Ayez bon espoir! Assis dans les splendeurs de la lumière, pourrions-nous les voir essayant de s’ouvrir, en tâtonnant, un chemin vers nous, à travers la nuit qui les entoure, trébuchant faute d’une main amie qui les soutienne, ou s’écartant du sentier faute d’une voix qui les dirige, et rester tranquilles, muets, prenant un cruel plaisir au spectacle de leurs pénibles efforts, ou, de temps en temps peut-être, insultant à leur détresse, en laissant arriver jusqu’à eux l’insolence d’un ricanement à demi étouffé? A Dieu ne plaise! Si nous devons nous tromper, si nous devons faire un faux pas, la chute sera plus comme de en tombant du côté de deux vertus théologales que sur le froid terrain de
230
la prudence humaine. Si j’ai eu trop de confiance dans mes motifs d’espérer et trop de charité dans mes manières d’agir, j’accepte le danger de voir sourire de ma simplicité et sur la terre et dans le ciel. Là-haut, du moins, il n’y aura point de dédain dans les sourires.
Wiseman tâche de toucher d’une main légère aux pratiques catholiques qui éveillent des préventions chez les anglicans; il évite de désavouer ses propres coreligionnaires, mais se garde de laisser croire que toute réforme est impossible. Il insiste sur la nécessité, pour les catholiques, de devenir meilleurs et surtout d’être charitables. « La dureté, dit-il, le sarcasme, l’aigreur ne contenteront jamais les intelligences et ne gagneront pas les coeurs. » Sans doute, il ne se fait pas illusion sur les difficultés que l’on rencontrera:
Le chemin, dit-il, est plein d’ennuis et de fatigues. La terre promise se trouve de l’autre côté du désert. Dans le désert, nous rencontrerons de durs rochers et des plaines de sable, également difficiles à traverser, pour des causes différentes. Il faudra de l’énergie pour les uns, une persévérance infatigable pour les autres... Il y aura de vastes solitudes sans eau, des sources amères, des découragements, des murmures et des infidélités. Les tables seront plus d’une fois jetées à terre et brisées, puis écrites de nouveau. Enfin on pourra mourir sur le Nébo, tout en regardant avec de tendres regrets la terre où surabondent le lait et le miel, sans espoir d’y entrer. Grâce à. Dieu, ni la manne ne nous manquera, ni l’espérance, ni la confiance dans le Seigneur d’Israël.
Pour Newman et ses amis, il y aurait eu certes plus d’une réflexion à faire sur le contraste entre le ton
231
dont parlait d’eux cet évêque catholique et le langage qu’à cette même époque leur tenaient leurs propres évêques. On ne saurait dire, cependant, que cette publication ait, sur le moment, exercé grande action sur la conduite des tractarians, Elle n’en honorait pas moins son auteur, dégageait sa cause des voies étroites et périlleuses où d’autres tendaient à la fourvoyer; elle traçait un programme et donnait une leçon dont, encore aujourd’hui, les catholiques d’Angleterre ne peuvent mieux faire que de s’inspirer.
VII
Newman avait été surpris et profondément blessé des censures épiscopales. Beaucoup d’écrivains anglicans ont cru trouver là l’explication de son changement d’Eglise. Si l’on veut dire que ce changement a été l’effet d’une sorte de ressentiment personnel, ce n’est pas exact, et Newman a pu écrire, au moment de sa conversion, « qu’il n’avait conscience d’aucun ressentiment» Mais il est très vrai que sa confiance dans l’Eglise d’Angleterre a été grandement ébranlée par l’attitude de ses évêques. «Ah! Pusey, disait-il peu après à son ami, nous nous sommes appuyés sur les évêques, et ils se sont effondrés sous nous, they have broken down under us 1 ». Par le tract 90, il avait voulu éprouver si son Eglise pouvait porter la charge de vérité catholique qu’il jugeait indispensable à la véritable Eglise du Christ. Les chefs autorisés de cette Eglise
1. Life of Pusey, t. II, p. 237.
232
répondaient qu’elle ne le pouvait ni ne le voulait, et, en même temps, par la constitution de l’évêché de Jérusalem, ils déclaraient vouloir être en communion avec les hérétiques. Malgré tout, Newman se refuse encore à condamner définitivement l’Eglise qu’il a si longtemps regardée comme sa mère. Il reprend péniblement, sur des bases devenues plus étroites, le travail auquel il s’épuise, depuis des années, pour établir les titres de l’anglicanisme. Sur les ruines et avec les fragments brisés de ses premiers systèmes, il essaye d’élever un édifice plus humble, mais qui paraisse habitable. Obligé de confesser que la situation de son Eglise est « anormale », il tâche de se persuader qu’elle n’est pas illégitime, et qu’on peut, qu’on doit lui rester fidèle. Il n’admet pas surtout l’idée d’une conversion individuelle à l’Eglise romaine dont il persiste à dénoncer les « abus » et les « corruptions» Son devoir lui semble être d’user de son autorité sur ses disciples pour les détourner d’une telle conversion. Sa correspondance nous le montre très occupé de cette préservation 1. C’est à lui que Pusey s’adresse pour retenir ses amis tentés d’aller à Rome 2. Son intervention est généralement efficace. A cette époque, un seul lui échappe, et encore n’est-il pas de ses intimes c’est un certain Sibthorpe, fellow de Magdalen, qui, étant allé, vers la fin d’octobre 1841, faire visite à Oscott, sans arrière-pensée d’abjuration, en revient, quelques jours après, au grand
1. Lett. and Corr. of J.-H. Newman, t. II, p. 346, 348, etc. 2. Life of Pusey, t. II, p. 229.
233
étonnement de tous, catholique romain ; conversion hâtive et peu réfléchie, car, deux ans après, il devait retourner à l’anglicanisme l. Newman, très mécontent de cette défection, en parle sévèrement et s’inquiète de mettre les siens en garde contre un exemple qu’il juge funeste. Il ne lui suffit pas de le faire dans ses lettres privées; il se détermine à aborder le sujet en chaire, et, en décembre 1841, dans une suite de quatre sermons, il tâche de démontrer qu’en dépit de ses faiblesses l’Eglise anglicane a encore des titres suffisants a la fidélité de ses enfants Dans cette vue, il imagine une théorie nouvelle, celle de Samarie. Si malheureusement séparée que soit son Eglise, il estime qu’elle ne peut être comme si elle n’avait jamais été une Eglise; «elle est, dit-il, Samarie. » Il rappelle alors comment, en dépit de leur schisme manifeste, les tribus rebelles du royaume d’Israël avaient continue a être traitées en peuple du Seigneur, comment Dieu leur avait envoyé les prophètes Elie et Elisée, comment, au moment ou tant de miracles s’étaient opérés devant elles, ni la foule sur le mont Carmel, ni la Sulamite et sa maison n’avaient reçu l’ordre de se séparer de leur peuple, de se réconcilier avec la race de David et de se rendre à Jérusalem pour adorer; comment, en un mot, les sujets d’Israël, sans être dans l’Eglise, avaient cependant gardé les moyens de salut. Or, plus encore que Samarie, l’Eglise angli-
1. Sibthorpe reviendra une seconde fois au catholicisme, en 1864, et mourra dans cette communion, en 1819. (Life of Bishop Wilberforce. t. Ier, p. 202.)
234
cane lui paraît posséder les marques d’une présence et d’une vie divine; il déclare le constater tous les jours, dans la réception des sacrements et particulièrement au lit des mourants 1. Il en conclut que cette Eglise, elle aussi, est dans l’alliance, ou qu’elle jouit, en dehors de l’alliance, de grâces extraordinaires. Par suite, dût-on admettre qu’elle n’est pas une portion de l’Eglise une, on n’est pas plus tenu de la quitter pour Rome, que le sujet d’Israël n’était tenu de quitter Samarie pour Jérusalem. Les paroles qui terminent ces sermons trahissent l’angoisse avec laquelle le prédicateur tâche de faire accepter aux autres, et aussi à lui-même, ce dernier essai de justification de son Eglise. « De quoi avons-nous besoin, s’écrie-t-il, si ce n’est de foi dans notre Eglise? Avec la foi, nous pouvons tout; sans la foi, nous ne pouvons rien. Si nous avons à son égard de secrètes défiances, tout est perdu; nous perdons notre nerf, nos pouvoirs, notre position, notre espérance. Un froid découragement, un malaise de l’esprit, une humeur mesquine et chagrine, la lâcheté et la nonchalance nous enveloppent, nous pénètrent, nous oppressent. Qu’il n’en soit pas ainsi pour nous! Ayons bon courage. Acceptons cette Eglise comme le don de Dieu et notre part. Imitons
1. C’est une idée sur laquelle Newman, à cette époque, revenait avec persistance. Ainsi écrivait-il à son jeune ami Wood « S’il n’est pas présomptueux de le dire, la présence intime du Christ en nous, par les sacrements, m’apparaît bien plus nettement. telle qu’elle nous est promise, au moment où les signes extérieurs de cette présence me sont retirés. Et je me résigne à demeurer avec Moïse dans le désert, ou avec Elie excommunié du temple. »
235
celui qui, sur le bord du Jourdain, prit le manteau qu’Elie avait laissé tomber sur lui, frappa les eaux et dit Où est le Seigneur, Dieu d’Elie? Cette Eglise est comme le manteau d’Elie, une relique de celui qui a été emporté là-haut. » Newman, sans doute, ne se dissimulait pas qu’en comparant ainsi Rome à Jérusalem et l’Eglise d’Angleterre à Samarie il « abaissait le niveau de son Eglise et affaiblissait la base de sa controverse». Mais il n’avait pas conscience de pouvoir mieux faire : c’était comme un dernier retranchement, élevé un peu à la hâte, pour essayer de prolonger la résistance. Cette conviction que le devoir de tout anglican est de rester dans son Eglise, Newman se fait un point d’honneur de l’affirmer plus hautement encore aux quelques catholiques avec lesquels les circonstances le mettent en correspondance. Il cherche visiblement à décourager, de ce côté, des espérances qu’il voit grandir et qui le troublent. « Que mes sympathies pour la religion de Rome, écrit-il à l’un de ces catholiques, se soient accrues, je ne le nie point; mais que mes raisons pour fuir sa communion se soient diminuées ou modifiées, ceci serait probablement plus difficile à prouver. Or je désire prendre pour guide la raison, non le sentiment. » Il ajoute, un autre jour: « Je vais vous affliger, je le crains, en vous disant que vous regardez le chemin que nous avons fait vers vous, sur le terrain de la doctrine, comme plus considérable qu’il ne l’est en réalité.» Il consent à envisager la possibilité d’une union entre les Eglises, mais pour plus. tard. Tant que
236
Rome ne se réforme pas, cette union lui paraît impossible. « Beaucoup parmi vous, écrit-il toujours à un de ses correspondants catholiques, disent que nous sommes vos plus grands ennemis; nous l’avons dit nous-mêmes; nous le sommes, nous le serons, tant que les choses resteront dans l’état actuel. » En attendant, il déclare « ne pouvoir souffrir l’idée que les siens passent individuellement à l’Eglise romaine». « Nous avons, ajoute-t-il, trop en horreur le principe du jugement privé, pour nous y confier dans une question aussi grave. » Et dans une autre lettre: « Je sais qu’il est tout à fait dans l’ordre des possibilités que tel ou tel des nôtres vienne à passer à votre communion: toutefois, ce serait pour vous un grand malheur, bien plus encore qu’un chagrin pour nous. Si vos amis veulent mettre un abîme entre eux et nous, qu’ils fassent des conversions ! ». On sent que Newman se raidit quand il a affaire à des catholiques, surtout à des prêtres. C’est bien le même homme qui, l’année précédente, avait si mal reçu Spencer. Cette raideur devient plus marquée encore, s’il croit entrevoir quelque dessein d’intervenir dans la crise intime de sa conscience. Wiseman en fait l’épreuve, le jour où il se risque à lui écrire directement. « Je ne pouvais souffrir, a rapporté Newman après sa conversion, que des catholiques charitables vinssent se mêler de nos questions d’Oxford, et je les repoussais durement quand ils tentaient de me faire du bien à moi personnellement. En vérité, il n’y avait rien, dans le moment, de plus propre à me rejeter en arrière. De quoi vous mêlez-vous, avais-je envie de leur dire, ne pouvez-vous
237
me laisser en repos? Vous ne pouvez me faire aucun bien; de moi, vous ne savez rien au monde; vous pouvez positivement me faire du mal; je suis en des mains meilleures que les vôtres. » Des prêtres catholiques alors en relations avec Newman, un seul trouve le chemin de son coeur : c’est le Dr Russell qui sera plus tard président du séminaire de Maynooth. Affable, discret, sobre de controverse, il évite de lui parler des questions en discussion, le laisse à ses propres réflexions et se borne à lui envoyer quelques livres pouvant l’éclairer sur les prétendus abus reprochés à Rome. Newman a dit de lui, dans son Apologia: « Il a eu peut-être plus de part que tout autre à ma conversion. 1 » Si ferme, si raide même qu’il affecte d’être quand il fait front à ceux qu’il regarde encore comme l’ennemi, Newman est loin de l’être toujours autant, une fois en face de soi et livré à ses propres pensées. Il ne peut pas s’empêcher de se demander si, après tout, ses arguments sont bien solides et si Rome n’a pas raison. Il a raconté depuis comment, au cours de l’été de 1841, le doute de 1839 était revenu; comment « le fantôme lui était apparu une seconde fois »; comment, en étudiant les ariens, il avait eu, tout à coup, la même illumination qui s’était produite, deux ans auparavant, à propos des monophysites; comment il avait vu clairement « que les ariens purs étaient les protestants, que les semi-ariens étaient les anglicans, et que Rome
1. Lettres des 8 et 26 avril, du 5 mai, du 18 juin, du 12 septembre 1841. (Apologia.)
238
était toujours la même». Cette lueur, à la vérité, n’a pas été plus durable qu’en 1839; cette fois encore, Samuel n’a pas reconnu la voix de Dieu; mais son trouble, son anxiété en ont été augmentés. Parfois ils se trahissent dans l’entraînement d’une conversation ou d’une correspondance intime. Ainsi, un soir, causant avec son curate, Isaac Williams, se laisse-t-il aller à dire, au grand scandale de ce dernier, « que l’Eglise d’Angleterre a tort et que le devoir est de se joindre à Rome 1». Un autre jour, c’est à Robert Wilberforce qu’il confie « le soupçon que sa foi dans l’anglicanisme pourrait bien finir par se briser et que peut-être ils se trouvent tous deux hors de l’Eglise». «Aucune communication, lui répond Wilberforce, ne m’a jamais bouleversé comme l’a fait votre lettre de ce matin 2 » D’ordinaire il se refuse à rien dire qui engage l’avenir. Tout en se défendant, par les motifs indiqués plus haut, de songer, pour le moment, à quitter son Eglise, il ne veut plus répéter ce qu’il aimait naguère à dire: «Anglican je suis né, anglican je veux mourir.» A propos d’un ami qui lui demandait une assurance de ce genre, il écrit, le 23 décembre 1841 : «M. et ses pareils ne peuvent-ils comprendre qu’il n’est ni sage, ni juste, ni patient, de demander à d’autres : Que ferez-vous dans telles circonstances? quand ces circonstances ne se sont pas présentées, quand elles peuvent ne se présenter jamais ?… Je parle en toute sincérité, lorsque je dis qu’il y a des choses auxquelles je ne songe pas et ne veux pas
1. Autobiography of Isaac Williams, p. 440. 2. Apologia.
239
songer ; mais, si l’on vient dix fois m’interroger sur ces choses, je commence enfin à y songer... Notre marche la plus sûre n’est-elle pas de faire simplement, jour par jour, ce que nous croyons juste, sans nous inquiéter des conséquences 1 ?» A son ami Hope, il écrit, le 17 octobre 1841 : « Je vous avouerai que les mandements des évêques (sur le tract 90) sont chose fort grave... Je ne puis nier qu’il se fait une grande et inquiétante épreuve pour voir si notre Eglise est ou n’est pas catholique. L’issue peut ne pas se produire de notre vivant. Mais je dois dire nettement que, si cela doit aboutir an protestantisme, je jugerai de mon devoir, si je vis, de m’en séparer... Je crains d’être obligé de dire que je commence à croire que le seul moyen de garder l’Eglise d’Angleterre est d’envisager ouvertement la possibilité de la quitter et d’agir en conséquence 2. » Plus tard, après sa conversion, quand il pouvait se rendre compte, mieux qu’il ne l’avait fait surie moment, des crises par lesquelles il avait passé, Newman écrivait: « A dater de la fin de 1841, je fus sur mon lit de mort, en tant que membre de l’Eglise d’Angleterre. »
VIII
L’anxiété de Newman ne pouvait qu’être aggravée par les divisions croissantes qu’il voyait éclater entre ses amis. Il a écrit le tract 90 pour retenir les ardents
1. Apologia. 2. Lett. and Corr. of J.-H. Newman, t. II, p. 355, 356.
240
et leur rendre l’anglicanisme habitable. La condamnation du tract produit naturellement l’effet contraire. Ces ardents, loin d’être retenus, sont poussés du côté où ils penchaient déjà. La faiblesse de l’anglicanisme leur paraît plus manifeste, et ils sentent davantage la supériorité du catholicisme romain. Ward et Oakeley, dans le British Critic, devenu leur organe, attaquent violemment la Réforme, insistent sur ce qui manque à leur Eglise et établissent, entre elle et l’Eglise de Rome, une comparaison qui se termine toujours à l’avantage de la dernière. Pas plus que Newman, ils ne concluent à changer de communion, mais leur langage n’en est pas moins assez menaçant. « Nous ne pouvons, écrit Oakeley, rester où nous sommes. Nous devons aller en arrière ou en avant, et ce sera sûrement ce dernier parti que nous prendrons.» Ward développe les mêmes idées, avec moins de ménagements encore, dans les conversations si bruyantes, si provocantes et, en même temps, de si belle humeur, dont il fait retentir tous les échos des common rooms. En même temps, Ward et ses amis sont en correspondance affectueuse et en relations de visite avec des convertis catholiques, porte-parole de Mgr Wiseman, l’architecte Pu gin et M. Phillips; ils confèrent avec eux sur les moyens de préparer la réunion des deux Eglises; ils se rendent, à plusieurs reprises, pendant le cours de 1841, à Oscott, s’y entretiennent avec Mgr Wiseman, visitent, à peu de distance de là, le monastère cistercien de la Grâce-Dieu, assistent aux offices et reviennent charmés des hommes et des
241
choses 1. Ce n’est pas seulement par ces démarches privées qu’ils fraternisent avec les papistes. Le 13 avril 1841, l’Univers de Paris publie une longue lettre, aussitôt reproduite et commentée par tous les journaux catholiques d’Europe, dont l’auteur, demeuré anonyme, dit être un jeune membre de l’Université d’Oxford : la lettre a été en effet écrite par Ward avec -l’assistance de Dalgairns. Elle commence par noter les signes qui, à Oxford notamment, paraissent annoncer la réunion de l’Eglise anglicane à l’Eglise catholique; puis, rappelant les déclarations, les aveux du tract 90, elle ajoute : « Vous voyez que l’humilité, première condition de toute réforme saine, ne nous manque pas. Nous sommes peu satisfaits de notre position; nous gémissons des péchés que commirent nos ancêtres, en se séparant du monde catholique; nous éprouvons un désir brûlant de nous réunir a nos frères, nous aimons d’un amour sans feinte le Siège apostolique que nous reconnaissons être le chef de la chrétienté... Nous reconnaissons encore que ce ne sont pas nos formulaires, ni même le concile de Trente, qui nous empêchent de nous y réunir. » La réunion qu’a en vue l’auteur de la lettre, c’est seulement la réunion eu corps. Il engage les catholiques à ne plus songer aux conversions particulières et à employer plutôt leurs efforts à se réformer eux-mêmes. «Qu’ils nous présentent, dit-il, ce que nous n’avons pas parmi nous, l’image d’une Eglise parfaite
1. Sur ces relations, voy. les deux ouvrages de Wilfrid Ward, W.-G. Ward and the Oxford Movement, p. 190 à 201, et Life and Times of Card. Wiseman, t. 1, p. 371, 372, 381 à 389, 395 à 397.
242
en discipline et en moeurs...; enfin qu’il se trouve, parmi eux, un saint tel que le Séraphin d’Assise, et le coeur de l’Angleterre est déjà gagné. » Il termine, en demandant des prières : « Sachez que, plusieurs d’entre nous tendent les mains, nuit et jour, vers le Seigneur et lui demandent, avec sanglots, de les réunir à leurs frères catholiques. Français! ne manquez pas de nous assister en ce saint exercice, et je suis persuadé qu’il ne se passera pas beaucoup de carêmes, avant que nous chantions ensemble nos hymnes pascales, dans ces accents sublimes dont s’est servi, pendant tant de siècles, l’Epouse divine du Christ. » Aussitôt qu’elle est connue en Angleterre, cette lettre y fait scandale. Les susceptibilités britanniques sont particulièrement blessées de voir prendre les catholiques étrangers pour confidents de l’aveu de détresse, de la confession humiliée et pénitente que l’auteur de la lettre prétend faire au nom de l’Eglise d’Angleterre. Plus les ardents se compromettent dans le sens catholique, plus ils se trouvent séparés de la fraction modérée des tractarians. Pusey s’en alarme et fait effort pour ramener ceux qu’il voit ainsi s’éloigner. Il demande des explications et adresse des représentations à Ward. Celui-ci révère sincèrement Pusey, mais il lui répond en homme qui ne s’embarrasse pas beaucoup d’être désapprouvé par lui. Loin de contester le désaccord, il déclare avoir parlé précisément pour qu’on ne juge pas des idées de Newman par l’interprétation qu’en eût pu donner Pusey. Loin de se défendre des opinions qu’on lui reproche, il s’en honore, confirme son
243
dégoût des misères de l’anglicanisme, son admiration pour Rome, son désir de lui être uni. Il répète, sans doute, qu’il ne songe pas à une conversion individuelle, mais, quand Pusey lui fait demander « une assurance formelle qu’il ne se joindra pas à l’Eglise romaine », il s’y refuse. A l’entendre, beaucoup sont, comme lui, à ce point convaincus «des corruptions et des défauts de l’Eglise anglicane, que, n’était leur confiance en Newman, ils ne pourraient croire qu’elle fût une véritable Eglise». Il affirme du reste être en conformité avec les vues de Newman, telles que celui-ci les a exposées, soit spontanément, soit en réponse aux questions qu’il lui a posées. Il ajoute être prêt à abandonner toute opinion qu’il saurait n’être pas admise par lui 1. L’accueil que Ward a fait à ses observations n’est pas pour rassurer Pusey. Tous ceux qui l’approchent remarquent à. quel point il est, chaque jour, plus préoccupé, plus triste. Un dimanche, sa mère le trouve tout en pleurs 2. Il sent d’ailleurs que les soupçons de romanisme s’étendent à tout le parti du Mouvement et ne l’épargnent pas lui-même. Pendant les vacances de 1841, il fait une tournée en Irlande pour y étudier sur place la vie monastique qu’il désirait introduire dans son Eglise; il suffit de ce déplacement pour donner occasion d’insinuer que lui aussi se dispose à trahir, et ses amis, inquiets, sollicitent de lui des lettres de démenti qu’ils puissent faire circuler. Rendons cette justice à l’honnête Pusey qu’il ne cherche pas à rentrer
1. W.-G. Ward and the Oxford Movement, ch. VIII, passim. 2. Life of Pusey, t. II, p. 247.
244
personnellement en grâce, en répudiant des amis devenus compromettants. Ce n’est pas seulement son cher Newman dont il prend la défense et dont il se porte caution auprès des high-churchmen qui le critiquent 1. Ce sont les ardents eux-mêmes, — ceux qui avaient si peu d’égard à ses représentations, — qu’il tâche de couvrir dans une lettre publique, adressée, en février 1842, à l’archevêque de Canterbury. Cette lettre est d’un accent plus ému, plus vibrant que n’étaient d’ordinaire ses écrits. La thèse qu’il y soutient est que, par leurs censures, les évêques créent précisément ou, en tous cas, aggravent le mal dont ils se plaignent :
On a troublé, dit-il, la paix des plus humbles villages. Chacun se croit menacé de je ne sais quel grand danger. On a raconté que nous sommes tous sur le point de devenir papistes. C’est préparer les gens à quitter notre Eglise. On enseigne à d’autres à se défier des ministres qui ont travaillé fidèlement, parmi eux, pendant des années. Les négligents se croient justifiés par le cri populaire. Les bien intentionnés se tiennent à l’écart, tristes et perplexes... Si cela continue, mylord, quelle sera la fin? Si nos propres évêques et d’autres encouragés par eux nous disent (quelque douloureux que ce soit à répéter, ce sont leurs propres paroles): « Retire-toi, Satan », tandis que ceux de la communion romaine prient pour nous et nous invitent, n’est-ce pas gravement augmenter les tentations, je ne dis pas de nous, mais d’hommes plus jeunes? Si nous sommes ainsi mis à part du reste du troupeau de Notre-Seigneur, comme des brebis malades et gâtées qui pourraient, si on ne les séparait des autres, les corrompre; si une marque
1 Voy., par exemple, une lettre de Pusey au Rev. Churton. (Life of Pusey., II, p. 269.)
245
est mise sur nous et si nous sommes désavoués, une telle situation ne peut durer. Pour nous qui sommes plus vieux, il peut être facile de nous retirer de ce débat pénible, pour rentrer, si cela était jamais nécessaire, dans la communion laïque ou chercher une autre branche de notre Eglise qui nous recevrait; mais, pour les jeunes dont les sentiments ne sont pas liés à leur Eglise par les habitudes et les miséricordes de beaucoup d’années et pour lesquels travailler à son service n’est pas une seconde nature, un élément de leur existence, leurs sympathies s’évanouiraient, et, s’ils se voient renvoyés de leur Eglise, ils se diront qu’ils doivent appartenir à une Eglise, et ils iront à Rome. Parmi ceux dans l’esprit desquels de sérieux doutes se sont élevés, il n’y a pas seulement ceux qu’on appelle généralement les jeunes gens; il y en a, on peut le dire, qui sont la fleur de l’Eglise d’Angleterre, des personnes que le sentiment du devoir lie à elle, qui voudraient, pour employer le langage de l’un d’eux, « sentir qu’il est de leur devoir de demeurer en elle le plus longtemps possible» Ce que nous craignons, ce n’est pas une ébullition passagère, mais plutôt que la pensée de se séparer de notre Eglise ne devienne graduellement familière à la pensée des gens;... c’est qu’un profond découragement sur nous-mêmes et notre Eglise ne s’empare des esprits, et qu ils ne l’abandonnent, en pensant que son cas est désespéré...
L’adjuration émue de Pusey ne change rien à l’attitude de l’épiscopat. L’évêque de Londres a probablement dessein de lui répondre, quand il dit, dans son mandement de 1842, que « l’apostasie de quelques fidèles, et même de beaucoup, serait un moindre mal que d’admettre qu’un membre de l’Eglise anglicane pût légitimement professer les erreurs romaines 1».
1. Memoir of bishop Blomfield, t. II, p. 30.
246
Pusey est-il plus heureux dans l’appel qu’il adresse en même temps à Newman? Il se rend compte que nul ne pourrait avoir plus d’autorité sur les ardents, et il se refuse à croire que ceux-ci soient aussi fondés qu’ils le prétendent, à se couvrir de son approbation. Esprit peu chercheur, peu inquiet, volontiers immobile et comme figé dans la sereine tranquillité de ses affections et de ses préjugés anglicans, habitué à vivre sur soi, absorbé par ses études, ne lisant rien en dehors, ne se mêlant pas aux libres conversations de la jeunesse universitaire, il n’est que très imparfaitement au courant du travail qui s’est fait dans l’esprit de Newman. Il se tourne donc vers lui et lui tient à peu près ce langage : «Voici ce que prétendent Ward et ses amis. Est-il donc vrai que vous les approuviez? Si, comme je l’espère, il n’en est rien, intervenez pour les arrêter, car ils sont en train de perdre le Mouvement 1. » C’est mettre Newman à une difficile et pénible épreuve. Entre les amis qui se disputent son adhésion, pour qui se prononcer? A ne consulter que son coeur, il se rangerait du côté des modérés. Là sont ses plus vieilles, ses plus tendres, ses plus profondes amitiés. Autant il se sent en sympathie avec la nature d’un Pusey, d’un Marriott, autant celle de Ward l’offusque. Il ne peut se faire à sa prétention de tout décider par la dialectique et tient pour la maxime de saint Ambroise: Non in dialecticâ complacuit Deo salvum facere populum suum. Cette logique à outrance est l’opposé de son tour d’esprit complexe et subtil; n’a-t-on pas pu
1. Life of Pusey, t. III, p. 248 à 226.
247
dire de lui qu’il communiquait volontiers ses pensées au public, à la façon des poètes, — dont il était, — sous une forme subjective et suggestive, souvent indéterminée et incomplète, laissant le lecteur ou l’auditeur développer et conclure, sans prétendre, pour son compte, tout raisonner et analyser? Et, cependant, en dépit de ces déplaisances dont, après plusieurs années, l’Apologia porte encore la trace, il ne peut se dissimuler que Ward et ses amis sont des natures généreuses, courageuses, élevées; que, s’ils sont des disciples peu commodes, ils sont des disciples très dévoués; que, depuis qu’il est censuré, suspecté, ce sont eux qui se serrent le plus près de lui. Et surtout, à considérer non plus les personnes, mais les doctrines, il se sent poussé, par un instinct mystérieux, dans la direction où se précipitent les impatients; il a l’intuition qu’en fin de compte ils sont dans le vrai, et que la conclusion vers laquelle ils tendent est celle à laquelle doivent, tôt ou tard, aboutir les principes qu’il vient d’être forcé d’admettre. « Ce sont, dit-il, mes vieux amis que j’aime, leur ethos et leur caractère, mais j’aime les opinions de mes nouveaux amis, quoique je ne les aime pas eux-mêmes 1. » Dans cet état d’esprit, comment Newman pourrait-il donner satisfaction à Pusey? Quand celui-ci se plaint des attaques violentes de Ward et d’Oakeley contre les reformers du XVIe siècle, Newman lui répond que, sans doute, il vaut mieux, quand on n’y est pas obligé, laisser ces reformers en paix, mais que, pour son
1. Autobiography of Isaac Williams, p. 113.
248
compte, il est bien près d’en penser autant de mal, Grand étonnement de Pusey qui ne s’en doutait pas. « Vous trouverez étrange, écrit-il à Newman, que je ne connusse pas votre opinion sur les reformers, mais la préface de la secondé partie des Remains de Froude ne m’étant pas tombée sous la main, je n’avais pas eu occasion de la lire. » De même pour les autres griefs de Pusey. Newman est à la fois désireux de ne pas le laisser dans l’ignorance où il paraît être de ce que sont devenues ses opinions, et soucieux de ne pas le blesser par une lumière trop brusque et trop vive. Il se félicite d’apprendre que ses idées viennent d’être exposées complètement à Pusey par Ward, car, dit-il à Church, « rien n’est pire qu’un état d’obscurité » . «Je suis bien aise, écrit-i! à Pusey lui-même, que Ward ait pu parler ouvertement de moi avec vous. Seulement, vous ne devez pas le prendre comme un bon rapporteur sur ce qui me concerne. Chacun colore ce qu’il entend, avec son propre esprit... Sans doute, sur certains points, il sait plus que vous ce que je pense, parce qu’il m’a posé plus de questions, mais je suis- sûr que souvent il n’a pas bien compris mon sentiment exact 1.» Si, au risque d’attrister un ami aussi cher que Pusey, Newman lui laisse voir qu’il est, sur plus d’un point, en accord avec les ardents, il n’est pas décidé, pour cela, à suivre ces derniers jusqu’où ils paraissent aller. Il n’oserait pas affirmer sans doute qu’ils sont dans l’erreur; mais il n’est pas assuré qu’ils soient dans le
1 Life of Pusey, t. II, p. 218 à 227.— Lett.. and Corr. of J.-H. Newman, t. II, p. 351.
249
vrai. D’ailleurs, dût-il suivre la même direction, c’est à son propre pas qu’il entend marcher. Aussi n’est-ce pas sans impatience qu’il subit ces questions incessantes par lesquelles Ward prétend l’amener à dévoiler le dernier terme de toutes ses pensées, ce terme qu’il ne connaît pas lui-même. Son esprit est loin d’être fixé il est en travail; que ne le laisse-t-on en paix, durant ce travail? De là, en face de ces interrogations, une attitude qui peut laisser quelque équivoque dans l’esprit de ceux qui l’approchent. « Quelquefois, a-t-il rapporté lui-même plus tard, dans ce que j’écrivais, j’allais exactement jusqu’où je voyais, et il m’était aussi impossible d’en dire davantage que de voir ce qui se trouve au-dessous de l’horizon; d’où il résultait que, quand on m’interrogeait sur les conséquences de ce que j’avais dit, je n’avais point de réponse à faire. Quelquefois encore, quand on me demandait si telles conclusions ne découlaient pas de tel principe, je ne pouvais le dire sur-le-champ; et cela, par cette raison qu’il y a une grande différence entre une conclusion dans l’abstrait et une conclusion dans le concret,… Ou bien encore, il pouvait m’arriver d’être positivement dérouté par la clarté même de la logique qu’on me présentait et de donner ainsi ma sanction à des conclusions qui, en réalité, n’étaient pas les miennes; puis, quand ces conclusions m’étaient rapportées par d’autres, il me fallait les rétracter... Venir à moi avec les procédés méthodiques d’une logique abstraite était donc une sorte de provocation; et, quoique je ne pense pas l’avoir jamais montré, la provocation me donna quelque indifférence
250
quant à la manière de combattre les systèmes et me conduisit peut-être, comme moyen de soulager mon impatience, à être mystérieux ou distrait, ou même à céder parce que je ne pouvais répliquer... En disant tout ceci, je n’attaque en rien la piété et le zèle profonds qui sont les traits caractéristiques de cette seconde phase du Mouvement à laquelle j’ai pris une part si prononcée. Ce que j’ai voulu marquer, c’est que cette phase tendait à troubler mon esprit et à me bouleverser, et que, au lieu de le dire avec simplicité, ainsi que je l’aurais dû, je puis avoir, par une sorte de paresse, donné au hasard des réponses qui m’ont fait paraître dissimulé ou inconséquent 1. » Ainsi tiraillé entre des amis de plus en plus divisés, hors d’état de leur imposer une direction impérative qui n’a jamais été dans ses moyens et qui l’est moins encore depuis qu’il a conscience que ses premiers systèmes se sont effondrés sous lui, s’entendant appliquer à lui-même ce vers d’un de ses poèmes : « Tu as pu soulever un peuple, mais tu n’as pas pu le gouverner », impuissant à rassurer les uns et à éclairer les autres, craignant de blesser ceux-ci et de troubler ceux-là, ne sachant comment dire ce qu’il croit utile à ceux qui sont ébranlés et impatients, sans surprendre et peiner ceux dont la foi n’a connu aucune incertitude, se demandant si ce qui est nourriture pour l’un n’est pas poison pour l’autre », convaincu du danger de parler et de celui de se taire, plus sensible que tout autre, avec sa nature tendre, au chagrin et à la désap-
1 Apologia.
251
probation de ceux qu’il aime, soucieux surtout, jusqu’au scrupule, des âmes qui ont eu foi en lui, incertain du point exact où en sont ses propres croyances, ne sachant pas et n’osant presque pas regarder où il va, passant par des alternatives de lumière et d’obscurité, se rendant compte que toutes ces difficultés, ces anxiétés, ces tâtonnements fournissent prétexte aux accusations d’équivoque et de dissimulation, Newman sent plus lourd, plus douloureux, ce rôle de chef de parti que les événements lui ont imposé bien malgré lui. Il aspire à s’en décharger. Au lendemain de la publication du tract 90, il a commencé un mouvement de retraite, en interrompant les tracts sur la demande de son évêque. Vers la même époque, il a abandonné la direction du British Critic, mis fin aux conférences théologiques qui se tenaient chez Pusey et cessé les réunions du soir auxquelles il se plaisait à convoquer ses amis. S’il n’a pas résigné sa cure, comme il en avait eu l’idée, si, dans la dernière partie de 1841, il est monté encore plusieurs fois dans la chaire de Sainte-Marie, ses sermons se sont faits plus rares et leur accent trahit comme l’émotion d’un adieu. Au mois de février 1842, sous l’empire d’anxiétés croissantes, il se décide à faire un pas de plus vers la retraite complète: sans se démettre encore de son titre de vicar, il remet à son curate le soin d’assurer le service religieux à Sainte-Marie, renonce désormais à y prêcher, et se retire dans une dépendance rurale de sa paroisse, au petit hameau de Littlemore, situé à deux milles d’Oxford.
252
IX
Littlemore était, depuis longtemps, particulièrement cher à Newman. Plein de sollicitude pour les besoins spirituels de cette partie la plus humble et, avant lui, la plus négligée de son troupeau paroissial, il y avait construit une église, consacrée en 1836 1 et y entretenait un curate. Au plus fort de ses luttes ou de ses troubles, il éprouvait une sorte de rafraîchissement et d’apaisement à passer quelques jours et, s’il lui était possible, quelques semaines dans cette retraite. Ainsi, au commencement de 1840, peu après sa première crise de doute, avait-il saisi l’occasion du départ du desservant pour s’établir lui-même à Littlemore pendant tout le carême, se donnant à ses paroissiens paysans comme s’il n’avait nul autre souci, célébrant pieusement l’office, matin et soir, ornant avec amour la petite église aux jours de fête, occupé surtout des enfants, leur faisant le catéchisme, suppléant auprès d’eux une maîtresse d’école peu capable, leur apprenant à chanter, visiblement heureux, après tant d’émotions, de se croire un simple curé de campagne 2. En 1842, ce n’est plus un séjour de courte durée que Newman entend faire à Littlemore: il s’y installe et y transporte ce qu’il a de plus précieux, cette bibliothèque théologique et spécialement patristique, dont il écrit
1. Lett. and Corr. of J.- H. Newman, t. II, p. 401, 442. 444. 2. Ibid., t. II, p. 300 à 304.
253
alors plaisamment qu’il craint de faire « son idole 1». Quel est son dessein? Tantôt il paraît prévoir que c’est un acheminement vers une retraite plus complète et notamment vers la résignation de sa cure 2. Tantôt, au contraire, il semble avoir espoir de refaire une situation tenable à l’anglicanisme 3, et il s’imagine ne reculer momentanément que pour forger des armes nouvelles et reprendre l’offensive; c’est alors que, faisant allusion à un épisode célèbre des campagnes de Wellington en Portugal, il appelle Littlemore son Torrès Vedras 4. Le vrai est qu’il ne voit clair ni dans sa position, ni en lui-même. Dans le désarroi où l’a jeté l’effondrement de toutes les thèses auxquelles il avait cru d’abord pouvoir s’attacher, il sent le besoin de se recueillir, de réfléchir, de travailler un peu en paix, de reprendre par le fondement ses études sur les titres de l’Eglise anglicane. Il sent surtout le besoin de chercher dans la prière, dans la méditation, dans la mortification, la lumière et la grâce nécessaires pour résoudre le problème qui le trouble. Il veut se sanctifier, assuré que là du moins il ne se trompera pas. C’est la pensée qu’il exprimait, le 23 janvier 1842, dans un de ses derniers
1. Lett. and. Corr., t. II, p. 390. — C’est avec l’argent provenant du tract 90, dont la vente avait tout de suite atteint des proportions inattendues, que Newrnan avait acheté la meilleure partie de ses livres. Cette bibliothèque deviendra plus tard la bibliothèque de l’Oratoire catholique d’Ebgbaston. 2. Ibid., t. II, p. 409. 3. Newman écrit à Hope, le 22 avril 1842 : « Nous sommes tous beaucoup plus calmes et plus résignés que nous n’étions, et nous sommes remarquablement désireux de reconstruire une position et de prouver que la théorie anglaise, ou plutôt que l’état de choses anglais est tenable. » (Ibid., t. II, p. 395.) 4. Apologia.
254
sermons de Sainte Marie: « Détournons-nous, disait-il, des ombres de toutes sortes. Efforçons-nous, avec la grâce de Dieu, de faire avancer et de sanctifier l’homme intérieur. Là, nous ne pouvons avoir tort.» La retraite qu’il cherchait pour lui-même à Littlemore, Newman l’offrait à ceux de ses disciples qui passaient par la même crise que lui. Depuis qu’il était atteint par le doute, il avait absolument renoncé à faire des prosélytes; mais il se reconnaissait des devoirs envers les jeunes âmes qui avaient eu foi en lui et qui subissaient, en ce moment, le contre-coup de son propre trouble. De ces disciples, quelques-uns, d’ailleurs, étaient presque sans asile, étudiants auxquels, à raison de leurs opinions, les chefs de Collèges refusaient les certificats exigés pour les ordres, jeunes clergymen qui avaient cru ne pouvoir plus, en conscience, exercer leurs fonctions paroissiales. A tous, Newman offrait l’hospitalité apaisante et méditative de Littlemore. Les lieux se trouvaient avoir été disposés pour cette hospitalité. Depuis quelque temps, Newman, fidèle à une idée mise en avant par Froude 1, se préoccupait de restaurer le monachisme dans l’Eglise d’Angleterre. Il s’en était ouvert à ses amis, entre autres à Pusey. Celui-ci avait le même désir ; il songeait surtout à établir des couvents de religieuses, de sisters of mercy, mais il se sentait fort embarrassé de s’avancer sur un terrain qui lui était si inconnu; il était même allé étudier sur
1. Lett. and Corr., of J.-H. Newman, t.II, p. 444.
255
placé, en Irlande, les couvents catholiques 1. Newman n’avait pas un sens moins vif de ces difficultés. Toutefois, lors du séjour qu’il avait fait à Littlemore en 1840, l’idée lui était venue d’y établir le monastère de ses rêves. Un endroit aussi retiré lui paraissait plus propre qu’un grand centre, à faire sans bruit un essai qui servirait ensuite d’exemple (which might preach to others 2). Il avait donc acheté, dans ce dessein, neuf à dix acres de terrain et dressé son plan: ce plan consistait à aménager cinq à six petits cottages de paysan : un cloître devait les réunir au bâtiment un peu plus grand, renfermant la bibliothèque, l’oratoire et le réfectoire. Mais, dès l’année suivante, devant l’orage soulevé par le tract 90, il avait compris qu’il devait renoncer à son premier dessein. Il se contenta de faire une partie de l’installation matérielle, sans constituer un monastic body 3. Ce n’était donc pas dans un monastère avoué et organisé que Newman offrait l’hospitalité à ses disciples. Plusieurs furent heureux de répondre à son invitation. Un an plus tard, il écrivait: « Voilà des mois que tous nos lits sont occupés, et je pense qu’il nous faudra couper les chambres en deux 4. » La vie était austère et pauvre. Rien du confortable anglais : des cellules étroites, basses de plafond, avec des murs blanchis à la chaux. Pas de domestique dans la maison: venaient seulement, chaque jour, une femme pour la cuisine et un jeune garçon pour quelques gros ouvrages.
1. Life of Pusey, t. II, p. 10, 37 à. 40, 135 à 138, 455 2. Ibid., t. II, p. 133 à 438. 3 Ibid., t. II, p. 224 et 268. 4. Lett. and Corr. of J.-H. Newman, t. II, p. 409.
256
Abstinence presque continuelle; jeûnes fréquents et rigoureux; pendant l’avent et le carême, on voulut retarder le repas jusqu’à cinq heures du soir; sur l’avis du médecin, il fallut bientôt y renoncer. On observait exactement les fêtes et les offices de la liturgie catholique; le bréviaire était récité en commun, aux heures canoniques, dans l’oratoire. Cet oratoire, qui ne servait qu’aux exercices intérieurs de la communauté et n’excluait pas la participation aux offices publics dans l’église du hameau, n’avait pas d’autel; sur une table, entre deux chandeliers, était placé un grand crucifix d’origine espagnole. Les matines se disaient à six heures du matin; sur le conseil de Dalgairns, admirateur de la règle cistercienne, on essaya de les réciter à minuit, mais Newman jugea plus sage d’interrompre cet essai. Une seule modification était faite au bréviaire : pour se mettre en règle avec celui des XXXIX Articles qui réprouvait l’invocation des saints, au lieu de dire, en s’adressant directement au saint: Ora pro nobis, on disait, de ce saint, en s’adressant à Dieu: Oret pro nobis. La méditation et l’examen se faisaient chaque jour, la confession toutes les semaines, la communion fréquemment. En dehors des prières et des offices qui prenaient ainsi une bonne partie du temps, chacun se livrait à ses études. Le silence régnait dans la maison. La lecture était faite pendant les repas. Dans l’après-midi, promenade en commun; après le repas du soir, réunion dans la bibliothèque; grande était la joie de la communauté, quand le maître prenait part à ces récréations.
251
Si profondément que Newman cherchât à s’enfoncer et à se cacher dans cette vie de retraite et de silence, il ne parvenait pas à se faire oublier du public religieux dont les regards étaient, depuis plusieurs années, fixés sur lui. Il demeurait le centre vers lequel beaucoup d’âmes continuaient à se tourner. Une partie de son temps était occupée à répondre aux correspondants connus ou inconnus qui lui faisaient confidence de leur trouble et sollicitaient ses conseils. Si l’on ne pouvait plus aller l’entendre prêcher à Sainte-Marie, on se jetait sur ces anciens sermons, dont la publication se poursuivait, et le volume des University Sermons, paru à cette époque, avait un succès de vente qui dépassait encore celui des volumes précédents; l’auteur en était le premier surpris 1. A la vérité, l’attention dont Newman demeurait l’objet n’était pas toujours sympathique. Plusieurs regardaient avec soupçon cette retraite mystérieuse et racontaient toutes sortes d’histoires étranges sur ce qui se passait dans ce qu’on appelait communément le « monastère » de Littlemore. A côté des amis qui y venaient en visite, des adversaires rôdaient autour et tâchaient d’en surprendre les secrets. Un jour, le chef de Wadham College, le Dr Symons, evangelical renforcé, sonnait à la porte et demandait à Newman, qui se trouvait lui ouvrir, si l’on pouvait voir le monastère. « Nous n’avons pas de monastère ici », lui fut-il répondu, en même temps que la porte lui était fermée au nez. Newman était très blessé de cette curiosité indiscrète
1. Lett. and Corr. of J.-H.Newman, t. II, p. 409, 411.
258
et malveillante. Il le laissa voir, à l’occasion d’une démarche faite auprès de lui, en avril 1842, par l’évêque d’Oxford. Celui-ci assailli de dénonciations, étourdi des attaques des journaux, lui avait écrit une lettre où, tout en refusant de croire à ce qui était raconté et imprimé sur le prétendu monastère, il demandait des explications qui lui permissent de démentir cet essai de restauration monastique. Newman ne cacha pas à l’évêque « qu’il trouvait offensante, pour ce dernier, comme pour lui-même, l’explication que la turbulence de l’esprit public l’avait obligé à lui demander ». Il s’étonnait d’être, depuis un an, en dépit de sa soumission, de son silence, de la suspension des tracts, « l’objet de faux rapports incessants ». Au ton de cette réponse, il était visible que Newman supportait, avec une tristesse et une impatience croissantes, la situation qui lui était faite dans son Eglise. Lui-même a rapporté en quels termes il formulait alors intérieurement sa plainte contre ceux qui le relançaient jusque dans sa retraite : « Ne me suis-je pas retiré de vous, disait-il, n’ai-je pas abandonné ma place et ma position?... Suis-je, de tous les Anglais, le seul dont les pas doivent être suivis par les regards indiscrets et jaloux?... Lâches! si j’avançais d’un seul pas, vous vous enfuiriez. Ce n’est pas vous que je crains. Di me terrent et Jupiter hostis. Ce qui m’accable, c’est de voir les évêques continuer à m’attaquer, malgré ma complète soumission; c’est le doute secret du coeur, qui me dit qu’ils- ont raison de le faire, parce que je n’ai plus rien de commun avec eux!... Pourquoi ne voulez-vous pas
259
me laisser mourir en paix ? La bête blessée se réfugie dans quelque tanière pour y mourir, et personne ne la lui dispute. Laissez-moi en paix, je ne vous tourmenterai pas longtemps 1!»
X
Aux attaques acharnées des adversaires, aux censures persistantes des évêques, s’ajoutait pour Newman une cause de trouble qui lui était peut-être plus sensible encore : c’était la division de ses amis. Ward, dans le British Critic, affichait plus ouvertement que jamais son romanisme. Dans des articles écrits à la diable, mais qui agissaient puissamment sur les esprits, il exaltait la doctrine et la spiritualité pratique de l’Eglise de Rome; il semblait prendre plaisir à s’approprier sa phraséologie, en ce qu’elle avait de plus effarouchant pour les préjugés protestants; à l’inverse des tractarians qui avaient fait appel à une sorte de patriotisme et d’esprit de corps anglicans, qui avaient présenté leur système comme un retour aux traditions de l’ Eglise nationale et un moyen de la grandir, il abaissait l’orgueil de cette Eglise, insistait sur « sa condition dégradée » et lui signifiait rudement qu’il ne lui restait plus qu’à implorer humblement, aux pieds de Rome, son pardon et son relèvement ». Si choquant que ce langage parât à plusieurs de ses amis, Newman ne consentait pas à le désavouer. « Quant
1. Apologia.
260
à savoir s’il y a accord complet entre Ward et moi, écrivait-il à Pusey le 16 octobre 1842, je ne vois pas bien les limites de mes propres opinions. Si Ward dit que ceci ou cela résulte de mes paroles, je ne puis dire ni oui ni non. C’est plausible; cela peut être vrai... Je ne puis affirmer que ce ne soit pas vrai, mais je ne puis m’en rendre compte avec cette vivacité de perception que possèdent certaines personnes. C’est un tourment, pour moi, que d’être forcé au-delà de ce que je puis convenablement accepter.» Peu auparavant, au mois d’août, Pusey lui avait écrit: « Chose étrange, on veut me faire croire que vous êtes moins convaincu que moi de la divinité de notre Eglise; je ne sais ce qui peut donner un fondement à cette idée; les catholiques romains mettent beaucoup d’empressement à la répandre. » Newman répondait aussitôt : « Je ne suis surpris ni blessé que des personnes aient des soupçons sur ma foi dans l’Eglise anglicane. Je pense qu’elles ont des raisons de le faire. Il ne serait pas honnête, de ma part, de ne pas confesser aux personnes qui ont le droit de m’interroger, que j’ai des doutes, non pas sur les ordres, mais sur les privilèges qui en découlent et qu’elle exerce, séparée, comme elle l’est, de la chrétienté et tolérant l’hérésie. Mais je pense que peu de gens ont droit à connaître mon opinion. » De telles confidences désolaient Pusey, et cependant, avec sa difficulté de comprendre un état d’esprit autre que le sien, il finissait bientôt par se rassurer. Comment admettre qu’il pût se trouver sérieusement séparé de son cher Newman? Persuadé que celui-ci était surtout démonté
261
par les mauvais procédés des chefs de Collèges et des évêques, il tâchait d’effacer cette impression, en lui affirmant que beaucoup continuaient à l’aimer, à avoir confiance en lui et dans son oeuvre, en redoublant de tendresse à son égard. Tel ce billet touchant qu’il lui écrivait, à l’occasion de Pâques, en 1843 : « J’aurais voulu vous écrire, la veille de Pâques. Cela me pèse souvent de penser que quelques-uns de ces misérables jugements qui circulent sur vous et cette triste privation de sympathies de quelques-uns doivent, par moment, vous être pénibles. J’aurais voulu obtenir quelque part à vos épreuves, mais je n’en ai pas été digne. J’aurais voulu, en vous souhaitant les fêtes de Pâques, vous dire que mon plus vif désir eût été d’avoir pour moi ces jugements, ces rudes paroles, ces soupçons qui sont tombés sur vous. J’espère, quelque aiguë qu’en soit la souffrance, que cela vous consolera, de penser que quelqu’un qui vous aime les regarde comme votre meilleur trésor 1. » Bien que vivant hors d’Oxford, Keble savait mieux que Pusey à quoi s’en tenir sur l’état d’âme de Newman. Il avait l’esprit plus ouvert aux idées d’autrui, et nul n’attirait davantage la confiance. La crise par laquelle il voyait passer son ami l’inquiétait. Il cherchait à le retenir, lui demandait s’il était bien sûr de n’être pas trop sévère pour l’Eglise anglicane, trop admirateur de celle de Rome; il tâchait d’émouvoir sa conscience au sujet de ces milliers
1. Life of Pusey, t. II, p. 292 à 305. — Apologia. — Lett. and Corr.of J.-H. Newman,t. II, p. 396.
262
d’âmes habituées à attendre sa direction, et que telle résolution de sa part jetterait dans la perplexité et la confusion; mais il le faisait avec une sorte d’hésitation modeste, de défiance de son propre jugement; surtout il tenait bien à marquer que rien n’était diminué « de l’amour, de l’estime, de la reconnaissance » qu’il ressentait pour Newman, de l’assurance où il était de la droiture de ses vues et de la hauteur de ses inspirations. On eût dit qu’en face du mystère qu’il pressentait s’accomplir dans cette âme, le sentiment qui dominait en lui était un sentiment d’humilité craintive et de tendresse respectueuse 1. Parmi les premiers tractarians, tous ne témoignaient pas à Newman une confiance aussi persistante : quelques-uns ne jugeaient plus possible de demeurer avec lui sur le même pied d’amitié. De là des refroidissements, des éloignements, particulièrement sensibles à la nature aimante de Newman. Ce n’était pas seulement son curate, IsaacWilliams, qui s’effarouchait de ce qu’il entrevoyait de ses idées et qui quittait Oxford; c’était Rogers, longtemps son confident le plus intime et le plus aimé, celui qu’il avait eu, pendant tant d’années, à Oriel, porte à porte, sur le même palier, qui s’effrayait, lui aussi, de son romanisme; sous cette impression, il allait s’établir à Londres et, de là, lui écrivait, le 3 avril 1843 :
Mon cher Newman, je n’aimerais pas à vous rencontrer de nouveau, sans vous avoir dit, une fois pour toutes, ce
1. Lettres du 14 mai et du 29 juillet 1843. (John Keble, par Lock, p. 119 à 122.)
263
dont, je l’espère, vous comprendrez la sincérité : c’est que je ne puis pas me dissimuler combien il est improbable, et peut-être impossible, que nous nous retrouvions dans les mêmes termes qu’autrefois. Mais je désire, avant que ne soit passé le temps de faire une telle constatation, vous avoir dit combien je sens profondément et douloureusement, — et je puis ajouter que je l’ai plus ou moins senti depuis plusieurs années, — la grandeur de ce que je perds, et vous remercier de tout ce que vous avez fait et avez été pour moi. Je sais que c’est, dans une grande mesure, par mon propre fait que je fais cette perte. Je ne saurais, sans doute, me persuader que je fusse dans mon tort sur le fond des choses, et que je pusse longtemps éviter ce qui est arrivé. Mais je crois, si je puis oser le dire, que Dieu aurait trouvé un moyen de me garder une aussi grande bénédiction que votre amitié, si j’en avais été moins indigne. Je sens combien je vous dois de reconnaissance pour ce que vous avez été dans ma formation, combien vous avez été toujours, pour moi, plus que bon, tendre, combien il est improbable que je puisse jamais rencontrer rien qui approche en valeur ce qu’a été pour moi votre intimité. J’aurais été peiné de vous avoir quitté, sans vous avoir dit cela. Mais je ne vous l’écris pas dans l’idée de vous forcer à me répondre : cela n’appelle pas une réponse, et je n’attacherai aucune signification à votre silence 1.
Si douloureux que fût à Newman l’éloignement d’un tel ami, il ne fit rien pour le retenir. Leurs relations ne devaient reprendre que de longues années après; mais, alors, l’ancienne tendresse se trouvera avoir survécu : en 1889, quand Ragers, devenu lord Blachford, se verra sur le point de mourir, il écrira trois lettres à ses amis les plus chers, Gladstone, Church et New-
1. Letters of lord Blachford. p. 440, 441,
264
man; et celui-ci, à son tour, léguant à un ami un objet que lord Blachford lui avait rapporté d’Italie, y joindra un message rappelant tout ce que le donateur avait été pour lui, ses rares qualités, et comment, de toutes les intimités qu’il avait formées à Oxford, nulle n’avait approché de son intimité avec le jeune Rogers. Les modérés du Mouvement avaient beau se distinguer des ardents, ils n’en étaient pas mieux traités par les autorités d’Oxford. Celles-ci, ne se contentant plus de taquiner quelques undergraduates suspects de tractarianisme, voulurent de nouveau atteindre un chef et firent tomber leur coup sur Pusey. Ce fut à l’occasion d’un sermon que ce dernier prêcha, le 14 mai 1843, dans l’église de Christ-Church, sur l’Eucharistie 1. Il n’avait eu nulle idée de faire une manifestation extraordinaire et provocante : bien au contraire. Voulant traiter des Comforts to the penitent, il lui eût été naturel de parler d’abord de l’absolution des péchés; il avait préféré commencer par l’Eucharistie, qui lui semblait devoir moins inquiéter. Son sermon était surtout pratique et visait à rendre plus fréquente, à Christ-Church, la célébration eucharistique, qui n’y était autorisée qu’une fois par mois. Toutefois, si peu controversiste qu’il se montrât en cette circonstance, il ne cachait pas sa croyance à une présence réelle objective. Il n’en fallut pas plus pour fournir un grief à certains esprits. Cette croyance, aujourd’hui assez répandue dans l’anglicanisme, semblait, aux préjugés protestants qui dominaient dans la première moitié du
1. Sur cet incident, cf. Life of Pusey, t. II, ch. XXIX.
265
siècle, une nouveauté suspecte1. Quelques jours après, le Dr Faussett, déjà connu par ses polémiques contre Newman, dénonçait le sermon de Pusey au vice-chancelier. La procédure suivie témoigna du même parti-pris, de la même précipitation dont les chefs de Collèges avaient fait preuve, deux ans auparavant, à propos du tract 90. Cinq des six docteurs chargés par le vice-chancelier d’examiner le sermon étaient des adversaires notoires du tractarianisme, et le dénonciateur lui-même en faisait partie. Vainement Pusey leur demanda-t-il d’entendre ses explications, ils s’y refusèrent et décidèrent, le 27 mai, par cinq voix contre six, « qu’il avait prêché certaines choses qui étaient soit en dissonance, soit en contradiction avec la doctrine de l’Eglise d’Angleterre ». Quelles étaient ces « choses »? Où portait la contradiction? Ils se gardaient de le dire. Sur la peine à infliger, ils hésitèrent quelque temps; après avoir essayé vainement de s’entendre avec Pusey sur les termes d’une rétraction, ils prononcèrent contre lui, le 2 juin, une suspen-
1. Newman lui-même n’était venu à cette croyance que peu à peu, sous l’influence de Froude, et Keble, tout High Church qu’il fût d’éducation et de tradition, n’avait pas sur ce point, lors de la rédaction de son Christian Year, d’idée bien nette. Il avait écrit, en effet, dans une pièce célèbre de ce recueil :
O come to our communion feast There present in the heart, NOT in ihe hands, the Eternal Priest Will His true self impart.
Ce n’est que sur la fin de sa vie qu’il consentit à écrire As au lieu de Not. (Cf. sur cette question, qui a donné lieu à beaucoup de discussions, John Keble, par W. Lock, p. 56, et un article du Church Times du 26 novembre 1897.)
266
sion du droit de prêcher, pendant deux ans, dans l’enceinte de l’Université. Surpris par cet orage, Pusey n’en avait pas été troublé. Dès le 18 mai, à la nouvelle de la dénonciation, il écrivait à Newman : « Vous serez chagrin que la tempête m’ait enfin atteint moi-même. Que Dieu me guide au travers, car elle peut être fâcheuse, non pour moi, mais dans ses effets sur les autres. » Chez ses amis, l’indignation fut vive, et des protestations, signées de noms considérables, furent adressées au vice-chancelier. Cet épisode laissa les esprits, à Oxford, singulièrement excités. Chacun se regardait avec méfiance et ressentiment. C’était un état de guerre. Du côté des tractarians, personne ne pouvait plus se croire en sûreté. Si Pusey, avec sa modération et la grande considération dont il jouissait, était ainsi traité, que ne pouvaient craindre les autres? Newman que, durant cette crise, Pusey avait traité comme son confident et son conseiller le plus sûr 1, prenait plus à coeur les épreuves de son ami qu’il n’avait fait des siennes propres. Il ne s’en indignait pas seulement comme d’une injustice, il ne pouvait s’empêcher d’y voir un argument de plus contre l’Eglise au nom de laquelle on répudiait de tels hommes et de telles doctrines.
1. Lorsque Pusey publia son sermon, après sa condamnation, sa première pensée fut de le dédier à Newman, afin de manifester leur union; il n’y renonça que sur l’avis de Keble, qui avait craint de voir ainsi exciter davantage les esprits.
267
XI
J’ai dit que l’un des desseins de Newman en se rendant à Littlemore avait été d’y soumettre à un examen approfondi ses idées religieuses, de se rendre à soi-même un compte exact de ses croyances et de ses doutes. Plus il poussait avant cette étude, plus il sentait la faiblesse de l’anglicanisme et la force de Rome. Il n’y voyait sans doute pas encore assez clair pour conclure à l’obligation de passer de l’un à l’autre. Lui-même a défini ainsi quel était alors son état d’esprit: « Supposons que je traverse une étendue de glace, rencontrée sur mon chemin : j’ai de bonnes raisons de la croire solide, et une foule de gens la traversent devant moi, sans accident; supposons que, de la rive opposée, un étranger, d’une voix pleine d’autorité et avec un accent sincère, m’avertisse que le passage est dangereux, puis se taise; je crois que cela me ferait tressaillir et regarder autour de moi, avec inquiétude, mais je crois aussi que je continuerais, jusqu’à ce que j’eusse de meilleures raisons de douter: telle fut, ce me semble, ma situation jusqu’à la fin de 1842 1. » Dans cette incertitude, Newman ne croyait pas devoir d’explication au public: convenait-il de lui parler, pour ne lui faire part que de doutes et de pressentiments? Et, cependant, il se faisait scrupule de lui laisser croire qu’il était toujours dans les mêmes idées qu’autrefois. Ce fut sous l’empire de ce scrupule qu’en février 1843
1. Apologia.
268
il se décida à publier, dans le Conservative Journal d’Oxford, une rétractation de ses plus violentes attaques contre l’Eglise de Rome. Après y avoir rappelé quelques-unes de ces attaques, il en rejetait la responsabilité sur les théologiens anglicans qu’il confessait avoir eu le tort de suivre sans les contrôler, et il ne cachait pas son ressentiment contre ceux qui l’avaient ainsi abusé. Il s’est comparé lui-même, à ce propos, au condamné qui, sur l’échafaud, mordit l’oreille de sa mère. «Par cet acte de fureur, ajoutait-il, ce condamné ne niait pas son crime pour lequel il allait être pendu, mais il montrait que l’indulgence de sa mère à son égard, quand il était enfant, y avait beaucoup contribué. De même, j’avais porté une accusation; mais je reprochais à d’autres de m’avoir conduit, par leur exemple, ày croire et à la publier. Et certes j’étais d’humeur à leur mordre l’oreille, à tous. Je le confesserai franchement, j’étais irrité contre les théologiens anglicans 1.» La rétractation de Newman ne parait pas avoir eu, sur le moment, un grand retentissement. Son auteur qui avait voulu seulement libérer sa conscience, mais qui redoutait de troubler celle des autres, avait évité tout éclat; il avait choisi, avec intention, un journal peu répandu. Quelques mois plus tard, les convictions de Newman étaient plus ébranlées encore. Il écrivait, le 4 mai 1843, à un ami : « Je crains maintenant, si je me rends bien compte de mes propres convictions, d’en être venu à regarder la communion catholique romaine comme l’Eglise des Apôtres et à considérer la part de grâce
1. Apologia.
269
qui nous est donnée (part encore considérable par la grâce de Dieu), comme provenant du superflu des miséricordes providentielles. » Il en revenait alors à l’idée de résigner sa cure. « Etre infidèle à la charge qui m’a été confiée, disait-il, est assurément mon grand sujet de crainte, et cela, depuis longtemps, vous le savez. » Il ajoutait, le 18 mai : «Quelle sincérité puis-je apporter dans mon obéissance à l’évêque? Comment agir, dans le cas si fréquent où, d’une façon ou d’une autre, l’Eglise de Rome est mise en discussion?... Si je conserve Sainte-Marie, je deviens un scandale et une pierre d’achoppement 1. » Newman ne s’en croyait pas moins le droit et le devoir de retenir ceux de ses disciples qu’il voyait tentés d’aller à l’Eglise de Rome. Il s’y croyait obligé par loyauté envers l’Eglise, dont il tenait son office, envers les parents qui lui avaient confié leurs enfants, et par intérêt pour les jeunes gens eux-mêmes qu’il craignait de voir agir avec précipitation. L’une de ses thèses préférées, quand il avait affaire à une de ces âmes troublées, était de l’engager à se perfectionner elle-même, au lieu de chercher à juger les Eglises. « Quelles que soient, disait-il en substance, les faiblesses de l’Eglise d’Angleterre, elle contient certainement les moyens de devenir beaucoup plus saints que nous ne le sommes. Travaillons-y. En le faisant, nous sommes sûrs de ne pas nous tromper 2. » En fait, l’influence de Newman était, pour plusieurs,
1. Apologia. 2. Lett. and Corr. of J.-H. Newman, t. II, p. 389, 410.
270
le dernier et unique lien qui les attachait à l’Eglise d’Angleterre. Ward répondait alors à un prêtre catholique qui s’étonnait de le voir rester dans l’anglicanisme, alors qu’il était si romain de croyance et de coeur : « Vous autres, catholiques, vous savez ce que c’est d’avoir un pape. Eh bien, Newman est mon pape; sans sa sanction, je ne puis remuer 1. » Même action sur Faber. Celui-ci, à la suite de voyages sur le continent et surtout d’un séjour à Rome, s’était de plus en plus rapproché du catholicisme romain 2 . En juin 1843, il avait une audience de Grégoire XVI. Le Pape s’y montra occupé et ému des événements religieux d’outre-Manche. A la nouvelle que son visiteur arrivait d’Angleterre: Inghilterra, Inghilterra ! s’écria-t-il, et il fondit en larmes. « Vous ne devez pas, dit-il à Faber, vous leurrer vous-même, en aspirant à l’unité et cependant en attendant votre Eglise pour vous mettre en mouvement. Pensez au salut de votre propre âme. » Et comme Faber se défendait d’obéir à son jugement individuel : «Vous êtes tous individuels, dans l’Eglise d’Angleterre, reprit le Pape; vous n’avez qu’une communion extérieure et cet accident d’être sous l’autorité de la reine. Vous savez cela, vous savez cela; vous savez que, parmi vous, toutes les doctrines sont enseignées n’importe comment. Vous devez donc penser à vous-même et à votre âme.» Le vieux pontife posa alors ses mains sur les épaules du jeune clergy-
1 W.- G. Ward and the Oxford Movement, p. 241. 2 Life and Letters of F.-W. Faber, par Bowden, p. 89, 90, 102, 150, 164 à 209.
271
man qui s’agenouilla aussitôt. « Que la grâce de Dieu, dit-il, corresponde à vos bons désirs, qu’elle vous délivre des filets de l’anglicanisme et qu’elle vous conduise à la vraie Eglise! » Faber quitta le Pape, profondément touché 1. Plus que jamais, il se disait « romain, très romain 2». On pouvait le croire proche du dénouement. Ne racontait-il pas que, deux fois, à Rome, il avait pris son chapeau pour aller au collège anglais prononcer son abjuration 3 ? Et cependant il ne faisait pas ce dernier pas. L’autorité qui le retenait et qui devait le retenir deux ans encore, c’était celle de Newman, c’étaient ses conseils et son exemple. Vainement souffrait-il de rester dans une Eglise sur laquelle il avait tant de doutes, vainement se rappelait-il l’avertissement du Pape et des prêtres italiens sur l’obligation de penser à son propre salut et tremblait-il à la pensée d’être « damné », sa déférence pour les avis de Newman était la plus forte. « Malgré tout, écrivait-il à ce dernier, j’attendrai, réconforté de voir que vous me recommandez le délai, même dans mon état d’esprit, heureux de savoir que, pendant ce temps, j’aurai vos prières 4. » Il tâchait de tromper sa soif de catholicisme, en étant aussi catholique que possible dans l’exercice de son ministère paroissial, en « faisant toutes choses dans sa paroisse, disait-il lui-même, comme s’il était un romain ». Il entretenait une correspondance suivie avec Newman, lui exposait ses angoisses,
1. Life and Letters of Faber, p. 196. 2. Ibid., p. 197, 209. 3. Ibid., p. 199. 4. Ibid., p. 210,211.
272
sollicitait de lui, par exemple, la levée de l’interdiction qui lui avait été faite d’invoquer les saints, mais toujours en promettant de se soumettre, si la défense était maintenue. Il demeurait convaincu, sur la foi de Newman, que son devoir était d’attendre. « La conclusion, lui écrivait-il, est que je ne dois pas décider par moi-même, niais, comme vous dites, être patient, jusqu’à ce que le chemin soit miséricordieusement éclairé pour nous 1. » Du poste où il observait, avec une attention sympathique et anxieuse, les vicissitudes du Mouvement d’Oxford, Wiseman ne laissait pas d’apercevoir par quelles raisons ces âmes, si proches de la vérité, cherchaient à se soustraire à l’obligation de consommer leur conversion. Il en était vivement préoccupé. Quelque désireux qu’il fût de ménager Newman et ses amis, de ne pas contrarier leur campagne, de rendre justice à leurs intentions, il ne pouvait laisser croire qu’il tenait leurs ajournements pour justifiés. Dans ses lettres aux laïques catholiques qui lui servaient d’intermédiaires avec Oxford, il déclarait ne pouvoir s’imaginer que la divine Sagesse permît aux tractarians romanisants de rester dans le schisme pour y faire du bien; il les mettait en garde contre l’illusion, qui leur faisait croire que Newman avait reçu, soit par une sorte d’illumination intime, soit par la constatation de l’action de la grâce autour de lui, une indication providentielle de demeurer dans l’Eglise d’Angleterre; et surtout il se refusait à promettre de ne pas solliciter de conversions
1. Life and Lett. of Faber, p. 211 à 223.
273
individuelles : un catholique lui paraissait avoir, en ces matières, des devoirs auxquels il ne pouvait manquer; il ne lui était pas loisible de négliger, sous prétexte d’on ne sait quelle voie extraordinaire de la Providence, l’occasion qui se présentait à lui de ramener une âme à l’unité 1. Ce fut ainsi qu’à la fin de 1849 Wiseman, prêta les mains à une conversion qui fit alors assez grand bruit, celle du révérend Bernard Smith, recteur de Leadenham, ancien fellow de Magdalen. Celui-ci, gagné depuis plusieurs années aux tendances catholiques du Mouvement, s’était trouvé récemment en rapport avec les prêtres d’Oscott et avait été surpris de les trouver tout autres que, sous l’empire de vieilles préventions, il se les était figurés. En même temps, son propre évêque, en réprouvant comme entachées de romanisme, les pratiques dont il usait dans son ministère paroissial, semblait lui signifier qu’il y avait incompatibilité entre ses croyances et l’Eglise d’Angleterre; un tel procédé n’était pas pour raffermir sa fidélité. Newman, informé de son trouble, lui écrivit pour le détourner de se joindre à l’Eglise de Rome, non certes en cherchant à déprécier cette Eglise, mais en insistant sur le devoir de rester là où la Providence l’avait placé; il l’invita même à venir à Littlemore. Smith déclina l’invitation, et, au contraire, se rendit à Oscott, où, après une retraite dirigée par Wiseman, il fit son abjuration. La « sécession d’un clergyman était alors chose rare, et l’émoi fut vif parmi les anglicans. L’évêque de Lincoln, dont
1. Life and Times of Card. Wiseman, t. I, p. 415 à 419.
274
dépendait la paroisse de Smith, songea un moment à le faire condamner à la prison pour avoir abandonné sa cure. Les protestants s’en prirent aux tractarians, particulièrement à Newman: ils lui reprochèrent d’être de connivence avec le transfuge et, dans certains journaux, l’accusèrent de lui avoir conseillé de garder sa cure après son abjuration : nouvelle preuve, à leurs yeux, de cette dishonesty dont ils prétendaient marquer Newman et ses disciples. Informé que l’évêque de Lincoln avait accueilli et colportait cette accusation, Newman lui adressa une lettre de protestation attristée; il n’y cachait pas combien de tels procédés contribuaient à le détacher de l’Eglise d’Angleterre. «Croyez bien, Monseigneur, lui disait-il, qu’il y a des limites très précises au-delà desquelles les hommes tels que moi ne voudraient ni donner le conseil de conserver, dans l’Eglise anglicane, des fonctions élevées, ni les conserver eux-mêmes, et que le blâme dirigé contre eux, par tant de chefs de l’Eglise, influe considérablement sur ces limites 1 ».
XII
Smith, après tout, n’avait jamais été de l’intimité de Newman, et ce dernier pouvait se défendre d’avoir à répondre de lui. Il n’en était pas de même du jeune Lockhart. De famille écossaise, Lockhart était arrivé à Oxford, en 1839, peu disposé à s’embarrasser des questions religieuses et plus porté à chercher ses rela-
1. Apo1ogia
275
tions dans la partie frivole de la jeunesse universitaire 1. Bientôt, cependant, l’exemple de sa mère et de sa soeur déjà conquises au Mouvement 2, la lecture des Remains de Fronde, les écrits de Pusey sur le baptême, le tract 90, et surtout l’assistance assidue aux sermons de Sainte-Marie, changèrent complètement la direction de son esprit. Une fois dans cette voie, il y avança plus vite que ses guides; il ne tarda pas à laisser voir que l’anglicanisme ne suffisait pas aux besoins de son âme et que Rome l’attirait. Peut-être, à raison de son origine écossaise, avait-il des attaches moins fortes que d’autres à l’Eglise d’Angleterre. Il en voulait surtout à cette Eglise d’avoir négligé la confession et l’absolution. A une heure de trouble, ayant demandé à un haut dignitaire qu’il croyait imbu des idées High Church de recevoir l’aveu de ses fautes, il le voyait se dérober, tout effaré d’une demande si insolite, Il recourut alors à Manning, qui entendit sa confession et l’engagea à se retirer à Littlemore. il s’y installa en 1849: il avait alors vingt et un ans. Ebranlé lui-même, Newman était-il en mesure de raffermir celui dont on lui remettait la garde? A Lockhart qui lui demandait « s’il était sûr de pouvoir donner l’absolution », il n’osait pas répondre affirmativement. «Pourquoi vous adressez-
1. Sur ces débuts de Lockhart, voir les Reminiscences publiées par ce dernier, dans le Dublin Review d’avril 1892, à l’occasion de la mort de Manning, et un article publié,en novembre 1893,dans le Month, sous ce titre : On the road to Rome. 2 Retenues, pendant plusieurs années, dans l’anglicanisme, par l’influence de Manning, ces deux femmes devaient finir par se faire catholiques, la mère en 1845, la soeur en 1850: celle-ci mourut religieuse franciscaine.
276
vous à moi? lui disait-il. Demandez à Pusey 1. » Il ne s’en croyait pas moins tenu envers ceux qui le lui avaient confié de l’empêcher d’aller à Rome : il ne voulait pas surtout qu’une talle sécession se produisît à Littlemore. Il s’en expliqua avec son jeune hôte et le mit en demeure ou de s’engager à écarter toute idée de changement pendant trois ans, ou de quitter immédiatement Littlemore. Comme Lockhart hésitait, Newman lui conseilla d’aller à Oxford, en causer avec Ward. L’entretien eut lieu au cours d’une promenade à travers les parcs et ne dura pas moins de trois heures : Ward insista sur la défiance que son jeune interlocuteur devait avoir de son propre jugement, en une matière aussi redoutable. De retour à Littlemore, Lockhart déclara à Newman avoir pris son parti d’attendre trois ans avant de faire aucun pas vers Rome 2. Il tint bon pendant une année, mais avec des perplexités croissantes. Un religieux rosminien, le P. Gentili, qui se trouva alors en rapport avec lui, n’eut pas de peine à voir que, seule, la promesse faite à Newman empêchait sa conversion; il l’engagea à faire une retraite de trois jours. Elle eut lieu dans la seconde quinzaine d’août 1843. L’issue en fut son abjuration et son entrée au noviciat des rosminiens. La nouvelle de cette conversion surprit et mécontenta Newman. Il en informa aussitôt son évêque, en ayant soin de lui raconter l’engagement qu’il avait exigé de son hôte, et la façon dont celui-ci y avait manqué.
1. W.-G. Ward and the Oxford Movement, p. 210, 2 Ibid.
277
Mais, s’il se justifiait de tout soupçon de déloyauté envers son Eglise, il n’en était pas moins convaincu que désormais sa situation ecclésiastique n’était plus tenable, et il ,jugea le moment venu de résigner sa cure. On sait que cette pensée le travaillait depuis longtemps. « Tel est le scandale causé par cette affaire Lockhart, écrivait-il à Keble, que, bien que je ne m’en sente pas responsable, je ne pourrai tenir la tête haute, tant que j’aurai Sainte-Marie1. » il prévoyait d’ailleurs que Lockhart aurait des imitateurs. « Des gens que vous ne soupçonnez guère, écrivait-il à un autre ami, ou du moins que je ne soupçonnais pas, sont dans une voie presque désespérée. Réellement, nous pouvons nous attendre à tout 2. » A peine connue, l’intention de Newman fut combattue par Pusey, par plusieurs autres de ses amis, par ses soeurs, qui pressentaient, avec alarme, une séparation plus complète encore. L’une de ces dernières lui rappelait tous « ces esprits habitués à guetter ses moindres mouvements, qui interpréteraient sa démarche comme un commencement de rupture formelle avec l’Eglise 3 ». Elle lui transmettait, en même temps, la lettre suivante qu’elle venait de recevoir d’une dame et dont l’accent de trouble et d’angoisse était bien fait pour remuer le coeur de Newman:
J’ai pensé que, parmi les opinions et les sentiments avec lesquels votre frère est appelé à sympathiser, ceux dont il entend le moins parler, qu’il connaît le moins et qui sont
1. Lett. and Corr., of L-H. Newman, t. II, p. 422. 2. Apologia. 3. Lett. and Corr., t. II, p. 448, 419.
278
cependant les plus nombreux, sont ceux des gens qui vivent loin de lui, dispersés dans le pays, sans moyen de communiquer avec lui..., et qui pourtant ont été habitués à le regarder comme un guide. Ces gens ont un droit sur lui; il a porté témoignage devant le monde, et ils ont reçu son témoignage; il a enseigné, et ils se sont efforcés d’être des pupilles obéissants... Il s’est chargé d’eux, et il ne peut plus s’en défaire. Ses paroles ont été dites en vain pour plusieurs, non pour eux... Il y a quelque chose d’assez triste et décourageant à être évité, regardé avec défiance par les voisins, par les amis, par le clergé; mais, tant que nous avons eu quelqu’un à qui nous confier et de qui recevoir instruction, nous l’avons supporté aisément, il nous semblait que tout son qui partait de Littlemore et de Sainte-Marie nous parvenait jusqu’ici, et qu’il réconfortait beaucoup d’entre nous, aux jours de tristesse. Mais, si cette voix se tait, les paroles mêmes qu’elle a prononcées naguère perdront quelque chose de leur pouvoir. Nous aurons des pensées tristes en les lisant. Tel était notre guide, nous dirons-nous, mais il nous a laissés chercher nous-mêmes notre chemin; notre champion nous a abandonnés; notre homme de guet, dont le cri avait coutume de nous réjouir, ne se fait plus entendre 1.
Newman fut touché jusqu’aux larmes; il souffrait cruellement du chagrin qu’il causait aux âmes qui avaient eu confiance en lui. Il redoublait de tendresse émue dans ses réponses à sa soeur, sa « très chère », sa « très douce Jemmina » Mais sa résolution n’était pas ébranlée. Il invitait sa soeur à avoir foi dans les motifs qui le faisaient agir; il ne lui cachait pas d’ailleurs que son parti était déjà arrêté depuis plusieurs mois 2. C’est, en effet, que l’incident Lockhart
1. Lett. and Corr., t. II, p. 420, 421. 2. Ibid., t. II, p. 421, 422.
279
n’était que l’occasion de sa retraite la cause en était plus lointaine, plus profonde. Cette cause, il se détermina à la dévoiler à J.-B. Mozley, dans une lettre sur laquelle il mettait lui-même cette note Confidentielle. « En réalité, lui écrivait-il, ce n’est ni un sentiment personnel, ni un ennui, sous l’empire duquel j’agis. Je crois pouvoir vous parler ouvertement, — ce que j’ai fait à très peu de personnes, — et vous dire la vraie cause... La vérité est donc que je ne suis pas un assez bon fils de l’Eglise d’Angleterre, pour pouvoir garder en conscience le bénéfice que je tiens d’elle. J’aime trop l’Eglise de Rome. Et maintenant, je vous en prie, brûlez ceci 1 ». A d’autres amis, s’il n’osait rien préciser, il laissait tout entendre : « Je pourrais vous dire des choses très douloureuses, mandait-il à son cher Bowden; mais, après tout, il vaut mieux ne pas aller au-devant de cette peine. Que peut-il arriver de pis? C’est qu’elle se réalise. Et que savons-nous si elle ne nous sera pas épargnée? Vous êtes si bon que, parfois, en vous quittant, je suis ému presque jusqu’aux larmes, et ce me serait un soulagement que de pleurer à la fois sur votre bonté et sur ma dureté. Je ne crois pas que personne ait jamais eu des amis aussi bons que les miens 2. » Dans une lettre à l’une de ses soeurs, Mrs Thomas Mozley, il s’exprimait ainsi : « Je désespère tellement de l’Eglise d’Angleterre, et je suis si évidemment rejeté par elle; d’autre part, je suis si attiré vers l’Eglise de Rome, que je juge plus sûr, au point de vue
1. Lett. and Corr., t. II, p. 423. 2 Ibid., t. II, p. 425.
280
de l’honnêteté, de ne pas conserver mon bénéfice... Je ne pourrais plus, sans hypocrisie, me présenter comme un docteur et un champion de notre Eglise. Très peu de personnes savent cela, à peine une à Oxford, James Mozley. Je pense que ce serait cruel et troublant de le dire aux autres. Ma chère Harriett, il vous faut apprendre la patience, comme nous tous, et la résignation à la volonté de Dieu 1. » Sa résolution prise, Newman en précipite l’exécution. Dès le 18 septembre 1843, il va, à Londres, signer sa démission. Le 24, il remonte, une dernière fois, dans la chaire de Sainte-Marie, à Oxford; son discours est d’un accent particulièrement ému et grave, mais sans allusion à sa retraite. C’est le lendemain, à Littlemore, qu’il fait réellement ses adieux à ses auditeurs anglicans. Les amis sont venus nombreux, beaucoup d’Oxford, bien que l’Université soit en vacances, quelques-uns de plus loin, comme Bellasis, accouru de Londres 2. La petite église est toute fleurie, en l’honneur du septième anniversaire de sa consécration; les fleurs recouvrent notamment la tombe de la mère de Newman. Quand celui-ci monte en chaire, un silence mêlé d’une sorte de crainte remplit l’église : chacun comprend qu’il va se passer quelque chose de très grave et de très solennel. L’orateur a pris comme sujet la séparation des amis, the parting offriends. Sa voix est basse, parfois un peu hésitante, avec de longues pauses où il semble
1. Lett. and Corr., t. II, p. 425, 426. 2. Bellasis a écrit à Mrs Bellasis un récit ému de cette journée. (Memorials of M. Serjeant Bellasis, p. 62 à 65.)
281
faire effort pour se contenir, et pourtant toutes les paroles sont distinctement entendues. Il passe en revue les scènes d’adieu racontées par la Bible, entre autres celle de David et de Jonathan. On devine, à l’accent de ses paroles, l’angoisse de son âme, le douloureux ressentiment des traitements qui l’obligent à se retirer, la détresse où le réduit la ruine de tant d’espérances. A la fin, il éclate en une plainte déchirante à l’adresse de cette Eglise qu’il a tant aimée et qui le rejette :
O ma mère, ma mère! D’où vient que tant de belles choses ont été versées sur toi et que tu ne peux pas les garder? D’où vient que tu portes tes enfants et que tu n’oses pas les avouer? Pourquoi n’as-tu pas l’habileté d’utiliser leurs services, ni le coeur de te réjouir dans leur amour? Pourquoi tout ce qu’il y a de généreux dans le propos, de tendre et de pénétrant dans la dévotion, tes fleurs et tes promesses, tombe-t-il de ton sein et ne trouve-t-il aucun asile dans tes bras? Qui t’a marquée de cette note, d’avoir « des entrailles qui avortent et des mamelles desséchées », d’être étrangère à ta propre chair et d’avoir l’oeil cruel à tes petits? Tes enfants, le fruit de tes entrailles, qui t’aiment et voudraient travailler pour toi, tu les regardes avec crainte, comme un présage de malheur, ou bien tu les as en aversion, comme une offense, ou, au mieux, tu ne fais que les supporter, comme s’ils n’avaient droit qu’à ta patience... Tu les fais « se tenir, tout le jour, oisifs »; c’est à cette condition que tu les supportes. Ou bien tu les invites à aller là où ils seront mieux reçus, ou tu les vends pour rien à l’étranger qui passe. Et, avec tout cela, où veux-tu donc en venir à la fin?
En terminant, cependant, l’orateur se dégage de ces souvenirs amers; il se retourne, avec une pensée d’une
282
mélancolie plus douce, vers les fidèles qui l’entourent pour la dernière fois : « Et maintenant, leur dit-il, mes amis, mes chers amis (ici une longue pause), si vous avez connu quelqu’un qui, par son enseignement, par ses écrits, par sa sympathie, vous a aidés ou a paru vous comprendre, sentir avec vous, oh! mes amis (ici encore une longue pause), souvenez-vous de lui et priez pour lui 1» Tous pleuraient, excepté l’orateur, raconte un témoin. Descendu de la chaire, Newman vient recevoir la communion, puis se tient à l’écart. C’est Pusey qui continue l’office, mais les larmes l’obligent souvent à s’arrêter. La cérémonie finie, chacun quitte Littlemore profondément ému et troublé, avec le sentiment plus ou moins net que tout un passé et quel passé! est définitivement clos. « Je rentre le coeur brisé, écrit Pusey le soir; le sermon était du pur Newman... La foule sanglotait sans contrainte. Si nos évêques savaient seulement quels coeurs fidèles, dévoués au service de Notre-Seigneur dans cette Eglise, ils sont entrain de briser 2. »
1. J’emprunte pour cette fin du sermon le compte rendu écrit sur le moment même par Bellasis. (Memorials of M. Serjeant Bellasis, p. 64, 65). 2. Life of Pusey, t. II, p. 374 et suiv. Le chanoine Scott Holland a pu écrire récemment, à propos de ce sermon, que la littérature anglaise ne connaissait pas d’adieu plus pathétique et que « l’écho en sonne pour toujours aux oreilles de tous ceux qui ont aimé John Henry Newman. » (Life and Lett. of Dean Church, p. 208.)
CHAPITRE VLE DÉNOUEMENT (1843-1845)
I. Emotion causée par la retraite de Newman. Sa conversion devait cependant se faire attendre encore pendant deux ans. Raisons de cette attente. Il se dégoûte de toute action publique. Il souffre de la perplexité et de la tristesse de ses amis. Ses rapports avec Keble, avec Pusey. Mort de la fille de Pusey. Celui-ci traduit des livres de dévotion catholique et se refuse à attaquer l’Eglise romaine. — II. Ward publie l’Idéal d’une Eglise chrétienne. Controverses soulevées par les doctrines hardiment romanistes de ce livre. Les chefs de Collèges le défèrent à la Convocation et veulent, en même temps, faire édicter un nouveau test, ou au moins censurer le tract 90. Séance de la Convocation. Ward est condamné, mais l’autre mesure est arrêtée par le veto des Proctors. Oakeley suspendu par la cour des Arches. — III. Effet de la condamnation de Ward sur Newwan. Il étudie la théorie du Développement de la doctrine chrétienne et se met à écrire nn Essai sur ce sujet. II avertit ses amis de sa prochaine conversion. Accueil fait à cette nouvelle. Newman dans la communauté de Littlemore. Il persiste à se tenir à l’écart des catholiques. Wiseman envoie Smith à Littlemore. — IV. Conversions de Ward et de plusieurs autres disciples de Newman. Newman se décide et appelle le P. Dominique. L’abjuration. L’impression produite. Nombreuses conversions. Les vieux amis de Newman ne le suivent pas. Entrevue de Newman et de Wiseman. Newman quitte Littlemore et Oxford.
I
L’émotion produite par le sermon d’adieu de Newman ne demeura pas renfermée dans Littlemore. Vingt-cinq ans plus tard, un témoin, qui n’était cependant pas de
284
ses disciples, gardait encore tout vivant « le souvenir du douloureux désarroi, de l’espèce de pause effrayante dont on eut l’impression, à Oxford, quand cette voix se tut et qu’on sut qu’on ne l’entendrait plus » . « Ce fut, ajoutait-il, comme si, au-dessus d’un homme agenouillé dans le silence de quelque vaste cathédrale, la grande cloche, sonnant solennellement, venait tout à coup à se taire 1. » L’idée générale était que cette retraite présageait une prochaine sécession et, de l’avis de tous, on ne pouvait exagérer la gravité du coup qui serait ainsi porté à l’Eglise d’Angleterre. « Hélas! hélas! écrivait aussitôt Gladstone à Manning, mon premier mouvement est de dire : « Je chancelle comme un homme ivre et je ne sais plus où j’en suis 2. » Ceux mêmes qui n’appartenaient pas à l’école tractarienne n’en sentaient pas moins l’immensité de la perte. Dans une lettre écrite sur le moment, Stanley rapportait l’émoi de tout le monde pensant d’Oxford : « On ne parle que de cela dans les conversations privées, disait-il, car on n’ose pas cri parler en public. » Il ajoutait : « Pour quiconque a été accoutumé à regarder Arnold et Newman comme les deux grands hommes de l’Eglise d’Angleterre, la mort de l’un et la sécession de l’autre ne peuvent être qu’un signe de fatal augure, comme ce bruit de départ de chariots qui fut entendu la veille de la chute du temple de Jérusalem 3. » On ne se trompait pas en croyant Newman perdu
1. Studies in Poetry and Philosophy, par le principal Shairp, p. 255. 2. Life of Card. Manning, par Purcell, t. I, p. 242. 3. Life of Stanley, t. I, p. 332.
285
pour l’anglicanisme; on se trompait en croyant sa sécession très prochaine. Il désespérait de son Eglise, doutait chaque jour davantage qu’elle fût une branche de l’Eglise catholique, était, au contraire, de plus en plus disposé à voir la véritable Eglise dans l’Eglise de Rome, et cependant n’en concluait pas à l’obligation de s’y joindre. Pour faire ce dernier pas, le doute ne lui suffisait point; il voulait une certitude dont il ne se sentait pas en possession 1. Les variations de ses convictions passées le portaient d’ailleurs à se défier de soi. « La difficulté pour moi, a-t-il écrit plus tard, était ceci J’avais été grandement trompé; comment pouvais-je être sûr de ne pas l’être une seconde fois? Quelle preuve avais-je que je ne changerais pas encore, lorsque je serais devenu catholique? J’avais toujours cette appréhension, tout en croyant qu’un temps viendrait où elle se dissiperait 2. » L’apostasie, survenue à la fin de 1843, d’un converti récent, Sibthorpe, ne semblait-elle pas un argument contre toute démarche précipitée? Cet état d’attente et d’incertitude devait se prolonger pendant deux ans. Quelques-uns en ont été surpris et parfois mal impressionnés. On leur répondrait volontiers, avec Newman lui-même, par ces paroles de saint Augustin « Que ceux-là soient sévères qui n’ont pas connu les difficultés qu’on éprouve à distinguer l’erreur de la vérité et à trouver le vrai chemin de la vie au
1. Lett. and Corr of J.-H. Newman, t. II, p. 425. — Lettres du 14 et du 25 octobre 1843, citées dans l’Apologia. 2. Apologia.
286
milieu des illusions du monde. » Plus les convictions de Newman avaient été profondes et gardaient de racines non seulement dans son intelligence, mais dans son coeur, plus il avait peine à s’en détacher, Il n’était pas jusqu’à la coutume qu’avait son esprit subtil et pénétrant d’envisager toutes les faces des questions qui ne lui rendît plus difficile de conclure. Et puis ne peut-on pas deviner une raison providentielle à ce retard? N’importait-il pas à l’effet produit sur les autres âmes que Newman eût visiblement épuisé tous les moyens de résistance avant de se rendre? La prolongation de son examen n’était-elle pas une preuve du sérieux, de la sincérité qu’il y apportait? Ce n’est donc certes pas avec un esprit de critique, c’est au contraire avec un sentiment de respect ému qu’il convient de considérer le drame prolongé de cette âme, son effort pénible, lent, mais persistant, pour se dégager de l’obscurité qui l’enveloppe encore et pour faire son ascension graduelle vers la lumière qu’elle entrevoit à l’horizon. Après la résignation de sa cure, Newman ne quitta pas l’ermitage de Littlemore et continua d’y vivre en compagnie de quelques jeunes disciples. S’il avait renoncé à toute fonction ecclésiastique, il se considérait comme étant toujours en communion laïque avec l’Eglise d’Angleterre, assistait aux offices dans la chapelle du village, évitait toute relation avec les catholiques et s’abstenait des pratiques qui, comme l’invocation des saints, lui paraissaient caractéristiques de leurs croyances. Toutefois il était bien obligé de s’avouer qu’il « était en train de
287
changer» Quand il se rendait à Oxford, il « ne s’y trouvait plus à sa place », et il lui semblait que chaque chose lui disait : « Ceci n’est pas ta demeure.» Il notait aussi en lui une sensibilité plus grande qu’autrefois; il ne pouvait lire une vie de saint sans avoir les larmes aux yeux 1. Plus que jamais, il se donnait à la prière, à la méditation. Son austérité croissante lui attirait les observations de son médecin 2 . Sa volonté était de se mettre sous la main de Dieu et d’attendre de lui l’indication de ce qu’il devait faire. Comment lui viendrait cette indication? A quelle occasion? Sous quelle forme ? Il l’ignorait et se tenait aux aguets. Un de ses plus chers amis de la première heure, Bowden, était alors gravement malade. Le voyant près de sa fin, il se demanda s’il devait lui faire part de ses doutes et l’aider à examiner sa propre croyance ; il ne le fit pas, par crainte de troubler une âme de bonne foi, sans être en mesure de lui apporter une certitude. Mais il gardait quelque espérance que les derniers jours de son ami lui apporteraient à lui-même quelque lumière; il n’en fut rien. «Je pleurai amèrement sur son cercueil, écrivait-il sur le moment, en pensant qu’il me laissait encore dans les ténèbres, sans me dire quel était le chemin de la vérité et ce que je devais faire pour plaire à Dieu et accomplir sa volonté. » . « Quand on voit, disait-il encore à ce propos, une fin aussi bénie couronner la vie si pure d’un homme qui vivait réellement des pratiques de notre foi anglicane
1. Lett. and Corr. of J.-H. Newman, t. II, p. 435. 2. Ibid., t. II, p. 439.
288
et y puisait sa force..., il est impossible de ne pas s’y arrêter du moins comme dans une sorte de zoar, de lieu de refuge et de repos momentané, placé là, à cause des aspérités du chemin. » Il ajoutait, il est vrai, aussitôt : « Puissions-nous seulement nous tenir en garde contre une sécurité illégitime. » Et il affirmait à un autre correspondant « qu’en présence du souvenir de son ami le témoignage énergique de sa raison en faveur de Rome demeurait ce qu’il était 1 ». Dans des lettres datées de quelques semaines plus taud, il se déclarait convaincu « que son Eglise était en état de schisme, que son salut personnel dépendait de son union à l’Eglise de Rome », que cette union se ferait un jour ou l’autre, et cependant il ajoutait : « Humainement parlant, il n’y a pas à craindre que je quitte notre rivage avant longtemps... Ce qui me retient encore est ce qui me retient depuis longtemps: la crainte d’être sous l’empire d’une illusion... Mon intention, si rien de nouveau ne survient en moi, ce que je ne puis prévoir, est de rester tranquillement dans le statu quo pendant un temps considérable 2. Dans l’état d’incertitude et d’évolution de ses croyances, Newman se sentait peu disposé à entrer en communication avec le public. S’il poursuivait l’impression des anciens sermons de Sainte-Marie, il ne se dissimulait pas que ces sermons parlaient de la situation de son Eglise, avec plus de confiance qu’il n’en ressentait maintenant; « mais, ajoutait-il, je pense que c’est
1. Lettres de septembre 1844. (Apologia.) 2. Lettres de novembre 1844. (Ibid.)
289
bien et que je ne dois pas m’inquiéter de paraître inconsistant. » Il avait eu l’idée, en 1843, de faire faire, sous sa direction, une série de Vies des Saints anglais; des amis de nuances diverses lui avaient promis avec empressement leur concours. Mais, quand on en vint à l’exécution, quand parut notamment, en 1844, la Vie de saint Etienne Harding par Dalgairns, le reproche de romanisme s’éleva de toutes parts. Des amis, comme Gladstone, Pusey, s’en firent l’écho. Hope Scott demanda si l’on ne pourrait pas commencer par des vies moins romaines. « Mais il n’y en a pas, répondit Newman; toutes fourniront matière à la même accusation.» Devant ces plaintes, toutefois il renonça à toute entreprise collective, et le public fut informé que les Vies publiées à l’avenir le seraient sous la responsabilité exclusive de chaque auteur. Un petit nombre parurent dans ces conditions 1. De cet incident, Newman conclut que «l’Eglise anglicane ne pouvait pas porter la vie de ses saints (bear the lifes of her saints)», et il ne cachait pas que cette nouvelle constatation ne contribuait pas à raffermir une foi déjà si ébranlée 2. Dégoûté définitivement, par une telle expérience, de toute action publique, Newman résolut d’attendre dans le silence le résultat du travail intérieur de sa conscience. S’il n’avait eu à compter qu’avec soi, il eût supporté patiemment cette attente. Il croyait s’être aban-
1. De ce nombre fut la vie de saint Wilfrid, par Faber, publiée en 1845. Son caractère très romain souleva beaucoup d’attaques et attira à l’auteur les représentations de Pusey et de Marriott. (Life and Lett. of F.-W. Faber, p. 223 à 228.) 2. Mémoirs of J.-R. Hope Scott, t. II; p. 24 et sq. (Apologia.)
290
donné à la direction divine, ne sachant où il allait, mais convaincu que tout serait pour son bien. C’était toujours au sujet des autres qu’il avait ses plus grandes perplexités, au sujet de ses jeunes disciples qui lui en voulaient de les laisser sans direction, au sujet de ses vieux amis qui s’inquiétaient de l’ébranlement de sa foi dans l’Eglise d’Angleterre. A l’un d’eux qui lui avait parlé des bruits qui couraient sur sa sécession prochaine ou possible, il répondait, le 31 octobre 1843 : « Votre lettre m’a arraché des soupirs plus nombreux, plus profonds que je n’en ai connu depuis longtemps... Je suis littéralement obsédé par ce terrible murmuré que tant d’échos me renvoient et qui cause à mes amis le plus cuisant chagrin 1. » A un autre, il écrivait, le 24 février 1844: « Je ne suis pas digne d’avoir des amis. Avec mes opinions que je n’ose pas toutes avouer, je me sens comme un coupable en présence d’autrui, bien que j’espère rie pas l’être. Les gens pensent, avec bonté, que j’ai beaucoup de choses à supporter extérieurement, — désappointement, calomnies, etc. Non, je n’ai à supporter que l’anxiété avec laquelle je ressens celle de mes amis à mon sujet. » Et plus tard, le 16 novembre: « Je traverse l’épreuve qu’il faut traverser, et ma seule espérance est que chaque jour de douleur est une goutte retirée du calice que je dois inévitablement épuiser. Autant que je me connais, ma grande souffrance, c’est la perplexité, le trouble, l’effroi, le scepticisme que j’apporte à tant d’âmes, et la perte des sentiments bienveillants et de la bonne opinion de
1. Lett. and Corr. of J.-H Newman, t. II, p. 431.
291
tant de gens connus et inconnus qui m’ont voulu du bien... Pendant des jours entiers, j’ai senti littéralement une souffrance aiguë dans toute la région du coeur, et, par moment, toutes les douleurs du Psalmiste semblaient être les miennes1. » Ce ne sont pas ceux qui essayent d’argumenter avec lui qui, comme Manning et Gladstone, font effort pour lui démontrer les titres de l’Eglise d’Angleterre 2, qui embarrassent Newman. Ces contradictions l’affermissent plutôt dans ses idées nouvelles. Il est ému, gêné, en face de ceux qui ne cherchent à le retenir que par un redoublement d’affection. Keble, par exemple, dans ses lettres, lui laisse voir une tristesse inaccoutumée dans cette âme naguère si sereine, une sorte de découragement humilié et repentant; on eût dit qu’il se reprochait d’avoir contribué à ouvrir, sans les avoir préalablement explorées, ces voies nouvelles dont l’issue devenait si inquiétante, et d’avoir été, en cette circonstance, « l’aveugle qui conduit des aveugles » ; mais, chez lui, nulle prétention de disputer; au contraire, la réserve modeste d’un homme qui ne se croit pas en situation d’en remontrer à son interlocuteur, le souci de ne rien dire qui puisse le chagriner ou le troubler, et surtout le besoin de se montrer d’autant plus tendre, plus confiant, qu’il sent son ami plus blâmé et plus affligé. Le seul procédé par lequel il tente d’agir sur lui, c’est de lui rappeler combien de centaines, de milliers de personnes sympathisent avec lui et sentent
1. Apologia. 2. Life of Manning, par Purcell t. I, p. 242 à 159.
292
lui devoir tout ce qu’elles sont 1 ». « Je puis, ajoute-t-il, parler pour l’une, de science certaine. Vos sermons m’ont mis dans la voie, et votre ministère réconfortant m’a aidé au-delà de toute mesure. C’est mon expérience propre, et, partout où je vais, est quelqu’un pour qui vous avez été un canal d’indicible bénédiction. Vous ne devez pas avoir d’amertume, car je sens cela mieux que je ne puis vous le dire, et je suis sûr que l’air même de l’Angleterre, tout autour de vous, dirait la même chose, s’il pouvait avoir une voix. Ces hommes ont eu de vous une aide inexprimable, et c’est maintenant leur tour de vous aider avec leurs prières et leurs bons souhaits 2...» Pusey ne se hasarde pas davantage à engager une controverse avec un esprit dont la perspicacité mobile et subtile le déroute et l’inquiète. Mais, disposé à croire que le trouble de son ami tient surtout à la façon dont il a été traité par ses coreligionnaires, il s’applique àen effacer l’amertume, multiplie les témoignages de tendresse et, sans discuter sur les doctrines, se borne à suggérer des pensées de haute piété. Newman ne veut pas laisser son ami dans cette idée que son ébranlement vient d’une susceptibilité blessée; il lui indique clairement que ce sont ses croyances qui se modifient. « La conviction a grandi en moi, lui écrit-il, et maintenant elle est très forte, que nous ne faisons pas partie de l’Eglise catholique. » Il se préoccupe sans doute du chagrin qu’un tel aveu va causer à son ami « Mais il
1. John Keble, par Lock, p. 114. 425, 141 à 144. 2. Lettre de novembre 1844. ( Ibid., p. 125.)
293
est impossible, ajoute-t-il, qu’il vous prenne tout à fait à l’improviste. » Si ému que soit Pusey de cette révélation, elle ne suffit pas à détruire sa confiance: « J’ai une telle conviction, répondit-il à Newman, que vous êtes sous la conduite de Dieu, que, malgré tout, je regarde joyeusement l’avenir ; je suis sûr que tout ira bien, j’entends pour notre pauvre Eglise et pour vous. » C’est d’ailleurs sur Newman que, dans les épreuves de sa vie privée, Pusey continue à s’appuyer. Ce que celui-ci avait été pour lui, en 1839, lors de la mort de sa femme, il l’est, en avril 1844, lors de la mort de sa fille aînée, cette délicate et pieuse Lucy, dont ce même Newman a écrit: « Elle était une sainte. » Malgré sa santé fragile, elle avait résolu de se vouer, dans le célibat (in a single life), au soin des malades et des pauvres, s’associant ainsi au désir de son père de restaurer dans l’anglicanisme les couvents de religieuses. Elevée par sa mère dans la vénération de Newman, elle le considérait comme son père spirituel. Pusey, rendant compte à ce dernier de la maladie de sa fille et des admirables sentiments qu’elle y témoignait, lui écrivait : « Elle était l’enfant de vos livres (She was a child of your writings). » Et il ajoutait : « Dieu vous le rendra, mon cher ami; voici, dans ma famille, le second lit de mort où je puis sentir quelles bénédictions vos sermons et votre affection ont été pour les miens. » Enfin, quand la séparation est accomplie, c’est dans le coeur de Newman que le malheureux père trouve con-
1. Life of Pusey, t. II, p. 380 à 382.
294
solation à s’épancher: « Que le nom du Seigneur soit béni! lui écrit-il. L’enfant de vos sermons a été acceptée par Dieu, et elle est en paradis. » Puis, après de douloureux détails sur l’agonie : « Soudain ses paupières s’ouvrent toutes grandes, et je n’ai jamais rien vu comme le regard fixé par elle sur des objets invisibles pour nous. J’étais sûr qu’elle voyait Notre-Seigneur... Après que ce regard eut duré quelque temps, elle se tourna vers moi, et alors passa, sur ses lèvres, un sourire céleste, si plein d’amour aussi. En un instant, il changeait toute ma douleur en joie. On eût dit que, déjà en paradis, elle m’invitait à l’y rejoindre. » C’est de Newman que Pusey prend avis sur l’épitaphe, d’une saveur toute catholique, qu’il a rédigée pour sa chère morte : Puella jam in votis Christo desponsata 1. Cette sorte de communion devant une tombe a-t-elle ranimé les illusions de Pusey? Moins que jamais, il parvient à se rendre compte qu’un changement radical s’est produit dans les croyances de son ami. Comme aux jours passés, il veut le consulter sur les actes de son ministère ecclésiastique. Newman se voit obligé, en août 1844, de lui écrire sur ses sentiments à l’égard de l’Eglise anglicane, en termes d’une netteté presque brutale. « Cette fois, répond Pusey, je ne ferme pas les yeux. » Dans son trouble, il se compare au marin sur un navire en détresse. « Il me semble, ajoute-t-il, que les eaux se soient amoncelées de chaque côté, et cependant j’ai foi que nous sommes Israël et non l’armée de Pharaon, et que ces eaux ne tomberont pas sur nous.
1. Life of Pusey, t. II, p. 385, 386.
295
Je puis à peine faire quelque chose ou prendre intérêt à quoi que ce soit. Peut-être vaut-il mieux qu’il en soit ainsi... J’ai comme l’impression que je suis en train de bâtir avec une mine sous les fondations 1. » Et cependant, si rude que soit le coup pour Pusey, il ne paraît pas que l’effet en soit durable. Quelques mois plus tard, à la fin de 1844, il écrit à quelqu’un qui l’a interrogé : « Vous avez tout à fait raison de croire que Newman n’a aucun sentiment qui tende à le séparer de nous; toutes ses sympathies sont pour notre Eglise 2.» Plus Pusey souffre et s’inquiète, plus il sent le besoin d’alimenter et de développer à a dévotion. Fait curieux, cet homme, si réfractaire à toute tentation romaine, se met, pour cette dévotion, à l’école de Rome. Au chevet de sa fille mourante, il lui lit des livres de saint François de Sales; pendant son agonie, il lui suggère la prière de saint Ignace : Anima Christi, et des invocations à la Sainte Face. Il a entrepris, depuis quelque temps, sous ce titre: Devotional Library, la publication d’ouvrages catholiques traduits et adaptés par lui à l’usage des anglicans, tels que les Guides pour l’Avent et le Carême d’Avrillon; le Fondement de la vie spirituelle, par Surin ; le Combat spirituel, par Scupoli; la Vie de Notre-Seigneur, par saint Bonaventure, sans compter de petits manuels sur la dévotion à la Passion, à l’Eucharistie, etc. Dans les préfaces de ces livres, il parle favorablement des doctrines de saint Ignace de Loyola, recommande la confession et les mortifications
1. Life of Pusey, t. II, p 407. 2. Ibid., t. II, p. 445.
296
corporelles. C’est pour lui un regret de ne connaître qu’imparfaitement tout ce qu’ont publié, sur ces matières, les auteurs catholiques étrangers; en septembre 1844, il écrit à Hope Scott qui voyage sur le continent, de s’informer des ouvrages ascétiques, italiens ou allemands, qui pourraient être ajoutés à sa collection; il l’invite, par la même occasion, à demander aux prêtres, directeurs de conscience, des renseignements sur l’usage des pénitences corporelles, notamment de la discipline dont il désire avoir un spécimen 1. En fait, les publications de Pusey ont aidé plusieurs âmes à se rapprocher de la vraie foi; elles les ont en quelque sorte acclimatées à la piété catholique. De ce résultat, on a plus d’un témoignage 2. Pusey n’avait pas idée que rien de semblable pût se produire. Vers la fin de 1843, il avait consulté Newman sur ses publications catholiques et, en particulier, sur l’idée qu’il avait de traduire le bréviaire. Newman s’était cru, en loyauté, obligé de l’avertir qu’une telle oeuvre acheminerait les esprits vers Rome. « Je ne pense pas, disait-il, que notre système puisse la porter. C’est comme si l’on voulait coudre une pièce d’étoffe neuve à un vieux vêtement. » Pusey n’avait pas eu égard à une objection qu’il ne comprenait pas. Il faudra, pour lui faire suspendre plus tard ces adaptations, une sorte de soulèvement de l’opinion anglicane et l’intervention des évêques.
1. Memoirs of J.-R. Hope Scott, t. II, p. 45. 2. Voir, par exemple, Some Side-Lights on the Oxford Movement, par Minima Parspartis, p. 8, 9, 263.
297
Pusey tenait d’ailleurs à honneur de ne pas se laisser aller contre l’Eglise romaine, à l’irritation que suscitaient, chez plus d’un High Churchman, les menaces de sécession; loin de considérer cette Eglise comme l’ennemie, il y voyait une alliée, et il adressait des représentations à ceux de ses amis qui comparaient les séductions de Rome à celles de Satan et de l’Antéchrist 1. Vainement, lui disait-on qu’il s’exposait ainsi, à des soupçons, il ne s’en troublait pas 2. Cette conduite contrastait avec celle de Manning qui jugeait, au contraire, nécessaire de donner des gages à l’opinion protestante inquiète et qui, à la fin de 1843, quand les esprits étaient encore troublés de la récente démission de Newman, prêchait à Oxford, dans la chaire même de Sainte-Marie, le « sermon du 5 novembre », commémoratif du complot de Guy Fawkes : il y attaquait violemment le papisme, en même temps qu’il exaltait la Réforme. Le fait fut jugé sévèrement, dans le monde tractarien, par Keble, par Pusey, et l’orateur, s’étant
1. Pusey écrivait à l’un de ces High Churchmen: « Je suis effrayé de vous voir appeler Rome l’Antéchrist ou son précurseur. Je crois que l’Antéchrist sera infidèle et sortira de ce qui s’appelle soi-même le protestantisme, et que Rome et l’Angleterre ne feront qu’un pour s’y opposer... Je pense que les sectes voient plus loin que vous, quand elles classent ensemble le papisme et le puseyisme, c’est-à-dire que les Eglises et ce qui admet la soumission à une autorité seront d’un côté, les sectes et le jugement privé, de l’autre... Je désire que vous ne vous laissiez pas entraîner par vos craintes du papisme. Pendant ce temps, l’ennemi (l’hérésie de toutes sortes, erreur, incrédulité) prend possession de notre citadelle. Notre vraie bataille est avec l’infidélité, et c’est de cela que Satan cherche à nous détourner.» (Life of Pusey, t. II, p. 447. — Voir aussi Ibid., p. 454-456.)
2. Ibid., t. II, p. 456, 457.
298
présenté le lendemain à Littlemore, pour voir Newman et lui expliquer sa conduite, n’y fut pas reçu 1.
II
L’un des effets de la retraite de Newman était de mettre en quelque sorte la bride sur le cou aux ardents du tractarianisme, à ceux qu’on appelait le parti extrême. Ward entre autres avait garde de ne pas en profiter. La hardiesse provocante de ses écrits faisait naturellement scandale chez les tenants du vieux parti High Church. L’un d’eux, Palmer, ayant vainement demandé à Newman un désaveu, se décida à publier, à la fin de 1843, une brochure où il protestait, avec une sévérité attristée, contre le romanisme dont faisaient étalage des membres de l’Eglise d’Angleterre 2. Ward fit tête à l’attaque. Privé de son organe accoutumé, le British Critic, que l’éditeur effrayé venait de suspendre, il entreprit, lui aussi, d’écrire une brochure qui, en quelques mois, devint, sous sa plume féconde et hâtive, un gros volume de six cents pages, lourd, désordonné, indigeste, mais substantiel, puissant et surtout animé d’une rare ferveur morale. Il parut, en juin 1844, sous ce titre : l’idéal d’une Église chrétienne, considéré par rapport à la pratique existante. Après avoir établi quel était cet idéal, l’auteur montrait à quel point l’Eglise d’Angleterre en était loin, flétrissait les
1. Life of Card. Manning, t. I, p. 241 à 253. 2. A Narrative of events connected with the publication of the « Tracts for the Times » with reflections on existing tendencies to Romanism.
299
réformateurs dont elle descendait, dénonçait son désaccord avec les Pères, sa séparation des autres parties de l’Eglise catholique, sa servitude à l’égard de l’Etat, son manque de théologie, sa faiblesse, son indifférence ou sa connivence à l’égard de l’hérésie, et surtout l’abaissement de son niveau spirituel, sa totale ignorance de l’ascétisme, son impuissance à susciter, à nourrir ou même seulement à concevoir la sainteté. Puis, sur tous ces points, à cette Eglise « dégradée» il opposait l’Eglise romaine, dans laquelle, en dépit de certaines corruptions, il reconnaissait les caractères essentiels de l’Eglise idéale. Non qu’il en conclût à s’unir immédiatement à Rome; dans sa pensée, l’Eglise anglicane gardait toujours son existence distincte; seulement il lui signifiait qu’elle devait se transformer, en prenant l’Eglise romaine pour modèle; il la sommait de reconnaître en celle-ci l’autorité divine et de se repentir humblement du grand péché qu’elle avait commis en se séparant de sa communion. Tout au plus consentait-il que, dans cette adaptation à l’idéal romain, on procédât par étapes, mais sans rien voiler du but à atteindre. Aussi, loin de se défendre du romanisme dont l’accusait Palmer, s’en faisait-il honneur. Il se félicitait, comme « du plus heureux, du plus merveilleux et du plus inattendu des spectacles », de voir « tout le cycle de la doctrine romaine prenant graduellement possession de nombre de churchmen anglais ». Au lieu de ménager ses adversaires, il se faisait un plaisir de les braver, de les irriter; on eût dit que, las et dégoûté d’une situation trouble, inconséquente,
300
équivoque, il avait pris son parti de précipiter la crise. Comment expliquer autrement que, connaissant, comme il le faisait, les sentiments des autorités universitaires et ecclésiastiques, il leur jetât ce défi si nettement prémédité « Trois années se sont passées depuis que j’ai dit formellement qu’en souscrivant les Articles je ne répudiais aucune doctrine romaine; cependant je conserve mon fellowship que je tiens sous la condition de cette souscription, et je n’ai reçu de censure ecclésiastique sous aucune forme. » Aussitôt paru, le livre de Ward est très attaqué. Les tractarians modérés n’en sont pas les moins mécontents. Gladstone se fait l’interprète de ce mécontentement, dans un article imposant du Quarterly Review. Newman, lui-même, qui a pris intérêt à la composition de l’ouvrage, est loin d’être satisfait de l’exécution. Il n’est guère que Oakeley et certains jeunes gens qui se proclament en plein accord avec l’auteur. Que vont faire les autorités qu’il a défiées? C’est seulement au retour des vacances de l’Université, en octobre 1844, que le conseil des chefs de Collèges (Board of heads of houses) peut se saisir de la question. Ses résolutions sont arrêtées au milieu de décembre; il a relevé, dans le livre de Ward, une série de passages qu’il juge incompatibles avec une loyale souscription des XXXIX Articles, et il annonce l’intention de proposer à la Convocation: 1° de condamner le livre; 2° de priver l’auteur de ses grades universitaires; 3° d’ajouter à la souscription des Articles, exigée des membres de l’Université, la déclaration qu’ils les entendent dans le sens où ils ont
301
été primitivement publiés et ois ils sont actuellement imposés par l’Université, ce sous peine d’expulsion. Les chefs de Collèges se laissaient emporter par leur passion, au-delà de ce que pouvait accepter le tempérament de l’Université. S’ils se fussent bornés à la première mesure, ils n’eussent soulevé à peu près aucune opposition. Mais la seconde paraît plus contestable, et la troisième surtout révolte ceux-là mêmes qui blâment le plus le livre de Ward. Un cri général s’élève contre cette prétention d’exiger un nouveau test qui serait l’ostracisme de toute une partie de l’Université. Les tractarians, tout à l’heure divisés, se retrouvent unanimes pour protester. Pusey annonce que, si cette déclaration est exigée, il la refusera. Keble publie contre elle une brochure considérable. Des High Churchmen encore plus éloignés de Ward, comme Moberly et Gladstone, font connaître leur désapprobation. L’opposition s’étend dans les rangs des libéraux. C’est, chez eux, l’indice d’un nouvel état d’esprit. Jusque-là, emportés par une animosité dont on a pu constater la vivacité chez Arnold, ils avaient paru empressés à seconder toutes les mesures de rigueur contre les tractarians; en 1841, lors de la censure du tract 90, Stanley, à cette époque, absent d’Oxford, avait été seul de son parti à regretter qu’une mesure fût prise pour restreindre la liberté d’interprétation des Articles. En 1844, Arnold est mort, et les idées plus tolérantes de Stanley ont gagné du terrain. Si l’archevêque Whately, fidèle à la vieille passion, pousse les chefs de Collèges à user de rigueur, Stanley et plusieurs autres, Maurice,
302
Donkin, Huil, Milman, s’élèvent au contraire contre leurs propositions, particulièrement contre le nouveau test; il leur paraît politique de défendre, chez ceux qui ne pensent pas comme eux, une liberté d’interprétation dont ils comptent user dans un sens différent, et puis il ne leur déplaît pas de prendre ainsi sous leur protection légèrement ironique et dédaigneuse ces tractarians qu’ils avaient accusés d’intolérance lors de l’affaire Hampden. Tait lui-même, promoteur de la censure de 1841, qu’on croyait acquis à toute mesure de combat, publie, contre la déclaration proposée, une brochure très fortement raisonnée. Déconcertés d’une opposition si vive et si étendue, les chefs de Collèges ne peuvent se cacher qu’à persister dans leur premier projet, ils vont au-devant d’un échec. La Convocation devait se réunir le 13 février 1845; le 23 janvier, un avis fait connaître que la troisième proposition est retirée. Mais, comme si les adversaires des tractarians ne pouvaient se résigner à ne pas viser plus loin et plus haut que Ward, ils lancent, deux jours après, une pétition tendant à ce que la Convocation soit appelée à prononcer une censure formelle contre le tract 90, et, le 4 février, le conseil des chefs de Collèges déclare accueillir cette demande. On se flatte que le peu de temps qui sépare de la réunion ne permettra pas à la résistance de s’organiser. Les tractarians, cependant, se remuent: Pusey est des plus actifs. Stanley et ses amis, cette fois encore, sont avec l’opposition. Des personnages influents, entre autres Gladstone, suggèrent l’idée que ce serait le cas pour les
303
Proctors, dont l’un, Church, se trouve être l’ami de Newman, d’user de leur veto. Ce veto n’a-t-il pas été précisément établi pour empêcher les mesures hâtives et inconsidérées? Le 13 février, la Convocation se réunit au théâtre. Au dehors, sévit une tempête de neige, Environ quinze cents membres de l’Université se pressent dans la salle, beaucoup venus de Londres ou des autres parties de l’Angleterre. L’excitation est extrême dans les deux camps. Tout Oxford est sur pied, attendant avec une anxiété passionnée le résultat de la délibération. En général, les étudiants, hostiles par tempérament aux abus d’autorité, prennent parti pour l’accusé, et quelques-uns d’entre eux, grimpés sur un toit, témoignent de leurs sentiments, en criblant de boules de neige le vice-chancelier à son passage. En séance, aussitôt les griefs exposés par le greffier, Ward présente sa défense; il a eu permission du vice-chancelier de s’exprimer en anglais. Il parle plus d’une heure, avec un grand accent de conviction, très maître de soi, du ton qu’il aurait eu dans le common room de son collège, mais sans souci d’amadouer ses juges. Bien au contraire, il dit très simplement, comme allant de soi, les choses qui peuvent le plus les scandaliser, les irriter, les humilier. Toute sa justification est fondée sur l’inconséquence irrémédiable de l’Eglise d’Angleterre; il reconnaît qu’il prend les Articles dans un sens qui n’est pas leur sens naturel, mais il met au défi les autres partis de l’anglicanisme de pouvoir faire autrement pour leur compte; il déclare, en passant, comme
304
si cela ne pouvait étonner personne, qu’il admet « tout le cycle dela doctrine romaine ». Après Ward, personne autre ne prend la parole, et l’on passe au vote. La censure est votée par 777 voix contre 391; la dégradation par 569 contre 511. Quand la troisième proposition contre le tract 90 est mise aux voix, des cris de non et de placet se heurtent de tous les coins de la salle; mais le tumulte est dominé par la voix du doyen des Procbors, M. Guillemard; la formule solennelle: Nobis procuratoribus non placet, est accueillie par des bravos 1. Le vice-chancelier lève aussitôt la séance, et les membres se dispersent à travers la neige qui tombe. A sa sortie, Ward est acclamé par les étudiants, acclamations aussitôt mêlées d’éclats de rire, quand on le voit, dans sa hâte, s’étaler dans la neige, en laissant échapper tous ses papiers. Avec ce personnage, il était toujours un peu à craindre que le bouffon ne se mêlât au dramatique. Peu de jours après cette condamnation qui faisait de lui une sorte de martyr, la nouvelle se répand tout à coup que ce grand admirateur de toutes les choses romaines, y compris le célibat des prêtres, se mariait. Ce mariage, décidé depuis quelque temps, avait été, par prudence, tenu secret jusqu’après la séance de la Convocation. C’est, dans Oxford, un mouvement de surprise qui, cette fois encore, se termine par un éclat de rire. Les journaux sont remplis, pendant quelques jours, de quolibets et d’épithalames satiriques à l’adresse du nouveau marié. Du coup, la sympathie naguère ressentie pour la victime d’un procédé violent, s’évanouit. Il semble, bien à tort, que ni le personnage, ni sa cause
305
ne méritent plus d’être pris au sérieux. En somme, l’impression dernière du procès n’est pas favorable au parti tractarien. Si les chefs de Collège n’ont pas obtenu de la Convocation tout ce qu’ils en espéraient, il ne paraît pas moins résulter des votes émis que ce parti est répudié par l’Université, sur laquelle il avait cherché à s’appuyer et qu’il avait été sur le point d’entraîner et de dominer. La condamnation de Ward est suivie d’un épilogue qui en aggrave encore la portée. L’ami le plus dévoué du condamné, Oakeley, qui, depuis 1839, exerçait son ministère dans la chapelle d’Old Margaret Street, à Londres, ne s’est pas contenté d’écrire au vice-chancelier de l’Université qu’il partageait toutes les opinions censurées; il a tenu à honneur de notifier à son propre évêque « qu’il croyait à toute la doctrine romaine, bien qu’il ne revendiquât pas le droit de l’enseigner» Cette sorte de défi est d’autant plus mal reçu que son auteur a déjà eu des difficultés avec l’autorité épiscopale : le culte qu’il a institué dans sa chapelle, le genre de piété qu’il y a suscitée, en vue d’y mettre en pratique les doctrines du Mouvement, l’ont fait accuser de romanisme, et, à plusieurs reprises, l’évêque de Londres lui a adressé des représentations. Cette fois, le prélat juge une répression nécessaire et, sans s’arrêter à l’offre que lui fait Oakeley de résigner son bénéfice, il le défère à la cour des Arches 1. Celle-ci, en juin 1845,
1. La Cour des Arches, bien que n’étant plus composée que de juges laïques, décidait des causes ecclésiastiques de la province de Canterbury.
306
se fondant sur les « opinions romanisantes » du ministre incriminé, le frappe de suspension perpétuelle. La disgrâce des tractarians semble donc complète. Répudiés par l’Université, ils le sont encore par l’épiscopat et par les cours de justice. Ceux d’entre eux qui, comme Pusey, se piquent de modération, qui, pacificateurs non écoutés, se sont vainement interposés pour prévenir le conflit, qui n’ont pu obtenir ni que les uns fussent prudents, ni que les autres fussent indulgents, sont réduits à constater tristement le désastre de leur cause. Et, si fâcheux que soit le présent, l’avenir leur paraît plus sombre encore; ils sentent la direction des événements leur échapper, la crise se précipiter. « La situation, dit Manning, me semble de la dernière gravité. »
III
Quel va être le contre-coup de ces événements sur l’âme de Newman? Ne sera-ce pas le signal d’une sécession que chacun pressent être de jour en jour plus probable ? Cette question pèse sur beaucoup d’esprits, non seulement sur les anciens amis dont le coeur se déchire à la pensée d’une séparation, mais même sur plus d’un adversaire qui ne peut s’empêcher de redouter, pour l’Eglise d’Angleterre, la diminution qui résultera d’une telle perte Durant les polémiques qui ont précédé la Convocation, même au moment où le tract 90
1. Voir, par exemple, une lettre de Jowett, de janvier 1845. Life and Letters of B. Jowett, t. I, p. 116.
307
était directement visé, Newman, en dépit des appels de ses amis effarés, a gardé le silence et témoigné une dédaigneuse indifférence. Lui-même l’a dit, il « se sentait comme mort par rapport à l’Eglise anglicane ». « Cette affaire, écrit-il le 11 février 1845, ne m’a pas un moment peiné tu intéressé... Je m’en suis allé trop loin pour cela. (I am too far gone for that.)» Et, quelques jours avant, il faisait à Pusey ces déclarations plus inquiétantes encore : « Je ne serais pas honnête, si je ne commençais par vous dire que je serais content, pour ce qui me regarde personnellement, que ce décret passât. Longtemps, en effet, j’ai attendu des circonstances extérieures pour déterminer ma course, et je ne désire pas que ce jour soit écarté 2.» C’est qu’en effet, depuis quelque temps, le travail intérieur de Newman a fait de grands progrès. Sa conscience a fini par s’inquiéter d’une attente qui lui avait paru longtemps légitime, et elle se pose maintenant la question sous cette forme : « Serais-je en sûreté si je mourais cette nuit? Est-ce pour moi un péché mortel de ne pas entrer dans une autre communion 3?» Pour sortir de cette immobilité, il s’est résolument engagé dans une voie où il croit trouver la fin de ses doutes. Il s’est mis à examiner si les dogmes nouveaux qu’il avait jusqu’alors reprochés à l’Eglise romaine, comme des corruptions de la foi primitive, n’en sont pas le
1. Apologia. 2. Life of Pusey, t. II, p. 428, 429. 3. Lettre du 8 janvier 1845. (Apologia.)
308
développement régulier. C’est aborder cette théorie du Développement de la doctrine religieuse, dont le germe existait chez certains Pères et que Wiseman, avec son intuition si perspicace des besoins de son temps et de son pays, avait, dès 1839, exposée dans un sermon célèbre 1. Elle peut se résumer ainsi : le dogme chrétien, étant une idée vivante, ne saurait demeurer stationnaire; il a dû se transformer, s’enrichir, s’agrandir, par l’effet de ses relations avec le monde où la religion est appelée à vivre; d’ailleurs, nul ne peut nier que ce développement ne se soit produit à l’origine de l’Eglise, au temps des Apôtres, et l’on ne voit pas pourquoi il se serait arrêté à la mort du dernier de ces Apôtres; il s’est continué depuis, selon les circonstances, selon les besoins, et il continuera dans l’avenir; le dépôt de la foi est, en effet, assez vaste pour qu’on en puisse tirer, jusqu’à la fin des siècles, des vérités dites à tort nouvelles; si donc l’erreur peut se manifester par des innovations téméraires, elle peut résulter aussi de l’obstination à ne pas suivre l’idée dans son évolution légitime ; ce qu’il importe, c’est d’établir à quels caractères le vrai développement se distingue du faux; ces caractères une fois fixés, reste à voir s’ils ne se rencontrent pas dans l’oeuvre de l’Eglise catholique, si surtout ce développement n’implique pas, ce que cette Eglise seule possède, une autorité infaillible pour le diriger et le préserver 2,
1 Life and Times of Card. Wiseman, t. 1, p. 314 à 319. 2. Voir, dans la Revue du Clergé français du 1er décembre 1898, un article remarquable sur le Développement chrétien, d’après le Cardinal Newman. L’auteur de l’article, qui se dissimule sous un pseudonyme, est un de nos plus savants exégètes. Il indique toutes les ressources qu’offre cette théorie pour répondre aux objections que la science antichrétienne prétend tirer des récentes découvertes de la critique historique sur nos origines religieuses.
309
C’est au commencement de 1843 que Newman avait commencé à considérer cette idée du développement; à la fin de 1844, voulant l’éprouver définitivement et mettre un terme à ses doutes, il s’est décidé à écrire un essai sur ce sujet. Des conclusions auxquelles il arrivera dépendra le parti qu’il prendra à l’égard de son Eglise. Jamais livre a-t-il été composé dans de telles conditions et, pour ainsi parler, avec un tel enjeu? Aussi, quand on le lit aujourd’hui, ressent-on une émotion singulière, à la pensée que, derrière cette discussion scientifique si nourrie et si serrée, se cache le plus personnel et le plus poignant des drames, celui d’une âme qui brise ses plus chères attaches pour s’élever vers la lumière. Ne peut-on pas en dire ce que l’auteur y dit du dogme, qu’on est en face non d’une idée abstraite, immobile et comme insensible, mais d’une idée qui vit, marche, grandit, on pourrait presque dire qui souffre et qui mérite? Dans le travail ainsi entrepris et auquel il s’est mis tout de suite avec une extrême ardeur, Newman ne tarde pas à rencontrer la lumière qu’il cherche : plus il avance, plus ses incertitudes se dissipent. A la fin de l’hiver de 1845, l’issue lui paraît assez sûre pour qu’il juge loyal d’avertir ceux de ses anciens amis qui n’ont pu encore se faire à l’idée de sa sécession 1.
1. Apologia. — Lett. and Corr. of J-H. Newman, t. II, p. 457 à 466.
310
« Ne vous cachez pas à vous-même, mande-t-il dès le 25 février à son cher Pusey, que je suis aussi près du pas décisif que si, en réalité, je l’avais fait. Ce n’est plus qu’une affaire de temps. J’attends, pour que, si je suis, par hasard, le jouet d’une illusion, Dieu me le fasse sentir. » Et, le 12 mars « Je suppose que Noël ne se passera pas avant la rupture 1. » Par plus d’un côté, sans doute, la perspective de cette rupture fait saigner son coeur. « Mes yeux, écrit-il le 3 avril, se mouillent de larmes, à la pensée de toutes les choses aimées qu’il me faut abandonner. » Et encore : « Je sens peser sur moi, sans relâche, la main de Celui qui est toute sagesse... Mon coeur et mon esprit sont épuisés de fatigue, comme peuvent l’être nos membres quand un fardeau pèse sur nos épaules 2. » Mais cette souffrance même ne prouve .telle pas à quelle nécessité supérieure il obéit? Dans une lettre du 15 mars, adressée à sa soeur, il énumère ainsi quelques-uns des sacrifices qu’il fait : « J’ai un bon renom auprès de plusieurs, je le sacrifie délibérément; j’en ai un mauvais auprès d’un plus grand nombre, je comble leurs pires désirs et leur donne le triomphe qu ils ambitionnent le plus. Je rends malheureux tous ceux que j’aime, je désoriente tous ceux que j ai instruits ou aidés. Je vais à ceux que je ne connais pas et dont j’attends très peu. Je fais de moi un exilé, et cela à mon âge. Oh! qu’est-ce qui peut m’y déterminer, sinon une puissante nécessité 3? ». Comme j’ai déjà eu
1. Life of Pusey, t. II, p. 448 et sq. 2. Apologia. 3. Lett. and Corr., t. II, p. 459.
311
souvent occasion de le noter, la douleur qu’il cause aux autres le touche plus encore que son sacrifice personnel; c’est la pensée qui lui revient sans cesse et semble faire sortir un gémissement de toutes ses lettres. Et cependant, grâce à sa conviction affermie, il se sent plus de force pour porter cette douleur. La tristesse subsiste, mais l’angoisse a disparu. Il est toujours ému du désarroi où il jette les âmes, mais il commence à entrevoir que ce désarroi peut leur être salutaire. « Je ne désire pas, écrit-il le 13 mars, qu’elles changent parce que je change moi-même, mais je ne puis être fâché qu’elles prennent mon changement comme une sorte d’avertissement de considérer où est la vérité 1. » Et surtout il n’est pas de sollicitations, si affectueuses, si pathétiques soient-elles, qui entament sa conviction. Il répond, avec émotion, mais aussi avec fermeté, aux amis qui les lui adressent. Ainsi fait-il à Pusey, qui, en mars, lui a envoyé une suprême adjuration; il lui raconte longuement la marche de son esprit, ses premiers doutes, ce qu’il a fait pour les rejeter et pour trouver, même contre toute espérance, un fondement acceptable à son Eglise, et comment son effort a échoué 2. » Cette fois Pusey ne peut plus se faire d’illusion. Il sent le coup porté à « sa pauvre Eglise». « Ce sera, écrit-il le 21 mars, une déchirure comme jamais elle n’en a connu. Tant sont déjà en suspens! Outre ceux-là, des centaines voudront le suivre. » Il n’entrevoit
1. Lettre du 14 mars 1845. (Life of Pusey, t. II, p. 450, 451.) 2. Ibid., t. II, p. 453.
312
qu’un moyen de les retenir. « J’espère, écrit-il peu après à Keble, qu’on pourra amener les gens à croire que Newman a une vocation, une mission spéciale, et que ses disciples n’ont pas le droit de le suivre. » Chez Pusey, cette idée un peu singulière n’est pas seulement une tactique, c’est une conviction née de l’impossibilité de concilier autrement son estime pour Newman et son attachement à l’Eglise que Newman abandonne. « Je vois là, dit-il, l’oeuvre d’une Providence mystérieuse, comme si Dieu appelait cet instrument choisi pour remplir quelque office dans l’Eglise de Rome (quoique, bien entendu, il y aille non pas en réformateur, mais en croyant), et ainsi Dieu lui donnerait des convictions qu’il ne donne pas aux autres. Du moins, j’en suis venu à cette idée, quand j’ai compris qu’il allait se convertir 1. » C’est que ceux qui ont connu et aimé Newman ne peuvent pas penser mal de lui, alors même qu’ils ne croient pas devoir le suivre. Tel l’excellent Marriott, qui, à la révélation de cette séparation prochaine, ne sait répondre, le 15 janvier, qu’en rappelant, en termes touchants, combien « la conduite de Newman envers l’Eglise d’Angleterre a toujours été généreuse, délicate et, s’il peut encore se servir d’un pareil mot, filiale». Il ajoute, avec sa modestie accoutumée : « J’ai souffert à chaque anneau que vous avez brisé, et je ne vous ai pas interrogé, parce que je sentais que vous deviez mesurer la confidence de vos pensées à l’occasion et aussi à la capacité de ceux à qui
1. Life of Pusey, t. II. p. 453,
313
vous parliez. J’écris à la hâte, au milieu d’occupations absorbantes, en partie privées de leur saveur, en partie rendues amères par ce que je viens d’apprendre. Mais je suis prêt à vous remettre, vous qui êtes ce que j’aime le mieux au monde, entre les mains de Dieu, priant ardemment qu’il lui plaise de se servir de vous de là manière la plus utile à la sainte Eglise catholique 1. » Avant de faire le dernier pas qu’il a ainsi annoncé à ses amis, Newman s’est imposé de mener à fin son Essai sur le Développement de la doctrine chrétienne. II y travaille sans relâche, y donnant tout son temps. A peine s’interrompt-il quelques instants, après chaque repas, pour tenir compagnie aux jeunes gens qui forment alors la communauté de Littlemore, Saint-John, Dalgairns, Bowles, Stanton. Alors, avec le charme habituel de sa conversation, il cause de mille sujets, de préférence des souvenirs du passé, mais jamais du travail qui l’occupe et de la question redoutable qui pèse sur sa conscience et sur la leur. Il semble tacitement admis que le temps des arguments et des controverses est passé, et que la prière, la méditation solitaire sont les meilleurs moyens de coopérer à la grâce divine. Newman ne fait exception que pour l’un de ces jeunes gens, auquel il ouvre parfois quelque chose de ses secrètes pensées : c’est le « cher Ambroise Saint John », qui prend alors auprès de cette âme ayant tant besoin de tendresse et d’intimité, la place laissée
1. Apologia.
314
vide par l’éloignement graduel des confidents d’autrefois 1. Les autres disciples se bornent à considérer avec respect, et aussi avec une sorte de terreur religieuse, leur impénétrable maître, absorbé dans son mystérieux ouvrage, toujours debout à son bureau, où il écrit jusqu’à quatorze heures par jour. Ils ont raconté plus tard qu’il leur semblait pâlir et s’amincir chaque jour davantage, si bien qu’à la fin, quand il travaillait devant la fenêtre ensoleillée, on eût dit qu’il était devenu presque transparent. Du reste, si Newman se tait, plus d’un indice laisse deviner à ses compagnons où il tend; on remarque qu’il a cessé de lire le service anglican de la communion; un des derniers arrivés a su qu’à moins d’être prêt à se convertir au catholicisme romain il ne serait pas admis dans la petite communauté. Seulement tout cela demeure secret à Littlemore, on ne parle pas tout haut du dénouement que chacun pressent 2. Si proche que Newman soit alors de sa conversion, il persiste à se tenir à l’écart des catholiques, particu-
1. Georges Elliott ne trouvait rien de plus tendre et de plus émouvant que l’espèce de dédicace adressée par Newman, en finissant son Apologia, à cet ami de la dernière crise : « A vous spécialement, cher Ambroise Saint John que Dieu m’a donné après m’avoir retiré tous les autres; à vous qui êtes le lien entre ma vie ancienne et ma vie nouvelle, qui, depuis vingt-quatre ans, avez été pour moi si dévoué, si patient, si zélé, si tendre, qui m’avez laissé m’appuyer si pesamment sur vous, qui avez veillé sur moi de si près, qui n’avez jamais pensé à vous lorsqu’il s’agissait de moi. » Saint-John devait être un des premiers compagnons de Newman, dans la fondation de l’Oratoire. 2. Life and Times of Card.Wiserman, t. I, p. 425 à 427.— Cardinal Newman, par Hutton, p. 185.
315
lièrement des prêtres, contre lesquels il garde toujours quelque chose de ses anciennes méfiances et antipathies. « Je n’ai, écrit-il vers cette époque, aucune sympathie présente pour des catholiques romains. A peine, même à l’étranger, ai-je assisté à l’une des cérémonies de leur culte. Je ne connais personne parmi eux; je n’aime pas ce que j’entends dire d’eux 1. » Ainsi, jusqu’au bout, ce retour à la vérité demeurait l’oeuvre, en quelque sorte spontanée, de quelques âmes d’anglicans, sans intervention étrangère, ou, pour parler plus exactement, il était l’action directe et immédiate de la grâce divine, et l’on s’acheminait à ce résultat vraiment extraordinaire et sans précédent, d’hommes qui, suivant les paroles mêmes de deux de ces convertis, allaient « se soumettre à l’Eglise, sans avoir subi l’influence d’aucun catholique vivant, sans avoir mis le pied dans une église catholique ni vu la figure d’un prêtre catholique 2» Wiseman était le premier à reconnaître, dans une lettre alors adressée aux évêques de France, que « ce qui se passait en Angleterre ne pouvait s’expliquer ni par l’activité des catholiques, ni par les prédications du clergé ». « Bien au contraire, ajoutait-il avec une sincérité modeste, il semble que toute intervention de notre part, ayant pour objet de hâter désiré de ce grand mouvement, ait eu pour résultat de retarder plutôt que de seconder
1. Lettre du 16 novembre 1844. (Apologia.) 2. Ces expressions sont du P. Morris, dans Catholic England in modern Times, et du cardinal Manning, dans l’introduction de England and Christendom, p. XXXIV.
316
les appels qui se produisaient. » Il saluait donc là « une impulsion spontanée de la grâce et une succession providentielle de circonstances 1». Pour être réduit à une inaction singulièrement pénible à son ardente nature, Wiseman n’en est que plus anxieux et plus impatient. Le procès de Ward, dont il a suivi avec émotion toutes les péripéties, lui a paru devoir précipiter le dénouement, et, depuis la condamnation, il attend, de jour en jour, la nouvelle de l’abjuration de Newman. Mais les
1. Cité par le P. Ragey. (La Crise religieuse en Angleterre, p. 51). Newman a fait allusion à ce caractère particulier du mouvement qui l’avait amené, lui et ses amis, à l’Eglise catholique, dans un sermon prononcé, quelques années après sa conversion, à l’installation du premier évêque de Birmingham. « De même, y disait-il, que, lors de la résurrection de Jésus-Christ, les hommes n’en eurent pas connaissance, car il ressuscita à minuit et en silence; ainsi, lorsqu’il voulut, dans sa miséricorde, accomplir sa nouvelle oeuvre parmi nous, il opéra secrètement, et il avait ressuscité, sans que les hommes y eussent même pensé. Il n’envoya pas, comme dans l’origine, ses apôtres et ses missionnaires, de la cité où il a fixé son trône. Ses prêtres, rares et dispersés, étaient occupés à la tâche qui leur était confiée, veillant la nuit sur leur troupeau et manquant de loisir pour songer aux multitudes qui criaient autour d’eux, sans avoir même la pensée que le pays pût se convertir. Mais il vint comme un Esprit sur les eaux; il marcha, de côté et d’autre, sur l’abîme sombre et agité, et, chose admirable à voir et inexplicable pour l’homme, les coeurs furent émus, les yeux s’élevèrent à l’espérance et les pieds commencèrent à se mouvoir vers la grande mère qui avait presque renoncé à penser à eux et à les chercher. D’abord l’un et puis un autre cherchèrent le repos qu’elle seule pouvait donner un premier, et un second, et un troisième, et un quatrième, chacun à son tour, selon que la grâce les touchait; ils ne venaient pas tous à la fois, comme si c’était une affaire de parti ou de politique; mais chacun était attiré par un pouvoir divin, et contre sa volonté, car il était heureux où il se trouvait, volontairement toutefois, car il était subjugué d’une manière aimable par la douce et mystérieuse influence qui l’appelait. L’un après l’autre, sans qu’on y prit garde, en silence, promptement, et pourtant nombreux, ils se pressaient d’entrer, jusqu’à ce qu’enfin tous pussent voir que la pierre était renversée, que Jésus-Christ était ressuscité et qu’il avait disparu. »
317
semaines, les mois s’écoulent, et il n’entend rien annoncer. L’attente lui est d’autant plus douloureuse qu’il a conscience de ne pouvoir rien pour l’abréger. Autour de lui, ne voit-il pas déjà triompher de sa déception, ces catholiques qui ont toujours traité ses espérances de chimériques et qui naguère se réjouissaient de l’apostasie du converti Sibthorpe, comme d’une leçon salutaire? En juillet, il n’y tient plus et députe un récent converti, Bernard Smith, pour aller, sous prétexte de visite à Newman, examiner ce qui se passe à Littlemore. Newman reçoit Smith avec une froideur marquée, lui dit quelques mots, puis quitte la salle, en le laissant avec ses jeunes disciples. Ceux-ci se montrent plus disposés à causer; après quelques échanges d’idées sur des questions de doctrine ou de pratique, ils témoignent d’une curiosité un peu inquiète au sujet de ces prêtres catholiques dans la compagnie desquels leur ancien collègue vit maintenant à Oscott; ne sont-ce pas des hommes « sans éducation », avec lesquels la cohabitation est « impossible »? Ils sont surpris et rassurés d’apprendre qu’un homme qui a eu leurs habitudes et leurs goûts se plait dans ce milieu. A l’heure du repas, Newman reparaît; il entre lentement dans la salle et s’arrête un moment, avant de s’asseoir. Smith remarque qu’il a un pantalon gris. Sachant la rigueur de ses principes sur le costume clérical, le fait lui paraît très significatif. Ce muet avertissement lui suffit pour
318
qu’en revenant il affirme, à Wiseman, que « Newman viendra et qu’il viendra bientôt 1»
IV
En août 1845, la nouvelle se répand que Ward s’est décidé à devancer Newman dans l’Eglise de Rome. Au point où il en était, il ne fallait pas grand’chose pour le déterminer. L’initiative est venue de sa femme; copiant un article de lui, elle a rencontré une phrase où il répétait ce qu’il avait dit souvent, depuis quelque temps, que l’Eglise romaine était la véritable Eglise; elle s’est arrêtée : « Je ne puis en rester là, dit-elle, j’irai et me ferai recevoir dans cette Eglise. » Cette parole fait réfléchir Ward sur sa situation. « Un peu plus tôt, un peu plus tard, répond-il, cela ne fait pas de différence; j’irai avec vous. » Le 13 août, il adresse à ses amis une lettre-circulaire où il annonce et justifie sa résolution, et, au commencement de septembre, l’abjuration est consommée 2. Le 29 de ce même mois, c’est le tour de Dalgairns, l’un des jeunes hôtes de Littlemore. Saint John suit, le 2 octobre; puis c’est Stanton qui quitte aussi Littlemore et qui fait part à newman de son intention de se faire recevoir à Stonyhurst. « Pourquoi n’être pas reçus ensemble? lui répond Newman. Le P. Dominique, passionniste, vient ici le 8, pour me recevoir; revenez pour ce jour 3. »
1 Life and Times of Card. Wiseman, t. I, p. 424 à 429. 2. W.-G. Ward and the Oxford Movement, p. 357 à 366. 3. Life and Times of Card. Wiseman, t. I. p. 429.
319
Newman, en effet, a pris son parti. Le 3 octobre, il a requis le prévôt d’Oriel d’effacer son nom des livres du collège et de l’Université, sans expliquer, du reste, le motif de sa demande. Le 8, au matin, il écrit une courte lettre à plusieurs amis, pour leur annoncer ce qu’il va faire. «Cette lettre, ajoute-t-il en post-scriptum, ne partira que lorsque tout sera fini. Il va sans dire qu’elle ne demande pas de réponse 1.» Deux jours auparavant, il a tracé les dernières lignes de son Essai sur le Développement de la doctrine chrétienne, et il y a ajouté cette conclusion personnelle dont Stanley a dit qu’elle est « l’une des pages les plus émouvantes qui aient jamais été écrites par une plume non inspirée 2 » :
Telles étaient les pensées d’un homme dont la longue et persévérante supplication avait été que le Très-Miséricordieux ne méprisât pas l’oeuvre de Ses propres mains et ne l’abandonnât pas à lui-même, alors que, la vue encore trouble, le coeur chargé, il ne pouvait employer que la raison dans les choses de la foi. Et maintenant, cher lecteur, le temps est court, l’éternité longue. N’écarte pas ce que tu as trouvé ici, ne le regarde pas comme pure matière à controverse, ne t’applique pas à le réfuter, cherchant seule. ment les meilleurs moyens de le faire; ne te trompe pas toi-même, en t’imaginant que cela vient de désappointement, ou de dégoût, ou d’agitation d’esprit, ou de sentiments blessés, ou d’une sensibilité mal placée, ou de quelque autre faiblesse. Ne t’enveloppe pas dans les liens des années passées, ne décide pas que la vérité est ce que tu désires qu’elle soit, et ne fais pas une idole des préjugés que tu chéris. Le temps est court, l’éternité longue. Nunc dimittis servum
1. Apologia. 2. Life of Stanley, t. I, p. 345.
320
tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace, quia viderunt oculi mei salutare tuum.
Le P. Dominique, auquel Newman a fait appel sans même l’informer explicitement du motif pour lequel il le demandait, était un religieux passionniste, italien de naissance, d’origine très humble, installé en Angleterre depuis 1841. Newman a eu l’occasion de l’entrevoir, quelques instants, l’année précédente, à Littlemore; il a goûté sa simplicité et sa piété; il lui sait gré, comme il l’écrit sous l’empire des mêmes préventions, de « s’être peu occupé de conversions ».
Le 8 octobre au soir, par une pluie battante, le P. Dominique arrive à Littlemore. Tout y est silencieux. Avis a été donné aux amis du voisinage que « M. Newman désirait rester seul ». Pas d’autres personnes présentes que deux convertis récents, Dalgairns et Saint-John, et deux disciples qui doivent abjurer avec le maître, Stanton et Bowies. A peine arrivé, le religieux essayait de se sécher auprès du feu, quand Newman entre dans la pièce, se prosterne à ses pieds, lui demande de le bénir et d’entendre sa confession. La nuit se passe en prières. Le lendemain, Stanton et Bowies se confessent à leur tour. Le soir tous trois font leur profession de foi et reçoivent le baptême sous condition. Leur ferveur fait l’admiration du P. Dominique. Le 10 au matin, celui-ci dit la messe, dans l’oratoire, sur une pierre d’autel que Saint-John est allé chercher à Oxford et donne la communion aux cinq assistants.
321
Ainsi se consomme, dans la simplicité, le silence et la solitude, ce grand événement dont, depuis plusieurs années,la préparation occupait et troublait tant d’âmes, et dont les conséquences sont loin d’être épuisées. Si prévue que soit la « sécession » de Newman, le retentissement en est considérable. « Il est impossible, dit un contemporain, Mark Pattison, de décrire l’effet énorme produit dans le monde académique et clérical, je puis dire, dans toute l’Angleterre, par ce fait qu’un seul homme a changé de religion 1 ». Gladstone affirme que « c’est une époque dans l’histoire de l’Eglise d’Angleterre 2 ». Plus tard, Disraeli constatera que cette conversion « a imprimé à l’Angleterre une secousse dont elle est encore ébranlée », et l’un des premiers historiens d’outre-Manche, à l’heure actuelle, M. Leecky, déclarera que, dans cet ordre d’idées, il n’y a pas eu de plus grand événement depuis les Stuarts 3. Sur le moment même, au reçu de la nouvelle, sauf quelques clameurs haineuses de protestants fanatiques, le premier sentiment qui domine à Oxford et dans les milieux éclairés de l’anglicanisme, est celui d’une tristesse respectueuse et aussi d’une attente inquiète. On se demande, avec tremblement, quelles seront, pour l’Eglise établie, les suites d’un tel coup. Chacun a aussitôt pressenti que plus d’un disciple accompagnerait le maître dans son exode. En effet, c’est comme
1. Memoirs, par Mark Pattison, p. 212. 2. Lettre du 10 décembre 1845, Life of Bishop Wilberforce, t. I, p. 328. 3. Cité par Wilfrid Ward, dans Life and Times of Card. Wiseman, t. I, p. 438.
322
une traînée de conversions. Oakeley s’en va l’un des premiers, puis Faber, depuis longtemps catholique de coeur, de conviction et de pratique 1, et beaucoup d’autres, dont de nombreux clergymen et gradés d’université. On a évalué à plus de trois cents les conversions, suite immédiate de celle de Newman, et le mouvement devait se continuer les années suivantes; à vrai dire, depuis lors, il ne s’est plus arrêté. Rien de pareil ne s’était vu depuis la Réforme. Les anglicans fidèles se demandent, effarés, quel sera le terme de ces défections. «Chaque matin, a raconté l’un d’eux, nous prenions place, tout tristes, à notre déjeuner, nous attendant que quelqu’un vînt nous apporter une fâcheuse
1. Faber, au dernier moment, s’était trouvé arrêté par le souci de dettes qu’il avait contractées pour les dépenses de sa paroisse et que la résignation de son bénéfice ne lui permettrait plus d’acquitter. Un ami protestant, qui voyait les conversions de mauvais oeil, mais qui ne voulait pas que la liberté de décision d’un tel homme fùt entravée par des préoccupations de cet ordre, lui envoya la somme dont il avait besoin pour s’acquitter, sous la condition qu’il ne serait jamais question de cette affaire entre eux. Le 16 novembre 1845, Faber monta, pour la dernière fois, dans la chaire de son Eglise, déclara à ses paroissiens que les doctrines qu’il leur avait enseignées, bien que vraies, n’étaient pas celles de l’Eglise d’Angleterre, que conséquemment il ne pouvait demeurer dans sa communion et devait aller là où il trouverait la vérité. Sur ce, il descendit en hâte de la chaire, enleva son surplis qu’il laissa à terre et se retira au presbytère. La congrégation demeura quelque temps dans un état de stupeur; puis bientôt, tandis que la majorité se retirait lentement, quelques notables allaient supplier le recteur de revenir sur sa décision, lui déclarant qu’il pourrait prêcher toutes les doctrines qu’il voudrait. Faber fut inébranlable. Le lendemain, comme il se mettait en route de bonne heure, avec quelques-uns de ses paroissiens décidés à se convertir avec lui, toutes les fenêtres s’ouvrirent sur son passage, et les pauvres gens agitaient leurs mouchoirs en lui criant : « Dieu vous bénisse, M. Faber, partout où vous irez ! » (Life and Letters of F.- W. Faber, p. 235 à 238.)
323
nouvelle, nous raconter qu’un tel s’en était allé, que tel autre s’en irait sûrement 1. » Dans certains esprits, l’effet produit est comme celui d’un choc en retour : ils sont rejetés dans le scepticisme; tels J.-A. Froude et Mark Pattison; suivant l’expression de ce dernier, la conversion du maître leur a donné « la sensation d’une fin subite de toutes choses, sans le commencement de rien de nouveau 2. » Parmi les disciples de Newman, les jeunes sont les plus empressés à le suivre: ils avaient des liens moins forts, des habitudes d’esprit moins anciennes à briser. Ses vieux airais, au contraire, les plus chers à son coeur, demeurent sur la rive qu’il quitte. Keble a-t-il été un moment ébranlé? En tout cas, l’ébranlement ne dure pas. Pusey, Marriott, Rogers, Isaac Williams, Church ne paraissent pas avoir un instant d’hésitation. Sur leur état d’esprit, sur leur effort pour se ressaisir dans cette déroute de leur parti, sur les conditions dans lesquelles ils essayeront d’établir, à leur tour, une via media, j’aurai occasion de revenir dans la suite de cette histoire. Notons seulement que, sous le premier coup d’une séparation qui leur est si douloureuse et si menaçante, ils n’ont aucune parole, aucune pensée de blâme et d’amertume à l’égard de l’ami qui s’éloigne. Dès le 11 octobre, à la première nouvelle de ce qui est pour lui, dit-il, un « coup de foudre », Keble écrit «Mon très cher Newman, vous avez été, pour moi, un ami bon, secourable, comme à peu près nul autre n’au-
1. Life and Letters of dean Church, p. 232. 2. Mémoirs, par Mark Pattison, p. 235.
324
rait pu l’être. Vous êtes mêlé, dans mon esprit, à toutes mes vieilles, chères et saintes pensées, au point que je ne supporte pas l’idée d’être séparé de vous, quelque parfaitement indigne que je me reconnaisse. Et, cependant, je ne puis marcher plus longtemps avec vous. Il me faut m’attacher à la croyance que nous ne sommes pas réellement séparés; c’est vous qui me l’avez enseigné, et je ne puis penser que vous ayez pu m’induire en erreur. Ayant donc relevé mon courage par ce peu de mots, je vous dirai seulement : Dieu vous bénisse et vous récompense cent fois pour le secours que vous m’avez donné, de toute façon, à moi, indigne, et à tant d’autres! Puissiez-vous avoir la paix là où vous allez, et nous aider, de quelque manière que ce soit, à l’avoir! En tous cas, je ne pense guère que ce puisse être par des controverses. Et ainsi, ressentant comme si le printemps de ma vie était fini, je suis, pour toujours, votre affectionné et reconnaissant 1. » Les autres s’appliquent à se montrer aussi affectueux. Toutefois, en dépit de leurs efforts, on sent une gêne, une contrainte. Entre eux et le converti, il y a quelque chose d’irrémédiablement brisé. A la suite d’une visite que lui a faite Newman, Pusey se plaint qu’il y ait eu comme une sorte d’aigreur dans ses manières. Newman répond en se plaignant, à son tour, qu’on soit ainsi disposé à éplucher avec sévérité les convertis. « Hélas! dit-il, je n’ai pas d’alternative entre le silence et dire ce qui vous peinerait. Puisse venir un jour où il n’en soit plus ainsi! Alors le vieux temps renaîtra et un
1. John Keble, par Lock, p. 128.
325
temps plus heureux. » En attendant, il estime qu’il « vaut mieux ne plus se rencontrer que s’exposer à de pareils malentendus 1. » Bientôt, en effet, toutes relations sont interrompues entre ces hommes qui s’étaient tant aimés; elles ne seront reprises que longtemps après. A la place de ces amitiés brisées, Newman n’a plus en perspective que la compagnie de ces catholiques dont il s’est tenu jusqu’alors si éloigné. La première rencontre avec eux a lieu le 31 octobre, à Oscott, où il s’est rendu, avec quelques-uns des nouveaux convertis, pour être confirmé par Mer Wiseman. Il semblait, comme l’a dit le biographe de ce prélat, que le grand leader d’Oxford, reconnaissant la victoire de Rome, vînt rendre son épée à celui qui le pressait depuis longtemps de le faire. L’entrevue, au début, n’est pas sans quelque embarras de part et d’autre. Wiseman qui, en présence d’un homme sortant d’une pareille agonie, ne veut ni avoir l’air de triompher ni se répandre en félicitations banales, trouve à peine quelques mots pour demander des nouvelles du voyage. Les deux principaux personnages restent assis, l’un en face de l’autre, presque sans se parler, pendant qu’à côté d’eux leurs compagnons causent plus librement. Au bout de peu de temps, l’évêque, avisé qu’un enfant l’attend pour se confesser, saisit cette occasion de se retirer. Le lendemain, après la confirmation, on se revoit et, cette fois, la glace se rompt. « Newman m’a ouvert complètement son coeur, écrit quelques jours après
1. Life of Pusey, t. II, p. 507, 508.
326
Wiseman. Je vous assure que jamais, en aucun temps, un converti n’est venu à l’Eglise avec une foi plus docile et plus simple. Tout va bien; ma santé seule serait inquiétante. Mais non. N’ai-je pas répété que, le jour de la conversion de Newman, je chanterais mon Nunc dimittis? Il n’est pas temps de manquer à ma parole 1. » Au sortir de cette cérémonie, Newman et ses compagnons retournent à Littlemore, où ils résident encore quelques mois, attendant que leur destination soit fixée. Avis leur est bientôt donné qu’un vieux cottage près d’Oscott est mis à leur disposition. Le 22 février 1846, Newman quitte définitivement Littlemore. A son passage à Oxford, où il couche une nuit, plusieurs de ses anciens amis, dont Pusey et Church, viennent prendre congé de lui. Avec un déchirement de coeur dont la trace se retrouve en plus d’un de ses écrits 2, il dit pour toujours adieu à la vieille cité universitaire et à ses collèges, qui ont tenu tant de place dans sa vie. Le sacrifice est complet. Newman a renoncé à tout, à sa situation, à ses amitiés, à sa famille même, dont aucun des membres ne devait le suivre dans sa conversion, et il va à des hommes qu’il ne connaît pas, contre lesquels il a des préventions et dont plusieurs ne sont pas sans en avoir à son égard. Faut-il se demander s’il va être humainement récom-
1. Life and Times of Card. Wiseman, t. I, 430 à 435. 2. La douleur de cet adieu, discrètement indiquée dans l’Apologia, se trahit davantage dans divers passages de Loss and Gain, sorte de fiction où l’auteur s’épanchait d’autant plus librement qu’il n’était plus directement en scène.
327
pensé de ses sacrifices? Non. S’il a ainsi brisé son passé, ce n’est pas en vue d’obtenir je ne sais quels avantages; c’est uniquement pour trouver la lumière et posséder la vérité. Sur ce point, son espoir a été réalisé. Près de vingt ans après, à une époque où il pouvait cependant avoir quelques sujets de se plaindre de ses nouveaux coreligionnaires, il témoignait hautement « de la paix et du contentement parfait » qu’il avait goûtés depuis sa conversion. Il déclarait « n’avoir plus jamais éprouvé un seul doute ». Il se comparait à « un voyageur entré au port après la tempête », et il ajoutait que « la jouissance de ce repos avait duré, depuis lors, sans interruption 1». Dieu n’a donc pas trompé l’attente de celui qui avait si généreusement répondu à son appel. Newman a dû trouver là de quoi supporter ce qui a pu lui paraître parfois une ingratitude des hommes. Toutefois, est-ce assez pour nous consoler nous-mêmes de ce que ceux auxquels il était venu n’aient pas toujours su se servir de la force incomparable qu’il leur apportait? Gladstone a dit, à propos de la conversion de Newman, que « l’année 1845 avait marqué la plus grande victoire que l’Eglise de Rome eût remportée depuis la Réforme 2 ». Les catholiques ont-ils conscience d’avoir pleinement tiré parti de cette victoire?
1. Apologia. 2. Vie de Lady Georgiana Fullerton, par Mme Craven, p. 200.
Haut du document ; Abbaye Saint Benoît ; Bibliothèque
|