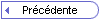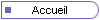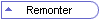ACCORD DES ÉVANGÉLISTES.
Oeuvres Complètes de Saint Augustin, Traduites pour la première fois en
français, sous la direction de M. Raulx, Tome Vème, Commentaires sur
l'Écriture, Bar-Le-Duc, L. Guérins & Cie éditeurs, 1867. p. 114-256.
Les deux premiers livres ont été traduits par M.
l'abbé TASSIN, les deux derniers par M. l'Abbé BURLERAUX.
ACCORD
DES ÉVANGÉLISTES.
LIVRE PREMIER.
CHAPITRE PREMIER. AUTORITÉ DES ÉVANGILES.
CHAPITRE II. ORDRE ET MANIÈRE D'ÉCRIRE DES
ÉVANGÉLISTES.
CHAPITRE III. ROYAUTÉ ET SACERDOCE DE JÉSUS-CHRIST.
CHAPITRE IV. DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST.
CHAPITRE V. LA CONTEMPLATION ET L'ACTION. —
SAINT JEAN ET LES AUTRES ÉVANGÉLISTES.
CHAPITRE VI. LES QUATRE ANIMAUX SYMBOLIQUES ET LES
QUATRE ÉVANGÉLISTES.
CHAPITRE VII. MOTIF DE CET OUVRAGE. —
POURQUOI JÉSUS N'A PAS LAISSÉ D'ÉCRITS.
CHAPITRE VIII. LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST ET SA
RÉPUTATION.
CHAPITRE IX. JÉSUS-CHRIST A-T-IL ÉCRIT DES LIVRES DE
MAGIE?
CHAPITRE X. CES LIVRES ONT-ILS ÉTÉ ADRESSÉS A PIERRE
ET A PAUL?
CHAPITRE XI. JÉSUS N'A PAS PU S'ATTACHER LES PEUPLES
PAR LA MAGIE.
CHAPITRE XII. POURQUOI LES ROMAINS, MAÎTRES DES JUIFS,
N'ONT-ILS PAS RECONNU LE DIEU D'ISRAËL ?
CHAPITRE XIII. POURQUOI DIEU A LAISSÉ LES JUIFS TOMBER
SOUS LE JOUG DES ROMAINS.
CHAPITRE XIV. TRIOMPHE DU DIEU DES HÉBREUX, PAR LA
RUINE DES IDOLES ET LA CONVERSION DES NATIONS.
CHAPITRE XV. LES PAÏENS, OBLIGÉS DE LOUER
JÉSUS-CHRIST, SE DÉCHAINENT CONTRE SES DISCIPLES.
CHAPITRE XVI. LES APOTRES, EN PRÊCHANT LA DESTRUCTION
DES IDOLES, NE SE SONT PAS ÉCARTÉS DE LA DOCTRINE DE JÉSUS ET DES PROPHÈTES.
CHAPITRE XVII. CONTRE LES ROMAINS QUI ONT REFUSÉ LEUR
CULTE AU SEUL DIEU D'ISRAËL.
CHAPITRE XVIII. LE DIEU DES HÉBREUX N'A PAS ÉTÉ REÇU
DES ROMAINS PARCE QU'IL VEUT ÊTRE SEUL ADORÉ.
CHAPITRE XIX.LE DIEU D'ISRAËL EST LE VRAI DIEU.
CHAPITRE XX. LES ORACLES DES PAÏENS NE DISENT RIEN
CONTRE LE DIEU DES HÉBREUX.
CHAPITRE XXI. POURQUOI LE DIEU DES HÉBREUX DOIT ÊTRE
SEUL ADORÉ.
CHAPITRE XXII. OPINION DES GENTILS TOUCHANT NOTRE
DIEU.
CHAPITRE XXIII. NIAISERIES PAÏENNES SUR SATURNE ET
JUPITER.
CHAPITRE XXIV. EN REJETTANT LE DIEU D'ISRAËL ON N'ADORE
PLUS TOUS LES DIEUX; EN ADORANT LES AUTRES ON N'ADORE PLUS LE DIEU D'ISRAËL.
CHAPITRE XXV. LES PAÏENS DOIVENT ADORER LE DIEU
D'ISRAËL; LEURS DIEUX NE S'Y OPPOSENT PAS, SES OEUVRES L'EXIGENT.
CHAPITRE XXVI. RUINE DE L'IDOLÂTRIE CONFORME AUX
ORACLES PROPHÉTIQUES.
CHAPITRE XXVII. LA PUISSANCE DU VRAI DIEU RENVERSANT
PARTOUT LES IDOLES, MOTIF D'ABANDONNER L'IDOLATRIE.
CHAPITRE XXVIII. DESTRUCTION DES IDOLES PRÉDITE.
CHAPITRE XXIX. POURQUOI LES PAÏENS N'ADORENT-ILS PAS
LE DIEU D'ISRAËL, S'ILS LE CROIENT DU MOINS PRÉPOSÉ AUX ÉLÉMENTS.
CHAPITRE XXX. AVEC L'ACCOMPLISSEMENT DES PROPHÉTIES LE
DIEU D'ISRAËL EST MAINTENANT CONNU PARTOUT.
CHAPITRE XXXI. IMPORTANTE PRÉDICTION RELATIVE A
JÉSUS-CHRIST.
CHAPITRE XXXII. DOCTRINE DES APOTRES CONTRE LE CULTE
DES IDOLES JUSTIFIÉE PAR LES PROPHÉTIES.
CHAPITRE XXXIII. LES TEMPS CHRÉTIENS ONT-ILS DIMINUÉ
LÉ BONHEUR SUR LA TERRE?
CHAPITRE XXXIV. CONCLUSION.
CHAPITRE XXXV. LE MYSTÈRE DU MÉDIATEUR DANS LES
PROPHÉTIES ET L'ÉVANGILE.
LIVRE SECOND. De l'Incarnation à la Cène. Nul
désaccord entre les quatre Évangélistes.
PROLOGUE.
CHAPITRE PREMIER. POURQUOI LA GÉNÉALOGIE DE JOSEPH ET
NON CELLE DE MARIE:
CHAPITRE II. COMMENT JÉSUS-CHRIST EST LE FILS DE
DAVID, SANS DEVOIR SA NAISSANCE A JOSEPH FILS DE DAVID.
CHAPITRE III. POURQUOI SAINT MATTHIEU ET SAINT LUC
DIFFÈRENT ENTRE EUX DANS L'ÉNUMÉRATION DES ANCÊTRES DE JÉSUS-CHRIST.
CHAPITRE IV. SUR LE NOMBRE DES ANCÊTRES DE
JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU ET SELON SAINT LUC.
CHAPITRE V. ACCORD DE SAINT MATTHIEU ET DE SAINT LUC
AU SUJET DE LA CONCEPTION ET DES PREMIÈRES ANNÉES DE JÉSUS-CHRIST.
CHAPITRE VI. ÉPOQUE DE LA PRÉDICATION DE
JEAN-BAPTISTE.
CHAPITRE VII. DES DEUX HÉRODES.
CHAPITRE VIII. RETOUR A NAZARETH.
CHAPITRE IX. MOTIFS DE PRÉFÉRENCE POUR LE SÉJOUR A
NAZARETH.
CHAPITRE X. VOYAGES À JÉRUSALEM.
CHAPITRE XI. COMMENT LA PRÉSENTATION AU TEMPLE SE
PEUT-ELLE CONCILIER AVEC LA COLÈRE D'HÉRODE ?
CHAPITRE XII. PRÉDICATON DE JEAN-BAPTISTE.
CHAPITRE XIII. DU BAPTÊME DE JÉSUS.
CHAPITRE XIV. VOIX DU CIEL APRÈS LE BAPTÊME DE JÉSUS.
CHAPITRE XV. JÉSUS-CHRIST CONNU OU INCONNU DE
JEAN-BAPTISTE .
CHAPITRE XVI . JÉSUS TENTÉ PAR LE DÉMON .
CHAPITRE XVII. VOCATION DES APOTRES.
CHAPITRE XVIII. DU TEMPS OU JÉSUS-CHRIST SE RENDIT EN
GALILÉE.
CHAPITRE XIX. SERMON SUR LA MONTAGNE.
CHAPITRE XX. LE SERVITEUR DU CENTURION.
CHAPITRE XXI. GUÉRISON DE LA BELLE-MÈRE DE PIERRE.
CHAPITRE XXII. AUTRES GUÉRISONS.
CHAPITRE XXIII. JE VOUS SUIVRAI PARTOUT OU VOUS IREZ .
CHAPITRE XXIV. TEMPÊTE APAISÉE. —
DÉMONIAQUES DÉLIVRÉS.
CHAPITRE XXV. PARALYTIQUE GUÉRI.
CHAPITRE XXVI. VOCATION DE SAINT MATTHIEU.
CHAPITRE XXVII. FESTIN DONNÉ PAR SAINT MATTHIEU.
CHAPITRE XXVIII. RÉSURRECTION DE LA FILLE DE JAÏRE.
CHAPITRE XXIX. DES DEUX AVEUGLES ET DU DÉMON MUET DONT
PARLE SEUL SAINT MATTHIEU.
CHAPITRE XXX. MISSION CONFIÉE AUX DISCIPLES.
CHAPITRE XXXI. DISCIPLES DE JEAN-BAPTISTE ENVOYÉS A
JÉSUS.
CHAPITRE XXXII. MENACES ADRESSÉES A PLUSIEURS CITÉS.
CHAPITRE XXXIII. LE JOUG ET LE FARDEAU DU CHRIST. MAIN
DESSÉCHÉE.
CHAPITRE XXXIV. ÉPIS ROMPUS.
CHAPITRE XXXVII. MUET ET AVEUGLE POSSÉDÉ DU DÉMON.
CHAPITRE XXXVIII. JÉSUS ACCUSÉ D'ÊTRE LE SUPPOT DE
BÉELZÉBUD.
CHAPITRE XXXIX. JONAS ET LA REINE DE SABA.
CHAPITRE XL. LA MÈRE ET LES FRÈRES DE JÉSUS.
CHAPITRE XLI. LES HUIT PARABOLES.
CHAPITRE XLII. JÉSUS DANS SA PATRIE.
CHAPITRE XLIII. HÉRODE APPRENANT LES MIRACLES DE
JÉSUS.
CHAPITRE XLIV. EMPRISONNEMENT ET MORT DE
JEAIN-BAPTISTE.
CHAPITRE XLV. MIRACLE DES CINQ PAINS.
CHAPITRE XLVI. ENCORE DU MIRACLE DES CINQ PAINS.
CHAPITRE XLVII. JÉSUS MARCHANT SUR LES EAUX.
CHAPITRE XLVIII. TERRE DE GÉNÉSAR ET CAPHARNAUM
CHAPITRE XLIX. LA CHANANÉENNE.
CHAPITRE L. MULTIPLICATION DES SEPT PAINS.
CHAPITRE LI. LE PROPHÈTE JONAS,
CHAPITRE LII. LEVAIN DES PHARISIENS.
CHAPITRE LIII. CONFESSION DE SAINT PIERRE.
CHAPITRE LIV. LA PASSION PRÉDITE.
CHAPITRE LV. SUIVRE LE CHRIST.
CHAPITRE LVI. TRANSFIGURATION.
CHAPITRE LVII. AVÉNEMENT D'ELIE.
CHAPITRE LVIII. DÉMONIAQUE GUÉRI.
CHAPITRE LIX. PASSION DE NOUVEAU PRÉDITE.
CHAPITRE LX. TRIBUT PAYÉ.
CHAPITRE LXII. PETIT ENFANT MODÈLE.
CHAPITRE LXII. EST-IL PERMIS DE RENVOYER SA FEMME ?
CHAPITRE LXIII. IMPOSITION DES MAINS AUX PETITS
ENFANTS. — CONSEIL DONNÉ AU JEUNE
HOMME RICHE. — OUVRIERS DE LA
VIGNE.
CHAPITRE LXIV. PRÉDICTION DE LA PASSION. —
LA MÈRE DES FILS DE ZÉBÉDÉE.
CHAPITRE LXV. AVEUGLES DE JÉRlCHO.
CHAPITRE LXVI. L'ANESSE ET SON ANON.
CHAPITRE LXVII. VENDEURS ET ACHETEURS CHASSÉS DU
TEMPLE.
CHAPITRE LXVIII. FIGUIER MAUDIT.
CHAPITRE LXIX. QUESTION CAPTIEUSE.
CHAPITRE LXX. DEUX FILS ENVOYÉS PAR LEUR PÈRE A LA
VIGNE. — VIGNE LOUÉE A D'AUTRES
VIGNERONS.
CHAPITRE LXXI. NOCES ROYALES.
CHAPITRE LXXII. TRIBUT PAYÉ A CÉSAR. —
FEMME AUX SEPT MARIS.
CHAPITRE LXXIII. LE DOUBLE PRÉCEPTE.
CHAPITRE LXXIV. LE CHRIST FILS ET SEIGNEUR DE DAVID.
CHAPITRE LXXV. ORGUEIL DES PHARISIENS CONDAMNÉ.
CHAPITRE LXXVI. PRÉDICTION DE LA RUINE DU TEMPLE.
CHAPITRE LXXVII. DISCOURS SUR LE MONT DES OLIVIERS.
CHAPITRE LXXVIII. JÉSUS ARRIVE A BÉTHANIE.
CHAPITRE LXXIX. FESTIN DE BÉTHANIE.
CHAPITRE LXXX. DISCIPLES ENVOYÉS POUR PRÉPARER LA
PÂQUE.
LIVRE TROISIÈME. De la Cène à l'Ascension.
PROLOGUE.
CHAPITRE PREMIER. LA CÈNE ET LE TRAÎTRE DÉVOILÉ.
CHAPITRE II. PRÉDICTION DU RENIEMENT DE SAINT PIERRE.
CHAPITRE III. DISCOURS APRÈS LA CÈNE.
CHAPITRE IV. CE QUI SE PASSE AU JARDIN DES OLIVIERS.
CHAPITRE V. ON SE SAISIT DE JÉSUS.
CHAPITRE VI. JÉSUS DEVANT LE PRINCE DES PRÊTRES. —
RENIEMENT DE SAINT PIERRE.
CHAPITRE VII. JUGEMENT DU MATIN. —
JÉRÉMIE CITÉ AU LIEU DE ZACHARIE.
CHAPITRE VIII. JÉSUS DEVANT PILATE.
CHAPITRE IX. JÉSUS JOUET DE LA SOLDATESQUE.
CHAPITRE X. JÉSUS AIDÉ A PORTER SA CROIX.
CHAPITRE XI. DU BREUVAGE DONNÉ A JÉSUS.
CHAPITRE XII. DU PARTAGE DES VÊTEMENTS.
CHAPITRE XIII. DE L'HEURE DE LA PASSION.
CHAPITRE XIV. DES DEUX LARRONS CRUCIFIÉS AVEC JÉSUS.
CHAPITRE XV. BLASPHÈMES VOMIS CONTRE JÉSUS EN CROIX.
CHAPITRE XVI. BLASPHÈMES DES LARRONS.
CHAPITRE XVII. DU BREUVAGE OFFERT À JÉSUS.
CHAPITRE XVIII. DES DERNIÈRES PAROLES DU SAUVEUR.
CHAPITRE XIX. LE VOILE DÉCHIRÉ.
CHAPITRE XX. DE L'ÉTONNEMENT DU CENTURION.
CHAPITRE XXI. LES SAINTES FEMMES AU CALVAIRE.
CHAPITRE XXII. JOSEPH D'ARIMATHIE.
CHAPITRE XXIII. SÉPULTURE DE JÉSUS.
CHAPITRE XXIV. CIRCONSTANCES DE LA RÉSURRECTION.
CHAPITRE XXV. APPARITIONS DE JÉSUS RFSSUSCITÉ.
LIVRE QUATRIÈME. Quelques traits particuliers dans S.
Marc, S. Luc et S. Jean.
PROLOGUE.
CHAPITRE PREMIER. ENTRÉE DE JÉSUS A CAPHARNAUM.
CHAPITRE II. EXORCISME A
CAPHARNAUM.
CHAPITRE III. DU NOM DE PIERRE.
CHAPITRE IV. DE LA PRESCIENCE DIVINE EN JÉSUS-CHRIST.
CHAPITRE V. QUI NEST PAS CONTRE VOUS EST POUR VOUS.
CHAPITRE VI.LE SEL ET LA PAIN.
CHAPITRE VII. NUL DÉSACCORD DANS SAINT MARC.
CHAPITRE VIII. L'ÉVANGILE DE SAINT LUC ET LES ACTES.
CHAPITRE IX. LES PÊCHES MIRACULEUSES.
CHAPITRE X. ÉVANGILE SELON SAINT JEAN.
Le Saint docteur dit quelques mots de l'autorité, du
nombre, de la manière ,d'écrire des Evangélistes et de l'ordre dans lequel ils
se présentent : puis avant de parler de leur accord, il répond dans ce livre à
ceux qui s'étonnent de l'absence de tout écrit composé par Jésus lui-même, ou
le supposent auteur de certains livres de magie ; et qui, pour détruire la
doctrine de l'Évangile, reprochent aux disciples de Jésus-Christ d'avoir trahi
la vérité, en donnant à leur maître le nom de Dieu, et d'avoir ajouté à son
enseignement, en proscrivant le culte des dieux. Il défend contre ces
détracteurs audacieux la doctrine des Apôtres et des Prophètes, en
montrant que le Dieu d'Israël doit seul être adoré, lui, qui d'abord repoussé
des Romains par une exception singulière, a fini par soumettre à son nom
l'empire Romain, et comme l'avaient annoncé ses prophètes, a renversé les
idoles chez toutes les nations par la prédication de l'Évangile.
1. Parmi tous les livres
divins, contenus dans les Saintes Écritures, l'Évangile tient à bon droit le
premier rang. Nous y voyons, en effet, l'explication et l'accomplissement de
ce que la Loi et les Prophètes ont annoncé et figuré. Il eut pour premiers
prédicateurs les Apôtres qui, de leurs propres yeux, virent dans la chair
ici-bas notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et qui ensuite revêtus de la
fonction d'Évangélistes s'employèrent à publier dans le monde ce qu'ils se
souvenaient de lui avoir entendu dire ou de lui avoir vu faire; ils
annoncèrent aussi les événements divins et mémorables de sa naissance et de
ses premières années, dont ils ne furent pas les témoins, n'étant devenus que
plus tard ses disciples, mais dont ils purent s'informer près de lui ou de ses
parents ou d'autres personnes, et qu'ils purent connaître enfin par les
témoignages les plus sûrs et les plus véridiques. Deux d'entre eux, saint
Matthieu et saint Jean nous ont même laissé sur lui, chacun dans un livre, ce
qu'ils ont cru devoir consigner par écrit.
2. Comme on aurait pu croire
qu'il importait à la connaissance et à la prédication de l'Evangile, d'établir
une différence entre les Évangélistes, et d'examiner s'ils étaient du nombre
des disciples qui, durant les jours de l'apparition du Seigneur dans la chair,
l'ont suivi et ont vécu à son service, ou du nombre de ceux qui ont cru sur le
rapport des premiers Apôtres après l'avoir recueilli fidèlement : la divine
Providence a pourvu par l'Esprit-Saint à ce que quelques-uns des disciples de
ces mêmes Apôtres reçussent non-seulement le pouvoir d'annoncer l'Évangile
mais encore celui de l'écrire. Nous en comptons deux, saint Marc et saint Luc.
Pour les autres hommes qui ont essayé ou ont eu la présomption à écrire sur
les actions du Seigneur lui-même ou de ceux qu'il avait réunis autour de lui;
ils n'ont offert à aucune époque les conditions voulues pour que l'Église les
considérât comme organes de la vérité et reçut leurs écrits dans le Canon des
Livres Saints : non-seulement, du côté du caractère, ils ne donnaient pas les
garanties qu'il fallait pour qu'on dût croire à leurs récits, mais de plus les
récits eux-mêmes contenaient plusieurs choses opposées à la règle catholique
et apostolique de la foi et condamnées par la saine doctrine.
3. Ces quatre Evangélistes,
bien connus dans l'univers entier, dont le nombre mystérieux, égal aux quatre
parties du monde, indique peut-être en quelque façon, que l'Église est
répandue par toute la terre, ont écrit dans cet ordre, suivant le témoignage
de la Tradition : d'abord saint Matthieu, puis saint Marc, ensuite saint Luc
et enfin saint Jean. Ainsi l'ordre dans
lequel ils ont connu et prêché l'Évangile n'est pas celui dans lequel ils
l'ont écrit. Car pour la connaissance et la prédication de l'Évangile, les
premiers, sans aucun doute, ont été les Apôtres, qui ont suivi le Seigneur
durant les jours de son apparition dans la chair, l'ont entendu parler, l'ont
vu agir et ont reçu de sa bouche la mission d'évangéliser le monde. Quant aux
écrits, par une (115) disposition certaine de la Providence divine, les deux
qui appartiennent au nombre des disciples que le Seigneur a choisis avant sa
passion, tiennent l'un la première place, c'est saint Matthieu, l'autre la
dernière; c'est Saint Jean; ils semblent ainsi soutenir et protéger de tout
côté, ainsi que des enfants chéris et placés entre eux à ce titre, les deux
évangélistes qui, sans être des leurs, ont suivi le Christ en les écoutant
comme ses organes.
4. La Tradition nous apprend,
comme un fait bien avéré, que saint Matthieu seul parmi ces quatre
évangélistes a écrit en hébreu et que les autres ont écrit en grec. Bien que
chacun d'eux paraisse avoir adopté dans sa narration une marche particulière,
on né voit pas que les derniers aient écrit sans savoir que d'autres l'eussent
déjà fait, et ce n'est pas par ignorance que les uns omettent certains
événements rapportés dans les livres des autres. Chacun a voulu concourir
efficacement à une oeuvre divine, suivant l'inspiration qu'il avait reçue,
sans s'aider inutilement du travail d'autrui. En effet, saint Matthieu a
envisagé l'Incarnation du côté de l'origine royale de Notre-Seigneur et n'a
guère considéré dans, les actes et les paroles de Jésus-Christ que ce qui a
rapport à la vie présente des hommes. Saint Marc, qui vient après lui, semble
être gon page. et son abréviateur. Car il n'emprunte rien de ce qui est
exclusivement propre au récit de saint Jean; il ajoute très-peu de choses â ce
que nous savons d'ailleurs; il prend encore moins dans les faits que saint Luc
est seul à rapporter; mais il reproduit presque tout ce que renferme le récit
de saint Matthieu et souvent à peu-près dans les mêmes termes; toujours
d'accord avec cet Evangéliste, jamais en désaccord avec les deux autres. Pour
saint Luc, on le voit surtout occupé de l'origine sacerdotale- du Seigneur et
de son rôle de pontife. Aussi bien, dans la généalogie qu'il trace de
Jésus-Christ, pour remonter jusqu’à David il ne suit pas la ligne royale, mais
par une autre quine compte pas de rois, il arrive à Nathan fils de David (1),
lequel ne fut pas roi non plus. Ce n'est pas comme saint Matthieu, (2), qui de
David vient à Salomon, héritier de son trône, et descend jusqu'à Jésus-Christ,
en prenant par ordre tous les rois de Juda qu'il réunit dans un nombre
mystérieux dont nous parlerons plus loin.
5. Et en effet, Notre-Seigneur
Jésus-Christ, qui seul est vrai roi et vrai prêtre, roi pour nous gouverner,
prêtre pour nous purifier du péché, a montré dans la double dignité royale et
sacerdotale, assignée chez ses ancêtres à des personnages différents, une
figure de ce qu'il est lui-même. Il l'a fait voir, d'un côté, par cette
inscription mise au haut de sa croix : « Jésus de Nazareth roi des Juifs, »
inscription que Pilate, poussé par une force mystérieuse, déclara vouloir
maintenir en disant : « Ce que j'ai écrit , je l'ai écrit, (1) » et aussi bien
longtemps d'avance on lisait dans les Psaumes : « N’altérez pas l'inscription
du titre (2). » Il l'a fait voir d'un autre côté pour ce qui regarde sa
qualité de prêtre, dans le grand mystère qu'il nous a dit d'offrir et de
recevoir, et au sujet duquel il se fait adresser ces paroles par un. prophète
: « Vous êtes prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédech (3). »
Beaucoup d'autres témoignages encore des divines Ecritures nous présentent
Jésus-Christ comme roi et comme prêtre. De là, David lui-même, dont il est
avec raison plus souvent appelé le fils, que le fils d'Abraham, et sur qui
saint Matthieu et saint Luc ont également fixé l'attention dans les
généalogies qu'ils ont dressées; l'un en descendant de lui par Salomonjusqu'à
Jésus-Christ, l'autre e n montant de Jésus-Christ jusqu'à lui par Nathan ;
David quoique proprement et évidemment roi, a néanmoins figuré aussi le
sacerdoce de Jésus-Christ en mangeant des pains de proposition, dont l'usage
n'était permis qu'aux prêtres (4). Ajoutons que seul l'Evangéliste saint Luc
rapporte le discours de l'ange à Marie, où nous apprenons la parenté de
celle-ci avec sainte Elisabeth, épouse du grand-prêtre : et que parlant de
Zacharie, il a soin de dire que sa femme était du nombre des filles d'Aaron,
c'est-à-dire de la tribu sacerdotale (5).
6. Comme saint Matthieu a
considéré en Jésus-Christ le titre de roi, et saint Luc le caractère de
prêtre, ils ont donc l'un et l'autre fait ressortir tout particulièrement
l'humanité du Sauveur. Car c'est à raison de sa nature humaine que
Jésus-Christ est devenu roi et prêtre, c'est ainsi qu'il est le fils de David
dont Dieu lui
116
a donné le trône où il doit régner toujours (1): c'est
ainsi qu'il est le médiateur de Dieu et des hommes pour intercéder en notre
faveur (2). Nous ne voyons personne qui ait 'suivi saint Luc en qualité
d'abréviateur, comme saint Marc a suivi saint Matthieu. Et ce n'est peut-être
point sans quelque mystère. La dignité royale, en effet, réclame l'honneur
d'un cortège; aussi celui qui s'était appliqué à mettre en relief la royauté
de Jésus-Christ a-t-il vu quelqu'un se joindre à lui pour l'accompagner et le
suivre pas à pas dans son discours. Au contraire, le grand-prêtre entrait seul
dans le saint des saints; c'est pourquoi l'Évangéliste saint Luc, dont le but
était de faire connaître le sacerdoce de Jésus-Christ, n'a eu personne à sa
suite pour reprendre en quelque manière et abréger sa narration.
7. Cependant les trois
évangélistes dont nous venons de parler se sont arrêtés, pour ainsi dire, aux
faits transitoires que présente le côté sensible et humain de la vie de
Jésus-Christ. Mais saint Jean a surtout considéré dans Notre-Seigneur la
divinité qui le rend semblable au Père; et en écrivant son Evangile c'est ce
qu'il a voulu principalement faire ressortir dans la mesure qui il a jugée
suffisante pour des hommes. Ainsi, il s'élève bien au-dessus des trois autres
: on croit voir ces derniers suivre sur la terre Jésus-Christ comme homme, et
saint Jean franchir l'enveloppe nébuleuse qui recouvre toute la terre et
arriver au ciel pur, où le regard de son esprit plein d'assurance et de
subtilité va découvrir en Dieu même le secret de l'éternelle génération du
Verbe par qui toutes choses ont reçu l'être; là il apprend que le Verbe s'est
fait chair pour habiter parmi nous (3); en ce sens que le Fils de Dieu s'est
uni la nature humaine et non qu'il s'est changé en elle : car si le Verbe
avait pris la chair sans garder immuable sa divinité, il ne dirait pas : « Moi
et mon Père nous sommes un (4), » puisque le Père et la chair ne peuvent pas
être une même nature. Seul l'Apôtre saint Jean a rapporté ce témoignage que
Notre-Seigneur rend de lui-même. Seul encore il a reproduit ces autres paroles
du divin maître : « Qui m'a vu, a vu mon Père (5) ; »
et celles-ci : « Afin qu'ils soient un comme nous sommes
un (1); » et celles-ci encore : « Toutes les choses que fait le Père, le Fils
les fait semblablement (2). » Enfin tous les passages qui révèlent aux
intelligences droites la divinité qui rend Jésus-Christ est égal au Père, seul
pour ainsi dire, saint Jean les a présentés, dans son Evangile. On dirait
qu'en reposant sur la poitrine du Seigneur, comme il avait coutume de le faire
quand il mangeait avec lui (3), il a puisé plus abondamment et plus
familièrement à cette source le secret de l'essence divine de son auguste
maître.
8. Il y a deux vertus
proposées à l'âme humaine : la vertu active et la vertu contemplative. Avec
l'une on marche, avec l'autre on atteint le but : avec l'une on travaille à
purifier le cœur et à se rendre capable de voir Dieu, avec l'autre on goûte en
liberté la vue de Dieu. L'une a pour objet les préceptes qui règlent la
conduite de cette vie passagère, et l'autre la science de la vie éternelle.
Ainsi l'une opère, l'autre se repose; car l'expiation des péchés est le propre
de la vertu active, et la lumière d'une conscience pure celui de la vertu
contemplative. Ainsi durant les jours de notre mortalité celle-là consiste
dans les œuvres d'une bonne vie, celle-ci plus particulièrement dans la foi;
et à l'égard d'un bien petit nombre c'est la vue en énigme et comme en un
miroir, è'est la vision en partie de l'immuable et éternelle vérité (4). On
trouve ces deux vertus figurées dans les deux épouses de Jacob, Lia et Rachel.
J'en ai discouru suivant le cadre que je m'étais tracé, et autant qu'il m'a
paru nécessaire, dans mon ouvrage contre Fauste le Manichéen (5). Lia est un
terme hébreu dont le sens présente l'idée de travail, et Rachel est un mot qui
signifie vue du principe. » De là on peut comprendre avec un examen attentif,
que les trois premiers Evangélistes, en s'attachant à retracer les faits
temporels de la vie de Notre-Seigneur et de celles de ses paroles dont le but
spécial est de former les moeurs et de régler la conduite dans le siècle
présent, ont surtout relevé par leurs discours la vertu active ; tandis que
saint Jean, qui ne raconte pas, à beaucoup près, en si
117
grand nombre les faits accomplis par Jésus-Christ, et,
quant aux paroles du divin maître, s'étend davantage et avec plus de soin sur
celles où il s'agit d'insinuer le mystère d'un seul Dieu en trois personnes,
le bonheur de la vie éternelle, a eu l'intention de faire valoir dans son
récit la vertu contemplative.
9. Il me semble que, envoyant
le symbole des quatre Evangélistes dans les quatre animaux de l'Apocalypse,
ceux d'après lesquels le lion représente saint Matthieu, l'homme saint Marc,
le boeuf saint Luc, et l'aigle saint Jean, ont plus probablement saisi la
vérité, que ceux qui attribuent l'homme à saint Matthieu, l'aigle à saint Marc
et le lion à saint Jean. Ceux-ci ont voulu trouver la raison de leur
conjecture dans les premiers mots des Evangiles, non dans tout le dessein des
Evangélistes, dont ils auraient dû se rendre compte avec plus d'exactitude.
Mais il est beaucoup plus rationnel de reconnaître sous l'emblème du lion
celui qui a surtout fait ressortir la
royauté de Jésus-Christ. Nous en avons la preuve dans ces paroles de
l'Apocalypse : « Le lion de la tribu de Juda est vainqueur, (1) » paroles qui
nous présentent l'image du lion en même temps que le souvenir de la tribu
dépositaire de l'autorité royale. De plus, c'est dans l'Evangile selon saint
Matthieu qu'il est parlé des Mages venus d'Orient pour chercher et adorer le
roi des Juifs, dont une étoile leur avait appris la naissance, ainsi que du
roi Hérode qui redoute ce roi encore enfant et pour le mettre à mort fait
mourir tant d'autres enfants (2). Pour l'Evangéliste saint Luc, qu'il soit
figuré par le bœuf, principale victime dit prêtre, personne n'en a douté.
C'est par le prêtre Zacharie, en effet, que commence le récit dont il est
l'auteur : c'est lui qui nous
fait connaître la parenté de Marie et d'Elisabeth (3) : c'est lui qui nous
montre les mystères du premier sacerdoce accompli dans la personne de
Jésus-Christ enfant (4). C'est dans son Evangile qu'un examen attentif peut
découvrir tant d'autres choses par lesquelles on voit bien qu'il s'est
appliqué à considérer Jésus-Christ comme prêtre. Saint Marc n'a voulu parler
ni de l'origine royale ni de la parenté et de la consécration
sacerdotale de Notre,-Seigneur ; toutefois comme on peut
le voir, il s'est occupé des faits qui appartiennent à l'humanité de
Jésus-Christ et paraît par conséquent n'avoir que l'homme pour emblême parmi
ces quatre animaux. Or le lion, l'homme et le boeufont la terre pour séjour :
aussi les trois Evangélistes dont nous venons de parler se sont appliqués
principalement
à retracer les oeuvres sensibles de Jésus-Christ durant
les jours de son apparition dans la chair, et à rappeler les préceptes qu'il a
laissés, pour la conduite de la vie
présente, aux hommes revêtus d'une chair mortelle. Au contraire saint
Jean par un vol hardi, s'élève comme un aigle au-dessus des nuages de la
faiblesse humaine, et contemple d'un regard très-ferme et très-perçant la
lumière de l'immuable vérité.
10. Les quatre Evangélistes
sont comme le noble et saint attelage du char sur lequel Notre-Seigneur a
parcouru l'univers pour soumettre les peuples à la douceur de son joug et au
fardeau léger de sa loi. Or, il est certains esprits qu'une fourberie pleine
d'impiété ou une ignorance présomptueuse porte à les assaillir d'injustes
reproches. Ils veulent les décréditer, ils veulent représenter comme peu
dignes de confiance les récits que nous leur devons, quand, parle ministère de
ces hommes, la religion chrétienne s'est répandue dans le monde avec tant de
force et de fruit, que maintenant nos tristes adversaires osent à peine redire
tout-bas entr'eux les misérables calomnies dont ils les poursuivent, arrêtés
qu'ils sont devant la foi des nations et le zèle de tous les peuples.
Néanmoins, comme il y a encore quelques personnes qu'ils retiennent dans
l'infidélité par leurs disputes artificieuses, ou qu'ils troublent et
déconcertent, autant que cela leur est possible, dans l'assentiment déjà donné
aux vérités saintes ; comme d'ailleurs plusieurs de nos frères désirent
savoir, soit pour avancer leur propre instruction, soit pour confondre les
vains discours des incrédules, ce qu'ils pourront bien répondre à leurs
objections sans blesser la loi; avec l'inspiration et l'aide du Seigneur notre
Dieu (ah ! qu'il daigne faire servir nos paroles au salut même de ces
infortunés) nous avons entrepris de démontrer dans cet ouvrage la (118)
fourberie ou la témérité de ceux qui prétendent produire des accusations assez
bien fondées contre les livres de l'Evangile, écrits séparément par les quatre
Evangélistes. Pour remplir notre dessein, il faut montrer que ces quatre
auteurs ne sont nullement en désaccord. Car on a coutume de nous opposer,
comme le triomphe d'un système plein d'erreur, que les Evangélistes sont en
contradiction les uns avec les autres.
11. Mais d'abord, nous devons
répondre à ceux qui croient soulever une difficulté sérieuse en nous
demandant pourquoi Notre-Seigneur n'a lui-même rien écrit, et a mis les hommes
dans la nécessité de déférer, en ce qui le regarde, à des livres composés par
d'autres personnages. Car voilà ce qu'objectent principalement ces païens qui
n'osent accuser ou blasphémer Jésus-Christ en personne et lui accordent une
sagesse supérieure, humaine toutefois; ils prétendent que ses disciples l'ont
fait passer pour ce qu'il n'était pas quand il l'ont proclamé Fils de Dieu, un
avec Dieu le Père, Verbe de Dieu par qui toutes choses ont été faites ; ou
nous ont appris dans leurs livres à lui donner quelque autre nom qui oblige de
l'adorer comme un seul Dieu avec le Père. Ces païens pensent donc qu'il faut
l'honorer comme le plus sage des hommes; ils nient qu'on puisse l'adorer comme
un Dieu.
12. Or, quand ils demandent
pourquoi lui-même n'a rien écrit, ils paraissent disposés à croire sur son
compté ce qu'il aurait écrit de lui, et nonce que d'autres ont pu ensuite
publier suivant leur bon vouloir. Mais je les prie de me dire pourquoi, au
sujet de quelques-uns de leurs philosophes les plus célèbres, ils admettent ce
que des disciples en ont écrit, ces philosophes n'ayant eux-mêmes laissé aucun
livre pour se faire connaître à la postérité ? Car ils savent que Pythagore,
le plus illustre représentant de la vertu contemplative parmi les Grecs, n'a
pas écrit un mot ni de lui ni d'aucune chose. Un philosophe qu'ils élèvent
au-dessus de tout le monde dans la vertu active, dont l'objet est de former
les mœurs, et qu'Appollon lui-même, si on les en croit, a déclaré le plus sage
des hommes,Socrate s'est contenté d'ajouter quelques vers aux fables d'Esope,
consacrant ainsi son style et sa poésie à l'ouvrage d'un autre. Bien qu'il
n'ait alors prêté les ornements de
sa parole qu'aux pensées du fabuliste, non aux siennes, il a dit, au
rapport de Platon, son plus célèbre disciple, qu'il avait été contraint
par son démon familier : tant il était loin de vouloir rien écrire !
Pourquoi donc au sujet de Socrate et de Pythagore croient-ils ce que des
disciples en ont écrit, et refissent-ils de croire ce que les disciples de
Jésus-Christ nous disent de lui dans leurs livres ? Car enfin, s'ils nient sa
divinité, ils n'hésitent pas à reconnaître qu'il surpasse tout le monde en
sagesse. Est-ce que ces philosophes, qu'ils mettent
bien au-dessous de lui, ont pu former des disciples véridiques à leur
égard, tandis que lui-même n'a pas eu ce pouvoir ? Si
c'est là une absurdité , qu'ils croient
de celui dont ils affirment la haute sagesse, non ce qu'ils veulent, mais ce
qu'ils lisent dans les livres des disciples qui ont appris de ce sage les
vérités contenues dans leurs écrits.
13. Qu'ils nous disent du
moins, d'où ils ont pu savoir ou entendre que Jésus-Christ fut le plus sage
des hommes. S'ils l'ont appris de la renommée qui l'a dit partout, la renommée
est-elle à son égard une messagère plus sûre que ses disciples, dont la
renommée elle-même ne fait que publier les prédications dans l'univers entier?
Enfin qu'ils comparent renommée à renommée et admettent pour lui celle qui est
la plus grande. Celle qui s'est propagée d'une manière si éclatante, grâce à
l'Eglise Catholique, dont ils voient avec tant de surprise le développement
prodigieux dans tout l'univers, triomphe incontestablement de leurs misérables
rumeurs. Elle les écrase par son caractère de grandeur et de célébrité ; ils
sont obligés de dévorer en silence leurs faibles et timides reproches de
petites contradictions, et ils craignent qu'on les entende bien plus qu'ils ne
veulent être crus, quand ils la voient déclarer ouvertement que Jésus-Christ
est le Fils unique de Dieu, Dieu lui-même par qui toutes choses ont été
faites. S'ils prennent donc la renommée pour témoin, que ne donnent-ils la
préférence à celle qui brille avec tant d'éclat ? Si c'est l'Ecriture,
pourquoi pas les livres de l'Evangile qui jouit d'une telle autorité? Pour
nous, certainement, nous croyons d leur Dieu ce que nous en apprennent leurs
plus anciens écrits et la renommée la plus célèbre. Si l'on doit les adorer,
pourquoi s'en moque-t-on sur les théâtres ? Et s'il (119) faut les tourner en
ridicule, ne faut-il pas rire davantage de ce qu'on les adore dans les
temples? Reste maintenant que nos adversaires veuillent être eux-mêmes témoins
au sujet du Christ, eux qui se privent du mérite de savoir ce qu'ils disent en
disant ce qu'ils ne savent pas. S'ils se flattent d'avoir certains livres
écrits de sa main, qu'ils nous les montrent. Sans doute, des livres écrits, de
leur aveu, par le plus sage des hommes, sont très-utiles et remplis des plus
saines maximes. S'ils craignent de les produire, assurément ce sont de mauvais
livres, qui ne peuvent être l'oeuvre du plus sage des hommes : car ils disent
que Jésus-Christ est le plus sage des hommes : rien donc de pareil n'a été
écrit par lui.
14. Ils en viennent à ce point
de démence, de prétendre que dans les livres composés, disent-ils, parlai,
sont développés les artifices diabolique à l'aide desquels, selon eux,
le.divin maître aurait opéré tous les miracles que la renommée à publié d'un
bout du monde a l'autre. Par là ils se trahissent eux-mêmes et montrent bien
ce qu'ils aiment et ce qui est l'objet de leur étude, puisqu'ils font
consister la haute sagesse de Jésus-Christ dans la connaissance de je ne sais
quelles pratiques illicites, que non-seulement la doctrine chrétienne, mais
même le bon gouvernement de toute république terrestre condamne à juste titre.
D'ailleurs, s'ils affirment avoir lu de tels livres de Jésus-Christ, pourquoi
donc n'opèrent-ils aucun de ces miracles, qu'ils donnent comme le résultat des
procédés magiques expliqués dans ces livres ?
15. Mais que dire de
l'aberration où quelques-uns sont tombés par un juste jugement de Dieu ? En
croyant ou en voulant faire croire que le Sauveur a écrit de pareils livres,
ils disent que ces mêmes livres sont en forme de lettres, adressées à Pierre
et à Paul. Et il est possible que des ennemis de la religion chrétienne ou des
hommes qui ont pensé donner par le nom de Jésus plus de crédit aux exécrables
pratiques de la magie, aient écrit de tels livres sous ce nom glorieux en y
joignant les noms des princes des Apôtres. Dans cette insigne et audacieuse
fourberie, ils se sont montrés tellement aveugles et insensés, qu'ils
deviennent à juste titre l'objet du mépris et de la risée des enfants mêmes
qui encore au rang des lecteurs connaissent suivant leur âge les lettres
chrétiennes.
16. Ces païens donc voulant
persuader, contre toute vérité, que le Sauveur a écrit à ses disciples quelque
chose de pareil, pensèrent qu'on les croirait plus facilement s'ils
affirmaient que ses lettres sont adressées à des hommes liés avec lui d'une
amitié plus étroite et dignes de recevoir la communication d'un secret. Pierre
et Paul se sont présentés à leur esprit. Sans doute c'est parce qu'ils ont vu,
en plusieurs endroits, les images de ces deux Apôtres à côté de celle de
Jésus-Christ ; et parce que l'Eglise de Rome honore d'une manière spéciale,
dans une fête commune, les mérites de saint Pierre et de saint Paul qui ont
reçu, le même jour, la couronne du martyre. Ces hommes ont mérité d'être ainsi
les jouets d'une erreur grossière en cherchant, non dans les livres saints,
mais dans les peintures des murailles, la connaissance de Jésus-Christ et des
Apôtres : et il n'est pas étonnant que ceux qui sont dans l'usage de donner à
la fiction les droits de la vérité, aient été trompés par les peintres. En
effet, tant que Jésus-Christ vécut dans sa chair mortelle avec les disciples
qu'il avait choisis, Paul n'était pas encore du nombre de ces derniers. Ce fut
seulement après la passion du Sauveur, après sa résurrection, son ascension et
la descente du Saint-Esprit, après la conversion miraculeuse de beaucoup de
Juifs à la foi chrétienne, après la mort d'Etienne diacre et premier martyr,
que Jésus-Christ l'appela du haut du ciel et en fit sols disciple et son
Apôtre (1). Jusque là il portait encore le nom de Saul et poursuivait à
outrance les fidèles du divin maître. Comment donc Jésus-Christ aurait-il pu
adresser aux Apôtres Pierre et Paul, comme à ses disciples, les plus
familiers, les livres que l'on prétend avoir été rédigés par lui avant sa
mort, puisque Paul n'était pas encore son disciple ?
17. Nous prions encore ceux
qui veulent, dans leur folie, que Jésus-Christ ait pu opérer tant de
120
merveilles, rendre son nom illustre, et s'attirer les
hommages des peuples par des opérations magiques, nous les prions de
considérer s'il a pu, par de tels moyens, remplir de l'Esprit de Dieu, avant
de naître, tous les prophètes qui ont annoncé à l'avance les événements que l'Evangile
nous montre accomplis déjà depuis longtemps en sa personne, et ceux que nous
voyons s'accomplir aujourd'hui dans tout l'univers. Si, par la magie, il a pu
se ménager l'honneur d'être adoré même après sa mort, du moins doit-on
convenir qu'il n'était pas magicien avant de naître. Et voilà qu'une nation
entière a été destinée à l'annoncer, de manière à offrir dans toute la suite
de son gouvernement une prophétie de ce roi qui devait venir pour former de
toutes les nations la cité céleste.
18. Cette nation des Hébreux,
dont le rôle, comme je l'ai dit, fut de prophétiser le Christ, n'avait d'autre
Dieu que le seul Dieu, le vrai Dieu qui a fait le ciel et la terre avec tout
ce que le ciel et la terre renferment. Souvent ils tombèrent sous le joug de
leurs ennemis après l'avoir offensé : et maintenant pour s'être rendus
coupables de la mort du Christ, on les voit arrachés de Jérusalem leur
capitale, et soumis à l'empire romain. Or, les Romains étaient dans l'usage
d'adorer, pour se les rendre propices, tous les dieux des nations qu'ils
subjuguaient, et d'en admettre le culte. Leur conduite fut différente envers
le Dieu des Hébreux, après qu'ils eurent détruit par les armes la nationalité
de ce
peuple. Car ils comprenaient bien, je crois, que recevoir le culte du Dieu
d'Israël, c'était s'engager à n'adorer que lui et à renverser toutes ces
idoles qui, en retour des hommages reçus, avaient, pensaient-ils, donné tant
de force et un si grand accroissement à leur empire. En quoi la malice des
démons les abusait étrangement : car ils devaient croire sans nulle hésitation
que ce n'était pas la faveur de tant de faux-dieux, mais bien la volonté
secrète du vrai Dieu, souverain Seigneur de toutes choses, qui leur avait
donné l'empire et en avait ménagé l'accroissement : il était facile de
comprendre, que les dieux des nations, s'ils avaient eu quelque puissance,
n'auraient point laissé leurs adorateurs tomber sous le joug des Romains, mais
les auraient plutôt rendus maîtres des Romains eux-mêmes.
19. Ils ne peuvent,
d'ailleurs, prétendre que les dieux des nations subjuguées par eux, les ont
favorisés pour leur piété et leurs bonnes mœurs. Ils n'oseront jamais le dire,
s'ils veulent se rappeler les commencements de leur empire, honteusement
marqués par l'asile ouvert aux brigands et par le fratricide de Romulus. En
effet, quand les fils de Rhéa Sylvia créèrent un refuge où pût se rendre tout
homme coupable de quelque crime, et par là se soustraire au châtiment,
donnèrent-ils des leçons de repentir, pour ramener au bien des âmes flétries
par le mal : ou plutôt n'armèrent-ils pas contre leur patrie ces fugitifs
qu'ils arrachaient à la crainte des lois et de -la justice en leur promettant
l'impunité ? Et quand Romulus tua son frère qui ne lui avait fait aucun mal,
sans doute c'était pour venger les droits de la justice, et non pour
satisfaire son ambition et sa soif du pouvoir? De telles moeurs ont-elles donc
charmé les dieux au point de les rendre ennemis de leurs propres villes
attaquées, et protecteurs des assaillants? Que dis-je ?en abandonnant ces
villes les dieux ne les condamnaient point à -périr, comme en passant du côté
des Romains ils n'assuraient point à ceux-ci la victoire : car il n'est
nullement en leur puissance de disposer des trônes et des couronnes. Il n'y a
que le seul vrai Dieu qui, par un jugement secret, les donne ou les reprend :
et ce n'est pas pour rendre heureux ceux à qui il les donne ni malheureux ceux
à qui il les enlève ; mais tandis que sa providence sait trouver ailleurs la
cause et l'objet du bonheur des uns et des autres, il distribue, suivant
l'ordre d'une prédestination 'éternelle, les royaumes temporels et terrestres,
en les laissant ou en les donnant à qui il veut et pour le temps qu'il veut.
20. De là, nos adversaires
n'ont pas davantage le droit de nous faire cette autre objection Pourquoi le
Dieu des Hébreux qui est, selon vous, le vrai Dieu et le souverain maître de
toutes choses, non-seulement ne leur a pas soumis les Romains, mais ne s'est
même pas employé à les soustraire au joug de ce peuple ? Pourquoi? C'est que
auparavant ils s'étaient souillés de crimes (121) manifestes, en punition
desquels les prophètes avaient si longtemps d'avance annoncé leur ruine ;
c'est que surtout, par un aveuglement monstrueux, juste châtiment d'autres
péchés secrets, ils ont trempé leurs mains avec une, fureur impie dans le sang
de Jésus-Christ. De plus les mêmes prophètes avaient prédit que la passion du
Christ serait avantageuse aux nations. Que tout chez les Juifs ait été une
prédication anticipée de Jésus-Christ, et leur royaume et leur temple, et leur
sacerdoce et leurs sacrifices, et cette onction mystique dont le nom grec
khrisma explique le nom de Christs donné aux rois de la nation et le nom
du Christ lui-même, voici qui le démontre avec la plus grande évidence :
aussitôt que Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts commença a être prêché
aux gentils, toutes ces figures cessèrent à l'insu des Romains et des Juifs
qui travaillaient à les détruire, les uns par leur victoire, les autres par
leur défaite.
21. Il est une chose
très-digne d'admiration, et dont ne tiennent pas compte les rares partisans du
paganisme que nous voyons encore au milieu de nous : c'est que le Dieu des
Hébreux, offensé par les vaincus et rejeté par les vainqueurs, est maintenant
connu dans tout l'univers et adoré par toutes les nations. Aussi bien c'est du
Dieu d'Israël que le prophète disait au peuple choisi, si longtemps auparavant
: « Celui qui t'a délivré, le Dieu d'Israël, sera appelé le Dieu de toute la
terre (1). » Cette prédiction s'est accomplie avec le nom de Jésus-Christ,
venu parmi nous du sang d'Israël, petit-fils d'Abraham qui fut la souche des
Hébreux (2); et en effet Israël lui-même avait reçu la promesse : « Que toutes
les nations de la terre seraient bénies en celui qui naîtrait de sa race (3).
» On doit comprendre par là que le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu qui a fait
le Ciel et la terre et qui conduit avec justice et miséricorde les affaires et
les événements de ce monde, sans que la justice entrave la miséricorde, sans
que la miséricorde soit un obstacle à la justice, n'a pas été vaincu dans son
peuple Hébreu quand il a laissé les Romains prévaloir et le réduire à n'avoir
plus ni royauté ni sacerdoce. Car le même Dieu d'Israël, avec
l'Évangile de Jésus-Christ vrai roi et vrai prêtre, deux
titres figurés par le trône et l'autel des Hébreux, abolit maintenant partout
les idoles des nations, pour le maintien desquelles les Romains n'avaient pas
voulu recevoir son culte comme ils avaient reçu le culte des dieux de tant
d'autres peuples, forcés de reconnaître leurs lois. Il a donc laissé périr le
sacerdoce et la royauté de la nation prophétique, parce que le rôle de cette
nation, instrument des promesses, était sans objet, du moment que le Christ
promis était venu. Et quant aux Romains vainqueurs des Juifs, il les a soumis
à son nom par le Christ roi; et en leur donnant la force, et la générosité de
la foi chrétienne, il a tourné leur zèle au renversement de ces idoles pour
l'honneur desquelles son culte
avait d'abord été rejeté.
22. Le Christ, ce me semble,
n'a point usé des artifices de la magie pour faire annoncer avant de naître,
par tant de prophètes, par la royauté même et le sacerdoce de toute une
nation, tout ce qui devait s'accomplir en lui. Aussi bien, le peuple Juif dont
le royaume a cessé d'exister et qui, par une admirable providence de Dieu, se
trouve maintenant dispersé dans tout l' univers, quoiqu'il n'ait plus aucune
onction royale ou sacerdotale, quoiqu'il ait perdu cette onction appelée
Chrême dans laquelle apparaît le nom du Christ, ce peuple garde encore
quelques-unes de ses observances, et veut conserver sa religion : vaincu et
subjugué par les Romains il a repoussé leur culte idolâtre; ainsi il rend
témoignage à Jésus-Christ par les livres des prophètes qu'il porte avec lui;
et la vérité des prédictions qui regardent Jésus-Christ trouve sa preuve, même
dans les mains clé nos ennemis. Pourquoi donc. faut-il que nous voyons encore
des misérables qui font connaître leur perversité en adressant au Christ de
fausses et perfides louanges? Si quelques livres de magie: ont été écrits sous
son nom quand la doctrine chrétienne se montre l'ennemie déclarée de
semblables pratiques, loin de s'en prévaloir contre nous, qu'ils comprennent
plutôt toute la grandeur de ce nom qu'empruntent ceux-mêmes dont la vie est en
opposition avec la morale du Christianisme, afin de donner du crédit à leurs
criminels artifices. Car de même que des erreurs diverses parmi les hommes ont
donné lieu à différentes hérésies qui s'autorisent du nom du Christ ; ainsi
les ennemis mêmes du Christ pensent que leurs paroles sont dépourvues de toute
autorité, (122) s'ils ne lui attribuent ce qu'ils avancent contre sa doctrine.
23. Que dire de la conduite de
ces hommes qui donnent à Jésus-Christ des éloges dérisoires et dénigrent par
mille voies détournées la religion chrétienne? Ils n'osent blasphémer le
Christ, parce que certains de leurs philosophes, comme le rapporte dans ses
livres Porphyre de Sicile, ayant consulté les dieux du paganisme et sollicité
une réponse au sujet de ce personnage merveilleux, les dieux ne purent se
défendre de faire son éloge dans les oracles qu'ils rendirent. Ce quine doit
pas nous surprendre, puisque nous, lisons dans l'Evangile, que les démons
confessaient le nom de Jésus-Christ (1). Or, nous apprenons par la lecture des
prophètes que les dieux des gentils ne sont autres que des démons (2). Ces
païens donc, pour ne point lutter contre les oracles de leurs dieux,
s'abstiennent de maudire le Christ et ils reportent leurs malédictions sur ses
disciples . Pour moi, il me semble que si les dieux des nations, consultés sur
Jésus-Christ par les philosophes du paganisme, l'eussent été de même au sujet
de ses disciples, ils se seraient vus contraints d'en faire aussi l'éloge.
24. Toutefois, ces hommes
s'efforcent de persuader que ce n'est point la doctrine de Jésus-Christ, mais
bien celle des disciples qui a déterminé le renversement des temples païens,
l'abolition des sacrifices et la ruiné des idoles : ils prétendent que les
Apôtres n'ont pas gardé l'enseignement de leur maître. Ainsi, en honorant et
en louant Jésus-Christ, ils veulent détruire la foi chrétienne, puisque c'est
par les disciples de Jésus-Christ que le monde a connu ses actions et ses
paroles, objets de la religion chrétienne, contre laquelle ce petit nombre de
païens, déjà las du combat, s'obstinent néanmoins à murmurer quelques
pitoyables objections. Mais s'ils ne veulent pas
croire que la doctrine de Jésus-Christ est publiée par
l'enseignement des Apôtres, nous les prions de lire les prophètes qui,
non-seulement ont prescrit de détruire le faux culte des idoles, mais qui ont
même annoncé que cette destruction se ferait dans les temps chrétiens. Si les
prophètes ont menti, d'où vient que leurs prédictions se sont accomplies avec
tant d'éclat? Et s'ils ont dit vrai, pourquoi résister à de telles
prédictions, marques infaillibles de la divinité de Celui dont ils étaient les
interprètes ?
25. Arrêtons-nous cependant à
leur demander ce qu'ils pensent du Dieu d'Israël, et pourquoi ils ne l'ont pas
relu pour l'adorer comme les dieux des autres nations assujetties par les
Romains, surtout quand ils admettent la maxime que le sage doit adorer tout
les dieux. Pourquoi donc ont-ils excepté le Dieu d'Israël? Si ce Dieu a
beaucoup de puissance, pourquoi est-il le seul qu'ils n'adorent pas? Et si son
pouvoir est nul ou peu étendu, comment se fait-il que presque partout les
idoles sont renversées et lui seul adoré? Ils ne pourront jamais se dégager du
lien de cette question, ceux qui, en adorant des êtres qu'ils croient des
divinités grandes ou petites, rejettent le seul qui a prévalu contre tous
leurs dieux. S'il a une grande puissance, pourquoi a-t-on pensé qu'il ne
fallait pas le reconnaître ? S'il n'a point ou n'a que peu de puissance,
comment ce Dieu méprisé a-t-il fait de si grandes choses? S'il est bon,
pourquoi ne l'a-t-on pas admis au nombre des dieux qu'on appelle bons? S'il
est méchant, d'où vient que tant de dieux bons ne peuvent triompher de lui
seul? S'il est véridique, pourquoi repousser les préceptes qu'il impose? Et
s'il est menteur, comment ses oracles se trouvent-ils accomplis?
26. Enfin que l'on pense de
lui ce qu'on voudra; est-ce que les Romains n'ont pas cru qu'il y avait des
dieux méchants et qu'il fallait aussi les adorer, puisqu'ils ont élevé des
temples à la Paleur et à la Fièvre? Est-ce qu'ils n'ont pas dit (123) qu'il
fallait invoquer les bons génies et apaiser les mauvais démons? Qu'ils aient
donc jugé bon ou mauvais le Dieu d'Israël, pourquoi n'ont-ils cru devoir ni
l'invoquer ni l'apaiser? Et quel est donc ce Dieu ou tellement ignoré qu'on ne
le trouve pas jusqu'alors dans l'immense multitude des divinités païennes, ou
tellement connu qu'aujourd'hui il est seul adoré par tant d'hommes? Pour
justifier le rejet de son culte on ne peut plus alléguer d'autre raison qu'un
ordre et une défense du même Dieu d'Israël, ordre de l'adorer lui seul,
défense d'adorer les dieux du paganisme qui étaient en possession des hommages
du monde. Mais il faut presser nos adversaires de dire quel est, suivant eux,
ce Dieu qui défend d'adorer les autres dieux en l'honneur desquels se sont
élevés tant de temples et d'idoles; quelle est la grandeur d'un Dieu dont 1a
volonté a eu plus de pouvoir pour détruire l'idolâtrie que. n'en ont eu les
Romains pour empêcher de recevoir son culte? Tout le monde tonnait sans doute
la maxime de ce philosophe, le plus sage des hommes, au.dire des païens et
d'Apollon lui-même. La maxime de Socrate est qu'il faut rendre à chaque Dieu
le culte que lui-même a prescrit. Pour ne point contredire à cette règle, les
Romains se voyaient dans l'étrange nécessité de ne pas adorer le Dieu des
Hébreux; car, en voulant l'adorer d'une manière opposée à ses ordonnances ils
ne l'auraient pas adoré lui-même, mais bien le fantôme de leur imagination ;
et en l'adorant comme ce Dieu voulait être adoré, ils s'obligeaient, pour
respecter sa défense, à ne pas adorer les autres dieux. Ainsi ont-ils rejeté
le culte du seul vrai Dieu dans la crainte d'offenser une multitude de faux
dieux, pensant que la colère de ceux-ci devait leur être plus funeste que la
bienveillance de celui-là ne pouvait leur être utile.
21. Mais c'était une nécessité
vaine et une crainte ridicule. Nous demandons maintenant ce qu'ils pensent du
Dieu d'Israël, ces hommes à qui il plait de dire que tous les dieux doivent
être adorés. Si celui-là ne doit pas l'être, comment le sont-ils tous tandis
qu'il ne l'est pas? Que s'il doit être adoré, il est impossible que tous le
soient puisqu'il n'est véritablement adoré qu'autant qu'on n'adore pas les
autres ? Diront-ils que ce n'est pas un Dieu, quand ils appellent dieux ceux
qui selon nous n'ont aucun pouvoir sans sa permission, et ne peuvent faire
aucun bien ni même aucun mal, sinon aux hommes que ce maître tout-puissant
juge à propos de punir ou d'éprouver? Du reste, comme ils sont obligés d'en
convenir, les dieux du paganisme n'ont montré qu'une puissance bien inférieure
à la sienne. Car, s'ils sont des dieux ceux dont les devins consultés par les
hommes ont fait des réponses, pour ne pas dire des mensonges, qui touchaient à
des intérêts privés ; comment n'est-il pas Dieu celui dont les prophètes
non-seulement ont répondu d'une manière exacte au sujet des événements du
temps sur lesquels on les consultait, mais ont prédit, tant de siècles
d'avance, sans être consultés, les grandes choses que nous lisons maintenant
et que nous voyons accomplies à l'égard du genre humain et de toutes les
nations de la terre? S'ils tiennent pour un dieu celui dont la Sybille à reçu
l'influence pour chanter les destins de Rome; comment n'est-il pas Dieu celui
qui a fait voir dans l'avenir les Romains et tous les peuples amenés à croire
en lui comme au seul Dieu, par l'Evangile de Jésus-Christ, et à renverser
eux-mêmes toutes les idoles de leurs pères, prédiction aujourd'hui réalisée?
Enfin, s'ils appellent dieux ceux q i n'ont jamais osé inspirer à leurs devins
une parole qui lui soit contraire, comment n'est-il pas Dieu, lui, qui par ses
prophètes a commandé de détruire leurs idoles, et a même prédit que tous les
peuples, à qui il donnait l'ordre de n'adorer que lui seul, lui obéiraient,
déserteraient leurs temples, et renverseraient eux-mêmes leurs autels?
28. Veulent-ils nous
contredire ? qu'ils lisent donc, s'ils le peuvent, dans les livres de leurs
sybilles ou autres devins, un oracle, annonçant que le Dieu des Hébreux serait
un jour adoré de toute les nations ; que les écrits de ses prophètes auraient
assez d'autorité pour obliger l'empire Romain à les recevoir et à prescrire
la. destruction des idoles ; qu'il faudrait néanmoins prendre garde d'obéir à
cette injonction, et que les adorateurs des autres dieux pourraient
s'applaudir comme d'une conduite raisonnable (124) d'avoir auparavant rejeté
celui-là : qu'ils lisent donc de telles choses, s'ils le peuvent, dans
quelques uns des livres de leurs devins. Car, j'omets de dire que comme les
démons étaient forcés de reconnaître Jésus-Christ même, durant les j ours de
son apparition ici-bas dans la chair, les auteurs des livres dont il s'agit,
rendent à notre foi, c'est-à-dire à la religion chrétienne, un témoignage qui
paraît bien être celui des saints anges ou de nos prophètes eux-mêmes. J'omets
cette remarque qu'ils veulent regarder comme une fiction des chrétiens quand
nous la produisons. Mais eux-mêmes, eux-mêmes, qu'ils produisent comme extrait
des oracles du paganisme quelque prédiction contraire au Dieu des Hébreux,
quand de notre côté nous leur montrons avec les livres de nos prophètes tant
de choses si importantes ordonnées, prédites et accomplies contre leurs dieux.
Le peu de païens qui nous restent aiment mieux déplorer les événements
accomplis, que de reconnaître le Dieu qui a pu les annoncer; et cependant,
selon eux, quand leurs faux dieux qui sont de vrais démons, ont une fois
prouvé leur puissance en prédisant quelque événement futur, on doit ne rien
demander de plus.
29. Pourquoi donc, alors, ces
malheureux ne reconnaissent-ils pas le vrai Dieu dans ce Dieu tellement
antipathique aux leurs, que tout en confessant sa Divinité ils se voient
contraints de lui refuser leurs hommages, eux dont la maxime cependant est
qu'on doit adorer tous les dieux? Puisque tous ne peuvent être adorés,
pourquoi donc ne pas choisir celui qui défend d'adorer les autres? pourquoi ne
pas abandonner ceux qui n'osent défendre de l'adorer lui-même ? Ou si les
dieux du paganisme ont formulé cette défense, qu'on ne refuse pas de la lire.
Est-il une chose qui ait dû frapper davantage les oreilles des
peuples dans leurs temples, dans leurs temples où rien de pareil n'a
cependant jamais retenti ? Et certes la défense d'un si grand nombre contre un
seul devrait avoir plus de notoriété, plus de pouvoir que la défense d'un seul
contre tant d'autres. Si le cuite du Dieu d'Israël est impie, des dieux qui
n'éloignent pas les hommes de l'impiété sont bien inutiles ; si au contraire,
c'est un culte légitime et pieux, comme on y trouve i'ordre de ne pas adorer
les divinités païennes, il y a donc impiété a les adorer. Mais, si les dieux
des nations proscrivent ce culte avec tant de défiance et de mystère, que le
téméraire désir de l'empêcher cède à la crainte de se faire entendre; ne
voit-on pas, ne sent-on pas à l'instant qu'il faut reconnaître et adorer un
Dieu qui défend le culte des autres avec toute sorte de publicité, qui a
ordonné de renverser leurs idoles, qui en a prédit la ruine et qui les a de
fait renversées par la prédication de l'Evangile, plutôt que des dieux timides
ou sans vertu, qui n'ont rien ordonné, rien prédit, rien pu contre lui? Car de
leur part nous ne connaissons, nous ne lisons, nous ne voyons rien dans ce
sens. De grâce, qu'on nous réponde : quel est donc ce Dieu qui flagelle ainsi
tous les dieux des nations, qui traite et pulvérise ainsi leur culte ?
30. Mais pourquoi interroger
des hommes qui, au sujet du Dieu d'Israël, se sont perdus dans leurs rêveries
? Les uns disent : c'est le même que Saturne; sans doute à cause de la
sanctification du samedi chez les Juifs, cardes païens ont affecté ce jour à
Saturne. Mais leur illustre Varron, qu'ils regardent comme le plus docte des
Romains, veut que le Dieu des Juifs soit Jupiter; selon lui, peu importe le
nom, si l'on s'entend sur la chose; or l'idée de la grandeur souveraine de ce
Dieu, l'a, je crois, arrêté dans ses recherches. Les Romains, en effet, comme
le prouve assez clairement leur Capitole, ne reconnaissent aucun dieu
supérieur à Jupiter, qu'ils considèrent comme le maître de tous les dieux;
aussi Varron n'a-t-il pu imaginer rien de mieux que Jupiter, quand il a su que
les Juifs adoraient le Dieu suprême. Mais, que dans le Dieu des Juifs on voie
Saturne ou Jupiter, peut-on dire que jamais Saturne ait osé défendre d'adorer
un autre Dieu, même Jupiter son fils qui le détrôna? S'il plaît aux païens
d'adorer Jupiter comme plus puissant et vainqueur de son père; alors qu'ils
n'adorent pas Saturne vaincu et chassé du ciel . Mais Jupiter n'a pas défendu
non plus de l'adorer, et s'il a pu le vaincre, il lui a permis aussi d'être un
dieu.
125
31. Ce sont là, disent nos
adversaires, des fables qui doivent être expliquées par les sages ou livrées
au ridicule. Pour nous, ce que nous adorons, c'est le Jupiter dont Virgile a
dit : « Tout est plein de sa présence (1) ; » c'est-à-dire nous adorons
l'esprit qui vivifie toutes choses. S'il en est ainsi, Varron ne s'est pas
trompé en supposant que les Juifs adoraient Jupiter, puisque le Seigneur dit
par son prophète: « Je remplis le ciel et la terre (2). » Mais qu'est-ce que
le poète appelle ciel ou Éther ; et eux-mêmes quel sens donnent-ils à ce mot
?Car nous avons un autre passage de Virgile ainsi conçu: « Alors l'Ether, père
tout-puissant, descendit en pluies fécondes dans le sein de sa joyeuse épouse
(3) ; » et ils disent que l'Ether n'est pas un esprit mais bien le corps
supérieur qui forme la voûte du ciel étendu au-dessus de l'air. Accordent-ils
au poète de parler de Dieu tantôt comme d'un pur esprit selon les
Platoniciens, tantôt comme d'un corps selon les Stoïciens? Et qu'est-ce donc
qu'ils adorent au Capitole ? Si c'est un esprit ou même le corps du ciel, que
fait là le bouclier de Jupiter qu'ils appellent Egide: car pour expliquer
l'origine de ce nom, ils disent que Jupiter, caché par sa mère, fut allaité
par une chèvre. Ceci est-il encore une invention des poètes ? Le Capitole des
Romains est-il donc aussi l'oeuvre des poètes ? Que veut dire cette momerie
fort peu poétique, de suivre les philosophes quand il s'agit d'acquérir dans
les livres la connaissance des dieux, et les poètes, quand il s'agit de les
adorer dans les temples?
32. Mais fut-ce un poète aussi
qu'Evhémère, bien que, au rapport de Cicéron (4), Ennius l'ait traduit en
latin ? Or il prouve que Jupiter lui-même et Saturne son père et Neptune et
Pluton ses frères ont été simplement des hommes; il le prouve avec tant de
clarté que les adorateurs de ces dieux devraient rendre grâces aux poètes dont
les fictions ont eu pour but d'embellir et non de déshonorer les objets de
leur culte. Et Cicéron lui aussi était-il un poète ? Voici comme il parle dans
les Tusculanes, à son interlocuteur qu'il suppose bien instruit de la doctrine secrète (5): « Si
j'interroge l'antiquité, si
je consulte les ouvrages que nous ont laissés les auteurs
grecs, j'y verrai que ceux qu'on regarde comme des dieux, même dans les plus
grandes nations, sont sortis du milieu de nous, pour alter prendre possession
du Ciel. « Informe-toi de quels dieux la Grèce possède les tombeaux ; puisque
tu es initié, souviens-toi de l'enseignement des mystères, et tu comprendras
enfin combien paraît hors de doute ce que je te dis. » On ne peut le nier,
Cicéron, dans ce passage, déclare d'une manière assez explicite, que les dieux
des païens furent des hommes ; et il suppose bénévolement qu'ils sont parvenus
au Ciel, quoiqu'il ait dit, sans balancer, dans une harangue publique, que
l'honneur de l'apothéose relève uniquement de l'opinion du monde; car en
parlant de Romulus il s'est ainsi exprimé : « Notre bienveillance et sa haute
renommée ont placé Romulus, fondateur de la Ville, au rang des dieux immortels
(1). » Et qui peut trouver invraisemblable que les hommes aient fait,
autrefois pour Jupiter, Saturne et les autres, ce que les Romains ont fait
pour Romulus, et ce qu'ils ont voulu faire aussi pour César dans des temps
plus rapprochés ? Virgile appuyait ce dessein des accents flatteurs de sa muse
: « Voici, disait-il, que paraît l'astre de César, fils de Vénus (2). » Qu'on
prenne donc garde à la vérité historique, qui peut montrer sur la terre les
tombes des faux dieux. Qu'on fasse donc réflexion que les poètes n'attachent
pas au Ciel, mais feignent d'y rencontrer et d'y reconnaître leurs étoiles.
Aussi bien, telle étoilé n'est pas de Jupiter, ni cette autre de Saturne;
mais, après leur mort, les hommes qui ont voulu les regarder comme des dieux
ont donné leurs noms à des astres créés dès l'origine du monde. Et à ce sujet,
voudrait-on nous dire quel si grand mal a fait la chasteté, quel si grand bien
la volupté, pour que Vénus ait son étoile parmi les planètes et pour que
Minerve n'ait pas la sienne ?
33. Mais, je le veux,
l'académicien Cicéron est moins certain encore de ce qu'il avance que les
poètes, quand il ose, jusque dans ses livres, faire mention des tombeaux des
dieux, bien que sa parole soit l'écho des traditions religieuses, et non
l'expression d'une opinion particulière. Est-ce que Varron, lui aussi, a voulu
feindre comme un poète ou supposer comme un académicien,
126
que le culte de tels dieux a son explication dans les
circonstances de la vie ou de la mort de chacun d'eux parmi les hommes ? Etait-il
aussi poète ou académicien ce prêtre d'Egypte, nommé Léon, qui, en exposant,
sur l'origine des dieux, une opinion différente, il est vrai, de celle des
Grecs, parle cependant de manière à faire comprendre au roi de Macédoine
Alexandre que ces dieux ont été de simples mortels?
34. Du reste, que nous importe
? Laissons nos adversaires
dire qu'en adorant Jupiter ils n'adressent pas leur culte à un homme
mort; admettons avec eux qu'ils n'ont pas dédié le Capitole à un homme mort,
mais à l'esprit qui vivifie toutes choses et qui remplit le monde;
permettons-leur d'expliquer comme ils voudront le bouclier de Jupiter, fait
d'une peau de chèvre en l'honneur de sa nourrice. Et Saturne qu'en disent-ils
? Et quel est le Saturne qu'ils adorent? N'est-ce pas celui qui le premier
descendit de l'Olympe, et qui, selon Virgile, « chassé, proscrit de ses états,
obligé de fuir pour échapper aux armes de Jupiter, réunit en société, soumit à
des lois une nation sauvage, dispersée sur le haut des montagnes, et préféra
donner au pays le nom de Latium (latere se cacher,) parce qu'il s'y
était caché et mis à l'abri de tout périt (1) ? » L'idole même de ce dieu qui
le représente la tête couverte, n'indique-t-elle pas quelqu'un qui se cache ?
La faux qu'on lui met à la main,ne fait-elle pas comprendre qu'il s'agit de
celui qui enseigna l'agriculture aux habitants de l'Italie? Non, disent nos
païens ; à vous de voir si le personnage dont on raconte ces choses fut un
homme et un roi quelconque. Saturne pour nous, c'est le temps universel, comme
l'indique son nom grec. Car il est appelé Khronos, dans cette langue,
et ce nom rend l'idée du temps quand on le prononce avec aspiration. De là
vient qu'en latin il est appelé Saturnus ou saturatus annis,
rassasié d'années. Je ne vois- plus de discussion, possible avec des gens dont
tous les efforts, pour donner la meilleure interprétation des images et des
noms de leurs dieux, se terminent par l'aveu que le premier et le père de tous
c'est le Temps. Que déclarent-ils par là, sinon que tous leurs dieux sont
temporels; puisque, selon eux, le temps lui-même en est le père?
35. C'est de quoi ont rougi
leurs philosophes plus récents, les Platoniciens qui ont paru depuis
l'établissement du Christianisme. Aussi essayent
ils de donner au nom de Saturne une étymologie plus
rationnelle. Son nom grec Khronos disent-ils, signifie : plénitude
de l'intelligence; car, en grec, Khronos signifie satiété ou
plénitude, et nous intelligence ou esprit. Le mot latin,
ajoutent-ils, parait lui-même favoriser cette interprétation, comme composé,
pour la première partie, du mot latin satur, et, pour la seconde, du
mot grec nous. Saturnus reviendrait ainsi à Satur nous,
plein d'intelligence. Ces philosophes ont compris, en effet, qu'il était trop
absurde de regarder Jupiter comme le fils du temps, quand ils pensaient ou
voulaient faire croire que c'était un dieu éternel, suivant leur
interprétation toute nouvelle; car si elle était ancienne, on rie comprendrait
pas que Cicéron et Varron l'eussent ignorée. Voici comment Jupiter est fils de
Saturne; ils voient en lui un esprit qui émane de cette souveraine
intelligence, et prétendent qu'il est comme l'âme de ce monde, qu'il pénètre
et remplit toute la nature corporelle soit au ciel soit sur la terre. D'où ce
mot de Virgile que nous avons déjà rapporté un peu plus haut : « Tout est
plein de Jupiter, tout est rempli de sa présence. »
S'ils en avaient le pouvoir,
comme ils ont changé l'explication du système de la théologie païenne, ne.
changeraient-ils pas aussi la superstition des hommes, ne s'abstiendraient-ils
pas d'élever aucune idole, ou du moins ne voueraient-ils pas plutôt le
Capitole à Saturne qu'à Jupiter? Car ils conviennent que nulle âme raisonnable
n'est sage qu'en vertu de la participation de la souveraine et immuable
sagesse; ils en conviennent, non-seulement pour l'âme humaine, mais encore
pour l'âme du monde qu'ils disent être Jupiter. Pour nous, nous accordons et
même nous affirmons hautement qu'il y a en Dieu une souveraine sagesse, dont
la participation rend sage toute âme qui le devient véritablement. Mais cette
masse corporelle dont l'ensemble est appelé,le monde, a-t-elle une âme, son
âme propre, une vie raisonnable qui en règle tous les mouvements comme, sont
réglés ceux de tout être animé ? C'est une grande question, très-difficile à
résoudre: on ne doit pas embrasser cette opinion si la vérité n'en est bien
démontrée, ni la traiter d'erreur à moins qu'il ne soit constant qu'elle est
fausse. Après tout, qu'importe à l'homme, dût-il toujours vivre sur ce point
dans l'ignorance ? La sagesse d'une âme, en effet, résulte seulement de la
souveraine et immuable sagesse de Dieu, et non (127) du fait d'une autre âme
qu'elle qu'elle soit.
36. Cependant, les Romains qui
ont voué le Capitole non à Saturne mais à Jupiter, et les autres nations qui
ont pensé qu'ils fallait mettre Jupiter au-dessus de tous les dieux et lui
adresser des hommages particuliers, n'ont pas été du même sentiment que les
Platoniciens. Ceux-ci, d'après leur opinion toute nouvelle, devraient
consacrer à Saturne la première forteresse de l'empire, s'ils avaient en cela
quelque pouvoir, et faire disparaître impitoyablement les Astrologues et les
tireurs d'horoscopes qui l'ont rangé comme un dieu malfaisant parmi les autres
étoiles, quand eux-mêmes le regardent comme la source et l'auteur de toute
sagesse. Du reste, cette opinion qui fait de Saturne un dieu malfaisant, a,
malgré eux, prévalu dans les esprits, à ce point qu'on ne veut pas même le
nommer : on l'appelle plutôt le vieillard que Saturne. Et telle est la crainte
qu'il inspire, aujourd'hui les païens de Carthage ont presque changé le nom du
bourg, qu'ils lui ont consacré et ils disent plus communément le bourg du
vieillard que le bourg de Saturne.
37. Nous savons donc à quoi
les adorateurs des idoles sont convaincus d'adresser leur culte, et ce qu'ils
s'efforcent de déguiser sous de belles couleurs. Mais il faut encore demander
à ces nouveaux interprètes du nom et des attributs de Saturne, ce qu'ils
pensent du Dieu des Hébreux. Car ils ont trouvé bon, eux aussi, d'adorer avec
les nations tous les dieux qu'elles reconnaissent, tout en refusant, dans leur
orgueil, de s'humilier aux pieds de Jésus Christ pour la rémission de leurs
péchés. Que pensent-ils donc du Dieu d'Israël ? S'ils ne l'adorent pas, ils
n'adorent pas tous les dieux; s'ils l'adorent, ils ne l'adorent as comme lui
même veut être adoré, puisqu'ils adorent aussi les autres que ce Dieu défend
d'adorer. Le Dieu d'Israël, en effet, a défendu le culte de toute autre
divinité, par les prophètes auxquels il a fait prédire en même temps ce que
les chrétiens font subir maintenant aux idoles. Soit, en effet, que des anges
envoyés à ces prophètes leur aient montré en figure par des images sensibles
convenablement ménagées, le seul vrai Dieu créateur et maître de toutes
choses, et leur aient appris de quelle manière il voulait être adoré; soit que
le Saint-Esprit ait répandu dans les âmes de quelques-uns d'entre eux une si
grande et si vive lumière, qu'ils fussent capables de voir par intuition,
comme les anges eux-mêmes, des objets tout spirituels; toujours est-il, qu'ils
ont servi ce Dieu qui défend d'adorer les autres; qu'ils l'ont servi par les
sentiments d'une foi et d'une piété sincères, dans la royauté et le sacerdoce
de leur nation et parla pratique d'un culte qui annonçait l'avènement futur du
Christ comme vrai roi et comme vrai prêtre.
38. Mais nous prions les
païens nos adversaires, qui en voulant adorer les dieux des nations refusent
leurs hommages à celui qui ne peut être adoré avec eux, nous les prions de
nous dire pourquoi l'on ne trouve aucun de ces dieux qui défende d'en adorer
un autre, puisque eux-mêmes leur assignent différents offices, différentes
fonctions et veulent que chacun préside à des choses qui le regardent
spécialement. Si Jupiter n'empêche pas d'adorer Saturne, parce que Jupiter
n'est point cet homme qui a détrôné son père, mais bien le corps du ciel, ou
l'esprit qui remplit le ciel et la terre, et ne peut par conséquent empêcher
le culte de l'intelligence suprême dont il est regardé comme l'émanation; si,
de même, Saturne autorise le culte de Jupiter, parce que différent de celui
qui, vaincu par je ne sais quel Jupiter, se retira en Italie pour échapper aux
armes du rebelle, il ne l'a jamais. vu lever l'étendard de la révolte et
triompher de sa puissance, mais que, premier esprit, il se montre bienveillant
envers une âme qu'il a engendrée : Vulcain devrait au moins s'opposer au culte
de Mars qui a violé sa femme ; Hercule ne devrait pas souffrir celui de Junon
qui l'a persécuté. Quel est donc entre les dieux cet accord tellement honteux
que Diane la vierge chaste, permet d'adorer, je ne dirai pas Vénus,
mais Priape ? Car si un. homme veut être à la fois chasseur et
laboureur, il les servira tous deux quoiqu'il ait honte de leur élever des
temples voisins l'un de l'autre. Mais que nos philosophes païens entendent
sous le nom de Diane la vertu (128) qu'ils voudront ; que Priape soit pour eux
le dieu de la fécondité, du moins Junon, en présidant aux mariages et aux
accouchements, devrait rougir d'avoir un tel aide. Qu'ils disent ce qui leur
plaît, qu'ils interprètent les choses comme bon leur semble : le Dieu d'Israël
ne laisse pas de confondre toutes leurs raisons. Quand il a défendu d'adorer
les dieux du paganisme sans que nul d'entre eux ait jamais défendu de l'adorer
lui-même, quand il a prescrit, annoncé, exécuté la destruction de leurs idoles
et de leur culte, il a montré suffisamment qu'ils sont des dieux imaginaires
et trompeurs, et lui un Dieu véritable et véridique.
39. Mais ces adorateurs d'une
multitude de faux dieux, ces païens aujourd'hui en si petit nombre, qui ne
s'étonnera de les voir refuser obéissance et adoration à ce Dieu dont ils
peuvent se faire une idée fausse et la manifester, quand on leur demande qui
il est; mais dont ils ne peuvent nier la divinité, parce que leur négation
tomberait d'elle-même devant l'examen des oeuvres qu'il a prédites et
accomplies? Car je ne parle pas des choses que ces hommes ne se croient
nullement obligés d'admettre. Je ne veux pas ici rappeler que lui-même le Dieu
d'Israël a créé, dans le principe, le ciel et la terre et tout ce qu'ils
renferment (1). Je, passe également sur les faits les plus anciens, qui ont
signalé sa grandeur et sa puissance divine, sur l'enlèvement d'Hénoch (2),
l'extermination des impies par le déluge, la délivrance de Noë le ,juste et de
sa famille parle moyen d'une arche (3). C'est à partir d'Abraham que je prends
l'histoire de ses rapports avec le monde. Abraham, en effet,. fut l'homme à
qui l'oracle d'un ange révéla de sa part et en termes si formels, cette grande
promesse que nous voyons maintenant accomplie : « Dans celui qui sortira de
toi seront bénies toutes les nations (4). » D'Abraham est issu le peuple
d'Israël, d'où nous voyons sortir la vierge Marie qui a mis au monde le Christ
en qui l'audace la plus téméraire ne peut maintenant nier que toutes les
nations soient bénies. La même promesse fut faite à Isaac fils d'Abraham (5);
elle fut encore renouvelée au petit-fils du patriarche, à Jacob, qui dans la
suite fut appelé Israël (6). Et c'est de lui que tout le peuple a pris son
développement et qu'il attiré son nom. Voilà pourquoi le Dieu de ce peuple est
connu sous le nom de
Dieu d'Israël ; non pas qu'il ne soit en même temps le
Dieu de toutes les nations, et de celles qui l'ignorent et de celles qui
croient en lui ; mais parce qu'il a voulu faire paraître d'une manière plus
éclatante, dans ce peuple, la vertu de ses promesses. Ce peuple, en effet, qui
commença durant la servitude d'Egypte, à se multiplier, et que Moïse délivra
par de nombreuses et grandes merveilles, se mit, après avoir triomphé de
plusieurs peuples, en possession d'une terre promise, elle aussi, et y régna
par ses princes issus de la tribu de Juda. Juda était l'un des douze fils
d'Israël petit-fils d'Abraham : il donna son nom aux Juifs qui firent beaucoup
de grandes choses avec l'aide à leur Dieu ; souvent aussi ce même Dieu les
châtia à cause de leurs péchés, jusqu'à ce que parut dans le monde, comme il
avait été promis, ce fils d'Abraham, ce descendant d'Israël, en. qui devaient
être bénies toutes les nations, et au nom de qui les nations devaient, de
leurs propre mouvement, briser les idoles de leurs pères.
40. Ce n'est pas aux premiers
temps du Christianisme, mais à une époque fort antérieure, que remonte la
prédiction des événements aujourd'hui accomplis par les chrétiens. Les Juifs
qui sont demeurés ennemis du nom de Jésus-Christ, les Juifs eux-mêmes dont
l'infidélité future n'a pas été oubliée dans les oracles prophétiques,
tiennent le livre de Jérémie où ils lisent ces mots : « Seigneur, qui êtes mon
Dieu et mon refuge dans te temps de l'affliction, les nations viendront à vous
des extrémités de la terre et diront: Vraiment nos pères ont adoré de vaines
idoles et n'ont pu en tirer aucun avantage (1). » Nous voyons aujourd'hui
l'accomplissement de cet oracle. Des extrémités de la terre les nations
viennent à Jésus-Christ, redisant ces choses et brisant les idoles, Et c'est
en effet une grande faveur accordée par Dieu à son Eglise répandue dans tout
le monde, que les ennemis de notre foi en attestent la vérité, et que la
nation juive, justement vaincue et dispersée dans l'univers entier, ne
permette pas de regarder comme une oeuvre frauduleuse
129
des chrétiens, les livres de nos . prophètes, qu'elle
porte avec elle chez tous les peuples. Comment donc, suivant les discours
frivoles de quelques insensés, les disciples de Jésus-Christ, en prêchant la
destruction des idoles, l'abolition du culte des divinités païennes, ont-ils
enseigné ce qu'ils n'avaient pas appris de leur Maître? Peut-on dire qu'ils
ont imaginé des prophéties dont on trouve le texte dans les livres vénérés par
les ennemis mêmes de Jésus-Christ. ?
41. Et qui donc a ruiné
l'idolâtrie, sinon le Dieu d'Israël ? Car c'est au peuple d'Israël que furent
adressées en la personne de Moïse ces paroles divines : « Ecoute Israël ; il
n'est d'autre Dieu que le Seigneur ton Dieu (1) : tu ne te feras point d'idole
; ni aucune ressemblance de ce qui est en haut dans le ciel ou en bas sur la
terre (2). » De plus, voici l'ordre qui lui fut donné de renverser même les
objets du culte idolâtrique dès qu'il en aurait le pouvoir : « Tu n'adoreras
point leurs dieux et tu ne les serviras pas ; tu ne feras pas selon leurs
oeuvres, mais tu abattras et tu briseras leurs idoles (3). » Et qui osera dire
que le Christ et les chrétiens sont étrangers à Israël, quand Israël est le
petit-fils. d'Abraham à qui d'abord fut faite la promesse dont j'ai rappelé
les termes: « Dans celui qui sortira de toi seront bénies toutes les nations,
» promesse renouvelée à Isaac, fils d'Abraham, et enfin à Israël lui-même,
fils d'Isaac ? C'est cette promesse que nous voyons maintenant accomplie en,la
personne de Jésus-Christ, puisque du sang de ces patriarches est venue la
Vierge que le prophète du peuple d'Israël et du Dieu d'Israël a célébrée en
disant : « Voici qu'une Vierge concevra et enfantera un fils dont le nom sera
Emmanuel (4). » Or Emmanuel signifie « Dieu avec nous (5). » Le Dieu d'Israël
qui a prescrit de l'adorer lui seul, qui a défendu de faire des idoles, qui a
ordonné de les renverser, et qui, par son prophète, a montré dans l'avenir
toutes les nations de la terre venant à lui et s'écriant : « Vraiment nos
pères ont adoré de vaines idoles et n'ont pu en tirer aucun avantage; » le
Dieu d'Israël a donc commandé, promis et consommé la ruine de toutes les
superstitions païennes par le nom de Jésus-Christ et la foi des chrétiens.
Vainement donc, parce que leurs dieux eux-mêmes, c'est-à-dire, les démons qui
tremblent au
nom de Jésus-Christ, leur ont défendu de le blasphémer,
nos misérables adversaires voudraient mettre en opposition avec la doctrine du
Christ celle donc les chrétiens se prévalent pour attaquer les idoles et faire
disparaître complètement, par toutes les voies possibles, tant de fausses
observances.
42. Qu'ils nous répondent au
sujet du Dieu d'Israël. Les livres non-seulement des chrétiens mais aussi des
Juifs témoignent que ses dogmes et ses ordres sont contraires à l'idolâtrie.
Qu'ils consultent leurs dieux, et que les divinités païennes, après avoir
défendu de blasphémer Jésus-Christ, rendent, si elles en ont l'audace,
quelques réponses injurieuses contre le Dieu d'Israël. Mais quels dieux
consulteraient-ils, et en quels lieux iraient-ils maintenant les consulter ?
Eh bien ! qu'ils lisent les ouvrages de leurs écrivains. Si le Dieu d'Israël
n'est autre que Jupiter, comme l'a écrit le docte Varron, et je veu4 bien
parler un moment d'après leur système, pourquoi ne pas se faire un devoir
d'abattre les idoles en faveur de Jupiter? Si l'on croit qu'il est Saturne,
pourquoi ne pas l'adorer ? ou du moins pourquoi ne pas l'adorer, de la manière
qu'il a prescrite par l'organe de prophètes dont il a su accomplir les
prédictions comme il les avait inspirées ? Pourquoi ne pas croire qu'il faut
renverser les idoles en son honneur et mépriser les autres dieux ? S'il n'est
ni 1upiter ni Saturne, car s'il était l'un ou l'autre, il ne serait pas si
opposé à leur culte, qui est-il donc, lui qu'on refuse seul d'adorer à cause
des autres dieux, et qui sur les ruines des idoles renversées en vient à se
faire adorer seul, après avoir abaissé toute hauteur qui
s'élevait contre le Christ, et abattu les orgueilleux sectateurs des
faux dieux qui persécutaient et mettaient à mort les chrétiens ? Certainement
aujourd'hui les païens cherchent où se cacher quand ils veulent offrir un
sacrifice ; du moins avisent-ils à bien cacher leurs dieux eux-mêmes pour
empêcher les chrétiens de les découvrir et de les mettre en pièces. D'où vient
cela, sinon de la crainte des lois et des empereurs, par qui le Dieu d'Israël
fait paraître maintenant sa puissance, après les avoir soumis au nom de
Jésus-Christ ? C'est ce qu'il avait promis si longtemps d'avance (130) en
disant par son prophète : « Et tous les rois de la terre l'adoreront : tous
les peuples le serviront (1). »
43. Nous voyons en effet,
aujourd'hui, l'accomplissement de ce que le même Dieu a plusieurs fois déclaré
par le prophète Isaïe ; qu'il repousserait son peuple impie et rebelle, non
pas toutefois le peuple tout entier, puisque beaucoup d'Israëlites ont cru en
Jésus-Christ, et que les Apôtres du divin maître étaient de cette nation qu'il
humilierait tout superbe, tout insolent, afin que lui-même fût seul élevé, en
d'autres termes, seul reconnu grand et puissant parmi les hommes : qu'un jour
les fidèles se déclareraient partout contre les idoles et que les infidèles se
verraient obligés de les cacher : que la terre serait brisée par la crainte,
c'est-à-dire, que les hommes terrestres seraient consternés et remplis
d'effroi, tant leur en imposerait la loi ou de ce Dieu lui-même, ou de ceux
qui, croyant en lui et régnant sur les nations, s'opposeraient aux pratiques
sacrilèges de l'idolâtrie.
44. Car voici le texte du
prophète sur ce que je viens d'exposer brièvement pour, en rendre
l'intelligence plus facile: « Et maintenant venez,
maison de Jacob, et marchons ensemble à
la lumière du Seigneur. Car le Seigneur a rejeté son peuple, la maison
d'Israël; parce que leur pays, comme autrefois quand y habitaient les
idolâtres, a été rempli d'augures, et que beaucoup d'enfants leur sont nés du
mélange de leur sang avec celui des étrangers. Leur terre a été remplie d'or
et d'argent, et leurs trésors étaient infinis. Leur terre a été remplie de
chevaux, et leurs chariots ne pouvaient se compter. Elle a été couverte des
oeuvres abominables de leurs mains, et ils ont adoré ce qu'ils avaient
fabriqué de leur propres doigts. Et l'homme s'est s'abaissé profondément et
les chefs se sont dégradés : je ne leur pardonnerai point. Maintenant, entrez
dans les fentes des rochers, cachez-vous dans les entrailles de
la terre, pour vous mettre à couvert de l'effroi que
répandra le Seigneur, et de l'éclat de sa puissance quand il viendra briser la
terre. « Car le Seigneur est grand; du haut du ciel ses regards embrassent
l'étendue de l'univers, mais l'homme est une faible créature ici-bas ;
et toute hauteur des hommes sera humiliée et le Seigneur
sera seul exalté en ce jour. Oui le jour du Seigneur des armées va éclater sur
tous les insolents, sur tous les superbes, sur tous ceux qui sont hautains
dans leur bassesse et il seront humiliés. Ce jour va éclater sur tous les
cèdres orgueilleux du Liban, sur tous les arbres de Basan, sur les montagnes
les plus hautes, sur les collines les plus élevées, sur tous les vaisseaux de
la mer, dont il dissipera le beau spectacle. Et toute élévation de l'homme
sera abaissée, et toute son insolence tombera, et le Seigneur seul paraîtra
grand en ce jour. « Et, poursuivis par la crainte du Seigneur et la majesté de
sa puissance quand il se lèvera pour frapper et ébranler la terre, les hommes
cacheront dans les antres, dans les fentes des rochers, dans les cavernes tout
ce qu'ils ont fabriqué de leurs mains. Car en ce jour on rejettera les idoles
abominables d'or et d'argent, les idoles vaines et funestes qu'ils avaient
faites pour les adorer, et ils entreront dans les trous de la pierre, dans les
fentes des rochers, pour se mettre à couvert de la frayeur qu'apportera le
Seigneur, et se dérober à la gloire de sa Majesté quand il se lèvera pour
broyer la terre (1). »
45. Que disent les païens de
ce Dieu que les Hébreux appellent Dieu « Sabaoth, »
c'est-à-dire Dieu des Vertus ou des
armées, parce que les vertus et toute l'armée des anges obéissent à ses lois?
Que disent-ils du Dieu d'Israël, ainsi appelé parce qu'il est le Dieu de ce
peuple d'où nous est venu Celui en qui devaient être bénies toutes les nations
? Pourquoi le laissent-ils seul sans l'adorer, quand ils prétendent qu'on doit
adorer tous les dieux ? Pourquoi refusent-ils de croire au Dieu qui a démasqué
l'imposture des autres et les a renversés ? Suivant mes souvenirs, quelqu'un
d'entre eux s'est flatté d'avoir lu dans les ouvrages de certain philosophe,
dont le nom ne me revient pas, que les rites sacrés des Juifs lui avaient fait
comprendre à quel Dieu s'adressait leur culte: « C'est, dit-il, à celui qui a
la direction des éléments dont se compose le monde visible et corporel. »
Cependant les livres
vénérables de ses prophètes montrent clairement la
prescription faite au peuple d'Israël d'adorer le Dieu qui a créé le ciel et
la terre et de qui vient toute vraie sagesse. Mais qu'est-il besoin de
disputer ici plus longtemps, quand je puis arriver à mon but, en m'appuyant
sur l'opinion bien ou mal fondée que ces hommes professent au sujet du Dieu
d'Israël, dont ils ne peuvent nier la divinité ? Car s'il est préposé aux
éléments dont la réunion forme ce monde, pourquoi ne pas l'adorer plutôt que
Neptune, qui est seulement préposé à la mer, plutôt que Sylvain, qui a
seulement puissance sur les champs et les forêts? Pourquoi ne pas l'adorer de
préférence au soleil, de qui relève seulement le jour, ou, si l'on veut
encore, toute la chaleur céleste? Pourquoi ne pas l'adorer de préférence à la
lune, qui ne règne que sur la nuit, ou, tout au plus encore, sur les vapeurs
dégagées par la terre et les eaux ? Pourquoi ne pas le préférer à Junon, que
l'on dit tenir seulement l'empire de l'air? Assurément, ces dieux, dont chacun
n'a d'autorité que sur une partie du monde, doivent être inférieurs, quels
qu'ils soient, au Dieu qui régit tous les éléments et toute la machine de
l'univers. Mais le Dieu d'Israël défend d'adorer aucun de ces dieux. Pourquoi
donc les païens, malgré le précepte d'un Dieu supérieur aux autres,
veulent-ils non-seulement adorer ceux-ci, mais, à cause d'eux, ne pas l'adorer
lui-même? Jusqu'alors ils ne voient rien qu'ils puissent affirmer nettement et
résolument à son sujet, et ils resteront toujours dans leurs ténèbres, tant
qu'ils ne le reconnaîtront pas comme le seul vrai Dieu dont la puissance a
créé toutes choses.
46. Leur grand déclamateur en
poésie, Lucain, après avoir lui-même, je le crois, cherché longtemps dans ses
propres réflexions et dans la lecture des auteurs profanes, quel était le Dieu
d'Israël, sans arriver à le connaître, parce que la piété demeurait étrangère
à ses recherches, a mieux aimé cependant appeler un Dieu incertain
celui qu'il ne trouvait pas, que de nier sa divinité dont il avait des preuves
si sensibles. Parlant de la Judée il a dit, en effet, qu'elle adore un Dieu
incertain : Et dedita sacris incerti Judaea Dei (1) . Or, le Dieu
d'Israël, ce Dieu saint et véritable, n'avait pas encore, par le nom de
Jésus-Christ, opéré dans toutes les nations, de merveilles semblables à celles
que le monde a vues depuis les temps de Lucain jusqu'à ce jour. Maintenant,
qui peut être assez dur pour ne point se rendre, assez froid pour ne point
sentir son âme embrasée, après l'accomplissement de cet oracle du roi-prophète
Il n'est personne qui se dérobe à sa chaleur ; quand se
trouvent réalisées avec tant d'éclat les choses prédites si longtemps d'avance
dans le même Psaume d'ou je tire le verset que je viens de rappeler ? Car dans
ce Psaume, le nom des cieux où règne l'Éternel désigne les Apôtres de
Jésus-Christ qui devaient annoncer l'Évangile sous l'empire et la conduite de
Dieu . Maintenant donc les cieux ont raconté la gloire du Très-Haut et le
firmament a publié les oeuvres de ses mains. Le jour a parlé au jour et la
nuit a transmis la science à la nuit. Maintenant est accompli l'oracle qu'il
n'y a point de langue point d'idiôme dans lequel les voix des cieux ne soient
entendues. Elles out éclaté dans toute la terre, et les paroles qu'elles ont
portées ont retenti jusqu'aux extrémités du monde. Maintenant Dieu a établi
dans le soleil, c'est-à-dire, a manifesté à tous les regards, son pavillon qui
est son Eglise elle-même. Dans cette fin, selon la suite du même Psaume, il
est sorti de sa couche nuptiale, c'est-à-dire, que le Verbe de Dieu est sorti
du sein de la Vierge Marie, où il a uni en sa personne la nature divine à. la
nature humaine. Maintenant il s'est élancé comme un géant et a parcouru sa
carrière. Maintenant il a accompli son départ du point le plus élevé du ciel
et son retour au plus haut du ciel. Aussi est-ce à bon droit que le verset
rappelé un peu plus haut conclut par ces paroles: « Il n'est personne qui se
dérobe à sa chaleur (2). » Et maintenant encore, ces misérables qui nous
opposent avec un tel babil quelques faibles apparences de contradictions,
aiment mieux être comme die l'étoupe, réduits en cendres par ce feu, que
purifiés de leurs souillures comme l'or; maintenant que l'imposture des faux
dieux se trouve confondue par les événements, et que les promesses véridiques
du Dieu d'Israël, de ce Dieu incertain, ont acquis aux yeux de tous, en se
réalisant, une éclatante certitude.
132
47. Que les faux panégyristes
de Jésus-Christ qui ne veulent pas être chrétiens cessent donc de dire que sa
doctrine n'impose aucune nécessité d'abandonner leurs dieux et de briser leurs
idoles. Car le Dieu d'Israël qui, suivant les prédictions, devait être un jour
appelé le Dieu de toute la terre, et qui de fait est maintenant appelé le Dieu
de toute la terre; le Dieu d'Israël, auteur de ces prédictions énoncées par
l'organe des prophètes, les a accomplies dans le temps voulu, par le ministère
du Christ. En effet, s'il est maintenant appelé le Dieu de toute la terre, il
faut bien rapporter à l'époque où le monde l'a connu comme seul vrai Dieu,
l'accomplissement des oracles par lesquels il ordonnait ce grand événement.
Or, qu'il ait été connu par le Christ et dans le Christ, cette circonstance
était prédite; et ceux qui le voudront peuvent lire dans le même prophète,
cité un peu plus haut, qu’au moyen du Christ, l’Eglise devait s'étendre par
tout l'univers et que,
par l'Eglise, le Dieu d'Israël serait appelé le Dieu de toute la terre. Ou
plutôt, je vais mettre moi-même ce passage sous les yeux de mes lecteurs; il
n'est pas d'ailleurs tellement long que je doive négliger de le transcrire.
Nous y voyons bien des choses touchant la venue, les abaissements, la passion
du Christ et le corps dont il est le chef, c'est-à-dire, son Eglise,
lorsqu'elle est interpellée comme stérile et sans enfants. Durant longues
années, en effet, celle à qui devaient appartenir toutes les nations ne parut
pas dans ses enfants, c'est-à-dire, dans les Saints; le Christ n'étant pas
encore annoncé par les Evangélistes à ceux qui n'avaient pas entendu les
prophètes. Or, il est dit ensuite, que celle qui est abandonnée aura plus
d'enfants que celle qui a un mari. Ce nom de mari désigne la loi, ou le roi
qui fut donné au premier peuple d'Israël: aussi bien, les nations n'avaient
pas reçu la Loi dans le temps où parlait le prophète , et le Roi des chrétiens
n'était pas encore apparu aux nations, chez qui cependant on a vu surgir un
nombre beaucoup plus considérable de fidèles que chez le peuple juif. Voici
donc comme parle Isaïe, en présentant d'abord les abaissements du Christ, puis
en se retournant vers l'Eglise pour lui adresser la parole, jusqu'au verset
que nous avons rappelé précédemment et dans lequel nous lisons : « Et celui
qui t'a rachetée, le Dieu d'Israël, sera appelé le Dieu de toute la terre. »
« Mon fils, dit-il, sera
rempli d'intelligence il sera exalté et grandement honoré. Comme beaucoup
doivent être saisis d'admiration à ton sujet, ô mon peuple, et que ta beauté
paraîtra cependant flétrie aux yeux de tous et ta gloire perdue devant les
hommes; ainsi lui-même sera-t-il pour beaucoup de nations un objet
d'étonnement, et les rois se tiendront devant lui dans le silence, parce que
ceux à qui il n'avait pas été annoncé, verront, et que ceux qui n'avaient pas
entendu parler de lui comprendront. Seigneur, qui a cru à notre parole et à
qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Nous l'avons annoncé devant le
Seigneur : il est comme un enfant, comme un rejeton qui s'élève d'une terre
sèche et aride. Il n'a ni beauté ni éclat. Nous l'avons vu dépouillé de toute
gloire et de toute beauté: son visage est abattu et contrefait, objet du
mépris de tous les hommes : c'est un homme couvert de plaies et qui a
l'habitude des souffrances. Aussi sa face s'est détournée : compté pour rien,
il a été accablé d'outrages. Il porte nos iniquités; c'est pour nous qu'il est
dans la douleur. Et nous l'avons pris pour un homme assujetti par son état au
plaies et aux tourments. Mais il a été blessé à cause de nos péchés, soumis à
la douleur à cause de nos iniquités. Le châtiment qui pouvait nous procurer la
paix est tombé sur lui et nous avons été guéris par ses meurtrissures. Tous
nous avions erré comme des brebis égarées, et le Seigneur l'a livré pour nos
péchés. Et quoique traité d'une manière si cruelle il n'a pas ouvert la
bouche. Il a été conduit à la mort comme une brebis, et de même qu'un agneau
se tait devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert la bouche pour se
plaindre. Condamné, il est mort dans la dernière humiliation. Qui redira son
origine ? car sa vie a été retranchée de la terre; il a été conduit à la mort
par les iniquités de mon peuple. Je lui donnerai donc les méchants pour le
prix de sa sépulture et les riches pour la récompense de sa mort, parce qu'il
n'a point connu l'iniquité, et que sa bouche n'a jamais proféré le mensonge.
Le Seigneur veut le guérir de ses plaies. O hommes, si vous donnez votre vie
pour vos iniquités, vous verrez votre race durer très-longtemps. Et le
Seigneur veut arracher sa vie aux douleurs, lui montrer la lumière, le revêtir
(133) d'éclat et de beauté ; justifier le juste qui a servi si généreusement
les intérêts d'un grand nombre. Et lui-même portera leurs iniquités. C'est
pourquoi il aura en partage la «multitude des nations et distribuera les
dépouilles des forts, parce qu'il a été livré à la mort et mis au nombre des
scélérats ; parce qu'il a porté les péchés de beaucoup et qu'il a été livré à
cause de leurs crimes. Réjouis-toi stérile qui n'enfantes pas ; sois
transportée d'allégresse et pousse des cris de joie, toi qui n'as point
d'enfants, parce que celle qui était abandonnée aura plus d'enfants que celle
qui a un mari. Car, le Seigneur a dit : Prends un lieu plus vaste pour dresser
tes tentes, n'épargne point l'espace dans la construction de ta demeure.
Recule plus loin les cordeaux ; plante des pieux solides. Que ton héritage se
dilate et se dilate encore, à droite et à gauche; car ta postérité possèdera
les nations et tu habiteras les villes qui étaient abandonnées, Bannis toute
crainte; car tu prévaudras certainement; et ne rougis pas d'avoir été
jusqu'alors un objet de mépris et d'aversion. Aussi bien, tu oublieras pour
toujours ta confusion et la honte de ton délaisse
ment : parce que je suis le Seigneur qui t'ai créé ; le
Seigneur est le nom de celui qui t'a rachetée ; et lui-même, le Dieu d'Israël,
sera appelé le Dieu de toute la terre (1). »
48. Que peut-on répondre à
cette exposition de faits si clairement prédits et si fidèlement accomplis ?
Si l'on pense que les disciples de Jésus-Christ ont eu recours au mensonge
pour affirmer sa divinité, sera-t-il possible de révoquer en doute sa passion
?Les païens n'ont pas coutume de croire que Jésus-Christ est ressuscité : mais
que les hommes lui aient fait endurer toutes ces souffrances qui sont le
propre de notre humanité, ils le croient même volontiers, parce qu'ils veulent
faire croire que Jésus-Christ n'est qu'un homme. Or, celui qui a été mené
comme une brebis à l'immolation ; qui a été rangé parmi les scélérats; qui a
été blessé, meurtri à cause de nos crimes, et pour nous guérir ; celui dont la
face a été méprisée, outragée, souffletée, souillée par les crachats ; qui a
été défiguré, réduit à une horrible difformité sur la croix ; qui a été
conduit à la mort par les iniquités du peuple d'Israël ; celui qui avait perdu
tout éclat, toute beauté, quand on le frappait, quand on le couronnait
d'épines et quand, sur son gibet, il était
assailli de moqueries; celui qui, semblable à un agneau
muet sous la main qui le tond, n'a pas ouvert la bouche, lorsqu'on lui disait
avec insulte: Christ devine (1): Celui-là dis-je, est maintenant exalté, il
reçoit maintenant les plus grands honneurs. Aujourd'hui, beaucoup de nations
sont dans l'admiration à son sujet ; aujourd'hui les rois ont cessé d'ouvrir
la bouche pour lancer contre les chrétiens de si cruels édits. Ils voient
maintenant, ceux à qui les prophètes ne l'avaient point annoté ; ils
comprennent maintenant, ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui (2). Les
nations chez qui les prophètes n'avaient pas fait retentir leurs prédictions,
sont celles qui voient le mieux toute la vérité de leurs oracles ; et ceux qni
n'ont pas entendu la voix même d'Isaïe, comprennent dans ses écrits de quel
personnage il a parlé. Même parmi les Juifs, qui donc croyait à la paroles des
prophètes ? à qui donc le bras du Seigneur, c'est-à-dire, le Christ annoncé
par les prophètes, était-il révélé, quand, de leurs propres mains, ils
commettaient sur la personne de Jésus-Christ tant de crimes prédits par ces
prophètes dont ils possédaient les oracles (3) ? Maintenant enfin, il a reçu
en héritage une prodigieuse multitude; et il distribue les dépouilles des
forts, quand il applique à fa construction de ses temples et aux différents
besoins de l'Eglise, ce que tenaient en leur pouvoir le diable et les démons
dont il a ruiné l'empire et démasqué l'imposture.
49. Que disent à cela nos
adversaires qui, en donnant ail Christ de perfides louanges, décrient avec
tant d'acharnement les chrétiens ? Jésus-Christ a-t-il trouvé, dans les
artifices de la magie, le moyen de faire annoncer tous ces événements par les
prophètes si longtemps d'avance ; ou bien, les disciples en ont-ils à plaisir
imaginé l'accomplissement ? Quoi donc! si répandue aujourd'hui parmi les
nations, l'Eglise, autrefois stérile, se réjouit de l'emporter, par le nombre
de ses enfants, sur la synagogue qui dans la Loi ou dans la personne de son
roi avait reçu un mari; si elle élargit l'espace pour ses pavillons, s'établit
chez tous les peuples, et s'impose à toutes les langues, de manière à reculer
ses cordages bien
134
au-delà des conquêtes de l'empire Romain, jusque chez les
Perses, les Indiens et les autres nations barbares ; si à droite, par les
chrétiens sincères, à gauche, par les chrétiens apparents, son nom est au loin
répandu et connu de tant de peuples; sises enfants possèdent les nations en
héritage et peuvent habiter maintenant les villes autrefois étrangères au vrai
culte de Dieu et à la vraie religion ; si elle n'a craint ni les menaces ni
les fureurs du monde, quand le sang des martyrs lui faisait comme un glorieux
vêtement de pourpre ; si elle a prévalu contre la violence des persécuteurs
nombreux, puissants, acharnés à sa perte ; si elle ne rougissait pas d'être en
exécration, quand c'était un grand crime de devenir ou d'être chrétien, et
oublie maintenant pour toujours son humiliation, parce que là où avait abondé
le péché a surabondé la grâce (1); si elle ne se souvient plus de la honte de
son délaissement, parce que, abandonnée pour un peu de temps et soumise à
l'opprobre, elle voit refleurir sa gloire d'une manière éclatante; enfin si le
Seigneur, le Dieu d'Israël, qui l'a faite et l'a délivrée de la puissance du
diable et des démons, est appelé maintenant le Dieu de toute la terre : tous
ces événements prédits, tant d'années avant que le Christ devint le fils de
l'homme, par des prophètes dont aujourd'hui les livres se trouvent entre les
mains des ennemis du Christ; tous ces faits accomplis aujourd'hui ont-ils été
imaginés par les disciples de Jésus-Christ?
50. Qu'ils comprennent donc
enfin ce qui n'est plus obscur ni douteux même pour les esprits les plus lents
et les plus bornés qu'ils comprennent, ces hommes pervers, dont nous entendons
les éloges en faveur du Christ et les imprécations contre la religion
chrétienne, que les disciples de Jésus-Christ ont puisé dans sa doctrine leur
enseignement contraire aux dieux du paganisme. Car le Dieu d'Israël qui a
prescrit, comme on le voit dans les livres des prophètes, de tenir en
abomination et de renverser partout les idoles que les païens veulent adorer,
se trouve maintenant, selon sa promesse bien antérieure au fait, appelé le
Dieu de toute la terre par le moyen de Jésus-Christ et de l'Eglise de
Jésus-Christ. Si par une étrange folie ces hommes supposent que Jésus-Christ
fut un adorateur de leurs dieux, et que par eux il devint capable d'opérer
tant de prodiges ; le Dieu d'Israël, les a-t-il aussi adorés, lui qui, après
avoir promis
que toutes les nations l'adoreraient uniquement, et que
toutes les idoles devenues un objet d'horreur seraient détruites, a réalisé sa
promesse par Jésus-Christ ? Où sont maintenant les dieux des païens ? Où les
devins furieux et les pythonisses rendent-ils leurs oracles ? Où sont les
augures, les auspices, les aruspices et les oracles des démons ? Pourquoi ne
montre-t-on dans les anciens livres où se trouvent consignés les monuments de
l'idolâtrie, aucun avertissement, aucune prédiction contre la foi chrétienne
et contre la vérité de nos prophètes, aujourd'hui si clairement révélée dans
toutes les nations ? Nous avons, disent-ils, offensé nos dieux, et ils nous
ont abandonnés; c'est pour cela que les chrétiens ont prévalu contre nous et
que nous voyons s'arrêter, décroître et disparaître la félicité du monde.
Qu'ils veuillent nous montrer dans les livres de leurs devins, un oracle
d'après lequel les chrétiens devaient leur causer tous ces maux; qu'ils lisent
des passages où leurs dieux aient maudit et réprouvé, sinon le Christ, qui
suivant eux a fléchi les genoux devant les idoles, au moins le Dieu d'Israël,
à qui l'on est bien obligé d'en attribuer la ruine. Mais jamais ils ne
produiront, dans ce sens, que ce qu'ils pourraient eux-mêmes avoir inventé
depuis peu de temps. Et s'ils le font, la vérité les confondra, car une chose
si importante n'aurait pu demeurer jusqu'alors dans un tel secret, et sans
aucun doute on l'aurait publiée avant l'événement, sous les voûtes des temples
de toutes les nations païennes, afin d'avertir, et de prémunir contre la
désertion, ceux qui aujourd'hui veulent être chrétiens.
51. Nos adversaires se
plaignent aussi que depuis l'apparition du Christianisme, les hommes sont loin
de jouir du même bonheur. Qu'ils prennent donc la peine de lire les ouvrages
de leurs philosophes ennemis de ces plaisirs dont ils sont privés aujourd'hui
à leur Bran- regret, et ils trouveront de quoi louer beaucoup les temps
chrétiens. Car en quoi leur félicité se trouve-t-elle diminuée, à moins qu'ils
ne lui donnent pour objet ce dont leur débauche faisait un abus si indigne au
grand mépris du Créateur? Le malheur des temps viendrait-il de ce que les
théâtres, écoles publiques de honteuses dissolutions et de toutes sortes de
crimes, s'écroulent dans presque toutes les villes avec les édifices, les
murailles dont l'enceinte était consacrée au culte des démons? Mais pourquoi
tombent-ils, sinon parce que les objets dont l'usage infâme et sacrilège en
avait motivé la construction, ont presque disparu? Est-ce que leur grand
orateur Cicéron, en faisant l'éloge d'un comédien nommé Roscius, ne l'a pas
dit tellement habile que lui seul était digne de paraître sur la scène, et
tellement homme de bien que lui seul méritait de ne jamais devoir y mettre le
pied (1). Qu'est-ce à dire? N'a-t-il pas avoué par là très-clairement que ces
théâtres étaient si honteux, qu'un homme de bien devait d'autant moins y
paraître qu'il était plus homme de bien? Et cependant on se rendait les dieux
propices par ces infamies, auxquelles, selon l'orateur, il eût fallu que les
honnêtes gens demeurassent étrangers. Rappelons encore ici un témoignage
formel du même Cicéron. Il déclare qu'il doit se concilier la faveur de la
déesse Flore, en célébrant les jeux que l'usage a établis (2). Or, ces jeux
étaient caractérisés par un tel oubli de maeurs que, près d'eux, tous les
autres dont il interdit la participation aux hommes de bien, doivent passer
pour honnêtes. Quelle est cette Flore, cette déesse mère, qu'une dissolution
plus éclatante et plus effrontée rend favorable et propice ? Combien il était
moins honteux à Roscius de paraître sur le théâtre, qu'à Cicéron
d'honorer une telle déesse ? Si les dieux sont offensés parce qu'ils voient
disparaître tant d'ignobles ressources de leur culte, on peut juger quels sont
ces dieux qui prennent plaisir à de pareils hommages. La diminution de ces
biens est-elle un effet de leur colère ? alors il est plus utile d'éprouver
leur courroux que d'obtenir
leur protection. Ainsi, que les païens désavouent leurs philosophes qui ont
condamné de tels désordres dans les hommes débauchés, ou qu'ils brisent leurs
dieux qui veulent être honorés de la sorte ; si toutefois ils en trouvent
encore aujourd'hui soit à briser soit à cacher. Mais qu'ils cessent leurs
blasphèmes contre les temps chrétiens; qu'ils cessent de reprocher aux temps
chrétiens la privation de ces biens
inférieurs, source de honteux et funestes excès, pour ne pas nous
fournir à leur dépens un nouveau motif de louer la puissance de Jésus-Christ.
Je pourrais dire encore
beaucoup de choses, si le titre de mon ouvrage ne m'obligeait à clore
maintenant ce livre e t à revenir au dessein que je me suis proposé. Car j'ai
entrepris de résoudre les difficultés de certains passages de l'Evangile où
plusieurs ennemis de la foi chrétienne prétendent que les quatre Evangélistes
ne sont pas d'accord. Or, après avoir exposé, comme j'ai pu, l'intention de
chacun d'eux, il m'a fallu, pour répondre à la question de quelques païens,
expliquer d'abord pourquoi nous ne montrons aucun écrit du Christ lui-même.
Ils veulent faire croire, en effet, que l'on a de Jésus-Christ, je ne sais
quel livre, bien différent de l'Evangile et conforme à leurs goûts ; ils
veulent faire croire que Jésus-Christ n'a pas réprouvé les dieux du paganisme,
mais les a au contraire adorés comme magicien, et que ses disciples, outre le
mensonge dont ils se sont rendus coupables, en faisant passer pour le Dieu
créateur de toute chose, un simple mortel doué d'une sagesse supérieure, ont
encore substitué leur doctrine à la sienne, en ce qui regarde les dieux des
nations. Alors nous les avons surtout pressés au sujet du Dieu d'Israël qui,
par l'Eglise des chrétiens se trouve maintenant adoré de tous les peuples; qui
a ruiné en tous
lieux le culte faux et sacrilège des divinités païennes, comme ses prophètes
l'avaient prédit si longtemps d'avance, et a réalisé toutes ses prédictions
par le nom de Jésus-Christ, en qui devaient être bénies toutes les nations,
suivant sa promesse. D'où ils doivent conclure d'abord, que Jésus-Christ n'a
pu penser ni enseigner que ce que lui-même, le Dieu d'Israël, a ordonné et
prédit par ses prophètes : car c'est le Dieu d'Israël qui a fait annoncer,
c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ; et quand au nom du Christ toutes les
nations ont été bénies, selon la promesse du Dieu d'Israël aux anciens, c'est
alors que Celui-ci a été appelé le Dieu de toute la terre. D'où ils doivent
Conclure, en second lieu, que les disciples de Jésus-Christ n'ont pas dévié de
la doctrine de leur maître, quand ils ont défendu d'adorer les dieux des
nations, pour nous empêcher ou de faire des voeux à des idoles privées de
sens, ou d'avoir société avec les démons, ou de rendre un culte religieux à la
créature de préférence au Créateur.
136
53. Le Christ est lui-même la
Sagesse de Dieu, par qui toute chose créée a reçu l'être, et nulle autre
intelligence soit dès anges, soit des hommes ne devient sage qu'en participant
à cette éternelle sagesse à laquelle nous unit l'Esprit Saint, ce dernier
terme d'une adorable Trinité en un seul Dieu, et la source d'où découle la
charité dans nos coeurs. C'est pourquoi la divine providence, attentive à
l'intérêt de pauvres mortels, dont la vie temporelle était absorbée par le
mouvement des choses qui commencent et finissent, leur est venue en aide.
Cette même Sagesse a pris la nature humaine en unité de personne, afin de
naître, de vivre, de mourir et de ressusciter dans le temps, de dire et de
faire, de souffrir et d'endurer des choses, appropriées à notre salut;. et
elle a ainsi présenté aux hommes ici-bas l'exemple du retour, comme aux anges
dans les hauteurs célestes un exemple de persévérance. S'il ne se produisait,
en effet, jusque dans la nature de l'âme raisonnable, quelque fait nouveau,
c'est-à-dire, quelque chose qui n'étant pas commence à être dans le temps,
jamais elle ne passerait d'une vie insensée et trés-misérable à la vie sage et
bienheureuse. Aussi, comme la possession de la vérité, pour ceux qui la
contemplent en elle-même, est la jouissance des choses éternelles, et que la
foi, pour ceux qui croient, doit s'appliquer à des choses dont l'existence à
commencé, l'homme se purifie dans la foi de mystères temporels, afin d'être
capable de voir et de posséder la vérité des choses éternelles. C'est ce que
Platon, le plus célèbre de tous leurs philosophes, a très-bien exprimé dans
son livre intitulé le Timée : « La possession de la vérité par rapport
à la foi, dit-il, c'est l'éternité par rapport à ce qui commence. » Or
l'éternité et la vérité sont en haut; la ;foi et ce qui a eu commencement se
trouvent dans une région inférieure. Ainsi pour nous élever de notre bassesse
à ce qui est au-dessus de tout, et pour faire participer à l'éternité ce qui a
eu yin commencement, il nous tant par la foi venir à la vérité. Et puisqu'un
terme moyen est nécessaire pour rapprocher des choses qui suivent une
direction opposée et que l'iniquité du temps nous éloignait de l'éternelle
justice; il nous fallait donc la médiation d'une justice qui tint à la fois du
temps et de l'éternité, de la terre et du ciel, et qui sans rompre avec les
choses d'en haut s'accommodât à celles d'en bas, de manière à réunir les unes
aux autres. C'est pour cela que le Christ a été appelé médiateur de Dieu et
des hommes (1). Dieu et homme entre.Dieu immortel et l'homme mortel, devenu ce
qu'il n'était pas en
demeurant ce qu'il était, il nous réconcilie avec Dieu (2) : et celui
qui est la vérité dans les choses éternelles, est aussi pour nous la foi dans
les choses que le temps a vu naître.
54. Ce grand mystère, que
nulle langue humaine ne peut dignement exprimer, ce mystère du Roi-pontife
révélé aux anciens par la prophétie, est maintenant prêché au monde par l'Evangile.
Il fallait, en effet, qu'un jour, dans toutes les nations fût accomplie la
promesse faite depuis si longtemps parle ministère d'une seule nation. C'est
pourquoi celui qui avant sa descente du ciel sur la terre envoyait les
prophètes, a aussi envoyé les Apôtres après son ascension de la terre au ciel.
Or, parla nature humaine dont il a voulu se revêtir, il est comme la tête de
tous ses disciples qui doivent être considérés comme les membres de son corps.
Par conséquent, quand les disciples ont écrit sa vie et ses discours, on ne
peut prétendre que lui-même n'a rien écrit, puisque les membres n'ont agi en
cela que sous l'inspiration et suivant la volonté du chef. Car il leur a
commandé comme à ses mains d'écrire ce qu'il a voulu nous faire lire de ses
actes et de ses paroles. Quiconque saura ainsi comprendre le ministère des
Apôtres, et considérer les disciples du divin maître comme des membres qui
gardent l'unité et une harmonie parfaite en exécutant différentes fonctions
sous un seul et même chef,recevra tout ce que leurs récits lui présentent dans
l'Evangile, comme si la main même du Seigneur l'écrivait devant lui.
Nous pouvons donc voir
maintenant quelles sont les contradictions que l'intelligence bornée de nos
adversaires croit apercevoir et qu'ils reprochent aux Evangélistes. Quand les
objections particulières seront résolues, on aura une nouvelle preuve que les
disciples de Jésus-Christ, membres d'un même chef, sont demeurés dans les
termes d'une concorde fraternelle, non-seulement par la conformité de leurs
sentiments, mais aussi par l'accord de leurs écrits.
137
1. Dans un discours assez long
pour former un premier Livre, discours d'ailleurs très-nécessaire, nous avons
réfuté la sotte erreur de ces païens, qui jugent indigne de toute confiance et
de tout égard la rédaction de l'Evangile due aux disciples de Jésus-Christ,
parce que nous ne montrons aucun écrit venant de Jésus lui-même. Selon eux,
Notre-Seigneur a droit aux hommages de la terre, non, il est vrai, comme un
Dieu, mais comme un homme doué d'une sagesse bien supérieure à celle des plus
célèbres philosophes; seulement, ils voudraient bien aussi le faire passer
pour l'auteur de certaines maximes vantées par eux, maximes capables de plaire
à des âmes perverses, non de corriger la perversité des lecteurs eu devenant
l'objet de leur croyance. Nous avons fait justice de ces billevesées ; voyons!
donc maintenant dans ce que les quatre évangélistes ont écrit du Sauveur,
l'accord que chacun a su garder avec lui-même
et avec les trois autres. Il se rencontre des gens plus curieux que capables,
qui, après avoir non pas lu d'une manière quelconque, mais étudié avec une
application particulière les livres évangéliques, croient y remarquer, en
divers endroits des choses incompatibles et contradictoires, et songent moins
à en faire un examen sérieux et prudent qu'à les relever avec contention. Nous
voulons leur ôter cette pierre d'achoppement pour la foi chrétienne.
2. Voici comment débute
l'évangéliste saint Matthieu: « Livre de la génération de Jésus-Christ, fils
de David, fils d'Abraham (1). » Il montre assez clairement par là qu'il veut
parler de la naissance de Jésus-Christ selon la chair ; car c'est en vertu de
cette génération que le Christ est le fils de l'homme, comme il s'appelle
très-souvent
lui-même (1), nous faisant ainsi souvenir de ce que dans
sa miséricorde il a daigné devenir pour nous. Quant à l'éternelle et sublime
génération suivant laquelle Jésus-Christ est le fils unique de Dieu, engendré
avant toute créature, puisque tout a été fait par lui, elle est tellement
ineffable qu'à elle seule conviennent ces paroles du prophète Isaïe : « Qui
racontera sa génération (2) ». Saint Matthieu expose donc la génération
humaine du Sauveur, et prenant ses ancêtres à partir d'Abraham il les conduit
jusqu'à Joseph, époux de Marie de qui est né Jésus. En effet, de ce que Marie
est devenue mère, sans nul concours de la part de Joseph et en demeurant
vierge, l'évangéliste ne pouvait croire pour cela que Joseph dût être
considéré comme n'étant pas vraiment l'époux de Marie. L'exemple de cette
chaste union prouve magnifiquement, au contraire, que l'état des fidèles
mariés, même dans la condition d'une continence parfaite mutuellement
consentie, ne laisse pas d'être un véritable mariage et peut en conserver le
nom; il suffit pour cela que les époux demeurent unis par les sentiments de
l'âme, quoique leurs corps ne s'unissent pas. Et cette preuve est d'autant
plus frappante qu'un fils a pu naître à Joseph et à Marie, en dehors de l'acte
charnel dont on ne doit faire usage que pour avoir des enfants. On ne devait
pas non plus refuser à Joseph le titre de père de Jésus-Christ, sous prétexte
qu'il n'avait pas concouru à la génération du Sauveur; puisque par l'adoption
il aurait pu devenir le père d'un enfant qui ne serait même pas né de son
épouse.
3. Il est vrai que
Jésus-Christ passait pour être le vrai fils de Joseph, engendré de sa chair.
Mais cette opinion n'avait pour fondement que l'ignorance où l'on était de la
virginité de Marie. « Et Jésus était alors âgé d'environ trente ans, fils de
Joseph, comme on le croyait. » Ce sont les paroles de saint Luc (3), qui
pourtant ne fait pas la moindre difficulté d'appeler à la fois Joseph et Marie
parents de Jésus, quand il dit : « L'enfant croissait et se fortifiait ; il
était rempli de
138
sagesse, et la grâce de Dieu était en lui. Et ses parents
allaient chaque année à Jérusalem, au jour solennel de la Pâque. » Dira-t-on
par hasard, qu'il est question ici des parents consanguins de Marie plutôt que
de Joseph? Mais que répondre à ce qu'a dit précédemment le même saint Luc : «
Et son père et sa mère étaient dans l'admiration des paroles qu'ils
entendaient à son sujet (1)? » L'évangéliste rapporte lui-même que le Christ
est né de Marie, sans nul concours de la part de Joseph; en appelant néanmoins
Joseph le père de Jésus, il nous autorise donc à le regarder comme le
véritable époux de Marie, en dehors du commerce charnel et par le seul lien du
mariage ; et d'ailleurs, dès là que son épouse a donné naissance à
Jésus-Christ, n'en est-il pas aussi le père à bien meilleur titre que s'il
l'avait simplement adopté? D'où l'on voit clairement que quand saint Luc a
dit: « Fils de Joseph, comme on le croyait, » il a parlé pour ceux qui
croyaient Jésus-Christ issu de Joseph, à la manière des autres hommes.
4. Quand même on pourrait
établir que Marie est complètement étrangère au sang de David, la raison pour
laquelle Joseph a été justement appelé le père de Jésus-Christ, serait déjà
suffisante pour justifier le nom de fils de David donné au Sauveur. A combien
plus forte raison ce nom lui convient-il, puisque l'Apôtre saint Paul, en
disant que Jésus-Christ descend de David selon la chair (2), nous oblige à
reconnaître la parenté de Marie elle-même avec David, Et comme l'Ecriture
relève aussi la famille sacerdotale de Marie, dans ce passage où saint Luc
déclare qu'elle était parente d'Elisabeth, une des filles d'Aaron (3); on doit
admettre sans hésiter, que la chair de Jésus-Christ a été formée tout à la
fois du sang des rois et du sang des prêtres ; du reste, l'onction mystique
que ces rois et ces prêtres recevaient, chez les Hébreux, cette onction dont
le nom Chrisma explique celui de Christ, était, bien des siècles
d'avance, une figure manifeste de ce nom divin.
5. Saint Matthieu, en
descendant de David à Joseph, et saint Luc, en remontant de Joseph à David, ne
donnent pas les mêmes ancêtres à Jésus-Christ (1). Mais c'est une difficulté
qui n'a point d'importance: il est facile de la résoudre en faisant réflexion
que Joseph a pu avoir un père adoptif, avec celui qui l'avait engendré (2).
Car c'était un antique usage, même chez le peuple de Dieu, d'adopter des
enfants pour les rendre siens, sans leur avoir donné naissance. En laissant de
côté, comme étrangère à ce peuple,- la fille de Pharaon qui adopta Moïse, nous
voyons Jacob lui-même adopter, dans les termes les plus clairs, ses
petits-fils, nés de Joseph: « Maintenant donc, dit-il, les deux fils que tu'
as eus avant mon arrivée près de toi en ce pays, Ephraïm et Manassés, seront à
moi comme Ruben et Siméon. Pour les autres que tu peux avoir dans la suite,
ils seront à toi (3). » C'est même de là qu'il y eut douze tribus en Israël,
sans compter celle de Lévi attachée au service (lu temple : car il y en avait
treize en la comptant, puisque Jacob avait eu douze fils. L'Evangéliste saint
Luc a donc nommé comme père de. Joseph, non celui qui l'avait engendré mais
celui qui l'avait adopté, et il a voulu rappeler les aïeux de ce père adoptif
en remontant la suite des générations qui le séparaient de David. En effet,
dès là que saint Matthieu et saint Luc, tous deux également véridiques,
suivent nécessairement, l'un la ligne des ascendants de Joseph, et l'autre la
ligne des ancêtres de son père adoptif, lequel des deux a dû tracer cette
dernière généalogie, sinon l'évangéliste qui, en faisant connaître le père de
Joseph, évite de dire qu'il a engendré son fils ? Dire que Joseph a été
engendré par un homme dont il n'était pas issu, paraît moins convenable que de
l'appeler le fils de quelqu'un qui l'avait adopté. Pour l'évangéliste saint
Matthieu, en disant : « Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, » et en
conservant ce terme engendra, » jusqu'à ce qu'il vienne à Jacob père de
Joseph, dont il dit également: « Jacob engendra Joseph; » il montre d'une
manière assez expresse qu'il a suivi la ligne des ancêtres directs de Joseph,
et a nommé le père
139
qui l'avait non pas adopté mais engendré.
6. Toutefois, même dans le cas
où saint Luc aurait dit que Joseph fut engendré par Héli, cette
expression ne devrait nullement nous empêcher de croire que l'un des deux
évangélistes a mentionné le père proprement dit, et l'autre le père adoptif.
Car la raison ne s'offense pas qu'on dise de quelqu'un qu'il a engendré non de
sa chair mais par la charité celui dont il est devenu le père au moyen de
l'adoption. C'est de la sorte que Dieu en nous donnant le pouvoir d'être ses
enfants, ne nous a pas donné sa nature, ne nous a pas engendrés de sa propre
substance comme son Fils unique, mais nous a adoptés par amour. Et si
l'Apôtre saint Paul fait de ce terme un fréquent usage (1), on doit comprendre
que c'est précisément dans le but de ne pas confondre avec nous le Fils
unique, qui existe avant toute créature et par qui toute chose créée a reçu
l'être, qui seul est de la substance du Père et lui est égal en tout dans sa
divinité. Ce fils unique, l'Apôtre dit qu'il a été envoyé pour revêtir notre
nature dans le sein d'une femme et devenir semblable à nous, afin de nous
rendre participants de sa divinité par l'adoption, en se rendant lui-même
participant de notre mortalité par amour. Voici en effet comme parle Saint
Paul: « Quand est venu le temps marqué, Dieu a envoyé son Fils formé d'une
femme et assujetti à la loi, pour racheter ceux .qui étaient sous la loi et
nous faire recevoir le bienfait de l'adoption en qualité d'enfants (2). » Et
cependant nous lisons dans l'Ecriture que nous sommes nés de Dieu, quand elle
veut nous apprendre qu'étant déjà hommes, nous avons reçu de pouvoir devenir
enfants de Dieu, et de le devenir par grâce non par nature: car si nous avions
ce titre par nature, nous l'aurions eu de tout temps. Après avoir dit, en
effet, que le Verbe a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui
croient en son nom, » saint Jean ajoute aussitôt, que ceux-là ne sont pas nés
du sang, ni des désirs de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu
lui-même. » Ainsi, ceux qui sont devenus enfants de Dieu en vertu de
l'adoption dont parle saint Paul, ceux-là sont désignés dans le même discours
comme étant nés de Dieu. Et pour nous,faire voir plus clairement à quelle
grâce est dû ce bienfait: « Le Verbe s'est fait chair, dit-il, et il a habité
parmi nous (3) » ; comme s'il disait : Est-il étonnant que ceux qui étaient
chair soient devenus enfants de Dieu,
quand le Fils unique qui était le Verbe éternel s'est
fait chair pour eux ? Il faut, sans doute, remarquer cette grande différence
qu'en devenant les enfants de Dieu nous sommes changés à notre avantage, mais
que le Fils de Dieu en devenant le fils de l'homme ne l'a été d'aucune sorte à
son détriment, et n'a fait que prendre une nature inférieure pour l'unir à la
sienne. Saint Jacques dit encore: « Dieu nous a volontairement engendrés par
la parole de la vérité, afin que nous fussions comme les prémices de ses
créatures (1). » Cet apôtre ne veut pas nous laisser entendre par les mots : «
Dieu nous a engendrés, » que nous devenons ce que Dieu est lui-même ; et c'est
pourquoi il nous déclare, de manière à fixer nos doutes; que l'effet de cette
adoption est de nous conférer une certaine prééminence sur la création.
7. L'évangéliste saint Luc ne
s'éloignerait donc pas de la vérité, quand il dirait du père adoptif de
Joseph, qu'il l'a engendré. Car en sa qualité de père adoptif, Héli a donné à
Joseph une naissance : s'il ne l'a pas fait naître comme homme, il l'a fait
naître comme fils. C'est ainsi que Dieu après nous. avoir créés comme hommes
nous a engendrés comme enfants. Quant au Fils unique, non-seulement il a été
engendré pour être Fils, ce que n'est pas le Père; mais il l'a été aussi pour
être Dieu, ce que le Père est également. Toutefois il est évident que si
l'évangéliste saint Luc avait comme saint Matthieu employé le mot engendra, on
ne pourrait nullement connaître qui des deux a parlé du père adoptif, et du
père proprement dit; de même encore, si aucun deux n'avait usé de ce terme, et
que l'un eût dit Joseph fils d'Héli, et l'autre, fils de Jacob, on ne verrait
pas davantage lequel a voulu nommer le père dont Joseph était issu, ou le père
adoptif. Mais, comme nous lisons dans saint Matthieu : « Jacob engendra
Joseph » et dans saint Luc: « Joseph qui fut fils d'Héli, » la différence même
des expressions nous montre clairement quel a été le dessein de chacun. Ainsi,
tout homme religieux qui pensera plutôt devoir recourir à toute sorte
d'hypothèse que de supposer menteur un Évangéliste , tout homme de ce
caractère verra sans effort, je le répète, comment un seul personnage a pu
avoir deux pères : et certainement
ceux contre lesquels est dirigé ce discours le verraient facilement
eux-mêmes, s'ils n'aimaient mieux contester que d'ouvrir les yeux à la
lumière.
140
8. On a fait cependant la
remarque subtile que saint Matthieu, dont le travail avait pour but de montrer
la royauté de Jésus-Christ, a nommé, outre Jésus-Christ lui-même, quarante
hommes en exposant la suite des générations. Avouons qu'il fallait un lecteur
bien attentif et bien appliqué pour observer ce détail dont nous devons
maintenant nous occuper et que nous essaierons de faire comprendre. Le nombre
quarante signifie le temps présent, durant lequel il nous faut être ici-bas
gouvernés par Jésus-Christ, suivant la règle d'une discipline rigoureuse ;
discipline dont parle saint Paul quand il dit que Dieu flagelle tous ceux
qu'il reçoit au nombre de ses enfants (1), » et que, pour entrer dans le
royaume du ciel, nous devons suivre la voie des tribulations (2); discipline
que désigne aussi cette verge de fer dont parle ainsi le Psaume: « Vous les
gouvernerez avec une verge de fer, » après avoir dit : « Pour moi, il m'a
établi Roi sur Sion, sa montagne sainte. » Et en effet l'usage de cette verge
est appliqué au gouvernement des bons eux-mêmes, car il est dit à leur sujet :
« Voici l'heure où le jugement doit commencer par la maison de Dieu : et s'il
commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui ne croient pas à l'Evangile
de Dieu ? et si le juste est à peine sauvé, où seront le pécheur et l'impie
(3) ? » C'est du pécheur et de l'impie qu'il s'agit dans les paroles suivantes
du Psaume : « Vous les briserez comme un vase d'argile (4). » Ainsi la même
règle qui sert à conduire les justes a pour effet de briser les méchants. Or;
il est également parlé des uns et des autres à raison de la communauté de foi
et de sacrements qui les unit sur la terre.
9. Que le nombre quarante soit
le symbole du temps de peine et de travail pendant lequel nous avons à
combattre contre le démon sous le sceptre de Jésus-Christ, c'est ce que
déclarent même la Loi et les Prophètes en exprimant l'humiliation de l'âme par
un jeûne de quarante jours dans la personne de Moise et d'Elie (5). C'est ce
que nous déclare aussi l'Evangile, par le jeûne du Seigneur lui-même, qui,
durant les quarante jours où il se priva de nourriture, fut encore tenté du
démon (6) : et sans aucun doute, il voulait,
par là, nous présenter dans la chair mortelle qu'il a
daigné prendre de nous, l'image de la tentation à laquelle nous sommes
assujettis tout le temps de cette vie. De plus, le divin maître après sa
résurrection, ne voulut demeurer visiblement avec ses disciples sur la terre
que l'espace de quarante jours (1). Il continua, durant cet intervalle, à
paraître dans leur société, à partager leur existence, à prendre avec eux les
aliments de la vie mortelle, quoique déjà la mort n'eût plus d'empire sur lui
: afin de faire comprendre, par ces quarante jours, qu'il accomplirait au
moyen d'une présence invisible, ce qu'il avait promis en disant : « Voici que
je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle (2). » Mais pour nous
persuader que le nombre quarante est le symbole de cette vie temporelle et
terrestre, la raison qui se présente tout d'abord, quoique peut-être il y en
ait une autre plus profonde, c'est que le temps qui forme nos années court
dans quatre saisons différentes et que le monde lui-même a quatre côtés dont
l'Ecriture fait quelque fois mention sous les noms des quatre vents: l'Orient,
l'Occident, l'Aquilon et le Midi (3). Or dans quarante il y a quatre fois dix;
et la série des dizaines est terminée quand le nombre s'en élève de une à
quatre.
10. Donc, comme l'Evangéliste
saint Matthieu avait pour but de nous montrer le Christ Roi qui vécut en ce
monde et partagea la vie terrestre et . mortelle des hommes afin de nous
gouverner au milieu des peinés et du travail de la tentation, il a nommé
quarante hommes en commentant par Abraham. C'est, en effet, de la nation des
Hébreux que le Christ est venu selon la chair ; de cette nation que Dieu avait
distinguée des autres en éloignant Abraham de son pays et de sa parenté (4) ;
afin que la désignation du peuple d'où le Messie devait sortir, précisât
davantage les oracles et les prophéties dont il était l’objet. Après avoir
exposé la suite de quarante générations et nommé le Sauveur, saint Matthieu se
résume, il est vrai, en disant que d'Abraham à David il y a quatorze
générations ;de David jusqu'à l'époque de la transmigration des Juifs à
Babylone, encore quatorze, et enfin le même nombre depuis cette époque ,
jusqu'à la naissance de Jésus-Christ 5 mais alors il n'additionne pas les
trois séries pour dire que toutes les générations sont au nombre
141
de quarante-deux. C'est qu'un même personnage a été
compté deux fois ici, savoir Jéchonias, avec lequel la ligne des ancêtres de
Jésus-Christ fait comme un détour dans les nations étrangères, au moment où
les Juifs quittent leur pays pour se rendre à Babylone. De même, quand une
ligne abandonne sa direction et, pour aller d'une autre côté, fléchit en forme
d'angle, on compte deux fois la pointe de l'angle qui termine la première
direction et commence la seconde. Ce fait annonçait déjà que le Christ
passerait en quelque sorte de Jérusalem à Babylone, c'est-à-dire des Juifs aux
gentils, et serait comme la pierre angulaire des uns et des autres, devenus
fidèles. Dieu exprimait alors en figure et préparait la réalité à venir. Car
le nom même de Jéchonias, en qui nous voyons l'image prophétique d'un tel
mystère, signifie préparation de Dieu. Ainsi, il n'y a pas quarante-deux
générations, quoique ce nombre soit le produit de trois fois quatorze : mais à
cause d'un personnage deux fois compté, on en trouve seulement quarante-et-une,
si l'on y comprend Jésus-Christ lui-même qui préside en Roi au nombre
quarante, c'est-à-dire à notre vie temporelle et terrestre, pour la gouverner.
11. Comme saint Matthieu
voulait représenter le Christ venant ici-bas participer à notre mortalité, il
a rappelé, en descendant depuis Abraham jusqu'à Joseph et jusqu'à la naissance
de Jésus Christ lui-même, les générations dont nous venons de parler : et cela
dès le début de son Evangile. Mais saint Luc, dont le dessein était de faire
ressortir particulièrement le caractère sacerdotal du Sauveur venu pour expier
les péchés des hommes, trace une généalogie qui va, non en descendant mais en
remontant ; et ce n'est pas dès le commencement de son récit, mais après le
baptême du divin Maître, quand une voix du ciel a fait connaître le Fils de
Dieu et que Jean-Baptiste lui a rendu témoignage en disant : « Voici celui qui
efface les péchés du monde (1). » Or, l'Évangéliste en remontant la suite des
générations ne s'arrête pas à Abraham, et il arrive jusqu'à Dieu, avec qui
nous sommes réconciliés par la rémission et l'expiation de nos fautes. C'est
encore à bon droit qu'il s'attache à l'origine d'adoption, parce que nous
devenons enfants de Dieu par adoption, en croyant au Fils de Dieu, et l'idée
d'une génération charnelle
marque plutôt le Fils de Dieu devenant pour nous le Fils
de l'homme. Du reste, que saint Luc en disant Joseph fils d'Héli n'ait pas
voulu faire entendre que Joseph était né de ce personnage, mais bien, que
celui-ci l'avait adopté, l'Évangéliste en donne la preuve suffisante dans les
derniers mots de sa généalogie. Il appelle, en effet, Adam lui-même fils de
Dieu, parce que, sorti des mains de Dieu, le premier homme fut placé comme un
fils dans le Paradis, en vertu d'une grâce que le péché lui fit perdre peu
après.
12. Ainsi donc la généalogie
selon saint Matthieu nous indique que Notre-Seigneur Jésus-Christ a pris sur
lui nos péchés, et celle de saint Luc, qu'il en a consommé l'expiation. C'est
pourquoi l'un présente la suite des générations en descendant, et l'autre en
remontant. Ce que nous disons s'accorde bien avec le langage de l'Apôtre saint
Paul. Quand il déclare que Dieu a envoyé son propre Fils revêtu d'une chair
semblable à celle qui est sujette au péché, » il montre Jésus-Christ se
chargeant de nos iniquités; et quand il ajoute ces paroles : « Afin de
condamner par le péché commis contre lui, le péché qui régnait dans notre
chair, » il fait voir le même Sauveur expiant nos crimes (1). Aussi,
l'Évangéliste saint Matthieu, à partir de David, poursuit la ligne des
ancêtres du Messie, par Salomon, avec la mère duquel David se rendit coupable
(2); tandis que saint Luc remonte au même patriarche par Nathan, prophète dont
Dieu se servit pour lui annoncer le pardon de son péché (3). Le nombre que
présente la généalogie tracée par saint Luc offre encore lui-même le signe
très-certain d'une entière rémission. Comme Jésus-Christ, toujours innocent,
n'a joint aux iniquités des hommes qu'il a prises en sa chair, aucune iniquité
personnelle, le nombre des noms, dans saint Matthieu, s'arrête à quarante sans
comprendre Jésus-Christ. Mais le Sauveur nous a fait participer à la justice
divine, nous a unis à lui et à son Père, en expiant nos fautes et en nous
purifiant de toute souillure, pour réaliser ce que dit l'Apôtre : « Celui qui
demeure attaché au Seigneur est un même esprit avec lui (4) : » et c'est pour
cela que le nombre des noms dans saint Luc comprend Jésus-Christ par qui
l'énumération commence, et Dieu par qui elle se termine. On trouve alors le
nombre
142
soixante-dix-sept, qui marque une rémission complète et
un entier oubli de tous les péchés. Notre Seigneur a déclaré lui-même d'une
manière évidente la mystérieuse signification de ce nombre, en disant qu'il
faut pardonner les offenses, non pas sept fois, mais soixante-dix-sept fois
(1).
13. On verra, du reste, si
l'on veut y regarder de plus près, que le rapport de ce nombre avec la
rémission de tout péché n'est pas sans fondement. Car le nombre dix apparaît,
dans les dix préceptes de la Loi, comme étant celui de la justice et de la
sainteté. Or, le péché est la transgression de la loi ; et certainement la
transgression d'une loi qui se compose de dix préceptes est convenablement
figurée par le nombre onze : de là, l'ordre de faire onze couvertures de crin
ou cilices pour le tabernacle (2); qui peut, en effet, douter que le cilice
ait une signification relative au péché ? Ainsi, parce que toute la suite du
temps se divise en semaines ou espaces de sept jours, c'est avec raison que le
nombre soixante-dix-sept, produit de sept fois onze,, exprime la masse de tous
les péchés. Mais nous voyons aussi dans le même nombre la rémission pleine et
entière des péchés: car la chair de notre pontife, à qui ce nombre commence,
dans le récit de saint Luc, nous purifie de nos souillures, et Dieu, à qui il
se termine, nous reçoit en grâce par l'Esprit-Saint. Et c'est au baptême de
Jésus-Christ, baptême dont l'Evangéliste prend occasion pour faire son
énumération, que l'Esprit-Saint apparut en forme de colombe (3).
14. Après avoir fait le
dénombrement des générations, saint Matthieu continue en ces termes: « Or
voici de quelle sorte arriva la naissance de Jésus-Christ : Comme Marie sa
mère, était fiancée à Joseph; avant
qu'ils eussent été ensemble, elle se trouva grosse ayant conçu de l'Esprit-Saint.
» Il ne dit pas comment s'est opéré le mystère ; et saint Luc, après avoir
parlé de la conception de Jean, l'expose ainsi : « Dans le sixième mois de la
grossesse d'Elisabeth, l'ange Gabriel
fut envoyé de Dieu en une ville de Galilée appelée Nazareth, à une Vierge qui
a était fiancée,à un homme de la maison de David, nommé
Joseph : et cette vierge s'appelait Marie. Et l'ange étant entré dans le lieu
où elle était lui dit : Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec
vous : vous êtes bénie entre toutes les femmes. Marie l'ayant vu fut troublée
de ses paroles, et se demandait quelle pouvait être cette salutation. Et
l'ange lui dit : Ne craignez pas, Marie, car vous avez trouvé grâce devant
Dieu : voici que vous allez concevoir dans votre sein, et vous enfanterez un
fils à qui vous donnerez le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils
du Très-Haut; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père : il
régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de
fin. Alors Marie dit à l'ange : Comment cela se fera-t-il, car je ne connais
point d'homme? Et l'ange lui répondit : Le Saint-Esprit surviendra en vous, et
la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi le fruit
saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. » Et le reste, qui
n'appartient plus à l'objet dont il s'agit présentement. Saint Matthieu, pour
tout ce détail, a donc dit de Marie qu' « elle se trouva grosse, ayant conçu
du Saint-Esprit » Mais quoique saint Luc ait exposé ce que ne raconte pas
saint Matthieu, il n'existe nulle contradiction entre l'un et l'autre, puisque
tous deux déclarent que Marie a conçu de l'Esprit-Saint ; on n'en peut voir
non plus dans le silence que garde saint Luc sur ce qui vient ensuite dans le
récit de saint Matthieu. Cet Evangéliste continue ainsi : « Joseph, son mari,
étant juste, et ne voulant pas la déshonorer, résolut de la quitter
secrètement. Mais comme il était dans cette pensée,un ange du Seigneur lui
apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains point de
prendre avec toi Marie ton épouse; car ce qui est en elle est du Saint-Esprit.
Elle enfantera un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, car ce sera lui qui
sauvera son peuple en le délivrant de ses
péchés. Or tout ceci s'est fait, pour accomplir ce que le
Seigneur avait dit par le prophète en
ces termes : Voici qu'une Vierge concevra et enfantera un fils, et il sera
appelé Emmanuel, ce qui signifie: Dieu avec nous. Joseph s'étant donc éveillé
fit ce que l'ange du Seigneur avait ordonné et prit son épouse avec lui. Et il
ne l'avait point connue quand elle enfanta son fils premier-né, à qui il donna
le (143) nom de Jésus. Comme donc Jésus était né à Bethléem, ville de Juda, au
temps du Roi Hérode.. » et le reste.
15. Saint Matthieu et saint
Luc disent également que Jésus-Christ est né dans la ville de Bethléem. Mais
saint Luc expose comment et pour quel motif Joseph et Marie s'y rendirent,
tandis que saint Matthieu n'en parle pas. Au contraire saint Luc ne dit rien
des Mages venus d'Orient, et saint Matthieu continue son récit par la
narration de ce fait : « Voici, dit-il, que des Mages vinrent d'Orient à
Jérusalem, et ils demandaient.: Où est le Roi des Juifs, nouvellement né ? Car
nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Ceci étant
arrivé à la connaissance du Roi Hérode « il en fut troublé, » et le reste,
jusqu'à l'endroit où il est écrit que ces Mages « ayant reçu en songe
l'avertissement de ne point retourner vers Hérode, revinrent dans leur pays
par un autre chemin. » Surtout cela saint Luc a gardé le silence, comme saint
Matthieu le garde sur plusieurs autres faits racontés par saint Luc, savoir
que le Seigneur fut couché dans une crèche, qu'un ange annonça aux bergers sa
naissance, qu'une grande multitude de l'année céleste se joignit à l'ange pour
louer Dieu, que les bergers se rendirent à Bethléem et reconnurent la vérité
des paroles de l'ange, et que le jour où l'enfant fut circoncis, il reçut un
nom. De même saint Matthieu ne dit rien de tout ce que raconte saint Luc au
sujet de la purification de Marie et de la présentation de Jésus-Christ dans
le temple de Jérusalem, ni au sujet des paroles que firent alors entendre le
vieillard Siméon et Affine la prophétesse, quand, remplis de l'Esprit-Saint,
ils eurent connu le Sauveur.
16. De là on désire avec
raison savoir le temps où se sont accomplies les ,choses omises par saint
Matthieu et rapportées par saint Luc, et celles que raconte saint Matthieu et
dont saint Luc ne parle pas. Car le premier, poursuivant son discours, nous
apprend encore qu'après le retour des Mages en Orient, d'où ils étaient venus,
Joseph fut averti par un ange de fuir en Egypte avec l'enfant, pour le
soustraire à la mort dont Hérode le menaçait ; qu'ensuite Hérode ne trouvant
pas cet enfant fit mourir tous les autres âgés de deux ans et au-dessous;
qu'Hérode étant mort, Joseph revint d'Egypte et qu'ayant appris l'élévation d'Archélaüs
sur le trône de Judée à la place de son père, il se rendit à Nazareth ville de
Galilée pour y habiter avec Jésus et Marie. Autant de faits que saint Luc ne
relève pas. On ne peut sans doute prétendre qu'il y a contradiction entre les
deux Evangélistes parce que l'un dit ce que l'antre tait, ou qu'une chose
rapportée par celui-ci est omise par celui-là. Mais on veut savoir en quel
temps a pu arriver ce que saint Matthieu nous apprend de la sainte famille
fuyant en Egypte, puis revenant de ce pays après la mort d'Hérode, pour
habiter désormais la ville de Nazareth, où saint Luc la fait retourner lorsque
se trouvent accomplies, à l'égard de l'enfant, dans le temple de Jérusalem,
toutes les prescriptions de la loi du Seigneur. Or, il faut ici reconnaître et
bien constater, pour résoudre d'un seul coup toute les difficultés semblables
et prévenir le trouble et l'embarras dont elles pourraient encore devenir la
matière, que chaque Evangéliste a joint ensemble les différentes parties de
son récit de manière à lui donner l'apparence d'une narration complète où rien
n'est omis. En taisant ce qu'il ne veut pas dire, il unit de telle sorte ce
qu'il veut dire à ce qu'il a dit, que les choses racontées paraissent avoir
été faites de suite. Mais quand l'un rapporte des choses dont l'autre ne parle
pas, l'ordre des deux récits considéré avec soin fait voir l'endroit où celui
qui les a omises a pu les passer, en liant ce qu'il avait dessein de dire à ce
qu'il avait dit précédemment, comme si tout se suivait sans aucun fait
intermédiaire. Ainsi, c'est dans le lieu de son récit où il nous représente
les Mages retournant par un autre chemin, selon l'avertissement du Ciel, que
saint Matthieu a passé ce qui, au rapport de saint Luc, s'est accompli dans le
temple au sujet du Seigneur, et les paroles de Siméon et d'Anne ; comme c'est
après avoir rapporté ç es derniers détails que saint Luc lui-même omet la
fuite en Egypte racontée par saint Matthieu, pour mentionner tout de suite le
retour de la sainte famille à Nazareth.
17. Si l'on veut, pour ce qui
regarde la Nativité, la première et la seconde enfance du Sauveur, réunir les
deux. récits en complétant l'un par l'autre, voici l'ordre qu'on peut suivre :
« La naissance de Jésus-Christ arriva de cette sorte (1). Au temps d'Hérode,
roi de Judée, il y avait un prêtre, nommé Zacharie, de la famille d'Abia, et
sa femme, de la race d'Aaron, s'appelait Elisabeth. Ils étaient tous deux
justes devant
144
Dieu, et ils marchaient dans la voie de tous les
commandements et de toutes les ordonnances a du Seigneur d'une manière
irrépréhensible. Ils n'avaient point d'enfant, parce que Elisaheth était
stérile et qu'ils étaient déjà tous deux avancés en âge. Or Zacharie, faisant
sa fonction de prêtre devant Dieu dans le rang de sa famille: il arriva par le
sort,
selon ce qui s'observait entre les, prêtres, que ce fut à lui d'entrer
dans le temple du
Seigneur pour y offrir des parfums. Cependant toute la multitude du peuple
était dehors faisant sa prière à l'heure où ces parfums étaient offerts. Et un
ange du Seigneur lui apparut se tenant debout à la droite de l'autel des
parfums. Zacharie le voyant, fut troublé et la frayeur le saisit. Mais l'ange
lui dit : Ne crains
point,
Zacharie ; car ta prière a été exaucée, « et Elisabeth ton épouse t'enfantera
un fils à qui tu donneras le nom de Jean. Tu en seras dans la joie et dans le
ravissement, et plusieurs se réjouiront aussi de sa naissance. Car il sera
grand devant le Seigneur. Il ne boira point de
vin, ni rien de ce qui peut enivrer, et il sera rempli du
Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il convertira plusieurs des enfants
d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Et il marchera devant lui dans l'esprit et la
vertu d'Elfe, pour réunir les coeurs des pères avec leurs enfants, pour
rappeler les incrédules à la prudence des justes, et préparer ainsi au
Seigneur un peuple parfait. Zacharie répondit à l'ange : Comment saurai-je que
cela arrivera ? Car je suis déjà vieux et ma femme est avancée en âge. Sur
quoi l'ange lui dit : Je suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu, et j'ai été
envoyé pour te parler et t'annoncer cette heureuse nouvelle. Or dans ce moment
tu vas devenir muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au moment où ceci
arrivera, parce que tu n'as point cru à mes paroles, qui s'accompliront en
leur temps.
Cependant le peuple attendait
Zacharie et il s'étonnait qu'il demeurât si longtemps dans le temple. Mais
étant sorti, il ne pouvait leur parler et ils reconnurent qu'il avait eu dans
le temple quelque vision; car il ne s'expliquait à eux que par signe, et il
demeura muet. Or, quand les jours de son ministère furent accomplis, il
retourna dans sa maison. Quelque temps après, Elisabeth sa femme conçut et
elle se tenait cachée durant cinq mois, disant C'est ainsi que le Seigneur en
a usé avec moi, quand il m'a regardée pour me tirer de l'opprobre où j'étais
devant les hommes !
Or, comme elle était dans son
sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu en une ville de Galilée
appelée Nazareth, à une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de
David, nommé Joseph; et cette vierge s'appelait Marie. L'ange étant entré dans
le lieu où elle était, lui dit: Je vous salue, pleine de grâce; le Seigneur
est avec vous; vous êtes bénie entre toutes les femmes. Marie l'ayant vu, fut
troublée de ses paroles et se demandait quelle pouvait être cette salutation.
Et l'ange lui dit : Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce
devant Dieu . Voici que vous allez concevoir dans votre
sein, et vous enfanterez un fils,à qui vous donnerez le nom de Jésus.
Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône
de David son père; il règnera éternellement sur la maison de Jacob et son
règne n'aura point de fin. Alors Marie dit à l'ange : Comment cela se
fera-t-il ? car je ne connais point d'homme. Et l'ange lui répondit : Le
Saint-Esprit surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son
ombre. C'est pourquoi le fruit saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de
Dieu. Voilà que votre cousine Elisabeth a elle-même conçu un fils dans sa
vieillesse; et c'est ici le sixième mois de celle qu'on appelle stérile; parce
qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Alors Marie lui dit : Je suis la
servante du Seigneur, qu'il me
soit fait selon
votre parole ;
et l'ange s'éloigna.
Aussitôt après, Marie partit
et se rendit en hâte au pays des montagnes, en une ville
de Juda . Et étant entrée dans la maison de Zacharie,
elle salua Elisabeth. Dès que Elisabeth entendit la voix de Marie qui la
saluait, son enfant tressaillit dans son sein, et elle-même fut remplie du
Saint-Esprit. Alors elle s'écria d'une voix forte : Vous êtes bénie entre
toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. D'où me vient ce
bonheur que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Car votre voix n'a pas
plus tôt frappé mes oreilles, lorsque vous m'avez saluée, que mon enfant a
tressailli de joie dans mon sein. Que vous êtes heureuse d'avoir cru, parce
que les choses qui vous ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront !
Alors Marie reprit : (145) Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit est
ravi de joie en Dieu mon Sauveur; parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse
de sa servante; et voici que désormais toutes les générations m'appelleront
bienheureuse ; car le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses, lui dont
le nom est saint, et dont la. miséricorde se répand d'âge en âge sur ceux qui
le craignent. Il a déployé la force de bon bras ; il a dissipé ceux qui
s'enflaient d'orgueil dans les pensées de leur coeur;il a renversé les grands
de leurs trônes, et il a élevé les petits ; il a rempli de biens ceux qui
étaient affamés, et renvoyé vides ceux qui étaient riches; il a pris en sa
protection Israël, son serviteur, se ressouvenant de sa miséricorde, selon la
promesse qu'il en avait donnée à nos pères, à Abraham et à sa postérité dans
tous les siècles.
Or Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois, puis elle retourna
en sa maison (1). — Elle se trouva
grosse, ayant conçu du Saint-Esprit.
Joseph, son mari, étant juste, et ne voulant pas la déshonorer, résolut
de la quitter secrètement. Mais, comme il était dans cette pensée, un ange du
Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains
point de prendre avec toi Marie ton épouse ; car ce qui est né en elle est du
Saint-Esprit. Elle enfantera un fils à qui tu donneras le nom de Jésus ; car
ce sera lui qui sauvera son peuple en le délivrant de ses péchés. Or tout ceci
s'est fait pour accomplir ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces
termes: Voici qu'une Vierge concevra et enfantera un fils, et il sera appelé
Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant donc éveillé fit ce
que fange du Seigneur lui avait ordonné et prit son épouse avec lui; et il ne
l'avait point connue (2).
Cependant le temps auquel Elisabeth devait accoucher
arriva, et elle mit au monde un fils. Ses parents et ses amis ayant appris que
le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde sur elle, l'en félicitaient. Et
le huitième jour, étant venus pour circoncire l'enfant,ils le nommaient
Zacharie, du nom de son père. Mais la mère prenant la parole: Non, « dit-elle,
il sera appelé Jean. Ils lui répondirent: Il n'y a personne dans votre famille
qui porte ce nom. En même temps ils firent
signe au père pour lui demander comment il voulait qu'on
le nommât. Le père s'étant fait apporter des tablettes, écrivit : Jean est son
nom. Et tous demeurèrent dans l'étonnement. Car aussitôt la bouche de Zacharie
s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait en bénissant Dieu . Tous ceux qui
habitaient les lieux voisins furent remplis de crainte, et le
bruit de ces merveilles se répandit dans tout le pays des montagnes de
Judée. Tous ceux qui les entendirent les
conservèrent dans leur coeur, et ils disaient : Que penses-tu que sera cet
enfant ? Car la main du Seigneur était avec lui. Et Zacharie son père, fut
rempli de l'Esprit-Saint, et prophétisa en disant :
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et
racheté son peuple ; de ce qu'il nous a suscité un puissant Sauveur, dans la
maison de David son serviteur; selon la parole qu'il avait donnée, par la
bouche de ses saints prophètes qui ont vécu dans les siècles passés, de nous
délivrer de nos ennemis et des mains de tous ceux qui nous haïssent, pour
exercer sa miséricorde envers nos pères et se souvenir de son alliance sainte:
selon le serment par lequel il a juré à Abraham notre père de nous accorder la
grâce de le servir sans crainte, étant délivrés des mains de nos ennemis et
marchant devant lui dans la sainteté et la justice tous les jours de notre
vie. Pour toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut : car tu
marcheras devant le Seigneur et tu prépareras ses voies; afin d'enseigner à
son peuple la science du salut, pour la rémission de ses péchés, par les
entrailles de la miséricorde de notre Dieu, par lesquelles le Soleil levant
est venu d'en haut nous visiter; afin d'éclairer ceux qui sont assis dans les
ténèbres et les ombres de la mort, et de diriger nos pieds dans le chemin de
la paix.
Cependant l'enfant croissait
et se fortifiait en esprit : et il demeurait dans le désert jusqu'au jour où
il devait paraître devant le peuple d'Israël. Or il arriva qu'en ce même
temps, « on publia un édit de César Auguste pour faire le dénombrement des
habitants de toute la terre. Ce premier dénombrement se fit par Cyrinus,
gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire enregistrer chacun dans la
ville dont il était. Alors Joseph partit aussi de la ville de Nazareth, qui
est en Galilée, et vint en Judée, à la ville de David, appelée Bethléem, parce
qu'il (146) était de la maison et de la famille de David, pour se faire
enregistrer avec Marie son épouse qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient
là, arriva le temps où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils
premier-né ; elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce
qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Or il y avait aux
environs des bergers qui passaient la nuit dans les champs, veillant
tour-à-tour à la garde de leurs troupeaux. Et tout-à-coup, un ange du Seigneur
se présenta à eux, et une clarté céleste les environna, et ils furent saisis
d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : Ne craignez point; car je viens
vous apporter une nouvelle qui sera pour tout le peuplé le sujet d'une grande
. joie : c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il
vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici la marque à
laquelle vous le reconnaîtrez : Vous trouverez un enfant enveloppé de langes
et couché dans une crèche. Au même instant, il se joignit à l'ange une grande
troupe de l'armée céleste louant Dieu et disant : Gloire à Dieu au plus haut
des r cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Après que les
anges se furent retirés dans le ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre :
Passons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, et ce que le Seigneur
nous a fait connaître. S'étant donc hâtés d'y aller, ils trouvèrent Marie et
Joseph avec l'enfant couché dans une crèche. Et l'ayant vu, ils reconnurent la
vérité de ce qui leur avait été dit touchant cet enfant. Et tous ceux qui
entendirent, admirèrent ce qui leur avait été rapporté par les bergers. Or,
Marie conservait toutes ces choses, les repassant dans son coeur. Et les
bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient
entendu et vu, selon qu'il leur avait été dit.
Le huitième jour, quand
l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus,
nom que l'ange lui avait donné avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère
(1).
Ensuite voici que des Mages vinrent d'Orient à Jérusalem,
et ils demandèrent : Où est le roi des Juifs nouvellement né ? Car nous avons
vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Ceci étant arrivé à la
connaissance du roi Hérode, il en fut troublé, et avec lui toute la ville de
Jérusalem. Ayant donc assemblé
tous les princes des prêtres et les scribes du peuple, il
s'informait, près d'eux, du lieu où devait naître le Christ. Ils lui dirent
que c'était à Bethléem de Juda, selon ce qui avait été écrit par le prophète :
Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales
villes de Juda : car de toi sortira le chef qui doit conduire mon peuple
d'Israël. Alors Hérode ayant appelé les mages en secret, s'enquit d'eux avec
soin du temps auquel l'étoile leur était apparue ; et, les envoyant à
Bethléem, il leur dit : Allez, informez-vous exactement de cet enfant, et
lorsque vous l'aurez trouvé, dormez-m'en la nouvelle, afin que j'aille aussi
moi-même l'adorer. Ayant entendu le roi, les mages partirent, et l'étoile
qu'ils avaient vue en Orient, se montra de nouveau et allait devant eux,
jusqu'à ce qu'étant arrivée au des sus du lieu où était l'enfant, elle s'y
arrêta. La voyant reparaître ils furent transportés de joie ; et lorsqu'ils
entrèrent dans la maison qu'elle leur marquait, ils trouvèrent
l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant ils l'adorèrent ; puis
ayant ouvert leurs trésors, ils lui offrirent pour présents de l'or, de
l'encens et de la myrrhe. Ensuite, ayant reçu en songe l'avertissement de ne
pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Quand ils furent repartis (1),
les jours de la purification de Marie étant accomplis, selon la a loi de
Moïse, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur ; « suivant qu'il est écrit dans la loi divine, que tout mâle qui
naîtra le premier sera consacré au Seigneur ; et pour donner ce qui
devait.être offert en sacrifice, comme il est écrit dans la même loi, deux
tourterelles ou deux petits de colombes. Or, il y avait alors à Jérusalem un
homme juste et craignant Dieu, nommé Siméon. Il attendait la consolation
d'Israël, et le Saint-Esprit était en lui. Et il lui avait été révélé par le
Saint-Esprit qu'il ne mourrait point, sans avoir vu auparavant le Christ du
Seigneur. Cet homme vint donc au temple par le mouvement de l'Esprit de Dieu,
et comme les parents de l'enfant Jésus l'y portaient afin d'accomplir à son
égard les prescriptions de la loi; il le prit lui-même entre ses bras et bénit
Dieu en disant : C'est maintenant, Seigneur, que vous laisserez mourir en paix
votre serviteur, selon votre parole ; puisque mes yeux ont vu
147
le Sauveur que vous nous donnez, et que vous destinez
pour être exposé à la vue de tous les peuples, comme la lumière qui éclairera
les nations, et la gloire de votre peuple Israël. Et c le père et la mère de
Jésus admiraient ce que l'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie,
la mère de l'enfant : Celui-ci est établi pour la ruine et la résurrection de
plusieurs dans Israël, et pour être en butte à la contradiction et votre âme
même sera percée d'un glaive, afin que soient découvertes les pensées de
plusieurs cachées au fond de leur coeur. Il y avait aussi une prophétesse
nommée Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser : elle était fort avancée en
âge ; elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité, et elle
était demeurée veuve jusqu'à quatre-vingt quatre ans elle ne s'éloignait point
du temple, servant Dieu jour et nuit dans les jeûnes et dans les prières.
Etant donc survenue à la même heure, elle se mit aussi à louer le Seigneur, et
à parler de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption d'Israël.
Après qu'ils eurent accompli
tout ce qui était ordonné par la loi du Seigneur (1), voici qu'un ange du
Seigneur apparut à Joseph au milieu de son sommeil et lui dit : Lève-toi ;
prends l'enfant et sa mère, fuis en Egypte et demeures-y jusqu'à ce que je te
dise d'en sortir : car Hérode cherchera l'enfant pour le faire mourir. Joseph
s'étant levé prit l'enfant et sa mère durant la nuit et se retira en Egypte,
où il demeura jusqu'à la mort d'Hérode. Cette retraite arriva pour accomplir
la parole que le Seigneur avait dite par le prophète : J'ai rappelé mon Fils
de l'Egypte. Alors Hérode voyant que les mages l'avaient trompé, entra dans
une extrême colère : il envoya tuer à Bethléem et dans tous les pays
d'alentour, tous les enfants âgés de deux ans et au-dessous, selon le temps
dont il s'était enquis exactement des mages.
Alors s'accomplit ce qui avait
été dit par le prophète Jérémie en ces termes: On a entendu dans Rama une voix
lamentable, des pleurs et de grands cris: c'est Rachel pleurant ses enfants et
ne voulant point recevoir de consolation parce qu'ils ne sont plus.
Or, après la mort d'Hérode, un
ange apparut la nuit à Joseph qui était en Egypte, et lui dit Lève-toi, prends
l'enfant et sa mère et retourne dans la terre d'Israël ; car ceux qui
cherchaient l'enfant pour lui ôter la vie sont morts. Joseph
s'étant donc levé prit l'enfant avec sa mère et s'en vint
dans la terre d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait en Judée à la
place d'Hérode son père, il craignit d'y aller, et sur un avertissement
céleste qu'il reçut pendant qu'il dormait, il se retira dans la Galilée et
vint demeurer dans la ville appelée Nazareth, avec Jésus, afin que cette
prédiction des prophètes fut accomplie : Il sera appelé Nazaréen (1).
Cependant l'enfant croissait
et se fortifiait, étant rempli de sagesse ; et la grâce de Dieu était en lui.
Or son père et sa mère allaient tous les ans à Jérusalem pour la fête de
Pâque. Et lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y allèrent selon leur coutume au
temps de la fête. Quand les jours de la solennité furent passés, lorsqu'ils
s'en retournèrent, l'enfant Jésus demeura à Jérusalem, sans que son père et sa
mère s'en aperçussent ; et pensant qu'il était avec quelqu'un de la compagnie,
ils marchèrent durant un jour ; et le soir, ils le cherchaient parmi leurs
parents et parmi ceux de leur connaissance. Mais ne l'ayant point trouvé, ils
retournèrent à Jérusalem pour l'y chercher. Et trois jours après, ils le
trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les
interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de sa sagesse et
de ses réponses. Lors donc qu'ils le virent, ils furent remplis d'admiration,
et sa mère lui dit : « Mon fils, pourquoi avez vous agi de la sorte envers
nous ? Voilà que nous vous cherchions tout affligés, votre père et moi. Il
leur répondit Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que
je sois à ce qui regarde le service de mon Père ? Mais ils ne comprirent point
ce qu'il leur disait. Il s'en alla ensuite avec eux et vint à Nazareth ; et il
leur était soumis. Or, sa mère conservait toutes ces choses en son coeur. Et
Jésus croissait en sagesse en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes
(2).»
18. Vient ensuite ce qui a
rapport à la prédication de Jean; et c'est un point que fait ressortir chacun
des quatre évangélistes. En effet, saint Matthieu, après avoir écrit les
dernières paroles que j'ai citées de lui , après avoir rappelé ce
148
témoignage d'un prophète : « Il sera appelé Nazaréen, »
continue ainsi son Evangile : « En ces jours Jean-Baptiste vint prêcher au
désert de Judée (1). » Et saint Marc qui n'a rien dit de la Nativité, ni de la
première ni de la seconde enfance du Seigneur, prend son récit à la
prédication même de Jean Car voici comme il débute : « Cmmencement de l'Evangile
de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le prophète Isaïe .
Voilà que ,j'envoie mon ange devant ta face, et marchant devant toi, il te
préparera le chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez la voie
du Seigneur ; rendez droits ses sentiers. Jean était dans le désert, baptisant
et prêchant un baptême de pénitence pour la rémission des péchés, etc (2). »
Saint Luc, lui aussi, après ces mots : « Jésus croissait en sagesse, en âge et
en grâce devant Dieu et devant les hommes, » parle aussitôt de la prédication
de Jean, et il dit : « La quinzième année de l'empire de Tibère César,
Ponce-Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée,
Philippe, son frère, de l'Iturée et du pays de Trachonite, et Lysanias, d'Abilène ;
Anne et Caïphe étant grands-prêtres, le Seigneur fit entendre sa parole à
Jean, fils de Zacharie, dans le désert, etc (3). » Et l'Apôtre saint Jean, qui
domine de si haut les trois autres évangélistes, après avoir parlé du Verbe,
Fils de Dieu, engendré avant tous les siècles de la création, puisque tout a
été fait par lui, rappelle immédiatement la prédication et le témoignage de
Jean- Baptiste: « Il y eut, dit-il, un homme envoyé de Dieu, qui s'appelait
Jean (4). »
Considérons maintenant
l'accord des quatre récits de l'Evangile, au sujet du saint précurseur. Je
n'entends pas ici exposer en détail et réunir toutes les paroles, comme je
l'ai fait un peu plus haut, quand il s'est agi des commencements du Christ né
de Marie. J'ai ramené à une seule narration ce qu'en disent saint Matthieu et
saint Luc , pour montrer même aux esprits les moins exercés, qu'il n'y a pas
la moindre contradiction entre les deux évangélistes et que l'un, en rappelant
ce que l'autre tait ou en taisant ce que l'autre rappelle, n'empêche nullement
de recevoir comme vrai ce que présente le récit de chacun. Cet exemple, tel
que je l'ai donné ou tel qu'on peut le donner si l'on voit un ordre meilleur,
suffit pour faire sentir à tout homme que dans les autres endroits
semblables les choses peuvent se traiter comme dans
celui-là.
19. Maintenant donc, comme je
viens de le dire, voyons au sujet de Jean-Baptiste, l'accord des quatre
auteurs des récits évangéliques. Saint Matthieu continue ainsi: «Or dans ces
jours, Jean-Baptiste vint prêcher au désert de Judée. » Saint Marc ne dit pas
« dans ces jours, » parce qu'il n'avait raconté précédemment aucun événement
contemporain, qui lui permit d'user de cette formule. Saint Luc a marqué d'une
manière plus précise par le nom des puissances terrestres, les temps de la
prédication et du baptême de Jean, quand il a dit: « La quinzième année de
l'empire de Tibère César, Ponce-Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode
tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, de l'Iturée et du pays de
Trachonite et Lysanias, d'Abilène; Anne et Caïphe étant grands-prêtres, le
Seigneur fit entendre sa voix à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. » Ne
croyons pas cependant que saint Matthieu ait voulu désigner l'époque où tous
ces hommes exerçaient leur autorité, en
disant: « Dans ces jours. » On doit appliquer son expression à un
espace de temps beaucoup plus étendu; car aussitôt qu'il nous a montré
Jésus-Christ de retour d'Egypte après la mort d'Hérode (et sans aucune doute,
le fait a eu lieu pendant la première ou la seconde enfance du Sauveur;
autrement l'on ne pourrait justifier les paroles de saint Luc au sujet de sa
présence et de sa conduite dans le temple de Jérusalem, à l'âge de douze-ans
(1)) aussitôt, dis-je, qu'il nous a fait voir dans la personne de l'enfant
Jésus, l'accomplissement de cet oracle : « J'ai rappelé mon Fils d'Egypte, »
saint Matthieu arrive à la prédication de Jean et dit aussitôt: « Dans ces
jours, Jean-Baptiste
vint prêcher au désert. » Ce n'est pas qu'il entende
seulement les jours de l'enfance de Jésus; il désigne toutes les années
écoulées depuis la Nativité jusqu'au temps,de la prédication et du baptême de
Jean-Baptiste, c'est-à-dire jusqu'au temps où nous voyons le Christ dans l'âge
de la jeunesse, puisque le Sauveur était né la même année que le précurseur,
et que, du reste, l'Evangile nous le présente comme ayant trente ans environ
quand il fut baptisé par lui.
20. Saint Luc rapporte
qu'Hérode était tétrarque de Galilée quand Jésus-Christ , alors dans l'âge de
la jeunesse , reçut le baptême de Jean (1) ; et saint Matthieu, que
Jésus-Christ encore enfant quitta l'Egypte pour revenir en son pays après la
mort d'Hérode. Plusieurs veulent trouver ici l'objet d'une difficulté
sérieuse. Pour affirmer la vérité des deux passages, il faut, sans doute,
reconnaître qu'il y a eu deux Hérodes. Comme aux yeux de tout le monde la
chose est très-possible, quel n'est pas l'aveuglement de ces hommes qui ne
cherchent qu'à calommier la vérité de l'Evangile, quand la moindre réflexion
leur ferait voir qu'il s'agit de deux personnages appelés du même nom ? C'est
de quoi l'on trouve partout des exemples. Il est certain, en effet, que ce
dernier Hérode était fils du premier; comme Archélaüs, que saint Matthieu
place sur le trône de Judée après la mort de son père, à l’époque du retour d'Egypte
(2);comme Philippe que saint Luc représente comme le frère du tétrarque Hérode
et tétrarque lui-même de l'Iturée (3). Aussi bien le premier Hérode qui
cherchait à faire mourir l'enfant Jésus avait le titre de roi: quant.à
l'autre, son fils, il n'avait que celui de tétrarque; c'est-à-dire qu'il était
gouverneur de l'une des quatre provinces formées alors de l'ancien royaume.
21. On voudra peut-être voir
encore une autre difficulté. D'après saint Matthieu Joseph revenant d'Egypte
n'osa aller en Judée avec l'enfant, parce qu'un fils d'Hérode, Archélaüs, y
régnait à sa place. Mais comment peut-il aller en Galilée, où, d'après le
récit de saint Luc, régnait le tétrarque Hérode, un autre fils de ce tyran? La
question suppose qu'il s'agit du même temps. Mais le temps dont parle saint
Luc n'est plus celui où Joseph craignait pour l'enfant Jésus: les choses
avaient tellement changé de face que la Judée n'était plus sous le sceptre d'Archélaüs,
et qu'elle obéissait à Ponce-Pilate, qui n'était pas roi mais gouverneur des
Juifs: alors les fils d'Hérode l'ancien administraient sous (autorité de
Tibère César, non un royaume mais une
tétrarchie. Il est clair que cette révolution n'avait pas
encore eu lieu quand Joseph, craignant Archélaüs, roi de Judée, se transporta
avec l'enfant dans la province de Galilée, où, du reste, était située Nazareth
sa ville natale.
22. Veut-on nous faire encore
une nouvelle objection, et nous demander comment saint Matthieu a dit que les
parents de l'enfant Jésus se rendirent avec lui en Galilée, parce que la
crainte d'Archélaüs les détourna d'aller en Judée: quand ils ont plus
vraisemblablement fixé leur séjour dans cette province parla raison que leur
ville était Nazareth de Galilée, comme le déclare saint Luc? Mais il faut
comprendre que Joseph ayant ouï en Egypte, durant son sommeil, ces paroles de
l'Ange: « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et retourne dans la terre
d'Israël, n y vit tout d'abord un ordre de se rendre en Judée; et sans
doute par la terre d'Israël il put entendre, avant tout, le pays dont
Jérusalem était le centre. Ensuite, ayant appris l'élévation d'Archélaüs sur
le trône d'Hérode son père, il voulut d'autant moins s'exposer aux poursuites
du tyran, qu'il pouvait considérer la Galilée comme étant aussi la terre
d'Israël, puisque les habitants de cette province étaient aussi des Israëlites.
On peut cependant résoudre encore cette objection d'une autre manière. Les
parents de Jésus-Christ purent croire que Jérusalem, à cause du temple du
Seigneur, était le seul séjour où il leur convint de s'établir avec cet
enfant, dont les oracles célestes leur apprenaient tant de merveilles: et
alors ils devaient, au retour d'Egypte,y fixer leur demeure, s'ils n'eussent
redouté la présence du fils d'Hérode, dont l'ordre divin ne leur enjoignait
pas de mépriser les menaces.
23. On dira peut-être encore :
Comment donc, au rapport de saint Luc, les parents de Jésus allaient-ils,
toutes les années de son enfance, à Jérusalem, puisque la crainte d'Archélaüs
leur interdisait l'accès de la ville ? Il me serait facile de répondre, lors
même qu'un évangéliste nous aurait fait connaître le temps que dura le règne
(150) d'Archélaüs en Judée. Il était possible, en effet, que le jour d'une
fête solennelle qui attirait une immense multitude, Joseph et Marié, favorisés
par la foule, se rendissent à Jérusalem secrètement avec l'enfant Jésus, pour
le court espace de quelques heures, tout en craignant d'y demeurer les autres
jours. Sans manquer à la religion, sans négliger la solennité, ils pouvaient
ainsi rester inconnus et conjurer le péril qu'un séjour continuel ne leur eût
pas permis d'éviter. Mais tous les évangélistes ayant gardé le silence sur le
temps qu' a duré le règne d'Archélaüs, il y a un autre moyen d'expliquer le
récit de saint Luc. Il suffirait de supposer que Joseph et Marie n'allèrent
chaque année à Jérusalem avec l'enfant Jésus (1), qu'à dater du moment où le
fils d'Hérode n'était plus à craindre. Si, à défaut de l'Evangile, quelque
histoire digne de foi nous oblige à reconnaître que le règne d'Archélaüs fut
assez long pour ôter à cette hypothèse tout fondement; la raison que j'ai
donnée plus haut doit suffire. En redoutant le séjour de Jérusalem, les
parents de Jésus ne voulaient point cependant négliger une fête solennelle du
Seigneur, quand il leur était facile de s'y rendre sans être remarqués. Est-il
inouï d'ailleurs que, saisissant l'opportunité des jours ou des heures, on
vienne parfois dans des lieux où on redoute de demeurer?
24. Ceci peut également servir
de réponse à ceux qui se demanderaient : puisque les mages avaient donné
l'éveil au roi Hérode en lui apprenant la naissance d'un nouveau roi des
Juifs, comment Joseph et Marie purent-ils, après les jours de la purification
de la mère de Jésus, se rendre en sûreté avec l'enfant dans le temple de
Jérusalem, pour y accomplir à son égard les prescriptions de la Loi du
Seigneur, dont saint Luc rappelle le détail? Qui ne voit, en effet, que de
nombreuses occupations pouvaient bien alors absorber l'attention d'Hérode et
l'arracher à tout autre soin durant l'espace d'un jour ? S'il ne parait pas
vraisemblable que malgré sa vive attente du retour des mages, qui devaient
l'instruire de ce qui concernait l'enfant, Hérode ait laissé passer tant de
jours avant de reconnaître qu'il était leur
dupe ; si l'on répugne à penser qu'il s'avisa seulement
de prendre contre cet enfant la plus cruelle résolution et d'en faire mourir
tant d'autres, quand fut écoulé le temps de la purification de Marie, quand
furent terminées les cérémonies solennelles prescrites à l'égard des
premiers-nés, et lorsque la sainte famille fut partie pour l'Egypte ; il faut
convenir cependant que beaucoup de graves affaires, dont j'omets le détail,
purent distraire le souci du roi, et lui faire oublier son projet durant
plusieurs semaines, ou en empêcher l'exécution. Il est impossible d'énumérer
les causes qui purent donner ce tour aux événements, mais nul n'est assez
étranger au monde, pour nier ou révoquer en douté qu'il pût s'en trouver
beaucoup et de très-sérieuses. Qui ne peut se figurer combien d'autres
nouvelles plus terribles, vraies ou fausses, purent arriver aux oreilles du
roi, pour enlever son âme, par la vive appréhension de périls plus prochains,
à la crainte que cet enfant, ce nouveau roi des Juifs, ne prit les armes, dans
quelques années, contre lui ou contre ses fils, et l'occuper entièrement du
soin de parer à des éventualités dont l'imminence appelait de promptes
mesures? Mais, laissant de côté toutes ces raisons, voici ce que je dirai. Les
Mages n'étant pas revenus vers Hérode pour l'instruire, celui-ci put croire
qu'ils s'étaient laissé abuser en s'imaginant voir une étoile qui n'existait
point, et que, n'ayant pas découvert l'Enfant qu'ils cherchaient, ils avaient
eu honte de retourner à sa cour. Ainsi le roi aurait cessé de craindre et
aurait abandonné son homicide dessein. Suivant cette hypothèse bien
vraisemblable, Joseph aurait été averti dans son sommeil de fuir en Egypte
avec l'enfant et sa mère quand, après les jours de la purification de Marie,
après la démarche de la sainte famille au temple de Jérusalem, après la
consommation de toutes les choses que nous fait connaître saint Luc (1),les
paroles prophétiques de Siméon et d'Anne à l'égard de Jésus, en se propageant
par les récits des témoins, allaient ranimer les craintes du roi, et le
rappeler à sa première intention. Hérode comprenant ensuite, par la
divulgation des faits accomplis et des discours prononcés dans le temple, que
les mages s'étaient joués de lui, et voulant assurer la mort de Jésus-Christ,
commanda alors ce massacre général dont parle saint Matthieu (2).
151
23. Le même Evangéliste aborde
ensuite ce qui regarde le précurseur: « En ces jours, dit-il, Jean-Baptiste
vint prêcher au désert de Judée, et il disait: Faites pénitence, car le
royaume des cieux est proche: voici en effet Celui dont a parlé le prophète
Isaïe, quand il a dit : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le
chemin du Seigneur; rendez droits ses sentiers (1). » Saint Marc et saint Luc,
de leur côté, s'accordent à reconnaître que ce témoignage d'Isaïe concerne
Jean-Baptiste. Car saint Luc lui appliqué encore plusieurs paroles qui suivent
dans le texte du même prophète (2). L'Evangéliste saint Jean dit de plus que
Jean-Baptiste s'est appliqué lui-même cet oracle, d'Isaïe (3) . comme du reste
saint Matthieu rapporte ici certaines paroles du précurseur que les autres ne
reproduisent pas. « Il vint prêcher au désert de Judée, et il disait: Faites
pénitence ; car le royaume des cieux est proche : » ces paroles de
Jean-Baptiste ne sont pas rappelées dans les trois autres récits. Quant à ce
que nous présente ensuite la narration de saint Matthieu qui ajoute : « Car
c'est lui dont a parlé ainsi le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans
le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers ; » on
ne voit pas si l'évangéliste reprend son discours et s'il rappelle en son nom
les paroles d'Isaïe, ou s'il continue à exposer la prédication de
Jean-Baptiste, et à lui attribuer tout ce que contient ce passage : « Faites
pénitence, car le royaume des cieux est proche : voici, en effet celui dont le
prophète Isaïe a parlé, » , etc. En effet, on ne doit pas se préoccuper de ce
que Jean-Baptiste, au lieu de dire: Je suis moi-même celui dont le prophète
Isaïe a parlé ; a dit : « Voici Celui dont le prophète Isaïe a parlé; » car
cette forme de langage est familière aux Evangélistes saint Matthieu et saint
Jean. En effet saint Matthieu dit en parlant de lui-même :
Jésus vit un homme qui était assis au bureau des impôts (4); » et il ne
dit pas : Jésus me vit. Et saint Jean (5) C'est là, dit-il, le disciple qui
rend témoignage de ces choses et qui les a écrites; et nous savons que son
témoignage est vrai. » Il ne dit pas: C'est moi, ni: Mon témoignage est vrai.
Notre-Seigneur, dit très-souvent: Le. fils de l'homme (1)
et, le Fils de Dieu; au lieu de dire: Moi. Il dit ailleurs (2) : « Il fallait
que le Christ souffrît et ressucitât d'entre les morts ; » et non pas : Il
fallait que je souffrisse. Après avoir dit :Faites pénitence, car le royaume
des cieux est proche ; » Jean-Baptiste a donc pu lui-même ajouter et
s'appliquer les paroles suivantes: « Car voici Celui dont le prophète Isaïe a
parlé, » etc. Par conséquent, après avoir rapporté les paroles sorties de la
bouche du précurseur, saint Matthieu reprendrait seulement son discours, à
l'endroit où nous lisons: « Or, Jean avait un vêtement de poil de chameau »
etc. S'il en est ainsi, l'on ne doit pas s'étonner que, pressé de rendre
témoignage de lui-même, le précurseur ait dit, suivant le rapport de
l'évangéliste saint Jean : «Je suis la voix de celui qui crie dans le désert
(3), » comme il l'avait déjà dit quand il recommandait de faire pénitence. Au
sujet du vêtement et du régime de vie de Jean-Baptiste, saint Matthieu dit
donc en continuant son récit : « Or, Jean avait un vêtement de poil de
chameau, et une ceinture de cuir, autour des reins; il se nourrissait de
sauterelles et de miel sauvage. » C'est ce que saint Marc dit aussi et presque
dans les mêmes termes mais les deux autres n'en parlent pas.
26. Saint Matthieu dit ensuite
: « Alors les habitants de Jérusalem, ceux de la Judée et de tout le pays des
environs du Jourdain venaient à lui ; et, en confessant leurs péchés, ils
étaient baptisés par lui dans le Jourdain. Mais voyant venir à son baptême
plusieurs des Pharisiens et des Sadducéens il leur dit : Race de vipères, qui
vous a appris à fuir la colère qui va tomber sur vous ? Faites donc de dignes
fruits de pénitence ; et ne songez pas à dire en vous-mêmes: Nous avons pour
père Abraham. Car je vous déclare que Dieu peut faire naître de ces pierres
mêmes des enfants d'Abraham. Déjà la cognée est à la racine des arbres; donc
tout arbre qui ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. Moi, je
vous baptise dans l'eau pour vous amener à la pénitence; mais Celui qui vient
après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter sa
chaussure. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu.
Il a le van à la main, et il nettoiera complètement son aire ; il amassera son
blé dans le grenier, mais il brûlera
152
la paille dans un feu qui ne s'éteindra jamais. » Nous
trouvons toutes ces pensées dans le récit de saint Luc, qui cite presque
textuellement ces mêmes paroles attribuées à Jean-Baptiste. Quand les deux
Évangélistes diffèrent pour les termes, ils ne diffèrent nullement pour le
sens. Ainsi, selon le premier, le précurseur parle de cette manière: « Ne
songez pas à dire en vous-mêmes Nous avons pour père Abraham ; » et, selon le
second : « Ne vous mettez pas à dire: Nous avons pour père Abraham. » Ainsi,
quand, plus loin, le texte de saint Matthieu nous présente ces paroles: « Moi,
je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la pénitence ; » celui de saint
Luc montre d'abord les différentes classes de la foule demandant ce quelles
doivent faire, et rappelle que Jean les engagea à multiplier les bonnes
oeuvres comme des fruits de pénitence ; particularités que saint Matthieu ne
rapporte pas: puis, à l'encontre de cette fausse idée que Jean pourrait bien
être le Messie, viennent les mêmes paroles Moi, je vous baptise dans l'eau; »
sans être accompagnées des mots: « Pour vous amener à la pénitence. » Selon
saint Matthieu., le précurseur dit ensuite: « Celui qui doit venir après moi
est plus puissant que moi ; » et selon saint Luc : « Il en vient un autre qui
est plus puissant que moi. » Nous lisons dans saint Matthieu ; « Je ne suis
pas digne de porter sa chaussure ; » et dans saint Luc: « Je ne suis pas digne
de délier les cordons de sa chaussure, » paroles que reproduit aussi saint
Marc, tout en omettant beaucoup d'autres détails . Car, après avoir parlé du
vêtement et de la nourriture du précurseur, il ajoute: « Et Jean prêchait en
disant
Il en vient un autre derrière moi, qui est plus puissant
que moi; et je ne suis pas digne, en me prosternant devant lui, de délier les
cordons de sa chaussure. Moi, je vous ai baptisés dans l'eau ; lui, vous
baptisera dans le Saint-Esprit. » Pour ce qui regarde la chaussure, il diffère
donc de saint Luc, par cette addition En me prosternant devant lui. » Au sujet
du baptême il diffère de saint Luc et de saint Matthieu en ce qu'il ne dit
pas: « Et dans le feu, » mais seulement : « dans le Saint-Esprit. » Saint Luc
nous fait lire aussi bien que. saint Matthieu et suivant le même ordre: « Il
vous baptisera dans, l'Esprit et dans le feu. » Toute la différence c'est que
le mot Saint, » n'est pas dans le récit de saint Luc comme dans celui de saint
Matthieu, où nous trouvons: « Il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans
le feu (1). » L'Evangéliste saint Jean confirme les trois récits, dans ce
passage: « Jean-Baptiste lui rend témoignage en s'écriant: Voilà celui dont je
vous disais: Celui qui vient après moi, m'a été préféré parce qu'il était
avant moi (2). » Par là, en effet, l'Evangéliste déclare que Jean-Baptiste a
prononcé ces paroles dans le temps où les trois autres les lui font dire, et
qu'ensuite il les a rappelées et répétées quand, il s'est écrié : « Voilà
celui dont je vous disais : Celui qui vient après moi, etc. »
27. Demanderait-on maintenant
quelles sont les paroles qu'a prononcées Jean-Baptiste; celles de saint
Matthieu, ou celles de saint Luc, ou celles de saint Marc dans le peu de
citations qu'il t'ait? Pour ne pas se préoccuper de cette question, il suffit
de comprendre que la connaissance de la vérité résulte des pensées elles-mêmes
et non des termes dans lesquels elles sont formulées. En effet, tel
évangéliste n'est pas contraire à tel autre, parce qu'on trouve dans sa
relation un ordre différent. De même il n'y a pas d'opposition, quand l'un
rapporte ce que l'autre passe sous silence. Il est évident, en effet, que
chaque évangéliste a écrit suivant ses souvenirs, et a donné son récit en plus
ou moins de mots, selon qu'il était porté à l'étendre ou à l'abréger, tout en
présentant néanmoins la même pensée.
28. De là ressort assez
clairement une observation très-importante. Puisque la vérité de l'Evangile
est parvenue au plus haut point d'autorité, par là même qu'elle repose sur la
parole de Dieu, sur cette parole qui,
subsistant éternelle et immuable au-dessus de toute créature, a été par
l'intermédiaire de la créature communiquée au moyen de signes temporels et du
langage humain , nous ne devons accuser personne de mensonge, quand plusieurs,
venant à faire le récit d'une même chose qu'ils se souviennent d'avoir vue ou
entendue, ne le font pas de la même manière ni dans les mêmes termes; soit que
la différence regarde la narration ; soit que des mots se trouvent remplacés
par d'autres mots équivalents; soit que tel narrateur omette une particularité
qui ne se présente pas à sa mémoire ou qui pourra se comprendre d'après les
autres parties du récit; soit qu'en faveur de certains points qu'il se propose
surtout de raconter, chacun veuille, afin de pouvoir y donner le temps
convenable, ne
153
toucher que légèrement d'autres détails et non les
développer entièrement; soit que, pour éclaircir la pensée et la mettre dans
tout son jour, l'un d'eux, sans rien ajouter aux choses elles-mêmes, ajoute
cependant au simple récit, des paroles qui les font mieux connaître ; soit
que, gardant bien la mémoire des faits dont il a été témoin, il ne puisse
malgré ses efforts se rappeler aussi, pour les reproduire littéralement, tous
les discours qui ont frappé ses oreilles. Si l'on prétend que les évangélistes
devaient, sous l'action de l'Esprit-Saint, jouir du privilège de ne pas
différer l'un de l'autre, même dans la nature, l'ordre et le nombre des
expressions, c'est qu'on ne comprend point que plus est grande l'autorité des
évangélistes, plus il importe aux autres hommes dans l'exposition de la vérité
d'être rassurés par leur exemple ; pour n'avoir aucunement à redouter
l'accusation de mensonge, quand ils différeront entre eux dans le narré d'un
même fait comme les écrivains sacrés, dont l'exemple pourra les justifier.
Comme il n'est permis ni de dire ni de penser qu'un évangéliste a menti, on
devra reconnaître, qu'un homme n'aura pas menti non plus, quand il lui sera
arrivé pour ses souvenirs ce qu'on sait être arrivé aux évangélistes. Et plus
la morale exige qu'on s'abstienne du mensonge, plus il est à propos qu'un
exemple de si haute autorité nous ait été mis sous les yeux; pour régler notre
jugement et nous empêcher de crier au mensonge lorsque plusieurs récits d'un
événement nous offrent des différences semblables à celles des quatre
Evangiles ; pour nous faire aussi comprendre, ce qui intéresse au plus haut
point l'enseignement de la foi, que nous devons moins chercher et considérer
l'exacte conformité des termes que la vérité des choses
; quand nous pouvons dire que sans user
du même langage, plusieurs ont énoncé cependant la même vérité pour s'être
accordé sur le fond et les pensées.
29. Qu'y a-t-il donc qui doive
paraître contraire dans ces passages des évangélistes que je viens de mettre
en regard ? Faut-il voir une opposition entre celui qui l'ait parler ainsi
Jean-Baptiste.: «Je ne suis pas digne de porter sa chaussure; » et ceux qui
lui font dire : « Je ne suis pas digne de délier les cordons de sa chaussure?
» Il semble, en effet, qu'il y a, non pour les termes, ni l'ordre des mots, ni
certaine forme particulière de langage, mais dans la chose elle-même une
différence entre porter la chaussure, » et « délier les cordons de la
chaussure. » On peut donc avec raison demander ce que Jean-Baptiste a dit
qu'il n'était pas digne de faire ; si c'est ale porter la chaussure ou d'en
délier les cordons. Car s'il n'a dit que l'une des deux choses, celui-là seul
qui a pu la rapporter parait être le narrateur véridique: et celui qui a écrit
l'autre, sera regardé, sinon comme ayant voulu tromper, du moins comme ayant
été trompé par une mémoire infidèle. Mais il faut écarter des évangélistes
toute erreur, non-seulement celle qui résulte du mensonge, mais celle même qui
vient de l'oubli; c'est pourquoi, s'il importe d'entendre sous les expressions
porter la chaussure » et délier les cordons de la chaussure, » deux idées
vraiment différentes, que penserons-nous devoir conclure pour ; l'exacte
intelligence des récits évangéliques, sinon que Jean-Baptiste a dit l'une et
l'autre chose, soit dans plusieurs discours, soit dans les mêmes ? Car il a pu
parler ainsi
Je ne suis pas digne de délier les cordons de sa
chaussure ni de la porter. Alors les évangélistes en rappelant, l'un la
première proposition, l'autre la seconde, ont tous également fait un récit
véridique. Cependant, en parlant de la chaussure du Seigneur, Jean-Baptiste a
eu seulement en vue de montrer la grandeur suprême du Seigneur et sa propre
bassesse ; qu'un évangéliste ait écrit : « Je ne suis pas digne de délier les
cordons de sa chaussure , » ou : « Je ne suis pas digne de porter sa
chaussure, », il a toujours rendu la même idée, exprimé le même sens, quand,
mettant dans la bouche du précurseur un langage quelconque au sujet des
souliers du divin Maître, il a également fait ressortir son intention de
montrer combien Jésus lui était supérieur. Une règle dont le souvenir sera
d'un très-grand avantage dans tout le cours de ce traité sur l'accord des
évangélistes, c'est donc
de ne pas regarder comme erroné le langage de celui qui en faisant,
certains changements aux dis cous d'un personnage, expose néanmoins son idée
et son intention, aussi exactement que celui qui rapporte rigoureusement
toutes ses paroles; par là nous apprenons avantageusement qu'il ne faut
chercher qu'à se rendre compte de la pensée et de la volonté de celui qui
parle.
30. Saint Matthieu continue
ainsi: « Alors Jésus vint de Galilée près du Jourdain trouver (154) Jean pour
être baptisé par lui. Mais Jean s'en défendait en disant: C'est moi qui dois
être baptisé par vous, et vous venez à moi ? Jésus lui répondit : Laisse-moi
faire maintenant, car c'est ainsi que nous devons accomplir toute justice.
Alors Jean cessa de lui résister. » Les trois autres évangélistes disent
pareillement que Jésus vint trouver Jean, et tous trois rapportent qu'il fut
baptisé par lui; mais ils gardent le silence sur ce que nous voyons dans le
récit de saint Matthieu, savoir les paroles de Jean au Seigneur et les
réponses du Seigneur à Jean (1).
31 . Saint Matthieu dit
ensuite : « Jésus ayant été baptisé sortit aussitôt de l'eau; et en même temps
les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre en forme de
colombe et se reposer sur lui . Et au même instant on entendit une voix du
ciel qui dit Celui-ci est mon Fils bien aimé, en qui je me complais. » C'est
ce que racontent pareille
a a a a ment deux autres évangélistes , saint Marc et
saint Luc. Ils exposent cependant d'une manière différente les paroles de la
voix qui se fit entendre du ciel: mais c'est toujours la même pensée. Car,
d'après ce que nous avons dit précédemment, on doit voir le même sens et
l'expression de la même idée dans la leçon de saint Matthieu: « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, » et dans celle de saint Marc et de saint Luc: « Vous êtes
mon Fils bien-aimé. » Sans doute il n'y eut, dans ce discours venu d'en haut ,
qu'une seule des deux locutions, mais saint Matthieu, en écrivant: « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, » aura voulu marquer le but de la voix du ciel,
qui était de faire connaître aux auditeurs la filiation
divine de Jésus-Christ; il a voulu montrer que les paroles : « Vous
êtes mon Fils, » furent prononcées de la même manière que si la voix eût dit à
la foule: « Celui-ci est mon Fils. » Car elle n'apprenait pas à Jésus-Christ
ce qu'il savait bien; mais elle l'apprenait à ceux qui étaient là et pour qui
elle se faisait entendre.
Maintenant la voix du ciel
a-t-elle dit: « En qui je me complais, in quo mihi complacui,» ou : «
Je mets en vous ma complaisance, in te complacui, » ou enfin : « Il me
complaît en vous,
in
te complacuit mihi (1) ? « On est
libre
d'admettre l'une ou l'autre de ce Trois leçons, pourvu que l'on comprenne
qu'en rapportant différemment les paroles, les Evangélistes ont rendu la même
pensée. La différence des ex pressions a même l'avantage
de nous faire mieux saisir l'idée, que si tous l'avaient rap portée
dans les mêmes termes , et d'écarter le danger d'une fausse interprétation .
Car celui qui voudrait, sous les mots: « En qui je me complais, in quo mihi
complacui , » voir le Père se plaisant à lui-même dans le Fils, est averti
de son erreur par le texte de saint Marc : «
En vous je complais, in te complacui. » De même, voulons-nous
par cette seule leçon : « in te complacui, » entendre que , dans le
Fils le Père plaît aux hommes ? nous sommes détrompés par le texte de saint
Luc: in te complacuit mihi. Donc, quelque soit l'Évangéliste dont le
récit nous présente le texte exact des paroles de la voix céleste, on voit
clairement que les autres n'ont varié les termes que pour rendre le même sens
plus saisissable. Ainsi , d'après les trois réunis , la voix du ciel a voulu
dire : Je mets en vous mon bon plaisir ; et cela signifie J'ai résolu de faire
par vous ce qui me plaît . Dans certaines copies de l'Évangile selon saint Luc
, au lieu de la leçon que nous venons de mettre sous les yeux , on lit cet
oracle du Psalmiste : « Vous êtes mon Fils , je vous ai engendré aujourd'hui
(2) . » Il est vrai qu'on ne montre ces mots dans aucune des copies grecques
les plus anciennes. Mais si quelques exemplaires dignes de foi peuvent
confirmer cette variante, que faut-il conclure , sinon que la voix céleste,
dans un ordre quelconque, a dit l'une et l'autre chose ?
32. Ce que nous lisons dans
l'Évangile selon saint Jean, du Saint-Esprit descendu en forme de colombe ,
n'est pas un discours placé au temps où le fait s'est accompli ; c'est une
citation des paroles du précurseur rappelant lui-même ce qu'il a vu . Or, ce
passage fait naître la question suivante : Comment Jean-Baptiste
155
a-t-il pu dire : « Pour moi , je ne le connaissais pas ;
mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : Celui sur qui tu
verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans le
Saint-Esprit » (1) ? En effet , s'il l'a connu seulement quand il a vu la
colombe descendre sur lui , comment , d'après saint Matthieu, lui disait-il,
avant d'être témoin de ce prodige , et dès qu'il le vit venir au Jourdain pour
se faire baptiser : « C'est moi plutôt qui dois être baptisé par vous (2)? »
Il faut conclure qu'à la vérité Jean-Baptiste le connaissait avant la descente
de la colombe , puisqu'il tressaillit même dans le sein maternel quand Marie
fut venue visiter Elisabeth (3); mais que à son égard, il apprit par cet
événement une chose dont il n'avait pas encore connaissance , c'est que Jésus
seul baptiserait dans le Saint-Esprit en vertu d'une puissance personnelle et
divine ; tandis qu'aucun homme après avoir reçu de Dieu le pouvoir de baptiser
ne pourrait dire eu baptisant qui que ce soit : c'est mon propre bien que je
te communique, ni : Je donne moi-même le Saint-Esprit .
33 . Saint Matthieu ajoute : «
Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert , pour y
être tenté par le démon . Ayant donc jeûné quarante jours et quarante nuits il eut faim
; le tentateur s'approchant
alors lui dit : Si vous êtes
le Fils de Dieu , commandez que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus lui
répondit : Il est écrit : L'homme ne vit pas seulement de pain , mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu ; » et le reste, jusqu'à l'endroit où
nous lisons : « Alors le diable le laissa , et aussitôt les anges
s'approchèrent de lui et le servaient . » Saint Luc raconte également tout
cela , mais dans un ordre différent ; de sorte qu'on ne voit pas ce qui s'est
fait en premier lieu , si d'abord ont été montrés au Sauveur les royaumes de
la terre et qu'ensuite il ait été transporté sur le pinacle du temple, ou si
ce dernier fait a précédé, et que l'autre ait suivi. Mais peu importe dans
quel ordre les choses soient racontées, pourvu qu'on fasse connaître qu'elles
se sont toutes accomplies. Du reste , que
saint Luc rende les mêmes pensées en d'autres termes ,
est-il besoin de rappeler toujours que cela ne nuit en rien à la vérité ?
Quant à saint Marc, il atteste , lui aussi, que Jésus demeura au désert
quarante jours et quarante nuits et y fut tenté par le démon ; mais il ne dit
rien des paroles du démon, ni des réponses de Jésus . Cependant il n'a pas
gardé le silence sur un point négligé par saint Luc, savoir que les anges
vinrent servir le divin Maître (1). Quant, à saint Jean, il a passé sous
silence tout ce qui regarde cette tentation .
34. Le récit de saint Matthieu
continue en ces termes : « Or Jésus ayant appris que Jean-Baptiste avait été
jeté en prison, se retira en Galilée. » C'est ce que disent aussi saint Marc
et saint Luc (2) excepté que saint Luc ne fait ici nulle mention de
l'emprisonnement de Jean-Baptiste. D'après l'évangéliste saint Jean, avant la
retraite de Jésus en Galilée, Pierre et André demeurèrent un jour avec lui et
alors fut donné ce nom de Pierre au premier, qui s'appelait auparavant Simon.
Le même dit encore que le jour suivant, comme Jésus voulait sortir et se
rendre en Galilée, il trouva Philippe et lui commanda de le suivre ; il arrive
de là à raconter aussi ce qui regarde Nathanaël ; puis il dit que le troisième
jour, étant en Galilée, Jésus fit à Cana le miracle du changement de l'eau en
vin (3). Les autres évangélistes ont omis tous ces détails, quand après avoir
rappelé la tentation du Sauveur ils ont parlé de son retour en Galilée. On
doit donc comprendre qu'il y eut un intervalle de quelques jours durant lequel
eut lieu ce que rapporte saint Jean au sujet des disciples. Mais ce qu'il dit
de Pierre n'est pas en opposition avec le passage où plus loin saint Matthieu
raconte que le Seigneur dit à l'Apôtre : « Tu es Pierre et sur cette pierre je
bâtirai man Eglise (4). » Car il faut croire que ce nom lui fut donné, non pas
quand Jésus lui adressa les paroles que nous venons de citer, mais bien quand,
d'après saint Jean, il lui parla ainsi Tu t'appelleras Céphas, c'est-à-dire
Pierre ; » de sorte qu'en lui disant plus tard : « Tu es Pierre, » il
l'appelait par le nom que l'Apôtre portait déjà. En effet, s'il ne lui dit pas
alors: Tu t'appelleras Pierre ; mais : « Tu es Pierre, » c'est
156
qu'il lui avait dit précédemment : « Tu t'appelleras. »
35. Après cela nous lisons
dans le récit de saint Matthieu : « Et Jésus, ayant quitté Nazareth, vint
habiter Capharnaüm, ville maritime sur les frontières de Zabulon et de
Nephtali, » et le reste, jusqu'à la fin du sermon sur la montagne. Saint Marc
lui fait écho dans l'ordre et la suite du récit pour la vocation de Pierre et
d'André, puis, un peu après, de Jacques et de Jean. Mais tandis que saint
Matthieu, aussitôt après avoir parlé de la multitude des malades guéris par
Jésus et des foules nombreuses qui le suivaient, s'applique à reproduire le
long discours du Sauveur sur la montagne, saint Marc interpose d'autres
détails ; à savoir, que Jésus enseignait dans la synagogue de Capharnaüm et
qu'on était éperdument étonné de sa doctrine ; puis il remarque, comme saint
Matthieu le fait après le grand discours sur la montagne, que Jésus enseignait
comme ayant puissance et non comme les scribes et les docteurs de la loi. »
Saint Marc raconte aussi l'histoire de cet homme qui fut délivré d'un esprit
immonde, ensuite la guérison de la belle-mère de Pierre. Pour ces détails le
récit de saint Luc s'accorde avec le sien (1). Saint Matthieu n'a rien dit du
possédé : il n'a parlé que plus loin de la belle-mère de Pierre (2).
36. Mais dans la partie de son
récit que nous considérons maintenant, le même saint Matthieu, après avoir
décrit la vocation des disciples auxquels Jésus ordonna d'abandonner leurs
barques de pêcheurs et de le suivre, rapporte que le Sauveur parcourut la
Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant l'Evangile, guérissant toute
sorte d'infirmités, et que se voyant entouré d'une grande multitude il gagna
le haut d'une montagne où il fit son grand discours. Il donne ainsi lieu de
comprendre que les choses rappelées par saint Marc après l'élection des
disciples dont il s'agit, furent accomplies quand Jésus parcourait la Galilée
et qu'il instruisait dans les synagogues; qu'alors aussi fut guérie la
belle-mère de Pierre ; mais qu'il n'a rapporté que plus loin ces événements,
encore qu'il n'ait pas fait rentrer dans sa narration tout ce qu'il y avait
omis précédemment.
37. Voici cependant une
difficulté. D'après saint Jean, ce fut sur les bords du Jourdain, non en
Galilée, qu'André s'attacha au Seigneur avec un autre dont le nom n'est pas
cité ; que Jésus-Christ
donna à Simon le nom de Pierre, et troisièmement qu'il
appela Philippe à le suivre : tandis que d'après les trois autres Evangélistes,
dont le récit se trouve ici complètement d'accord, d'après surtout saint
Matthieu et saint Marc, André, Simon et les fils de Zébédée étaient occupés à
pêcher sur la mer de Galilée lors qu'ils furent appelés . Si en effet saint
Matthieu et saint Marc rapportent qu'André était dans la même barque que
Simon, saint Luc ne le nomme point , tout en donnant à entendre qu'il y était;
si de plus eux-mêmes n'exposent qu'en peu de mots l'événement, lorsque saint
Luc le présente avec plus de détails; car il rapporte l'histoire de la pèche
miraculeuse et il nous montre le Seigneur adressant de la barque de Simon ses
premières paroles à la multitude;il n'y a là aucune opposition. Une autre
différence serait que d'après saint Luc, le Seigneur dit, seulement à Simon
Pierre: « Dès ce jour tu seras pêcheur d'hommes, » et que suivant les récits
de' saint Matthieu et de saint Marc, il tient ce langage aux deux frères en
même temps. Mais sans nul doute, il est possible que Jésus ait ainsi parlé
d'abord à Pierre, surpris de la quantité de poissons qu'on venait de prendre ;
puis à tous deux. Alors les récits se concilient facilement.
Revenons donc et
appliquons-nous à la difficulté offerte par le texte de saint Jean comparé à
ceux de saint Matthieu, de saint Marc et de saint Luc. On peut la regarder en
effet comme très-sérieuse ; puisqu'il y a une différence notable pour le
temps, le lieu et le fait même de la vocation. Si c'est près du Jourdain, et
avant le départ de Jésus pour la Galilée que sur le témoignage de
Jean-Baptiste les deux disciples, dont l'un était André, suivirent le Sauveur
; si c'est alors, que conduit à Jésus par son frère André, Simon reçut le nom
de Pierre : comment, d'après la leçon des autres Évangélistes, est-ce en
Galilée que Jésus, les trouvant sur leurs barques de pêcheurs, les appela à
devenir ses disciples (1) ? Mais il suffit de supposer que quand ils virent le
Seigneur près du Jourdain, ils ne s'attachèrent pas à lui inséparablement,
mais seulement commencèrent à le connaître, et retournèrent ensuite à leurs
foyers, pleins d'admiration polir sa personne.
38. Aussi bien le même saint
Jean dit-il que les disciples de Jésus crurent en lui à Cana en Galilée, quand
il changea l'eau en vin. Ce qu'il raconte en ces termes : « Or le troisième
jour il
157
y eut des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y
était. Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples (1). » Si ce fut
alors qu'ils crurent en lui, comme l'Évangéliste ledit un peu après, ils
n'étaient pas encore ses disciples quand ils furent conviés aux noces. Mais
l'écrivain sacré emploie ici une manière de parler que nous employons lorsque
nous disons, par exemple, que l'Apôtre Paul reçut le jour à Tarse en de
Cilicie (2), quoique Paul n'ait pas été Apôtre en naissant. Quand donc il dit
que les disciples de Jésus furent conviés aux noces, nous devons par ce nom de
disciples entendre, non pas ce que ces hommes étaient alors, mais ce qu'ils
devaient être ensuite. Sans aucun doute ils étaient disciples de Jésus lorsque
saint Jean raconta et écrivit cet événement ; et c'est pour cette raison qu'en
sa qualité d'historien du passé il leur donne ce titre.
39. « Après cela, continue
saint Jean, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses
disciples : mais ils n'y demeurèrent pas longtemps (3). » On ne sait pas si
alors Pierre, André et les fils de Zébédée lui étaient déjà attachés Car saint
Matthieu rapporte d'abord que Jésus vint habiter à Capharnaüm et ensuite que
les ayant trouvés sur leurs barques occupés à pêcher, il leur commanda de le
suivre ; tandis que, selon saint Jean, les disciples vinrent avec lui à
Capharnaüm. Serait-ce que saint Matthieu rappelle ici un fait que d'abord il
avait omis ? Aussi bien, ne dit-il pas: après cela, comme Jésus marchait sur
le rivage de la mer de Galilée, il vit deux frères. Mais sans exprimer aucun
rapport de temps : « Comme Jésus, dit-il, marchait sur le bord de la mer de
Galilée, il vit deux frères, etc. » Il est donc possible que saint Matthieu,
relate en cet endroit non un fait postérieur à ceux dont le narré précède ;
mais un fait qu'il a omis auparavant de rapporter. Ainsi rien n'empêche de
comprendre que les disciples soient venus à Capharnaüm avec le Sauveur,
puisque, selon saint Jean, il s'y rendit accompagné de sa mère et de ses
disciples. Qu plutôt ne s'agit-il pas d'autres disciples? Car Philippe déjà le
suivait, puisqu'il l'avait précédemment appelé en lui disant Suis-moi ? » En
effet les récits évangéliques ne nous montrent pas quel a été, pour tous les
douze Apôtres, l'ordre de leur vocation ; attendu qu'ils ne mentionnent même
pas la vocation de
tous, mais parlent seulement de celle de Philippe, de
Pierre et d'André, des fils de Zébédée et de Matthieu le publicain, lequel se
nommait aussi Lévi (1): Pierre cependant est le premier et le seul qui ait
reçu en particulier de la bouche de Jésus-Christ un nom nouveau. Car ce ne fut
pas chacun en particulier mais tous deux ensemble, que les fils de Zébédée
reçurent le nom de Fils du tonnerre (2).
40. Du reste observons que l'Evangile
et les livres Apostoliques nomment disciples de Jésus-Christ, non seulement
les douze Apôtres, mais tous ceux qui, croyant au divin maître, étaient par
ses leçons formés au royaume des cieux. C'est parmi eux qu'il en choisit douze
auxquels il donna le nom d'Apôtres. Saint Luc, de qui nous apprenons ce fait,
dit un peu plus bas : « Il descendit ensuite avec eux et s'arrêta dans la
plaine, où il se vit entouré de la foule de ses
disciples et d'une grande multitude de peuple (3). » Assurément
l'Évangéliste n'appellerait pas la réunion de douze hommes,une foule de
disciples. Plusieurs autres passages des Écritures nous montrent avec non
moins d'évidence que le nom de disciples de Jésus appartenait à tous
ceux qui apprenaient de lui, discerent, ce qui regarde la vie
éternelle.
41. Mais on peut demander
comment, d'après les récits de saint Matthieu et de saint Marc, Jésus appela
de leurs barques de pêcheurs, d'abord Pierre et André, puis s'étant avancé
un peu plus loin, les deux fils de Zébédée ; quand, suivant saint Luc,
chacune des barques se trouvant remplie des poissons de la pêche miraculeuse,
Pierre fit signe aux fils de Zébédée, Jacques et Jean, ses compagnons, de
venir l'aider à retirer les filets: et que tous ensemble ils témoignèrent leur
étonnement d'une si grande quantité de poissons, et que tous en même temps
quittant leurs barques ramenées à bord, suivirent le Seigneur, bien qu'à
Pierre seul il eût dit : « A dater de ce jour tu seras un pêcheur d'hommes.»
Il faut donc admettre que le fait rapporté par saint Luc fut antérieur à la
vocation formelle des quatre disciples ; que le Seigneur ne les appela point
dans cette circonstance à le suivre, mais prédit seulement à Pierre que
dorénavant il prendrait des hommes. Ce qui ne voulait pas dire qu'il ne
prendrait jamais plus de poissons; car nous lisons que même après la
résurrection
158
du Sauveur, les Apôtres se livraient encore à la pêche
(1). Si donc Jésus-Christ annonça à Pierre que désormais il prendrait des
hommes, ce ne fut pas pour lui dire qu'il ne prendrait plus de poissons. Ainsi
l'on peut comprendre que les disciples revinrent pêcher selon leur coutume sur
la merde Galilée, et qu'ensuite eut lieu
ce que rapportent saint Matthieu et saint Marc ; c'est-à-dire que le Seigneur
les appela deux à deux, d'abord Pierre et André, puis les fils de Zébédée.
Aussi bien cette fois ils n'amenèrent pas leurs barques à terre comme ayant
l'intention de revenir un autre jour à la pêche, mais ils suivirent
Jésus-Christ comme un maître qui les appelait et leur intimait l'ordre de
s'attacher à lui.
42. Une autre question se
présente. L'Evangéliste saint Jean fait venir Jésus en Galilée avant
l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Car après avoir rapporté que le Sauveur
changea l'eau en vin à Cana de Galilée, puis descendit pour quelques jours à
Capharnaüm.avec sa mère et ses disciples, il nous le montre allant à Jérusalem
pour la fête de Pâque, venant ensuite avec ses disciples habiter et baptiser
dans
la terre de Judée. C'est alors qu'il dit en continuant- son récit : «
Or Jean baptisait lui-même à Ennon près de Salim, parce qu'il y avait là
beaucoup d'eau : plusieurs y venaient,
et y étaient baptisés ; car Jean n'avait
pas encore été mis en prison (2). » Cependant nous lisons
dans saint Matthieu : « Ayant appris que Jean avait été arrêté, Jésus
se retira en Galilée (3). » C'est ce que nous lisons pareillement dans saint
Marc
Après que Jean eut été mis en prison, dit-il, Jésus vint
en Galilée (4). » Saint Luc de son côté, sans faire aucune mention de
l'emprisonnement de Jean-Baptiste, nous dit comme eux, après avoir raconté le
baptême et la tentation de Jésus-Christ, que le Sauveur se retira en Galilée.
Car voici la suite de sa narration : « Le diable ayant fini de le tenter,
s'éloigna de lui pour un temps ; et Jésus, par la vertu de l'Esprit, retourna
en Galilée; et sa réputation se répandit dans tout le pays (5). » On doit
conclure de là non pas que les trois évangélistes contredisent
le récit de saint Jean, mais d'abord qu'ils ont omis de
rappeler.une première apparition du Seigneur en Galilée après son baptême,
alors que le précurseur n'avait pas encore été mis en prison; et secondement
que sans rien dire de cette première démarche signalée parle miracle de Cana,
ils en ont tout de suite rapporté une autre qui suivit l'emprisonnement de
Jean-Baptiste. Saint Jean parle lui-même de cette seconde retraite de Jésus en
Galilée après son baptême. « Jésus donc, dit-il, ayant su que les Pharisiens
avaient appris qu'il faisait plus de disciples et baptisait plus de personnes
que Jean, « bien que Jésus ne baptisât pas, mais ses disciples, quitta la
Judée et s'en alla de nouveau en Galilée (1). » Il nous laisse entendre ici
que dès lors Jean-Baptiste était en prison, mais que les Juifs avaient appris
que Jésus faisait plus de disciples que n'en avait faits Jean, et baptisait
plus de personnes que celui-ci n'en avait baptisées.
43. Voyons maintenant si l'Evangéliste
saint Matthieu ne semble en rien contredit par les autres, au sujet du long
discours que, d'après lui, le Seigneur prononça sur la montagne. Saint Marc n
en dit rie n; il n'a même rien rapporté de semblable, si ce n'est quelques
maximes éparses dans son récit, et que le Seigneur aura répétées en d'autres
lieux. Il nous permet cependant de voir dans le texte de sa narration la place
de ce discours et nous laisse conclure que Jésus-Christ l'a prononcé, mais que
lui-même a omis de le reproduire. « Jésus, dit-il, prêchait dans leurs
synagogues et par toute la Galilée, et il chassait les démons. » Dans cette
prédication de Jésus par toute la Galilée, se trouve compris aussi le discours
qu'il fit sur la montagne, et que rapporte saint Matthieu. Carie même saint
Marc continue ainsi : « Or, un lépreux vint à lui ; le
suppliant et se jetant à genoux il lui dit : Si vous voulez, vous pouvez me
guérit (2) ; et il expose de telle sorte ce qu'il dit
ensuite de la guérison de ce lépreux qu'on doit le reconnaître pour le
même que saint Matthieu dit avoir été guéri, quand, après le discours dont
nous parlons, le Seigneur fut descendu de la montagne. Voici en effet le texte
de saint
1 Jean, IV, 1-3. — 2 Marc, I, 39, 40
159
Matthieu : « Jésus étant descendu de la montagne une
grande multitude de peuple le suivit.Et voilà qu'un lépreux, venant à lui,
l'adorait en disant : Seigneur, si vous voulez,vous pouvez me guérir, » et le
reste (1).
44. Saint Luc a parlé
aussi de ce lépreux (2), non pas au même endroit, mais suivant l'usage
des évangélistes d'exposer certains faits après les avoir d'abord omis, ou
d'anticiper le récit de faits postérieurs, selon le mouvement de l'inspiration
divine qui les portait à n'écrire qu'ensuite en se le rappelant à la mémoire,
ce qui pourtant leur était bien connu : néanmoins le même saint Luc rapporte
aussi du divin maître un long discours qui débute comme celui que nous donne
saint Matthieu. Car dans ce dernier nous lisons : « Bienheureux les pauvres en
esprit, parce que le royaume des cieux est à eux: » et dans l'autre : « Vous
êtes bienheureux, pauvres, parce que le royaume des cieux est à vous. » Le
texte de saint Luc présente ensuite beaucoup d'autres ressemblances , et à la
fin du discours la conclusion est toute pareille ; c'est de part et d'autre la
comparaison prise de l'homme sage qui bâtit sur la pierre ferme, et de
l'insensé qui bâtit sur le sable. Toute la différence est que dans saint Luc,
il n'est parlé que du fleuve qui vient se précipiter contre la maison, tandis
que le récit de saint Matthieu y joint les vents et la pluie. On pourrait
donc très-facilement admettre qu'il s'agit d'un seul et même discours
dans les deux évangélistes; que saint Luc a laissé
de côté certaines pensées rendues par saint Matthieu ; qu'il en a reproduit
d'autres, omises par lui, et qu'il en a aussi présenté plusieurs dont il
exprime semblablement tout le sens et toute la vérité, quelle que soit la
différence des termes.
45. On pourrait, dis-je,
admettre cela très-facilement, si ce n'était que, d'après saint Matthieu, le
Seigneur parle assis sur une montagne, et que d'après saint Luc c'est debout
et dans une plaine. Cette diversité porte donc à penser que ,le discours
rapporté par l'un, n'est pas le discours rapporté par l'autre. Et pourquoi
aussi bien Jésus-Christ n'aurait-il pas répété ailleurs ce qu'il avait déjà
dit, ou fait de nouveau certaines choses qu'il avait déjà faites auparavant ?
Du reste, entre ces deux discours dont l'un est reproduit par saint Matthieu
et l'autre par saint Luc, il n'a pas dû s'écouler beaucoup de temps;
car avant et après les deux évangélistes rapportent des
choses semblables ou parfaitement identiques ; et l'on peut avec raison penser
que leurs récits regardent les mêmes jours et les mêmes lieux. Voici, en
effet, ce que nous lisons dans saint Matthieu: « Et une grande multitude de
peuple le suivit de la Galilée, de la Décapote, de Jérusalem, de la Judée, et
d'au-delà du Jourdain. Or, voyant cette foule, Jésus gagna le haut d'une
montagne; et lorsqu'il s'y fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui ; et
ouvrant la bouche, il les instruisait en disant. Bienheureux les pauvres en
esprit, parce que le royaume des cieux est à eux, » et le reste (1). On peut
croire ici que Jésus voulut échapper à la presse de la multitude ; et qu'alors
il gagna le haut de la montagne, pour s'éloigner de la foule afin de parler à
ses seuls disciples. C'est ce que semble aussi confirmer la narration de saint
Luc. « En ce temps là, dit-il, Jésus alla sur une montagne, pour y prier, et
il y passa toute la nuit en prière. Quand le jour fut venu, il appela ses
disciples et choisit douze d'entre eux qu'il nomma Apôtres, savoir: Simon
auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques et Jean, Philippe
et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques fils d'Alphée et Simon appelé le
zélé, Jude frère de Jacques et Judas Iscarioth, qui fut le traître. Il
descendit ensuite avec eux et s'arrêta dans une plaine où il se vit environné
de la troupe de ses disciples et d'une grande multitude de peuple, accouru de
toute la Judée, de Jérusalem, du pays maritime, de Tyr et de Sidon, pour
l'entendre et pour être guéris de leurs maladies. Ceux d'entre eux qui étaient
possédés d'esprits impurs étaient aussi guéris. Or tout le peuple tâchait de
le toucher, parce qu'il sortait de lui une vertu qui les guérissait tous.
Alors levant les yeux sur ses disciples, Jésus dit : Vous êtes bienheureux,
pauvres, parce que le royaume des cieux est à vous (2). » On peut donc croire
que quand Jésus, sur la montagne, eut choisi parmi tous ses disciples, les
douze Apôtres, détail omis par saint Matthieu, il y prononça le discours que
cet évangéliste a reproduit et dont saint Luc ne parle pas; qu'ensuite, étant
descendu dans la plaine, il fit un autre discours semblable, dont saint
Matthieu ne dit rien, mais dont parle saint Luc : et qu'il les termina tous
deux de la même manière.
160
46. Nous lisons dans le texte
de saint Matthieu immédiatement après le discours du Seigneur : « Jésus ayant
achevé de parler, la foule était dans l'admiration de sa doctrine ; » ceci
peut-être rapporté à la foule des disciples parmi lesquels avaient été choisis
les douze Apôtres. Le même Evangéliste dit un peu plus loin : « Lorsqu'il fut
descendu de la montagne, une grande multitude de peuple le suivit ; et voilà
qu'un lépreux venant à lui l'adorait. » Nous pouvons entendre cela comme ayant
eu lieu non-seulement après le discours que lui-même rapporte, mais après
l'autre que reproduit le texte de saint Luc. Car on ne voit rien qui fasse
connaître quel espace de temps s'écoula entre la descente de la montagne et le
fait relatif au lépreux ; et sans rien insinuer à cet égard, saint Matthieu a
voulu marquer seulement, qu'après être descendu de la montagne le Seigneur
était accompagné d'une grande foule de peuple lorsqu'il guérit le lépreux.
Ceci est d'autant mieux fondé que, suivant saint Luc, Jésus était déjà dans la
ville quand il opéra cette guérison; circonstance que saint Matthieu ne relève
pas.
47. Cependant on pourrait
admettre encore que d'abord le Seigneur était seul avec ses disciples sur la
partie la plus élevée de la montagne, quand parmi eux il choisit les douze
Apôtres; qu'ensuite il descendit, non jusqu'au bas, mais dans un lieu qui est
spacieux, c'est-à-dire une espèce de plaine qui se trouvait au flanc de cette
montagne et qui pouvait contenir une foule nombreuse; qu'il s'arrêta là, y
resta debout attendant que la multitude fût rassemblée autour de lui ;
qu'enfin s'étant assis et les disciples s'étant approchés, il leur fit à eux
et à toute la foule un seul et même discours: discours que saint Matthieu et
saint Luc auront rapporté, non de la même manière, mais sans varier pour le
fond des choses et des pensées reproduites par tous deux. Car déjà nous avons
averti et, en dehors même de tout avertissement, chacun doit voir, qu'il n'y a
pas d'opposition entre deux évangélistes dont l'un omet de dire ce que dit
l'autre ; qu'il n'y en a pas davantage si les expressions sont différentes, du
moment que les mêmes choses et les mêmes pensées s'y retrouvent. De sorte donc
que quand saint Matthieu dit : « Jésus étant descendu de la montagne ; » il
est permis d'entendre qu'il s'agit en même temps de la plaine, qui a pu
s'étendre sur le flanc de cette montagne. Vient encore l'histoire du lépreux
guéri, que rapportent également saint Matthieu, saint Marc et saint Luc.
48. Saint Matthieu poursuit
ainsi : « Lorsqu'il fut entré dans la ville de Capharnaüm, un centurion
s'approcha de lui et lui fit cette prière: Seigneur, mon serviteur gît
paralytique dans ma maison et il souffre extrêmement; » et le reste jusqu'à
l'endroit où nous lisons: « Et à l'heure même son serviteur fut guéri (1).»
Saint Luc de son côté rapporte cet événement, relatif au serviteur du
centurion, non, comme saint Matthieu, après avoir parlé de la guérison du
lépreux dont il fait plus tard le récit, mais immédiatement après l'exposition
du long discours sur la montagne. « Jésus, dit-il, ayant achevé de faire
entendre toutes ces paroles aux oreilles du peuple, entra dans Capharnaüm. Or,
il. y avait là un Centurion dont le serviteur qui lui était cher était fort
malade et près de mourir, » et le reste, jusqu'à l'endroit où nous voyons ce
serviteur guéri (2). Entendons ici qu'à la vérité Jésus entra dans la ville de
Capharnaiim après avoir achevé d'adresser au peuple toutes ses paroles,
c'est-à-dire qu'il n'y entra pas avant d'avoir fini de parler; mais que l'Evangéliste
ne marque point l'intervalle de temps compris entre le discours du Seigneur et
son entrée à Capharnaüm. Dans cet intervalle fut guéri le lépreux dont saint
Matthieu fait l'histoire en son lieu, et que saint Luc rappelle plus tard.
49. Voyons actuellement si les
deux évangélistes sont d'accord entre eux au sujet de ce serviteur du
Centurion. Voici comme parle saint Matthieu : « Un centurion s'approcha de
lui, le priant et disant : Mon serviteur gît paralytique dans ma maison. » Or
saint Luc paraît le contredire : « Ce centurion, dit-il, ayant entendu parler
de Jésus, lui envoya des anciens d'entre les Juifs pour le prier de venir
guérir son serviteur. Etant donc venus trouver Jésus, « ces anciens le
suppliaient instamment et lui disaient: Il mérite que vous fassiez cela pour
lui. Il aime en effet notre nation, et il nous a même bâti une synagogue.
Jésus s'en alla donc avec eux, et comme il n'était plus loin de la maison, le
Centurion envoya de ses
amis pour lui dire de sa part : Seigneur, ne vous donnez
point tant de peine, car je ne suis pas digne que vous entriez chez moi. C'est
pourquoi je ne me suis pas jugé digne d'aller vous trouver; mais dites
seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Si la chose a eu lieu de
cette sorte, où est la vérité dans ces mots de saint Matthieu : « Un centurion
s'approcha de lui, » puisqu'il ne vint pas lui-même le trouver, mais lui
envoya ses amis ? Ne faut-il pas qu'une observation attentive nous fasse
comprendre que saint Matthieu a employé ici une figure de langage assez
habituelle? Car, non-seulement nous disons de quelqu'un qu'il s'approche,
avant même qu'il arrive près de l'objet dont, il est dit s'approcher; et de là
les expressions: il s'approche peu, ou , il s'approche beaucoup du but qu'il
veut atteindre : mais de plus, nous disons ordinairement qu'on est parvenu
près de quelqu'un, (et l'on ne s'approche que pour parvenir,) bien qu'on ne le
voie pas soi-même, quand on arrive, par l'intermédiaire d'un ami, près de
quelqu'un dont on recherche la faveur. Cette forme de langage a tellement
prévalu, que l'on dit vulgairement d'un homme, qu'il est parvenu jusqu'à
certains personnages puissants, quand avec les manœuvres de l'ambition et au
moyen de ceux qui les entourent, il a pu agir sur leur esprit, dont l'accès
lui était en quelque sorte fermé. Si donc nous disons communément qu'on
parvient soi-même, quand on parvient par autrui; à combien plus forte raison
peut-on s'approcher par d'autres, puisque d'ordinaire on n'avance pas autant
en s'approchant qu'en parvenant ; car il est possible qu'on s'approche
beaucoup, sans toutefois parvenir. Le centurion s'étant donc approché du
Seigneur, par l'intermédiaire des anciens, saint Matthieu a pu dire pour
abréger: « Un centurion s'approcha de lui. » C'est une façon de parler que
tout le monde est capable d'entendre.
50. Il ne faut pas du reste
négliger de considérer la vérité profonde que révèle dans le sens mystique le
langage du saint Évangéliste et qu'expriment ces paroles d'un Psaume : «
Approchez-vous de lui, et vous serez éclairés (1). » Aussi bien, la foi du
centurion ayant été l'objet de ce magnifique éloge du Sauveur : « Je n'ai
point trouvé une si grande foi dans Israël ; » l'Évangéliste a voulu dire qu'à
raison de cette vertu qui nous approche
véritablement de Jésus, le centurion s'était plutôt
lui-même approché de lui que ceux qu'il avait chargés de lui présenter sa
requête. Quant à saint Luc, s'il a expliqué comment tout s'est passé, c'est
pour nous faire comprendre dans quel sens saint Matthieu, également
infaillible, a dit que le centurion s'était approché de Jésus. C'est ainsi
qu'en touchant seulement la frange du vêtement du Sauveur, l'hémorroïsse le
toucha mieux que la foule dont il était pressé (1). De même donc qu'elle
toucha d'autant plus le Seigneur qu'elle avait plus de foi en lui, ainsi le
centurion s'approcha d'autant plus de Lui que sa foi fut plus vive. A quoi bon
maintenant discuter les particularités que l'un des évangélistes relève et que
l'autre néglige dans ce passage, puisque selon la règle établie précédemment,
on n'y trouve aucune opposition entre les deux récits ?
51. Saint Matthieu continue
ainsi : « Jésus étant venu dans la maison de Pierre, vit sa belle-mère gisante
et travaillée de ta fièvre ; il lui toucha la main et la fièvre la quitta ;
puis se levant elle se mit à les servir (2). » Saint Mathieu n'indique pas en
quel temps, c'est-à-dire, après quoi ni avant quoi ce fait eut lieu. Carde ce
qu'une chose soit racontée à la suite d'une autre, on n'est pas obligé de
conclure qu'elle s'est accomplie immédiatement après. On voit bien cependant
qu'ici l'Évangéliste rappelle une oeuvre qu'il a omis de mentionner plus haut.
Car saint Marc raconte le même fait (3), avant de rapporter la guérison du
lépreux, qui dans son Evangile semble venir après le discours du Seigneur sur
la montagne, quoiqu'il n'ait point parlé de ce discours. Aussi saint Luc parle
de la belle-mère de Pierre, après avoir rapporté le même fait que saint Marc
(4), et avant d'arriver à ce long discours qu'il a reproduit, et dans lequel
il est permis de. voir celui qui, selon saint Matthieu, fut prononcé sur la
montagne. Mais qu'importe à un fait d'être relaté soit à sa place naturelle,
soit avant soit après qu'il a été accompli, pourvu que l'historien ne soit en
contradiction ni avec lui-même ni avec un autre, qu'il s'agisse du même fait
ou de faits différents ? Il n'est au pouvoir de personne de
162
fixer toujours l'ordre de ses souvenirs à l'égard même de
ce qu'il tonnait le mieux; car une chose ne revient pas plus tôt ou plus tarda
l'esprit selon la volonté de l'homme, mais suivant l'inspiration qu'il reçoit.
Il est donc assez probable que chacun des évangélistes a cru devoir écrire les
faits à mesure qu'il plaisait à Dieu de les lui remettre en mémoire; ce qu'il
faut entendre uniquement des faits dont l'ordre, quel qu'il soit, ne nuit en
rien à l'autorité ni à la vérité de l'Évangile.
52. Pourquoi l'Esprit-Saint,
qui distribue à chacun ses dons comme il veut (1), qui par conséquent et sans
aucun doute, gouverne et dirige aussi l'intelligence et les souvenirs des
auteurs sacrés dans la rédaction de Livres destinés à jouir d'une si haute
autorité, a-t-il permis que l'un ordonnât son récit . de telle manière et
l'autre de telle autre ? Quiconque en recherchera la raison avec attention et
piété, pourra la trouver moyennant l'aide de, Dieu. Cette question cependant
est étrangère au plan. d'un ouvrage où nous nous proposons seulement de
montrer que chaque évangéliste n'est en contradiction ni avec lui-même ni avec
les autres, quel que soit l'ordre que chacun ait pu ou voulu suivre en
rapportant les mêmes actes et les mêmes paroles, ou des paroles et des actes
différents. Ainsi donc, quand la suite des temps n'est point marquée, nous ne
devons pas nous préoccuper de l'ordre suivant lequel un évangéliste a disposé
son récit: dans le cas contraire, si quelque chose parait le mettre en
opposition avec lui-même ou avec un autre, alors il faut examiner et résoudre
la difficulté.
53. Saint Matthieu poursuit en
ces termes: « Or, le soir étant venu, on lui présenta plusieurs possédés, et
d'une parole il chassait les démons ; et il guérit tous ceux qui étaient
malades ; de sorte que s'accomplit cet oracle du prophète : Isaie : Lui-même a
pris nos infirmités et il s'est chargé de nos langueurs (2).» Quand il dit :
« Le soir étant venu , » l'évangéliste montre assez clairement que les choses
dont il parle ont eu lieu le même jour que la guérison dont il vient de
parler. Saint Marc également, après avoir dit de la belle-mère de Pierre,
guérie par le Sauveur,
qu'elle se mit à les servir, » continue ainsi Le soir
venu, lorsque le soleil fut couché, on lui amena tous les malades et tous les
possédés ; « et toute la ville était assemblée à la porte ; et il guérit
beaucoup de malades affligés de diverses infirmités, et il chassait beaucoup
de démons mais il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils le
connaissaient. Et s'étant levé de grand matin, il sortit et s'en alla dans un
lieu désert (1). Comme après avoir dit: « Le soir venu, » il ajoute Et s'étant
levé de grand mâtin, » saint Marc parait avoir en cet endroit gardé l'ordre
chronologique. Sans doute il n'est pas nécessaire, lorsqu'il est parlé du
soir, d'entendre le soir du même jour ; ni, lorsqu'il . est parlé du matin,
d'entendre le matin de la même nuit : cependant l'ordre chronologique peut
avoir été conservé ici, puisque l'évangéliste a soin de le marquer. Saint Luc
de son côté, après avoir écrit ce qui regarde la belle-mère de Pierre ne dit
pas : « Le soir venu; » mais, ce qui exprime la même idée : « Quand le soleil
fut couché, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités,
les lui amenèrent, et imposant les mains sur chacun de ces malades, il les
guérissait. Les démons sortaient aussi de plusieurs, criant et disant : Vous
êtes le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et, les empêchait de dire qu'ils le
reconnaissaient pour le Christ. Lorsque le jour fut venu, il sortit et s'en
alla dans un lieu désert (2). » L'ordre des temps est présenté tout-à-fait de
la même manière que dans saint Marc. Quant à saint Matthieu, qui semble avoir
raconté la guérison de la belle-mère de Pierre, non dans l'ordre où le fait a
eu lieu, mais suivant l'ordre de ses souvenirs et comme une chose d'abord
oubliée ; après le récit des événements qui ont encore signalé le soir du même
jour, il ne parle pas du matin suivant, mais sa narration continue ainsi : «
Jésus se voyant environné d'une grande multitude de peuple, commanda de passer
à l'autre bord du lac. » Ce n'est plus ce que nous offrent après les mêmes
détails le texte de saint Luc et celui de saint Marc, où est exprimée cette
succession du soir et du matin. Quand donc saint Matthieu dit : « Jésus se
voyant entouré d'une grande multitude de peuple, commanda de passer à l'autre
bord du lac; » nous devons entendre que c'est encore un autre fait dont le
souvenir lui revient et qui s'est accompli un jour quelconque.
163
54. On lit ensuite dans saint
Matthieu : « Or, un docteur de la loi s'étant approché, lui dit : Maître, je
vous suivrai en quelque lieu que vous alliez ; » et le reste, jusqu'à la
réponse du Seigneur: « Laisse les morts ensevelir leurs morts (1). » C'est ce
que raconte également saint Luc ; toutefois .après beaucoup d'autres détails
et, sans exprimer l'ordre des temps, mais à la manière d'un homme qui suit la
marche de ses souvenirs, et sans qu'on voie s'il reprend ce qu'il avait
d'abord omis , ou s'il expose d'avance un événement postérieur à ceux qu'il
rapporte ensuite . Voici comme il parle : « Tandis qu'ils marchaient sur le
chemin, un homme dit à Jésus : Je vous suivrai partout ou vous irez . » La
réponse du Seigneur à cet homme est tout-à-fait la même que dans saint
Matthieu . Il est vrai que selon celui-ci la chose arrive quand Jésus vient de
dire qu'il faut passer à l'autre bord du lac ; et que d'après saint Luc c'est
quand Jésus et ses disciples marchent sur le chemin . Mais il n'y a pas de
contradiction ; car il fallut marcher sans doute pour venir au lac .
De même, à l'égard de celui
qui demande la permission d'aller d'abord ensevelir son père, les deux
évangélistes s'accordent parfaitement . Qu'importe en effet, pour le sens ,
que saint Matthieu place la demande de cet homme avant ces paroles de Jésus .
« Suis-moi ; » et que saint Luc nous fasse lire les mêmes paroles du Sauveur :
« Suis-moi; » avant cette même demande ? Au rapport de saint Luc un autre
vient encore dire à Jésus : « Seigneur , je vous suivrai ; mais permettez-moi
d'aller auparavant renoncer à ce qui est dans ma maison . » Saint Matthieu
n'en parle pas . Dès lors saint Luc passe à autre chose que ce qui viendrait
selon l'ordre du temps. « Après cela, dit-il, le Seigneur choisit encore
soixante-douze nouveaux disciples (2). » Il déclare que c'est après -cela:
mais il n'indique pas le temps qui s'est écoulé jusqu'à l'élection dont il
s'agit. Durant l'intervalle cependant ont eu lieu les faits que rapporte
ensuite saint Matthieu. Car cet évangéliste, qui continue ici sa narration
suivant l'ordre des temps, ajoute
55 . « Jésus entra dans la
barque, suivi de ses disciples . Et aussitôt s'éleva sur la mer une grande
tempête ; » et le reste, jusqu'à l'endroit où il est dit que « Jésus repassa
le lac et vint dans sa ville . » Les deux faits que saint Matthieu raconte à
la suite l'un de l'autre, le miracle de la tempête apaisée tout-à-coup sur
l'ordre de Jésus éveillé par les disciples, et la délivrance de ces hommes
que; possédait un démon cruel , qui brisaient leurs liens et fuyaient au
désert, se trouvent racontés semblablement dans saint Marc et dans saint Luc
(1). Quelques pensées sont rendues en termes différents , mais elles ne
laissent pas d'être les mêmes . Ainsi quand saint Matthieu rapporte que le
Seigneur dit aux disciples : « Pourquoi craignez-vous, hommes de peu de foi ?
» nous lisons dans saint Luc : « Où est votre foi ? » et dans saint Marc : «
Pourquoi craignez-vous? n'avez-vous pas encore la foi? » cette foi parfaite ,
semblable au grain de sénevé ? C'est une autre manière de dire : « Hommes de
peu de foi . » Du reste le Seigneur put bien prononcer toutes ces paroles : «
Pourquoi craignez-vous ? Où est votre foi ? Hommes de
peu de foi; » et alors chacun des trois évangélistes en rapporte ce que
nous voyons dans son récit . Quant aux disciples qui éveillaient le divin
Maître , saint Matthieu les fait ainsi parler : « Seigneur , sauvez-nous ;
nous périssions; » et saint Marc : « Maître, n'avez-vous point souci que nous
périssions ? » et saint Luc : « Maître , nous périssons. » C'est encore ici
une seule et même pensée ; c'est le cri d'hommes qui éveillent le Seigneur et
qui veulent être sauvés. Il est inutile de rechercher quelle leçon doit être
préférée comme reproduction littérale da langage des disciples . Que ce soit
en effet l'une ou l'autre , ou bien que ce ne soit ni l'une ni l'autre , mais
des paroles équivalentes pour le sens et qu'aucun évangéliste n'a citées ,
cela peut-il nuire à la vérité des récits ? D'ailleurs il est encore permis de
supposer que , venant tous ensemble éveiller Jésus , les uns lui dirent :
Seigneur, sauvez-nous , nous
périssons , » d'autres : « N'avez-vous point souci que nous périssions
? » d'autres enfin : « Maître, nous
164
périssons . » Que saint Matthieu leur fasse dire ensuite,
quand la tempête fut apaisée: « Quel est celui-ci, puisque les vents et la mer
lui obéissent? » et saint Marc : « Qui, pensez-vous, « est celui-ci, puisque
les vents et la mer lui obéissent? » et saint Luc : « Qui, pensez-vous, est
celui-ci, qui commande aux vents et à la mer et qui s'en fait obéir? » tout le
monde ne voit-il pas dans les trois textes un seul et même sens? « Qui,
pensez-vous, est celui-ci » et « quel est celui-ci, » sont des exclamations
tout-à-fait semblables; et si l'idée de commandement n'est pas formellement
exprimée dans saint Matthieu ni dans saint Marc, elle se révèle par une
conséquence nécessaire; car obéir c'est exécuter un commandement.
56 . Mais d'après saint
Matthieu il y avait deux hommes possédés de cette légion infernale à laquelle
il fut permis d'entrer dans les pourceaux; tandis que saint Marc et saint Luc
ne parlent que d'un seul. Comprenons que l'un des deux était un personnage
plus fameux et plus renommé , dont le pays déplorait extrêmement le malheur ,
et au salut duquel chacun s'intéressait beaucoup . Pour faire connaître cette
circonstance saint Marc et saint Luc auront jugé à propos de ne,faire mention
que de celui des deux malades dont on parlait davantage et bien plus au soin .
Si les paroles des démons se trouvent encore diversement rapportées par les
évangélistes , il n'y a pas non plus matière à difficulté, car elles peuvent
être dans chaque récit ramenées au même sens ; il est même permis d'admettre
que toutes ont été prononcées . Il ne faut pas se préoccuper de ce que,
d'après saint Matthieu, le possédé parle au pluriel, et au singulier d'après
saint Marc et saint Luc . Car ces derniers nous disent eux-mêmes qu'interrogé
par le Sauveur il déclara s'appeler légion , parce qu'il y avait avec lui un
grand nombre de démons . Enfin si saint Marc dit que les pourceaux paissaient
aux environs de la montagne , et saint Luc sur la montagne , il n'y a pas non
plus contradiction . Le troupeau était considérable ; au rapport de saint
Marc; il comprenait jusqu'à deux mille pourceaux . Une partie alors était sur,
la montagne et une autre dans la plaine environnante .
57. On lit donc ensuite dans
saint Matthieu, qui en cet endroit continue à garder l'ordre des temps : «
Jésus montant sur une barque repassa le lac et vint dans sa cité. Et voilà
qu'on lui présenta un paralytique, » et le reste, jusqu'à ces mots. « Or le
peuple, témoin du fait, fut rempli de crainte et rendit gloire à Dieu de ce
qu'il avait donné unetelle puissance aux hommes (1). » Saint Marc et saint Luc
ont également raconté l'histoire de ce paralytique. Si le Seigneur, d'après
saint Matthieu, dit: « Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis, » et
si d'après saint Luc, au lieu de dire : mon fils, il dit ô homme, » c'est pour
faire mieux ressortir sa pensée, car c'était à l'homme qu'il remettait les
péchés, et cet homme ne pouvait dire comme homme: Je n'ai point péché ;
c'était aussi pour faire entendre que celui qui remettait les péchés à cet
homme était Dieu même. Saint Marc a écrit comme saint Matthieu: « Mon fils,
tes péchés te sont remis; » mais on ne trouve pas dans son récit : « Aie
confiance. » Il se peut encore que le Seigneur ait dit en même temps Aie
confiance, ô homme ; tes péchés te sont remis , mon fils ; ou bien : Aie
confiance , mon fils ; tes péchés te sont remis , ô homme ; ou enfin que ses
paroles se soient suivies autrement .
58. Mais voici certainement
matière à une difficulté. Au sujet du paralytique, nous lisons dans saint
Matthieu : « Jésus montant sur une barque repassa le lac et vint dans sa cité.
Et voilà qu'on lui présenta un paralytique couché sur un lit. » Si par la cité
de Jésus on doit entendre Nazareth, d'après saint Marc, cependant , le fait
dont il s'agit eut lieu à Capharnaüm. « Après quelques jours, dit-il , Jésus
revint à Capharnaüm ; et quand on eut appris qu'il était dans la maison, il
s'y assembla une telle quantité de monde, que l’espace même en dehors de la
porte ne pouvait contenir la multitude , et il leur prêchait la parole de Dieu
. Alors on vint lui amener un paralytique qui était porté par quatre hommes.
Et comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule , ils
découvrirent le toit à l'endroit où il était; et par l'ouverture ils
descendirent le lit sur lequel le paralytique était couché . Or Jésus , voyant
leur foi, » etc. (2). Saint Luc ne parle pas du lieu de l'événement : « Un
jour, dit-il , comme Jésus était assis pour enseigner, étaient assis aussi des
Pharisiens et des docteurs de la loi , venus de tous les
villages de la Galilée et de la Judée ainsi que de la
ville de Jérusalem et la vertu du Seigneur agissait pour la guérison des
malades. En ce même temps quelques personnes, portant. sur un lit un homme qui
était paralytique, tâchaient de le faire entrer et de le déposer devant lui.
Mais ne trouvant point de passage à cause de la foule du peuple, ils montèrent
sur le toit et le descendirent par les tuiles au milieu de l'assemblée devant
Jésus; qui , voyant leur foi dit : O homme , tes péchés te sont. remis (1). »
Reste donc à voir comment on peut concilier saint Marc et saint Matthieu ;
puisque saint Matthieu dit que le fait se passa dans la cité de Jésus et que
d'après saint Marc ce fut à Capharnaüm . La difficulté serait autrement grave
si saint Matthieu avait nommé Nazareth . Mais il a bien pu appeler cité de
Jésus la Galilée elle-même où Nazareth était située. En effet, on appelle cité
Romaine tout l'empire, qui comprend tant de villes . De plus, lin prophète
donne le nom de cité à l'Eglise répandue par toutes les nations , quand il
dit : « On a publié de toi des choses admirables, cité de Dieu (2). » L'Ecriture
même nomme maison d'Israël le premier peuple de Dieu, qui habitait cependant
un si grand nombre de villes (3). Ne voit-on pas alors que ce fut dans sa cité
même que Jésus opéra le miracle dont il s'agit , quand il l'opéra à Capharnaüm
ville de Galilée, où il était revenu du pays des Géraséniens lorsqu'il repassa
le lac ? Quelle que fût la ville de son séjour en Galilée , on pouvait
justement dire qu'il était dans sa cité ; à plus forte raison quand il se
trouvait à Capharnaüm, qui dominait les autres villes de la province ail point
d'en être comme la métropole . Si cependant rien n'autorisait à prendre pour
la cité de Jésus-Christ, soit la Galilée elle-même, où était située Nazareth,
soit la ville de Capharnaüm, qui était comme la capitale des villes de
Galilée; nous dirions que saint Matthieu a omis le récit de ce qui se passa
depuis le retour de Jésus dans sa cité jusqu'à son arrivée à Capharnaüm, et
qu'il a rapporté aussitôt la guérison du paralytique ; comme font souvent les
évangélistes qui négligent , sans en avertir , certains faits intermédiaires ,
et semblent laisser croire que les autres ont suivi immédiatement.
59. Saint Matthieu continue
ainsi : « Jésus sortant de là vit un homme nommé Matthieu, qui était assis au
bureau des impôts, et il lui dit : Suis-moi. Aussitôt il se leva et le suivit
(1). » Saint Marc gardant le même ordre raconte aussi ce fait après la
guérison du paralytique : « Jésus, dit-il, étant sorti pour aller du
côté de la mer, tout le peuple
venait à lui ; et il les instruisait. Et lorsqu'il passait, il vit
Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts et il lui dit : Suis-moi. Cet
homme se leva aussitôt et le suivit (2).» Point contradictoire; le même homme
s'appelle à la fois Matthieu et Lévi. C'est encore après la guérison du
paralytique que saint Luc expose le même fait : « Après cela, « dit-il, Jésus
sortit et voyant un publicain nommé Lévi assis au bureau des impôts, il lui
dit Suis-moi. Et quittant tout Lévi se leva et le
suivit (3). » Ce qui porte à croire que saint Matthieu
rapporte ce t'ait comme un fait omis précédemment, c'est qu'on doit regarder
sa vocation comme antérieure au discours prononcé sur la montagne. Car au dire
de saint Luc, les douze que Jésus avait choisis dans le nombre de ses
disciples et qu'il avait appelés Apôtres, se trouvaient tous avec lui sur
cette montagne (4).
60. Saint Matthieu poursuit
ainsi : « Or il arriva que Jésus étant à table dans la maison, beaucoup de
publicains et de gens de mauvaise vie vinrent s'y asseoir avec lui et avec ses
disciples, » etc, jusqu'à l'endroit où nous lisons : « Mais on met le vin
nouveau dans des outres neuves, et tous deux se conservent (5).» Ici
l'évangéliste ne dit pas dans la maison de qui Jésus mangeait avec des
publicains et des pécheurs. On pourrait croire alors que son récit ne présente
pas ce fait dans l'ordre chronologique et qu'il s'agit d'un fait arrivé dans
un autre temps et dont le souvenir lui revient. Mais saint Marc et saint Luc,
qui le racontent absolument de même, déclarent que Jésus était à table chez
Lévi ou Matthieu, le nouveau disciple, et que là fut dit tout ce qui suit. Car
à ce sujet, voici en
166
effet le texte de saint Marc : « Et il arriva, dit-il, en
gardant le même ordre, que Jésus étant à table dans la maison de cet homme
beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie
y étaient avec lui et avec ses disciples (1). » Quand il dit « dans la
maison de cet homme, » il désigne évidemment celui dont il vient de parler,
c'est-à-dire Lévi. Ainsi encore, saint Luc, après ces mots: « Jésus lui dit :
Suis-moi; et quittant tout, il se leva et le suivit; » ajoute aussitôt : « Et
Lévi lui lit un grand festin dans sa maison, où il se trouva un grand nombre
de publicains et d'autres gens qui étaient avec eux à table (2).» On sait donc
clairement dans quelle maison tout cela se passa.
64. Voyons maintenant,
rapportées d'après les trois évangélistes, les paroles qui furent adressées au
Seigneur et les réponses qu'il y fit : « Témoins de tout cela, dit
saint Matthieu, les Pharisiens disaient à ses disciples : Pourquoi votre
maître mange-t-il avec des publicains et des pécheurs? » Sauf deux mots de
plus, cette question a été rapportée de la même manière par saint Marc: «
Pourquoi votre maître mange-t-il et boit-il avec des publicains et des
pécheurs ? » Saint Matthieu n'a donc pas reproduit les mots : « et boit-il, »
que nous trouvons dans le texte de saint Marc ; mais qu'importe, puisque dans
saint Matthieu le sens est complet et donne pareillement l'idée de convives ?
Le récit de saint Luc parait offrir un peu plus de différence : « Or, dit-il,
les Pharisiens et leurs Scribes murmuraient, et ils disaient aux disciples de
Jésus: D'où vient que vous mangez et buvez avec des publicains et des pécheurs
? » Il ne veut pas sans doute nous faire entendre que ce discours ne regardait
pas le divin Maître, mais il veut montrer que le reproche était en même temps
dirigé contre le maître et contre les disciples; que cependant les.paroles
n'étaient directement adressées qu'aux seuls disciples. Aussi bien, cet
évangéliste rapporte lui-même que le Seigneur répondit: « Je ne suis pas venu
appeler les justes, mais les pécheurs à la pénitence. » Une pareille réponse
n'aurait pas eu de raison, si les mots « vous mangez et vous buvez, »
n'eussent principalement regardé le Sauveur. Si donc, d'après saint Matthieu
et saint Marc, on formule devant les disciples un reproche qui s'adresse au
Maître, c'est parce qu'en s'appliquant aux disciples on le fait tomber plus
vivement sur
le maître dont la vie était la règle de la leur. Ainsi la
pensée est la même, et d'autant mieux exprimée, qu'il y a, sans préjudice de
la vérité, certaines différences dans les termes. Ainsi encore, quand saint
Matthieu rapporte que le Seigneur répondit : « Ce ne sont pas ceux qui se
portent bien, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecin ; allez donc
et apprenez ce que veut dire ceci : J'aime mieux la miséricorde que le
sacrifice ; car ce sont les pécheurs et non les justes que je suis venu
appeler; » saint Marc et saint Luc exposent la même pensée à-peu-près dans les
mêmes termes, sauf que ni l'un ni l'autre ne relèvent ce témoignage emprunté
au prophète : « J'aime mieux la miséricorde que le sacrifice. » Saint Luc,
après avoir écrit : « Je ne suis pas venu
appeler les justes, mais les pécheurs, » ajoute les mots : « à la pénitence. »
Ce qui sert à faire mieux ressortir la pensée et empêche de supposer que les
pécheurs soient, comme pécheurs, aimés de Jésus-Christ. Car la comparaison
même, établie entr'eux et les malades, montre bien que Dieu veut, en les
appelant comme un médecin appellerait des malades, les guérir de leur iniquité
comme d'une maladie, et c'est ce qui a lieu par la pénitence.
62. Saint Matthieu dit
ensuite: « Alors des disciples de. Jean s'approchèrent et lui dirent Pourquoi
les Pharisiens et nous jeûnons-nous fréquemment, tandis que vos disciples ne
jeûnent point? » Saint Marc dit pareillement: « Or les disciples de Jean et
les Pharisiens étaient dans l'usage de jeûner. Plusieurs donc vinrent dire à
Jésus Pourquoi les disciples de Jean et ceux des Pharisiens jeûnent-ils,
tandis que les vôtres ne jeûnent pas ? » Il n'y a point de différence ;
seulement saint Matthieu fait parler uniquement les disciples de Jean, au lieu
que d'après saint Marc, les Pharisiens étaient avec eux pour adresser à Jésus
la même question. Mais les paroles que nous lisons dans le texte de saint Marc
paraissent plutôt avoir été prononcées par d'autres que par ceux qu'elles
concernent. Ainsi, quelques uns des convives s'approchant du Sauveur lui
auraient objecté que les disciples de Jean et les Pharisiens avaient coutume
de pratiquer le jeûne. Alors ceux dont l'évangéliste dit : « Plusieurs
vinrent, » ne seraient plus ceux dont il a parlé en disant : « Or les
disciples de Jean et les Pharisiens jeûnaient; » mais des hommes qui, frappés
de l'opposition qu'ils voyaient entre l'usage de ceux-ci (167) et la conduite
des disciples de Jésus, se mirent à dire : « Pourquoi les disciples de Jean et
ceux des Pharisiens jeûnent-ils, tandis que les vôtres ne jeûnent pas ? »
C'est ce que nous fait mieux comprendre encore le récit de saint Luc. Car,
après avoir reproduit les réponses du Seigneur aux Scribes et aux Pharisiens
sur la vocation des pécheurs comparés à des malades, il ajoute : « Mais alors
ils lui dirent : Pourquoi les disciples de Jean aussi bien que ceux des
Pharisiens font-ils des jeûnes fréquents et de longues prières, tandis que les
vôtres boivent et mangent ? » On voit que, comme saint Marc, cet évangéliste
rapporte ce discours comme prononcé par d'autres que ceux dont il fait
mention. D'où vient donc que nous lisons dans saint Matthieu : « Alors des
disciples de Jean s'approchèrent et lui dirent : Pourquoi observons-nous des
jeûnes fréquents, les Pharisiens et nous ? » sinon parce qu'il y avait là des
disciples de Jean, et que tous à l'envi, et chacun selon son pouvoir,
faisaient au Seigneur la même objection ? Les trois évangélistes ont énoncé la
pensée commune dans un langage différent, mais toujours conforme à la vérité.
63. Saint Matthieu et saint
Marc ont aussi l'un comme l'autre parlé des fils de l'époux qui ne jeûneront
pas, tant que l'époux est avec eux. Seulement au lieu de dire comme saint
Matthieu les fils de l'époux, » saint Marc dit : « les enfant, des noces. »
Mais qu'importe au sens, puisque les enfants des noces sont à la fois les fils
de l'époux et ceux de l'épouse ? Ce n'est donc pas chez lui une pensée
contraire, mais c'est la même pensée qu'il exprime plus amplement. Saint Luc
ne dit pas : « Est-ce que vous pouvez faire jeûner les fils de l'époux, tandis
que l'époux est avec eux ? » Ici donc lui aussi exprime avec justesse la même
pensée ; mais il fait de plus entendre autre chose. On entrevoit en effet
qu'en mettant eux-mêmes l'époux à mort, les interlocuteurs devaient plonger
les amis dans le jeûne et dans les larmes. Le mot pleurer dans le texte de
saint Matthieu a le même sens que le terme jeûner dans saint Marc et dans
saint Luc, puisque saint Matthieu écrit un peu après : « Alors ils jeûneront,
» et non pas : « Alors ils pleureront. » Mais par ce mot, il a fait entendre
que le Seigneur parlait du jeûne spécial qu'inspirent l'humiliation et
L'affliction, et que les comparaisons suivantes, empruntées à l'étoffe neuve
et au vin nouveau et reproduites également par saint Marc et par saint Luc,
désignent cet autre jeûne auquel porte la joie de l'esprit attaché aux choses
spirituelles, dont la douceur lui imprime une sorte d'aversion pour les
aliments corporels ; jeûne qui ne convient pas à l'homme animal et charnel,
tout occupé de son corps, par là même toujours esclave de ses anciennes
passions. Il est inutile, sans doute, de redire ici que deux évangélistes ne
sont pas en contradiction, si l'on trouve dans l'un certaines expressions ou
même certains détails que l'autre a négligés, du moment que le fond est le
même ou qu'une pensée n'est pas opposée à l'autre.
64. Saint Matthieu gardant
toujours l'ordre chronologique continue ainsi : « Comme il leur disait ces
choses, un prince de la synagogue l'aborda et l'adora en disant : Seigneur, ma
fille vient de mourir ; mais venez, imposez- lui les mains, et elle vivra ; »
et le reste, jusqu'à l'endroit où l'évangéliste nous fait lire : « Et la
petite se leva, et le bruit de cet événement se répandit aussitôt dans tout le
pays (1). » Le fait est également raconté par saint Marc et saint Luc, mais
non dans le même ordre. Ils s'en souviennent et l'exposent dans un autre
endroit, c'est-à-dire après nous avoir montré Jésus repassant le lac et
revenant du pays des Géraséniens, où il avait chassé les démons et leur avait
permis d'entrer dans des pourceaux. En effet, saint Marc rapporte ce fait
après avoir relaté ce miracle opéré chez les Géraséniens : « Lorsque Jésus,
dit-il, eut repassé le lac sur une barque, et qu'il a était encore auprès de
la mer, une grande a multitude de peuple s'assembla autour de lui. Et un chef
de synagogue nommé Jaïre vint le trouver et le voyant il se jeta à ses pieds,
» etc (2). On doit voir ici que ce qui regarde la fille du chef de synagogue
arriva quand Jésus sortant du pays des Géraséniens eut repassé le lac : mais
l'évangéliste ne dit pas combien de temps après. S'il n'y avait pas eu
d'intervalle, on ne trouverait plus où.placer ce que vient de raconter saint
Matthieu sur le repas donné dans sa maison. Car après ce qui arriva chez lui
et à son occasion, quoiqu'il en ait parlé, suivant l'usage des évangélistes,
comme d'événements étrangers à sa personne ; il n'est d'autre fait que celui
de la fille
168
du chef de synagogue, pour se présenter immédiatement.
Aussi la transition de saint Matthieu montre clairement par elle-même que ce
qu'il va raconter fait suite à ce qu'il a raconté. Il vient de rapporter les
paroles du Sauveur au sujet de l'étoffe neuve et du vin nouveau , puis il
ajoute aussitôt : « Tandis qu'il leur disait ces choses, un prince de la
synagogue l'aborda. » Mais si cet homme l'aborda quand il disait ces paroles,
il n'y eut pas d'intervalle pour d'autres discours ni pour d'autres actions.
Au contraire dans le récit de saint Marc, comme déjà nous l'avons montré, il y
a place pour des événements intermédiaires. De même saint Luc, en passant du
miracle opéré chez les Géraséniens à ce qui regarde la fille du chef de
synagogue, ne le fait pas de manière à contredire saint Matthieu, qui présente
ce dernier fait comme ayant suivi les comparaisons de l’étoffe neuve et du vin
nouveau, en disant : « Comme Jésus parlait ainsi. » En effet, quand saint Luc
a fini de raconter ce qui eut lieu chez les Géraséniens, il aborde de cette
manière l'autre sujet: « Jésus, dit-il, étant revenu dans la Galilée, le
peuple le reçut avec joie parce qu'ils l'attendaient tous. Et un homme appelé
Jaïre, qui était chef de synagogue, vint à lui, et tombant à ses pieds, il le
priait, etc (1); »De ce texte on conclut qu'à la vérité le peuple reçut alors
avec joie le Seigneur dont il attendait impatiemment le retour; mais ce
qu'ajoute l'évangéliste: « Et un homme appelé Jaïre, etc » ne doit pas être
pris comme une chose qui suivit immédiatement. Il faut faire précéder ce fait
du festin où parurent les publicains et dont le texte de saint Matthieu rie
permet pas de le séparer.
65. Au sujet de cette femme
qui était affligée d'une perte de sang et dont l'histoire nous est présentée
au milieu de le narration qui maintenant nous occupe, l'accord des trois
évangélistes ne donne lieu à aucune question. Peu importé à la vérité que tel
détail relevé par l'un, ne le soit point par l'autre ; que saint Marc fasse
dire à Jésus: « Qui a touché mes vêtements ? » et saint Luc : « Qui m'a touché
? » L'un a usé du langage ordinaire, et l'autre a employé les termes propres.
Car nous disons plus ordinairement : Vous me déchirez, que: Vous déchirez mes
vêtements ; et il est hors de doute que tout le monde comprend alors notre
pensée.
66. Mais d'après saint
Matthieu le prince de la synagogue vint dire au Seigneur non pas que sa
fille était en danger de mort, ou quelle était mourante,
ou qu'elle rendait le dernier soupir, mais bien qu'elle était déjà morte ; et
suivant les deux autres elle était à l'article de la mort, mais encore vivante
cependant ; au point que leurs récits nous parlent des gens qui arrivèrent
ensuite pour annoncer qu'elle était morte, et dire qu'il ne fallait pas
davantage tourmenter le Maître, comme s'il fût venu non avec le pouvoir de la
rendre à la vie du moment qu'elle serait morte, mais pour l'empêcher de mourir
en lui imposant les mains. Afin d'écarter toute apparence de contradiction, il
faut comprendre que saint Matthieu pour abréger a mieux aimé dire que le
prince de synagogue pria le Seigneur de faire ce qu'il fit en effet lorsqu'il
ressuscita sa fille. L'évangéliste ne considère pas tant les paroles que
l'intention de ce père ; et il lui prête un langage conforme à ses pensées.
Jaïre aussi bien avait tellement désespéré de sa fille, qu'il avait plutôt
dessein de demander une résurrection qu'une guérison ; ne croyant pas la
retrouver en vie après l'avoir laissée mourante. Saint Marc et saint Luc ont
donc reproduit ses paroles ; saint Matthieu a exprimé sa .pensée et sa
volonté. Ainsi demanda-t-il également au Seigneur ou de guérir sa fille
mourante ou de la rendre à la vie si elle était morte ; mais saint Matthieu se
proposant de tout dire en peu de mots, fait demander au père ce qu'il voulait
certainement, et ce que fit le Christ. Sans aucun doute, si, d'après les deux
autres évangélistes ou l'un des deux, le père avait dit lui-même, ce que les
gens de sa maison vinrent lui représenter, qu'il ne fallait plus importuner
Jésus, parce que la fille était morte, le texte de saint Matthieu contredirait
la pensée de Jaïre; mais on ne lit pas qu'il se soit rendu aux observations de
ceux qui en venant lui apporter la triste nouvelle, lui disaient de ne plus
faire d'instance près du Maître. On voit encore par là que quand le Seigneur
dit à Jaïre : « Ne crains pas ;
crois seulement, et elle sera sauvée ; » il ne lui reprochait pas de défiance
; mais voulait affermir sa foi. La foi chez lui était la même que chez cet
autre qui, en demandant la délivrance de son fils, dit à Jésus : « Je crois
Seigneur, mais suppléez vous-même ce qui manque à ma foi (1). »
67. Puisqu'il en est ainsi;
ces différentes manières,de parler, qui n'empêchent pas les évangélistes
d'être d'accord entr'eux, donnent lieu à une observation bien utile et bien
nécessaire.
169
C'est que dans le langage de qui que ce soit, il faut
considérer seulement l'intention, que les mots sont destinés à exprimer, et
qu'on n'est pas menteur pour rendre en d'autres termes ce qu'a voulu dire
quelqu'un dont on n'emploie pas les expressions. Il est certain que,
non-seulement dans les paroles, mais dans tous les autres signes des pensées,
on ne doit chercher que la pensée elle-même; et c'est être misérable que de
tendre pour ainsi dire aux mots et de se représenter la vérité comme enchaînée
à des accents.
68. On lit dans plusieurs
exemplaires de saint Matthieu: « Cette femme n'est point; morte, mais elle
dort. » Comme saint Marc et saint Luc déclarent que la fille dont il s'agit
avait douze ans, il faut voir dans l'expression employée par saint Matthieu
une locution hébraïque. Aussi bien, dans d'autres passages de l'Écriture ce
terme désigne, non-seulement celles qui ont eu commerce avec un homme mais les
vierges elles-mêmes. Il est dit d'Eve : « Et de la côte qu'il avait tirée
d'Adam, le Seigneur Dieu bâtit la femme (1). » Au livre des Nombres il est
ordonné d'épargner les femmes, mulieres, qui n'ont point connu d'homme,
c'est-à-dire les vierges (2); et saint Paul donne le même sens à ce mot quand
il dit que Jésus-Christ est né d'une femme, ex muliere (3). Mieux vaut
comprendre ainsi la variante de saint Matthieu que de regarder cette fille de
douze ans comme étant déjà mariée, ou n'étant plus vierge.
69. Saint Matthieu continue
ainsi : « Comme Jésus sortait de là, deux aveugles le suivirent et ils
criaient : Fils de David, ayez pitié de nous; » et le reste, jusqu'à l'endroit
où nous lisons ces mots : « Mais les Pharisiens disaient : « Il chasse les
démons par la vertu du prince des démons (4). » Saint Matthieu est le seul qui
ait parlé de ces deux aveugles et du démon muet. Car les deux aveugles dont il
est question dans saint Marc et dans saint Luc (5), ne sont pas les mêmes que
ceux-ci. Il s'agit néanmoins d'un fait qui s'est accompli dans des conditions
toutes semblables : et si saint Matthieu ne l'avait également relevé (6), on
pourrait croire que saint Marc
et saint Luc ont voulu raconter ce que lui-même expose
ici. Remarquons bien et n'oublions pas qu'il y a dans l'histoire évangélique
certains faits qui se ressemblent. Nous en avons la preuve quand nous les
trouvons relatés par le même Evangéliste. Et si telle ou telle circonstance
met de l'opposition entre deux écrivains sacrés pour un fait qui parait le
même, sans qu'on puisse les concilier sur ce point, nous devons penser qu'il
ne s'agit pas du même fait, mais d'un autre qui est semblable ou qui s'est
accompli semblablement.
70. On ne voit point si
maintenant l'Evangéliste continue à suivre l'ordre des événements. Car après
avoir parlé des deux aveugles et du démon muet, il reprend ainsi : « Or Jésus
parcourait toutes les villes et les bourgades, enseignant dans leurs
synagogues, prêchant le royaume de l'Evangile et guérissant toutes sortes de
maladies et d'infirmités. Voyant ces troupes de peuples il eu eut compassion,
parce qu'ils étaient accablés et abattus comme des brebis qui n'ont point, de
pasteur. Alors il dit à ses disciples : La moisson est abondante, mais il y a
peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers.
Puis ayant appelé ses douze disciples, il leur donna puissance sur les esprits
impurs, » et le reste, jusqu'à ces mots : « Je vous le dis en vérité, il ne
sera point privé de sa récompense (1). » Dans tout ce passage on trouve un
grand nombre de recommandations adressées aux disciples : mais je le répète,
on ne voit pas si l'évangéliste suit dans sa narration l'ordre des événements
ou l'ordre de ses souvenirs. Saint Marc parait avoir résumé en peu de mots ce
passage ; et voici comme il aborde ce sujet : « Jésus cependant allait
enseigner partout dans les bourgades des environs. Or, ayant appelé les douze,
il commença à les envoyer deux à deux et leur donna puissance sur les esprits
impurs; » et le reste, jusqu'aux paroles: « Secouez la poussière de vos pieds,
afin que ce soit un témoignage contre eux (2). » Mais avant de faire ce récit,
et après avoir rapporté la résurrection de la fille de Jaïre, saint Marc nous
montre Jésus venant en son pays,
170
où on se demandait avec étonnement d'où pouvait lui venir
une si grande sagesse, une puissance si merveilleuse. Saint Matthieu ne parle
de ce fait qu'à la suite des avis donnés aux disciples et après plusieurs
autres choses (1). Est-ce donc saint Matthieu qui rappelle un détail oublié
précédemment? Est-ce saint Marc qui expose par avance ce que lui offre son
souvenir ? A cet égard nous restons dans l'incertitude. Immédiatement après
avoir décrit la résurrection de la fille de Jaïre, saint Luc parle, aussi
brièvement que saint Marc, du pouvoir conféré aux disciples et des
recommandations qui leur furent adressées (2); mais sans indiquer non plus
l'intention de raconter les choses suivant l'ordre dans lequel elles sont
arrivées. Pour les nones que le même évangéliste donne aux douze Apôtres, en
parlant plus haut de leur élection sur la montagne; il n'y a de la différence
entre lui et saint Matthieu, que dans le nom de Jade, fils de Jacques (3), que
saint Matthieu appelle Thaddée, et, selon quelques exemplaires, Lebbée. Mais
qui peut jamais empêcher qu'un même personnage porte deux ou trois noms?
71. Il est ordinaire aussi de
demander comment d'après saint Matthieu et saint Luc Jésus dit aux disciples
de ne point porter de bâton, quand d'après saint Marc, « il leur commanda de
ne porter en chemin qu'un bâton, » et que la suite du récit où il est dit
encore : « Ni sac, ni pain, ni argent dans leur bourse, » accuse évidemment un
discours qui roule sur le même objet et se rapporte aux mêmes circonstances
que ceux des autres évangélistes, d'après lesquels les disciples ne devaient
point porter de bâton. Il faut . comprendre, pour résoudre la difficulté, que
ce terme n'a pas dans saint Marc la même signification que dans saint Matthieu
et dans saint Luc; et que le bâton dont l'usage est interdit suivant les uns,
n'est pas celui dont l'usage est permis suivant l'autre. Ainsi l'idée de
tentation se prend, de deux manières bien différentes dans ces deux passages :
« Dieu ne tente personne (4), » et: « Le Seigneur votre Dieu vous tente, afin
qu'il paraisse si vous l'aimez (5). » Dans le premier c'est le sens de
séduction; dans l'autre le selfs d'épreuve. Ainsi encore quand il est dit : «
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle, et ceux qui
auront fait le mal ressusciteront pour le jugement (6); » ce jugement
n'est pas celui dont parle en ces termes le Psalmiste : «
Jugez-moi, Seigneur, discernez-moi de la nation qui n'est pas sainte (1). » Là
c'est un jugement qui condamne, ici un jugement qui distingue des condamnés.
72. Il est encore beaucoup
d'autres mots qui n'ont pas une signification unique, mais dont le sens varie
selon la place qu'ils occupent dans le discours, et qui sont quelquefois
accompagnés de leur explication. Ainsi dans.ce passage: « Ne soyez pas enfants
pour la sagesse, mais soyez enfants pour la malice, afin que vous soyez sages
comme des hommes parfaits (2) ; A l'Apôtre, en voilant sa pensée, pouvait dire
plus brièvement : Ne soyez pas enfants, mais soyez enfants. Ainsi encore dans
cet autre verset (3) : « Si quelqu'un d'entre vous pense être sage selon le
monde, qu'il devienne fou pour devenir sage; » n'est-ce pas dire : Qu'il ne
soit pas sage afin d'être sage? Quelquefois cependant, pour exercer
l'intelligence, ces mots ne sont point expliqués, comme dans cet endroit de l'Epître
aux Galates: « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez
ainsi la loi du Christ. Car si quelqu'un s'estime être quelque chose, il se
trompe lui-même, parce qu'il n'est rien. Mais que chacun examine ses actions
et alors il trouvera sa gloire seulement en lui-même et non dans les autres :
car chacun portera son propre fardeau (4). » A moins de voir plusieurs
significations dans le mot fardeau, a on croira sans doute que l'Apôtre se
contredit, et cela dans l'exposition de la même pensée, à quelques lignes
d'intervalle; puisque après ces paroles : « Portez les fardeaux les uns des
autres, » il ajoute un peu plus loin : « Chacun portera son propre fardeau. »
Mais le fardeau de l'infirmité à laquelle il faut compatir, n'est pas le
fardeau du compte que nous devons rendre à Dieu de nos actions. Le premier se.
communique et la charité nous fait un devoir de le porter avec nos frères; on
porte l'autre chacun pour soi-même. C'est ainsi encore que nous entendons au
figuré cette verge dont parle l'Apôtre quand il dit : « Viendrai-je à vous la
verge à la main (5)? » et à la lettre celle que l'on emploie pour conduire un
cheval, ou pour quelque autre usage : je m'abstiens de relever ici toutes les
significations métaphoriques du mot.
78. Il faut donc penser que le
Seigneur Jésus
recommanda également aux Apôtres et de ne point porter de
bâton et de ne porter autre chose que le bâton. Aussi bien, après leur avoir
dit, suivant saint Matthieu : « Ne possédez ni or, ni arc gent, ni monnaie
quelconque dans votre bourse; n'ayez pour le voyage ni sac, ni deux habits,
«ni souliers, ni bâton; » il ajouta aussitôt : « Celui, en effet, qui
travaille mérite qu'on le nourrisse. » D'où l'on voit suffisamment la raison
pour laquelle il disait aux Apôtres de ne rien posséder et de ne rien porter
avec eux. Il ne prétendait pas que l'usage des choses du monde ne fût point
nécessaire à la vie, mais il les envoyait de manière à leur faire. Connaître
que de la part des croyants évangélisés par eux toutes ces choses leurs
seraient dues; qu'ils y auraient droit comme le guerrier à sa solde, comme le
vigneron au fruit de la vigne qu'il a plantée, comme le berger au lait du
troupeau. C'est pourquoi a dit: saint Paul. « Qui fait la guerre à ses dépens
? Qui plante une vigne et ne mange pas de son fruit? Qui paît un troupeau sans
en recueillir le lait (1) ? » L'Apôtre parle ici des choses nécessaires aux
prédicateurs de l'Evangile; aussi dit-il un peu plus loin : « Si nous avons
semé en vous des biens spirituels, est-ce une grande chose que nous
moissonnions de vos biens temporels ? Si d'autres usent de ce pouvoir à votre
égard, pourquoi pas plutôt nous-mêmes? Mais nous n'en avons point usé. » Ces
dernières paroles montrent que Jésus-Christ n'a pas voulu faire, aux
prédicateurs de l'Evangile, une obligation de vivre uniquement sur les
offrandes des fidèles instruits par eux de la sainte doctrine; autrement
l'Apôtre, vivant du travail de ses mains pour n'être à charge à personne,
aurait agi contre ce précepte (2); mais qu'il a entendu leur donner un droit
qui implique un devoir pour autrui. Or, quand le Seigneur commande une chose,
il y a péché de désobéissance à ne pas la faire; mais quand il accorde un
droit, on est libre de l'exercer ou d'y renoncer. Jésus-Christ donc en
adressant aux disciples les paroles qui nous occupent, faisait ce que nous
explique mieux le même Apôtre quand il dit un peu plus loin : « Ne savez-vous
pas que les ministres du temple mangent de ce qui est dans le temple, et que
ceux qui servent à l'autel ont part aux oblations de l'autel ? Ainsi.le
Seigneur a établi que les prédicateurs de l'Evangile vivraient de l'Evangile.
Pour moi cependant je n'ai usé d'aucun
de ces droits (1). » En disant que le Seigneur l'a ainsi
établi, mais que lui-même n'en a point profité, il montre qu'il s'agit d'un
simple droit pour les ministres de l'Evangile, et non pas d'une obligation.
74. En établissant donc, comme
le dit l'Apôtre , que les prédicateurs de l'Evangile devraient vivre de l'Evangile,
Jésus-Christ voulait faire comprendre aux douze disciples qu'il leur fallait
bannir toute inquiétude, et ne posséder ni ne porter absolument rien des
choses de la vie. C'est pour cela qu'il dit : « pas même un bâton, » mettant
ainsi en relief ce principe que les fidèles doivent tout procurer à leurs
ministres, qui du reste ne demandent rien de superflu. Et en ajoutant : «
L'ouvrier en effet mérite qu'on le nourrisse, » il déclarait parfaitement
pourquoi et dans quel but il tenait ce langage.
D'un autre côté c'est ce droit
qu'il désigne sous le nom de verge lorsqu'il dit de ne rien porter en chemin
que le bâton seulement; » on pourrait exprimer ainsi brièvement sa pensée : Ne
portez rien avec vous des choses nécessaires, pas même de bâton, ou : le bâton
seulement. Pas même de bâton, c'est-à-dire : pas même les moindres choses, ou:
seulement le bâton, c'est-à-dire le pouvoir que je vous donne et en vertu
duquel ce que vous ne porterez pas ne vous fera point défaut. Le Sauveur a
donc recommandé également les deux choses. Mais parce que le même Evangéliste
ne les a pas mentionnées dans son récit, on est porté à voir de l'opposition
entre la défense de porter le bâton pris dans un sens, et l'ordre de ne porter
que le bâton, pris dans un autre sens; or notre explication doit éloigner
cette idée.
75. Ainsi encore, en disant
aux Apôtres, comme nous le lisons dans saint Matthieu, de ne point porter de
chaussure avec eux, Jésus leur défendait le soin de s'en procurer et la
crainte d'en manquer. C'est ainsi encore qu'il faut comprendre ce qui regarde
les deux tuniques. Le Sauveur ne voulait pas qu'ils se missent en peine d'en
porter une seconde pour remplacer au besoin celle dont ils étaient couverts,
puisqu'ils avaient le pouvoir de s'en procurer autrement. Dès lors, si d'après
le texte de saint Marc les Apôtres devaient avoir aux pieds des sandales ou
des semelles, c'était pour faire ressortir une signification mystique de cette
chaussure.
172
Comme la semelle ne couvre pas le pied, mais l'empêche de
toucher la terre; ainsi l'Evangile rie devait ni se cacher, ni s'appuyer sur
des moyens terrestres. De même encore, s'il leur est défendu, non de porter ou
d'avoir deux tuniques mais d'en être revêtus, n'était-ce pas pour les avertir
de n'agir point avec dissimulation, mais toujours avec simplicité?
76. Ainsi donc il ne faut
nullement douter que le Sauveur a parlé tantôt dans le sens propre et tan tôt
en termes figurés et que chacun des évangélistes a rappelé telles ou telles de
ses paroles; que quelques-unes ont été relatées par deux, par trois, ou même
par les quatre, sans que néanmoins tout ce qu'a dit ou fait le Sauveur ait été
écrit par eux. Si l'on pense que le Seigneur n'a pu dans un même discours
employer le langage propre et le langage figuré, qu'on veuille bien considérer
le reste de ses paroles; on verra combien ce sentiment est téméraire et accuse
d'ignorance. Pour ne citer qu'un exemple qui me revient à l'esprit, il
faudrait donc ne prendre qu'au figuré le précepte de l'aumône et les autres
qui le suivent, parce que la main gauche doit ignorer ce que fait la main
droite (1).
77. Je fais, du reste,
observer encore une fois, ce que le lecteur doit se rappeler constamment, pour
n'avoir pas souvent besoin qu'on le luit appelle, que dans ses discours,
Jésus-Christ a répété plusieurs choses qu'il avait déjà dites ailleurs . Par
conséquent , si la suite du récit n'est pas la même entre deux évangélistes,
on ne doit pas croire à une contradiction ; on doit comprendre au contraire
qu'il s'agit d'instructions données et répétées dans plusieurs circonstances.
Cette observation regarde non-seulement les discours, mais encore les actions
du Sauveur; car rien n'empêche d'admettre qu'un même fait se soit produit deux
fois ; et il y aurait une vanité sacrilège à calomnier l’Evangile en refusant
d'admettre la réitération d'un acte, quand personne ne prouve qu'il n'a pu se
reproduire.
78. Saint Matthieu continue
ainsi sols récit Après que Jésus eut achevé les instructions qu'il donnait à
ses douze disciples, dit-il, il partit de là pour aller enseigner et prêcher
dans leurs villes.
Or Jean ayant appris, dans le prison, les oeuvres de
Jésus-Christ, envoya deux de ses disciples lui dire : Etes-vous celui qui doit
venir, ou est-ce un autre que nous attendons ? » et le reste, jusqu'à
l'endroit où nous lisons : « Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants
(1). » Nous trouvons dans saint Luc tout ce passage relatif à Jean-Baptiste,
aux deux disciples qu'il envoya à Jésus, à la réponse que reçurent ces envoyés
et ce que dit le Sauveur après leur retour au sujet de Jean (2). Ce n'est pas
pourtant dans le même ordre, et l'on ne voit pas lequel des deux garde ici
l'ordre des événements, lequel s'attache à l'ordre de ses souvenirs.
79. Saint Matthieu dit ensuite
: « Alors il commenta à reprocher aux villes où il avait opéré plusieurs de
ses miracles , de n'avoir point fait pénitence, » et le reste, jusqu'aux mots
: « Le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi au jour du
jugement (3). » Saint Luc rappelle ces reproches dans la suite d'un discours
prononcé par le Sauveur (4) ; ce qui fait croire qu'il retrace plus
probablement les paroles de Jésus-Christ suivant l'ordre où elles ont été
dites, et que saint Matthieu écrit, ici, suivant l'ordre de ses souvenirs.
Estime-t-on que, dans ce texte de saint Matthieu : « Alors Jésus commença à
faire des reproches aux villes, » le terme « alors, » doit s'entendre d'un
moment précis et non du temps plus long durant lequel s'étaient faites ou
dites plusieurs autres choses? On est obligé de croire que les mêmes reproches
ont été adressés deux fois. Aussi bien, puisque nous voyons dans un même
évangéliste certaines choses dites deux fois par le Seigneur : comme dans
saint Luc, la prescription relative au sac et à tous les objets que les
Apôtres ne devaient point porter en chemin (5); faut-il s'étonner qu'une autre
pensée pareillement exprimée deux fois, se trouve à sa place dans les récits
des deux évangélistes ? car si l'ordre parait différent, c'est que chacun des
écrivains sacrés la rapporte au moment différent où elle a été énoncée.
173
80. Saint Matthieu dit
ensuite: « En ce temps-là, Jésus prononça ces paroles : Je vous bénis, « mon
Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses
aux sages et aux prudents ; » et le reste, jusqu'aux mots Car mon joug est
doux et mon fardeau léger (1). » Saint Luc, lui aussi, a cité ce discours ;
mais en partie seulement. Car il ne dit pas : « Venez à moi, vous tous qui
êtes dans la peine, » ni les paroles suivantes. Or, il est à croire que ceci
n'a été dit qu'une fois, mais que saint Luc n'a pas tout rapporté. Aussi bien
quand après les reproches du Sauveur aux villes impénitentes saint Matthieu
nous fait lire : « En ce temps-là Jésus prononça ces paroles etc ; » saint Luc
fait suivre ces mêmes reproches de quelques paroles encore, peu nombreuses,
puis il dit : « A cette même heure Jésus tressaillit de joie dans le
Saint-Esprit, et s'écria (2). » Ainsi, quand saint Matthieu au lieu de dire :
« En ce temps-là, » aurait dit. « A cette même heure,» l'expression n'eût pas
laissé d'être exacte, tant est peu long ce qu'intercale saint Luc.
81. Saint Matthieu continue
ainsi : « En ce temps-là Jésus passait le long des blés, un jour de sabbat; et
ses disciples ayant faim, se mirent à rompre des épis et à en manger, » et le
reste, jusqu'à l'endroit où nous lisons: « Car le Fils de l'homme est le
maître du sabbat même (3). » C'est ce que rapportent aussi saint Marc et saint
Luc, sans aucune apparence de contradiction (4). Mais ils ne disent point : «
En ce temps-là; » ce qui peut faire croire que saint Matthieu a plutôt gardé
ici l'ordre des événements, et les autres celui de leurs souvenirs ; à moins
que les mots: « En ce temps là, » ne doivent se prendre dans un sens plus
étendu et ne désignent tout le temps où s'accomplissaient tant de merveilles
de tout genre.
82. Saint Matthieu poursuit :
« Jésus s'étant éloigné de là, vint dans leur synagogue. Alors se présenta un
homme qui avait une main desséchée, » et le reste, jusqu'à l'endroit où nous
lisons : « Il étendit sa main et elle devint saine comme l'autre (1). » Saint
Marc et saint Luc parlent aussi de la guérison de cet homme qui avait une main
desséchée (2). Or on pourrait croire que le fait arriva le même jour que ce
qui est relatif aux épis. Car il s'agit encore d'un jour de sabbat: mais saint
Luc déclare que cette guérison eut lieu un autre jour de sabbat. Ainsi donc
ces termes de saint Matthieu : « Jésus s'étant éloigné delà, vint dans leur
synagogue, » nous font connaître, à la vérité, qu'il y vint seulement 'après
s'être éloigné, mais ne nous disent pas combien de jours après, ni s'il y alla
directement et immédiatement après avoir quitté le champ de blé ; ce qui donne
place à la guérison de la main desséchée, rapportée par saint Luc à un autre
jour de sabbat.
Mais voici peut-être l'objet
d'une difficulté. Selon saint Matthieu les Pharisiens interrogèrent le
Seigneur et lui demandèrent s'il était permis de guérir quelqu'un le jour du
sabbat, » voulant trouver une occasion de l'accuser ; puis il leur proposa
lui-même la comparaison suivante : « Quel est celui d'entre vous qui, ayant
une brebis qui vienne à tomber dans une fosse le jour du sabbat, ne la
saisisse et ne l'en retire pas? Or, combien un homme vaut mieux qu'une brebis!
Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Saint Marc et saint
Luc disent au contraire que ce fut le Seigneur, qui leur adressa cette
question : « Est-il permis, les jours de sabbat, de faire du bien ou du mal ?
de sauver la vie ou de l'ôter ? » Il faut donc entendre que d'abord ils
interrogèrent le Sauveur, et lui demandèrent: « s'il était permis de guérir au
jour du sabbat ; » qu'ensuite, connaissant les pensées de ces hommes qui
cherchaient un moyen de l'accuser, il plaça au milieu d'eux celui dont il
avait guéri la main ; qu'alors il leur adressa les questions rapportées par
saint Marc et saint Luc ; puis, que les voyant garder le silence, il proposa
la comparaison de la brebis tombée dans une fosse, et conclut au droit de
faire du bien le jour du sabbat; qu'enfin les ayant regardés
174
avec colère, suivant le texte de saint Marc et touché
d'un profond sentiment de tristesse à cause de l'aveuglement de leur cœur, il
dit à l'homme guéri: « Étends la main. »
CHAPITRE XXXVI. CHRONOLOGIE INCERTAINE.
83. Saint Matthieu continue
ainsi sa narration : « Les Pharisiens étant sortis tinrent conseil ensemble,
contre lui, sur les moyens de le perdre. Mais Jésus, qui le savait, s'éloigna
de là, et une multitude de gens l'ayant suivi, il les guérit tous; et il leur
commanda de ne point le découvrir. Or il agissait de la sorte, afin que fût
accomplie cette parole du prophète Isaïe ; » et le reste, jusqu'à cet endroit:
« Et toutes les nations espéreront en son nom (1). » Saint Matthieu seul
rappelle ce. fait. Saint Marc et saint Luc passent à autre chose. Saint Marc
paraît sans doute garder quelque temps l'ordre des faits, quand il dit que
Jésus, connaissant la mauvaise disposition des Juifs contre lui, se retira du
côté de la mer avec ses disciples, et qu'une grande multitude étant venue le
trouver il guérit beaucoup de malades (2). Mais en quel endroit l'Evangéliste
commence-t-il à s'écarter de l’ordre chronologique ? Il n'est pas facile de le
voir. Est-ce quand il dit qu'une grande multitude vint trouver le Sauveur?
Mais cela peut se rapporter à un autre temps. Ou bien est-ce quand il dit que
Jésus gagna le haut d'une montagne ; ce que parait rappeler aussi
l'évangéliste saint Luc en disant
En ces jours-là, Jésus alla sur une montagne pour y
prier; » car les mots en ces jours-là, » montrent suffisamment que la chose
n'eut pas lieu tout aussitôt (3) ?
84. On lit ensuite dans saint
Matthieu: « Alors lui fut présenté un homme possédé d'un démon qui le rendait
aveugle et muet ; et il le guérit, en sorte que cet homme parlait et voyait
(4). » Saint Luc ne raconte pas ce fait dans le même ordre, mais après
beaucoup d'autres choses. Il dit seulement que cet homme était muet, sans
ajouter qu'il était aveugle 5. De ce qu'il omet quelque chose, il ne faut pas
conclure
cependant qu'il parle d'une autre guérison; car les
circonstances qui suivent sont les mêmes que dans saint Matthieu.
85. Saint Matthieu dit
ensuite: « Or tout le peuple était dans l'étonnement et disait: Ne serait-ce
point ici le fils de David ? Mais les Pharisiens entendant ces paroles
répliquèrent Il ne chasse les démons que par Béelzébud prince des démons.
Jésus connaissant leurs pensées leur dit alors : Tout royaume divisé contre
lui-même sera ruiné, » et le reste, jusqu'à l'endroit où nous lisons : « Tu
seras justifié par tes paroles et par tes paroles tu seras condamné (1). »
L'accusation élevée contre Jésus de chasser les démons au nom de Béelzébud, ne
vient pas dans le récit de saint Marc à la suite de la guérison du muet, dont
il ne parle pas; mais à la suite de plusieurs autres choses que lui seul
rappelle ; soit que cette accusation lui revenant à l'esprit, il l'insère au
milieu de détails étrangers, soit que, sans redire ce qui a précédé, il
reprenne ici l'ordre des événements (2). Mais saint Luc rapporte à peu près
mot pour mot ce que raconte ici saint Matthieu (3). S'il appelle doigt de Dieu
l'Esprit de Dieu, le sens est le même ; de plus cette expression nous apprend
ce que nous devons entendre par Doigt de Dieu partout où ces mots se
rencontrent dans les Ecritures. Quant aux omissions faites ici par saint Marc
et saint Luc, elles.ne peuvent devenir le sujet d'aucune controverse : il en
est ainsi des termes différents qu'ils emploient et qui ne changent rien à la
pensée.
86. Saint Matthieu continue
ainsi: « Alors quelques-uns des Scribes et des Pharisiens lui dirent: Maître,
nous voudrions que vous nous fissiez voir quelque prodige, » et le reste,
jusqu'aux mots: « C'est ce qui arrivera à cette race criminelle (4). » Saint
Luc aussi rapporte cela au même endroit, mais dans un ordre un peu différent
(5). Car il a rappelé plus haut et après la guérison du muet, la demande que
firent les
175
Juifs à Jésus-Christ d'un signe dans le ciel, mais sans
relater alors la réponse du Seigneur; il ne la rapporte que plus tard, quand
le peuple est réuni autour de Jésus; et il donne à comprendre que là se
trouvaient ceux qui précédemment, demandaient à Jésus un signe dans le ciel;
il rattache même cette réponse à ce qu'il dit de cette femme qui s'est écriée
devant le Seigneur: « Heureux le sein qui vous a porté. » Cette femme à son
tour intervient à la suite du discours où le Sauveur a parlé de l'esprit
immonde, qui après être sorti d'un homme y revient et trouve la maison
nettoyée et parée. Or quand, après avoir parlé de cette femme, l'Evangéliste a
rapporté la réponse que Jésus fit à la foule en faisant intervenir la
comparaison du prophète Jonas, sur le signe qu'elle désirait voir dans le
ciel, il continue le discours du Seigneur et rapporte ce qu'il dit de la reine
du Midi et des Ninivites. Ainsi au lieu d'omettre rien de ce que relate saint
Matthieu, il dit plus que lui. Qui ne voit du reste qu'il serait inutile de
demander dans quel ordre le Sauveur a dit tout cela, quand nous devons
apprendre, par l'autorité suréminente des Evangélistes, qu'il n'y a pas de
mensonge à
rapporter les pensées d'un discours quelconque dans un ordre différent de
celui où elles ont été exposées, l'ordre, quel qu'il soit, ne changeant rien
au fond? De plus, saint Luc permet de croire que ce discours fut plus long
dans la bouche du Seigneur, et il y a inséré des pensées semblables à celles
que nous a présentées saint Matthieu en reproduisant le discours prononcé sur
la montagne (1); ce qui nous fait comprendre que ces pensées ont été exprimées
dans l'une et l'autre circonstance. Saint Luc, après ce discours, passe à un
autre sujet; mais on ne voit pas s'il suit l'enchaînement des faits, car voici
ce qu'il dit ensuite: « Pendant que Jésus parlait, un Pharisien le pria de
dîner chez lui. » L'Evangéliste ne dit pas: Comme il parlait ainsi; mais : «
Pendant qu'il parlait. » S'il avait dit: Pendant qu'il parlait ainsi, on
devrait croire que ces actes du Sauveur se sont succédé dans l'ordre où son
récit les présente.
87. Saint Matthieu continue :
« Comme il parlait encore au peuple, sa mère et ses frères
étaient dehors cherchant à lui parler; » et le reste,
jusqu'à cet endroit : « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les
cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère (1). »
Sans aucun doute nous devons voir ici la suite de ce qui précède. Car
le texte commence ainsi: « Tandis que Jésus parlait encore au peuple. » Que
signifie ce mot : « encore, » sinon la fin du discours qui vient d'être
rapporté? Il n'est pas dit en effet: Tandis qu'il parlait au peuple, sa mère
et ses frères, mais : « Tandis qu'il parlait encore au- peuple ; »
c'est-à-dire, évidemment, tandis qu'il lui disait ce qui vient d'être rappelé.
Car après avoir rapporté les paroles. de Jésus-Christ louchant le blasphème
contre l'Esprit-Saint, saint Marc ajoute aussitôt: « Cependant arrivent sa
mère et ses frères; » il omet ainsi plusieurs passages que rapporte saint
Matthieu dans le discours du Seigneur, et ceux que saint Luc ajoute encore au
texte de saint Matthieu (2). Sans égard à l'ordre des événements et saisissant
le fait quand son souvenir le lui présente, saint Luc de son côté anticipe le
récit de ce qui est relatif à la mère et aux frères de Jésus, il le place de
telle façon qu'on ne le voit lié ni à ce qui précède ni à ce qui suit.: En
effet, c'est après l'exposition de quelques paraboles du Sauveur, que ce fait
lui revenant à la mémoire il écrit : « Or, sa mère et ses frères vinrent le
trouver, et ils ne pouvaient pénétrer jusqu'à lui, à cause de la foule du
peuple ; » ce n'est pas marquer le temps où ils vinrent. Puis le même saint
Lire passant à un autre objet, s'exprime ainsi : « Un certain jour, il monta
dans une barque, avec ses disciples. » Là encore, quand il dit : « Un certain
jour, » il montre suffisamment que rien n'oblige à penser que ce fut le jour
où arriva ce qu'on vient de lire, ni le jour suivant. Donc en racontant ce qui
a rapport à la mère et aux frères de Jésus, saint Matthieu ne contredit les
deux autres évangélistes ni pour les paroles du Seigneur ni pour l'ordre des
événements.
88. Saint Matthieu continue
ainsi: « En ce jour là Jésus étant sorti de la maison s'assit sur le bord de
la mer. Et il s'assembla près de lui une si grande multitude qu'il monta dans
une barque, il s'y assit et le peuple resta sur le
176
rivage. Et il leur dit beaucoup de choses en paraboles,
leur parlant de cette sorte : » et le reste, jusqu'à l'endroit où nous lisons
: « Tout docteur bien instruit de ce qui regarde le royaume des cieux, est
semblable à un père de famille qui tire de son trésor des choses nouvelles et
des choses anciennes (1). » Le texte de saint Matthieu insinue que ceci arriva
aussitôt après ce qui vient d'être rapporté de lanière et des frères de Jésus,
et que l'ordre du récit ne diffère pas de celui des faits: « En ce jour-là,
dit en effet l'Evangéliste pour passer d'un objet à l'autre, Jésus étant sorti
de la maison, vint s'asseoir près de la mer, et une foule nombreuse se réunit
autour de lui. » Qu'est-ce -à dire : « En ce jour là ? » A moins que jour ne
signifie ici temps, comme dans plusieurs passages des livres saints,
l'expression indique assez clairement ou qu'il s'agit d'un fait qui suivit
d'une manière immédiate, ou qu'il ne se fit pas grand-chose dans l'intervalle.
Du reste saint Marc suit le même ordre (2). Si saint Luc, après avoir raconté
ce qui regarde la mère et tes frères de Jésus, rapporte autre chose, la
transition qu'il emploie n'a rien d'opposé à l'enchaînement indiqué par saint
Matthieu (3). Ainsi donc, il n'y a pas l'ombre de contradiction ni dans les
paroles que les trois évangélistes prêtent à Jésus-Christ ni, bien moins
encore, dans ce que saint Matthieu seul lui attribue. Je ne vois pas non plus
que, pour l'ordre même, un évangéliste soit en opposition avec un autre,
quoiqu'il présente les choses un peu différemment, suivant en partie la suite
des faits, en partie aussi la suite de ses souvenirs.
89. On lit ensuite dans saint
Matthieu : « Après que Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là, et,
venant en son pays, il les instruisait dans leurs synagogues, » et le reste,
jusqu'à cet endroit : « Or il ne fit que peu de miracles parmi eux à cause de
leur incrédulité (4). » Le texte n'oblige pas de regarder ce fait comme ayant
eu lieu immédiatement après les paraboles qui précèdent. D'ailleurs saint Marc
en relate un autre et le même que saint Luc, à la suite de ces paraboles, et
sa transition même porte à croire qu'aux paraboles a succédé d'une manière
immédiate
non pas ce qui vient dans le récit de saint Matthieu,
mais ce que disent saint Marc et saint Luc, de la barque sur laquelle dormait
Jésus et du miracle de l'expulsion des démons au pays des Géraséniens (1);
deux faits que saint Matthieu a exposés plus haut quand le souvenir lui en est
revenu (2). Voyons donc si pour ce que dit le Seigneur, et pour ce qui fut dit
dans sa patrie, saint Matthieu est d'accord avec saint Marc et saint Luc. Car
pour saint Jean, c'est dans des circonstances bien différentes (3) qu'il place
des traits analogues à ceux que rappellent ici les trois autres évangélistes.
90. Or, le récit de saint Marc
est ici presque absolument le même que celui de saint Matthieu. Toute la
différence, c'est que Jésus y est appelé charpentier et fils de Marie par ses
compatriotes (4); tandis que selon saint Matthieu on l'appelait le fils du
charpentier. Mais cela ne doit pas nous surprendre. Il put à la fois être
appelé charpentier et le fils du charpentier; puisque s'ils le croyaient
charpentier, c'est qu'ils le regardaient comme le fils d'un charpentier. Mais
saint Luc expose le même fait avec beaucoup plus de détails; et nous le
trouvons dans son récit un peu après ce qui regarde le baptême et la tentation
du Seigneur; et sans aucun doute il relate d'avance ce qui arriva plus tard, à
la suite de beaucoup d'autres choses. Ceci nous donne lieu de faire une
remarque très-importante pour cette grande question de l'accord des
Évangélistes, que nous avons entrepris de résoudre avec l'aide de Dieu: C'est
que ce n'est pas pour avoir ignoré ni les faits ni leur enchaînement naturel
qu'ils en ont omis quelques uns ou qu'ils ont suivi de préférence l'ordre de
leur souvenirs. Cette remarque est justifiée avec éclat par le texte de saint
Luc; car sans avoir fait nulle mention des miracles de Jésus à Capharnaüm, il
rapporte, ce que nous examinons maintenant, comment les compatriotes du
Sauveur admiraient sa vertu merveilleuse et méprisaient la bassesse de sa
naissance. D'après lui en effet Jésus leur parlait ainsi : « Vous me direz,
sans doute : Médecin, guéris-toi toi-même ; ces grandes choses faites à
Capharnaüm et dont le bruit est arrivé jusqu'à nous, fais-les ici encore, dans
ta patrie, » et cependant le même saint Luc n'a jusque là rien raconté des
prodiges opérés à Capharnaüm. Comme le passage n'est pas long, mais
très-facile à comprendre,
177
Et d'ailleurs très-nécessaire, nous le mettons tout
entier sous les yeux du lecteur avec la transition qui l'amène.
Après avoir parlé du baptême
et de la tentation du Sauveur, l'évangéliste poursuit ainsi : « Or toute
tentation achevée, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Alors Jésus par
la vertu de l'Esprit revint en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout
le pays. Il enseignait dans leurs synagogues, et tout le monde lui donnait de
grandes louanges. Etant venu ensuite à Nazareth, où il avait été élevé, il
entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour
lire. Ou lui présenta le livre des prophéties d'Isaïe, et l'ayant ouvert il
trouva l'endroit où il était écrit : L'Esprit du Seigneur est sur moi ; c'est
pourquoi il m'a consacré par son onction et m'a envoyé évangéliser les
pauvres, annoncer aux captifs leur délivrance, aux aveugles qu'ils vont
recouvrer la vue, mettre en liberté ceux qui sont accablés sous les fers,
publier l'année des miséricordes du Seigneur et le jour de la rétribution.
Ayant replié le livre, il le rendit au ministre et s'assit. « Et tous dans la.
synagogue avaient les yeux arrêtés sur lui. Or il commença à leur dire: « Ce
que vous entendez aujourd'hui de vos oreilles est l'accomplissement de ces
paroles de l'Ecriture. Et tous lui rendaient témoignage, et dans l'étonnement
où ils étaient des paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche, « ils
disaient : N'est-ce pas là le fils de Joseph ? Alors il leur dit : Vous
m'appliquerez sans doute ce proverbe : Médecin, guéris-toi toi-même; et vous
me direz: Les grandes choses faites à Capharnaüm et dont le bruit est arrivé
jusqu'à nous, fais-les ici encore, dans ta patrie (1). » Nous laissons ce qui
termine cette partie du récit de l'évangéliste.
N'est-il pas évident qu'il a
sciemment anticipé ce fait dans son récit ? Car il connaissait certainement
les merveilles opérées à Capharnaüm, puisqu'il en parle; puisque d'ailleurs il
sait qu'il ne les a pas rapportées. Il est encore si près du baptême de Jésus
qu'un pareil oubli n'est pas vraisemblable ; car depuis ce baptême il n'a
presque rien dit encore.
91. On lit ensuite dans saint
Matthieu: « En ce temps-là Hérode le tétrarque apprit ce que l'on publiait de
Jésus ; et il dit à ses serviteurs C'est Jean-Baptiste, c'est lui-même qui est
ressuscité d'entre les morts ; et c'est pour cela qu'il se fait par lui tant
de miracles (1). » Saint Marc raconte la même chose et de la même manière,
mais non dans le même ordre (2). Car après avoir rappelé que Jésus envoya ses
disciples, en leur recommandant de ne rien porter avec eux que le bâton, et
après avoir terminé ce qu'il apporte de son discours, il relate le fait qui
nous occupe; mais sans obliger de croire que ce fait ait suivi d'une manière
immédiate ce qui précède, non plus que saint Matthieu chez qui nous lisons: «
En ce temps-là » et non: En ce jour là, ni : A cette heure. Néanmoins, d'après
saint Marc, ce ne fut pas Hérode mais d'autres qui disaient: « Jean-Baptiste
est ressuscité d'entre les morts, » tandis que d'après saint Matthieu ce fut
Hérode qui le dit à ses serviteurs. » Tout en gardant ici le :même ordre que
saint Marc, et sans obliger, non plus que lui, à croire que telle fut la suite
des événements, saint Luc rapporte en ces termes le même fait: « Cependant
Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce que faisait Jésus, et il ne
savait que penser, parce que les uns disaient Jean est ressuscité d'entre les
morts; d'autres : Elie est apparu; et d'autres enfin: Un des anciens prophètes
est ressuscité. Mais Hérode disait : J'ai décollé Jean ; quel est donc
celui-ci, « de qui j'entends de si grandes choses ? Et il souhaitait de le
voir (3). » Ici l'évangéliste, de même que saint Marc, rapporte que ces
paroles: « Jean est ressuscité d'entre les morts, furent prononcées par
d'autres et non par Hérode. Mais quand saint Luc parle de l'hésitation
d'Hérode et cite ensuite ces mots du tétrarque : J'ai décollé Jean; quel est
donc celui-ci, dont j'entends de si grandes choses? » il faut comprendre qu'
Hérode témoigna d'abord cette hésitation, puis, que persuadé de ce qu'on
disait autour de lui, il dit à son tour ce, que nous lisons dans saint
Matthieu: « C'est Jean-Baptiste, « c'est lui-même qui est ressuscité d'entre
les morts; et c'est pourquoi il se fait par lui tant de miracles. » Ou bien
peut-être faut-il prononcer ces paroles sur le ton du doute. S'il y
178
avait : Celui-ci n'est-il point, ou : Ne serait-il point
Jean-Baptiste ? cette réflexion serait inutile, car on verrait de prime abord
le doute et l'hésitation d'Hérode. Mais comme la forme interrogative manque
dans les paroles du tétrarque, on peut ou la suppléer ou la négliger dans la
prononciation ; et l'on est libre de comprendre ou bien que convaincu de ce
qui se disait il parla comme n'ayant plus de doute, ou bien encore qu'il était
dans l'hésitation marquée par le texte de saint Luc. D'ailleurs, après avoir
rapporté que d'autres qu'Hérode disaient de Jean-Baptiste : Il est ressuscité
d'entre les morts, saint Marc finit parfaire dire à Hérode lui-même: «
Jean-Baptiste, à qui j'ai fait trancher la tête, est ressuscité d'entre les
morts ; » et ces dernières paroles peuvent aussi être prononcées ou de manière
à marquer la conviction, ou de manière à faire entendre le doute.
Après avoir rapporté ce fait,
saint Luc passe à un autre objet, mais saint Matthieu et saint Marc racontent
à cette occasion comment Jean-Baptiste fut mis à mort par Hérode.
92. Saint Matthieu en effet
continue ainsi: « Car, Hérode, ayant fait arrêter Jean-Baptiste, l'avait
chargé de fers, et fait jeter en prison, à cause d'Hérodiade femme de son
frère, » et le reste, jusqu'à l'endroit où il dit : « Ses disciples vinrent
ensuite prendre son corps, l'ensevelirent et allèrent porter cette nouvelle à
Jésus (1). » C'est ce, que raconte aussi saint Marc et dans le même ordre (2).
Mais saint Luc rappelle cet emprisonnement du précurseur, dans une autre
occasion, au moment même du baptême de Jésus. Ce qui prouve qu'il raconte ce
fait par avance. Car après avoir rapporté que Jean-Baptiste disait du Seigneur
qu'il avait le van à la main, qu'il nettoyerait son aire, mettrait le bon
grain dans son grenier et brûlerait la paille dans un feu éternel; il ajoute
aussitôt le fait de l'emprisonnement que saint Jean l'évangéliste démontre
clairement n'avoir eu lieu que plus tard ; car il dit qu'après son baptême,
Jésus alla en Galilée, y changea l'eau en vin, demeura quelques jours à
Capharnaüm, puis revint dans la terre de Judée,
où il baptisa beaucoup de monde sur les bords du
Jourdain, avant que Jean-Baptiste eût été mis en prison (1). Quine croirait,
s'il est peu versé dans la connaissance des saintes lettres, que ce fut en
parlant du van et de l'aire nettoyée que saint Jean offensa Hérode, et que
celui-ci le fit aussitôt jeter en prison? La vérité, comme nous l'avons déjà
démontré ailleurs, c'est que les choses ne sont pas relatées dans l'ordre où
elles se sont accomplies; la preuve en est ici même, dans le texte de saint
Luc (2). S'il était vrai que Jean eût été jeté en prison aussitôt après son,
discours, comment expliquerait-on ce que dit le même évangéliste, que Jésus
fut ensuite baptisé par saint Jean? Il est donc manifeste que saint Luc s'est
rappelé ce fait accidentellement et en a parlé par anticipation, et avant
beaucoup d'autres choses qui ont précédé la détention de Jean-Baptiste. Ni
saint Matthieu ni saint Marc, ne rapportent eux-mêmes ce fait dans l'ordre où
il a eu lieu suivant le témoignage même de leurs écrits. Car eux aussi nous
disent que Jean-Baptiste ayant été arrêté, le Sauveur alla en Galilée (3) ;
c'est après avoir relaté de nombreux miracles opérés par Jésus dans ce pays,
qu'ils en viennent à parler de la conviction ou de l'hésitation d'Hérode sur
la prétendue résurrection de Jean qu'il avait fait décapiter (4), et des
circonstances de l'emprisonnement et de la mort de Jean-Baptiste.
93. Après avoir rappelé que la
nouvelle de,la mort de Jean fut portée à Jésus-Christ, saint Matthieu poursuit
ainsi : « Jésus, ayant appris cela, partit de là dans une barque pour se
retirer à l'écart dans un lieu désert. Et le peuple l'ayant su, le suivit à
pied, de diverses villes. Lors donc qu'il sortit de la barque, il vit une
grande foule, il en eut pitié et guérit leurs malades (5). » Selon le texte de
l'évangéliste, ceci eut lieu immédiatement après la mort du précurseur. Par
conséquent ce qui est raconté plus haut des miracles de Jésus, dont la
nouvelle troubla Hérode et lui fit dire : « J'ai fait trancher la tête à Jean,
» n'arriva que plus tard. On doit en effet regarder comme postérieures des
actions qui, portées à la connaissance d'Hérode
179
par la renommée, le jetaient dans le trouble, et lui
donnaient lieu de se demander quel pouvait être celui dont il apprenait de si
grandes merveilles, après avoir fait couper la tête à Jean-Baptiste. Mais
après avoir parlé du martyre de Jean, saint Marc rapporte que les disciples
envoyés par Jésus revinrent près de lui, et lui rendirent compte de ce qu'ils
avaient fait et enseigné;
qu'ensuite, et lui seul parle de ceci, Jésus leur dit de se reposer un peu à
l'écart; qu'il monta sur . une barque et se rendit avec eux dans un autre lieu
; qu'une foule nombreuse informée de leur départ s'y trouvait déjà quand ils
arrivèrent ; que le Sauveur ayant pitié de cette foule, l'enseigna longuement
et que, l'heure étant déjà bien avancée, il nourrit tous ceux qui étaient là
avec cinq pains et deux poissons (1). Les quatre évangélistes ont tous
rapporté ce miracle. Saint Luc même, après avoir plus haut, et à l'occasion
dont nous avons parlé, raconté ce qui regarde l'emprisonnement de
Jean-Baptiste (2); joint ici d'une manière immédiate à ce qu'il vient de dire
de l'hésitation d'Hérode touchant la personne du Seigneur, les faits relatés
par saint Marc; savoir, que les Apôtres revinrent près de Jésus, lui rendirent
compte de ce qu'ils avaient fait, et que, les prenant avec lui, le Sauveur se
retira à l'écart dans un lieu désert ; qu'il y vit arriver une foule
considérable, à qui il parla du royaume de Dieu et dont il guérit les malades.
C'est après cela qu'il raconte aussi le miracle des cinq pains opéré vers le
déclin du jour (3).
94. Quant à saint Jean, qui
diffère beaucoup des trois autres, en ce qu'il s'arrête plus aux discours
qu'aux actions merveilleuses de Notre-Seigneur, il dit d'abord que Jésus
quittant la terre de Juda prit de nouveau le chemin de la Galilée, ce qui doit
s'entendre du voyage qu'y fit Jésus, au rapport des trois autres évangélistes,
lorsque Jean eut été mis en prison ; après avoir rappelé cela, il rapporte ce
que dit le Seigneur en traversant le pays de Samarie et en rencontrant la
Samaritaine près du puits de Jacob; il ajoute qu'au bout de deux jours le
Sauveur se remit en marche pour venir en Galilée ; qu'il se rendit à Cana où
précédemment il avait changé l'eau en vin, et qu'il guérit alors le fils d'un
officier (4). Il ne parle pas des autres actions ni des autres discours que
les autres évangélistes attribuent à Jésus pendant son séjour en Galilée :
mais, ce que n'a relevé aucun d'eux, il dit que le jour
de la grande fête des Juifs il se rendit à Jérusalem, et y guérit
miraculeusement cet homme qui, depuis trente-huit ans malade, n'avait personne
pour le descendre dans la piscine où trouvaient leur guérison ceux qui
souffraient de quelque infirmité. Il rappelle ensuite un long discours de
Jésus-Christ à cette occasion; puis il nous le montre passant à l'autre bord
de la mer de Galilée, c'est-à-dire du lac de Tibériade, et suivi d'une grande
multitude; allant ensuite sur une montagne et s'y reposant avec ses disciples;
c'était aux approches de la fête de Pâque pour les Juifs, et c'est alors
qu'ayant levé les yeux et voyant une foule très-considérable, il la nourrit
avec cinq pains et deux poissons (1), ce que rapportent également les autres
évangélistes. Il a donc omis sûrement les faits qui conduisent ceux-ci au
récit du miracle dont nous parlons. Mais ces derniers ayant de même gardé le
silence sur des choses relatées par lui, on voit que tous sont arrivés au
récit de ce miracle comme par des chemins différents ; eux en marchant
à-peu-près du même pas, et lui en volant en quelque sorte à la poursuite de
ce qu'il y avait de plus relevé dans les discours du Seigneur, et en
redisant ce qu'ils omettent, il s'est rencontré avec eux pour retracer la
multiplication des cinq pains et pour reprendre bientôt son essor vers des
régions supérieures.
95. Saint Matthieu,
poursuivant son récit, arrive ainsi au fait même de ce miracle. « Or le soir
étant venu, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Ce lieu-ci
est désert et il est déjà bien tard; renvoyez-le peuple, afin que tous aillent
dans les villages acheter de quoi manger. Mais Jésus leur dit : Il n'est pas
nécessaire qu'ils y aillent ; donnez-leur vous-mêmes à manger, » et le reste,
jusqu'à l'endroit où nous lisons : « Le nombre de ceux qui mangèrent fut de
cinq mille hommes, sans compter les femmes et les petits enfants (2). »
Arrêtons-nous donc à bien examiner ce fait que nous trouvons dans les quatre
récits (3), et où on prétend voir entre eux quelque opposition; et faisons
remarquer , afin qu'on s'en souvienne pour tout
180
autre passage semblable, que d'après les règles du
langage la différence des expressions n'empêche pas d'énoncer la même pensée
et de conserver aux choses la même couleur.
Nous pourrions commencer, par
saint Matthieu, le premier des évangélistes ; mais il vaut mieux commencer par
saint Jean, qui va jusqu'à nommer les disciples avec lesquels Jésus parla de
son dessein. Voici comme il raconte le fait : « Jésus donc ayant levé les yeux
et voyant qu'une fort grande multitude de peuple était venue à lui, dit à
Philippe : Où pourrons-nous acheter assez de pains pour donner à manger à tout
ce monde ? Philippe lui répondit: Quand on aurait pour deux cents deniers de
pain, cela ne suffirait pas pour leur en donner à chacun un petit morceau. Un
autre de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit : Il y a ici un
petit garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons ; mais qu'est-ce que
cela pour tant de gens ? Jésus leur dit: Faites-les asseoir. Or il y avait en
ce lieu beaucoup d'herbe; et environ cinq mille hommes s'y assirent. Jésus
prit donc les pains; et après avoir rendu grâces, il les distribua à ceux qui
étaient assis et on leur donna de même.des deux poissons autant qu'ils en
voulurent. Après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : Amassez les
morceaux qui sont restés, afin que rien ne se perde. Et les ayant amassés ils
emplirent douze corbeilles des morceaux qui étaient restés des cinq pains
d'orge, après que tous en eurent mangé (1). »
96. On n'a pas à rechercher
ici ce qu'étaient ces pains, puisque l'Évangéliste déclare que c'étaient des
pains d'orge ; quoique là dessus les trois autres gardent le silence. Il ne
s'agit pas non plus d'examiner ce qu'il ne dit pas des femmes et des petits
enfants, puisque selon saint Matthieu, ils étaient en dehors. des cinq mille
hommes. Si l'un rapporte une chose dont l'autre a négligé de parler, y a-t-il
là une difficulté ? Non, et c'est ce qui doit être maintenant hors de doute,
ce qu'il faut tenir comme un principe toutes les fois que le cas se présente.
Mais comment sont vrais de tout point les quatre récits dans ce qu'ils
contiennent ? et n'est-il aucun détail qui les mette en contradiction les uns
avec les autres? voilà une question que nous avons à traiter. Si en effet,
comme le rapporte saint Jean, Notre-Seigneur, après avoir vu la multitude,
demanda
à Philippe, pour le tenter, où il serait
possible d'avoir des vivres pour tout ce monde ; on peut se demander
comment les trois autres peuvent avoir, raison de raconter que d'abord les
disciples de Jésus-Christ lui dirent de renvoyer la foule, afin que chacun pût
acheter des aliments dans les lieux voisins, et que le Seigneur répondit,
d'après saint Matthieu : « Il n'est pas nécessaire qu'ils y aillent;
donnez-leur à manger vous-mêmes. » Ces mots: «Il n'est pas nécessaire qu'ils y
aillent, » n'ont pas été reproduits par saint Marc ni par saint Luc. Et c'est
ici toute la différence entre eux et saint Matthieu.
Ce serait donc après cela que
le Sauveur aurait jeté les yeux sur la multitude et dit à Philippe ce que nous
lisons dans le seul texte de saint Jean. Quant à la réponse que celui-ci prête
à Philippe, saint Marc la présente comme ayant été faite par les disciples;
pour faire entendre que cet Apôtre exprimait alors la pensée commune; à moins
que, comme il arrive très-fréquemment,les trois évangélistes n'aient employé
le nombre pluriel pour le singulier. Ainsi donc, ces paroles de Philippe, dans
saint Jean: «Eût-on pour deux cents deniers de pain, cela ne suffirait pas
pour leur en donner à chacun un petit morceau, » reviennent à celles-ci de
saint Marc : « Allons acheter pour deux cents deniers de pain, et nous leur
donnerons à manger . » La question de Jésus : « Combien avez-vous de pains? »
que l'on trouve encore dans saint Marc, n'a pas été rappelée par les autres ;
et l'observation que fit André, selon l'évangéliste saint Jean, qu'il y avait
là cinq pains et deux poissons , saint Matthieu, saint Marc et saint Luc
l'attribuent aux disciples par l'emploi du nombre pluriel an lieu du nombre
singulier. De plus saint Luc réunit dans une même phrase la réponse de
Philippe et celle d'André. Car ces mots : « Nous n'avons que cinq pains et
deux poissons, » sont la réponse du dernier ; et ces autres : « A moins
peut-être que nous n'allions acheter des vivres à tout ce peuple , »
paraissent être la réponse de Philippe , sauf les deux cents deniers, qui
peuvent venir d'André. Car après avoir dit : « Il se trouve parmi nous un
petit enfant qui a cinq pains et deux poissons » il ajouta : « Mais qu'est-ce
que cela pour tant de monde ? » ce qui, revient aux paroles : « A moins
peut-être que nous n'allions acheter des vivres pour toute cette multitude. »
97. D'un pareil accord pour le
fond et les (181) pensées, avec une telle différence dans les termes, résulte
assez clairement pour nous l'utile leçon de ne chercher dans les mots que
l'intention de ceux qui parlent. C'est à faire bien ressortir cette intention
que doivent s'appliquer tous les narrateurs véridiques, quand ils racontent
quelque chose soit d'un homme, soit de Dieu, soit d'un ange. Leurs discours,
en effet, peuvent la révéler sans présenter entre eux aucune divergence pour
le fond.
98. Mais voici une observation
qu'il ne faut pas négliger, afin de prévenir l'embarras que pourrait éprouver
le lecteur, dans la rencontre de tout autre passage semblable. D'après saint
Luc on fit asseoir la foule par groupes de cinquante, et d'après saint Marc
par groupes de cinquante et par groupes de.cent. La difficulté ne peut venir
ici de ce que l'un rapporte tout ce qui s'est fait et l'autre une partie
seulement. Celui en effet qui fait mention des groupes de cent personnes en
même temps que des groupes de cinquante, dit.ce que l'autre a passé sous
silence; il n'y a donc point de contradiction. Mais il y en aurait eu quelque
apparence, si l'un, par exemple, avait seulement parlé des groupes de
cinquante et l'autre seulement des groupes de cent, et il ne serait pas facile
de voir dans leurs récits deux choses également véritables relatées
séparément. Qui n'avouera néanmoins qu'il faudrait en venir à cette conclusion
après un examen plus attentif? J’ai fait cette remarque, parce que l'on
rencontre souvent dans les Évangélistes des passages semblables que le défaut
de réflexion et la précipitation font regarder comme opposés, quand ils ne le
sont aucunement.
99. Saint Matthieu continue
ainsi : « Après avoir congédié la foule, Jésus monta sur une montagne pour y
prier seul. La nuit venue, il y était donc seul. Cependant la barque était
fort battue des flots au milieu de la mer, parce que le vent était contraire.
Mais à la quatrième veille de la nuit, Jésus vint à eux marchant sur la mer.
Lorsqu'ils le virent ainsi marcher sur l'eau, ils furent troublés et
s'écrièrent : C'est un fantôme, » et le reste, jusqu'à l'endroit où nous
lisons : « Ils s'approchèrent de lui et l'adorèrent en disant : Vous êtes
vraiment le Fils
de Dieu (1). » Saint Marc rapporte aussi le même fait
après ce qu'il a raconté du miracle des cinq pains. « Le soir étant venu,
dit-il, la barque se trouvait au milieu de la mer, et Jésus était seul à
terre. Et voyant qu'ils avaient beaucoup de mal à ramer, parce que le vent
leur était contraire (2). etc » C'est un récit pareil à celui de saint
Matthieu, sauf qu'il ne dit rien de Pierre marchant sur les eaux, et qu'il
nous apprend qu'en y marchant Jésus voulait dépasser ses disciples. Cette
circonstance ne doit embarrasser personne. En effet comment put venir aux
disciples l'idée d'une pareille intention, si ce n'est parce que Jésus allait
d'un autre côté, affectant de passer devant eux comme devant des étrangers,
dont il était alors si peu connu qu'ils le prenaient pour un fantôme? Mais
quel homme aurait l'esprit assez lourd pour prendre ceci à la lettre? Du
reste, quand les disciples troublés poussèrent un cri, Jésus vint à eux en
leur disant : « Ayez confiance ; c'est moi ; ne craignez point. » Comment donc
voulait-il passer outre, lui qui les rassura de telle sorte ? Ne voit-on pas
qu'en s'éloignant, il avait dessein de leur faire jeter ce cri, qui
l'obligeait à les secourir ?
100. Jusque là nous retrouvons
encore l'Évangéliste saint Jean avec saint Matthieu et saint Marc. Lui aussi,
après avoir raconté le miracle des cinq pains, parle de la barque luttant
contre les flots, et du Seigneur marchant sur les eaux. Car voici comment il
continué sa narration: « Jésus donc, sachant qu'ils devaient venir pour
l'enlever et le faire roi, s'enfuit de nouveau sur la montagne, sans être
accompagne de personne. Le soir venu, ses disciples descendirent près de la
mer et montant dans une barque ils passèrent de l'autre côté à Capharnaüm : il
était déjà nuit, et Jésus n'était pas encore revenu à eux. Cependant le vent
soufflait avec violence, et la mer s'enflait (3) etc. » On ne peut trouver ici
l'apparence d'aucune contradiction. Il est vrai, dans le texte de saint
Matthieu nous ne voyons le Sauveur gagner le haut ale la montagne pour y prier
seul, que quand il eut congédié la foule, au lieu que d'après saint Jean, il y
était déjà lorsqu'il vit cette multitude et qu'il la nourrit avec cinq pains.
Mais comme saint Jean nous dit lui-même qu'après ce miracle, il s'enfuit sur
la montagne pour ne pas être enlevé par la foule
182
qui voulait le faire roi ; n'est-il pas évident que du
haut de la montagne où il se trouvait d'abord il était descendu sur un terrain
plus uni quand les disciples distribuèrent les pains à tout le peuple? On
comprend ainsi comment Jésus put regagner le sommet de la montagne, comme le
disent saint Marc et saint Jean. Pourtant nous lisons dans saint Matthieu : «
Jésus monta » et dans saint Jean: « il s'enfuit; » mais ces deux termes ne
seraient opposés l'un à l'autre que si en fuyant il n'eût pas monté. Il n'y a
pas plus de contradiction quand saint Matthieu écrit: « Il monta sur la
montagne pour y prier seul, » et que saint Jean nous l'ait lire : « Ayant su
qu'on allait venir pour le faire roi il s'enfuit de nouveau sur la montagne. »
Car le motif énoncé par l'un n'exclut pas le motif indiqué par l'autre. Aussi
bien le Seigneur, qui a transformé en lui notre corps vil et abject pour le
rendre conforme à son corps glorieux (1), nous apprenait en joignant ainsi la
prière à la fuite, qu'il y a pour nous grande raison de prier quand il y a
raison de fuir. Si saint Matthieu représente d'abord le Sauveur donnant
l'ordre aux disciples d'entrer dans une barque afin de passer de l'autre côté
du lac, pendant que lui même renverrait la foule, et nous le montre ensuite
allant sur la montagne pour y prier seul ; et si saint Jean le montre fuyant
d'abord sur la montagne, et dit seulement ensuite : « Le soir étant venu, ses
disciples descendirent près de la mer, et entrant dans une barque ils
passèrent de l'autre côté, » etc; il n'y a non plus aucune contradiction. Car
ne voit- on pas que pour abréger, et comme on fait souvent, l'Evangéliste
rappelle le voyage commandé aux disciples par Jésus avant sa fuite sur la
montagne? Mais comme il ne dit pas qu'il reprend ici un détail antérieur, et
surtout parce qu'il l'énonce en deux mots, ceux qui lisent ce passage croient
facilement que les choses ont été faites suivant l'ordre où elles sont
exposées. C'est encore ainsi qu'après avoir dit que les disciples étant montés
sur une barque passèrent au delà de la mer et se rendirent à Capharnaüm, cet
Évangéliste raconte que le Sauveur vint à eux marchant sur les eaux lorsqu'ils
ramaient péniblement: tandis que, sans aucun doute ce fut dans le cours même
de leur navigation vers Capharnaüm.
101. Mais après avoir rapporté
le miracle des cinq pains, saint Luc passe à un sujet différent et ne suit
plus le même ordre. Il ne parle pas de la barque ni de
Jésus marchant sur les eaux; et après avoir dit: « Ils en mangèrent et furent
rassasiés; et l'on emporta douze paniers des morceaux qui restaient, » il
ajoute : « Un jour qu'il était seul en prière, ayant ses disciples avec lui,
il leur demanda : Qui le peuple dit-il que je suis (1)? » Ainsi donc tandis
que les trois autres Evangélistes nous montrent Jésus marchant sur les eaux
pour rejoindre ses disciples qui étaient dans la barque, saint Luc rapporte
d'autres faits. Si en disant: « Jésus étant seul en prière, » il paraît
reprendre comme saint Matthieu qui écrit: « Jésus monta sur une montagne pour
prier seul, » ne croyons pas pour cela qu'il s'agisse ici de la même montagne
où le Seigneur demanda: « Qui dit-on que je suis. » Il est hors de doute que
ce l'ut ailleurs, puisqu'en priant seul Jésus avait pourtant ses disciples
avec lui. Car saint Luc en disant qu'alors il était seul, n'exclut pas les
disciples, comme saint Matthieu et saint Jean qui nous les montrent quittant
le Sauveur pour le précéder à l'autre bord de la mer. Aussi cet Évangéliste
ajoute formellement: « Et les disciples étaient avec lui. » Si donc il le dit
seul, c'est pour faire entendre que la foule ne l'accompagnait pas.
102. On lit ensuite dans saint
Matthieu Ayant passé l'eau ils vinrent dans la terre de Génésar. Or, les
habitants ayant connu que c'était Jésus, envoyèrent dans tout le pays et on
lui présenta tous les malades en le priant de permettre qu'ils touchassent
seulement la frange de sa robe. Et tous ceux qui la touchèrent furent guéris.
Alors des Scribes et des Pharisiens venus de Jérusalem s'approchèrent de lui
en disant: Pourquoi vos disciples violent-ils la tradition des anciens ? Car
ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas, » et le reste,
jusqu'aux mots : « Un homme n'est pas souillé pour manger sans s'être lavé les
mains (2). » Saint Marc raconte les mêmes choses sans la moindre contradiction
(3). Partout oit l'un diffère de l'autre pour les termes, il ne laisse pas
d'exprimer la même pensée. Mais tout occupé selon sa coutume des discours du
Seigneur, saint jean quitte la barque où. le Sauveur était monté
183
en marchant sur les eaux, et après avoir parlé de son
arrivé à l'autre bord, il rapporte un entretien long et véritablement divin,
dont le récent miracle des pains fournit l'occasion, puis il porte son vol de
différents côtés (1). Cependant, si différente qu'elle soit, sa marche ne
contredit point l'ordre indiqué par saint Marc et saint Matthieu. Quelle
difficulté de comprendre que le Sauveur guérit les malades dont parlent ces
deux Évangelistes et qu'il adresse au peuple venu à sa suite sur l'autre bord
les discours reproduits par saint Jean, puisque la ville de Capharnaüm, vers
laquelle naviguaient les disciples, selon le texte du même saint Jean, est
tout proche du lac de Génésareth, sur les bords duquel ils débarquèrent,
d'après saint Matthieu?
103. Après avoir rapporté le
discours où Notre-Seigneur répond aux Pharisiens sur le reproche de ne se pas
laver les mains avant le repas, saint Matthieu continuant à suivre dans son
récit l'ordre des faits , comme la transition l'indique , reprend de cette
manière : « Jésus, étant parti de ce lieu-là , se retira du côté de Tyr et de
Sidon. Or, une femme Chananéenne, qui était sortie de ce pays, s'écria :
Seigneur, Fils de David , ayez pitié de moi; ma fille est misérablement
tourmentée par le démon. Mais il ne lui répondit pas un seul mot ; » et le
reste, jusqu'à l'endroit où nous lisons : « O femme , ta foi est grande ;
qu'il te soit fait comme tu le désires. Et sa fille fut guérie à l'heure même
(2). » Saint Marc rapporte ce trait sans une ombre de contradiction , et en
suivant le même ordre. Toute la différence, c'est que d'après son récit, le
Sauveur était entré dans une maison lorsque cette femme vint le prier pour sa
fille (3). On pourrait s'expliquer facilement que saint Matthieu n'ait rien
dit de cette circonstance, tout en rapportant le même fait. Mais comme il nous
apprend que les disciples disaient au Seigneur : « Renvoyez-la, car elle crie
derrière nous ; » ne faut-il pas conclure que cette femme suivait Jésus sur le
chemin en faisant entendre ses cris suppliants? Comment alors était-ce dans
une maison ? Il est
vrai, saint Marc nous dit de la Chananéenne qu'elle entra
où était Jésus, après avoir dit que lui-même était entré dans une maison .
Mais le texte de saint Matthieu porte que Jésus » tout d'abord ne répondit pas
un seul mot . » Ce qui donne à connaître une chose qui n'est rappelée ni par
l'un ni par l'autre ; c'est que sans rompre son silence, Notre-Seigneur sortit
de cette maison . Dès lors tout le reste se lie facilement dans les deux
récits et n'offre plus la moindre opposition . Car saint Marc, en faisant
répondre. au Seigneur qu'il ne fallait pas jeter aux chiens le pain des
enfants, laisse place aux particularités relevées par saint Matthieu , savoir
, que les disciples intercèdent pour cette femme , que Jésus répondit n'avoir
été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël , qu'elle-même vint
près de lui, le suivit, l'adora et lui dit : « Seigneur, aidez-moi . » A
partir de là, ce sont les mêmes circonstances dans les deux Evangélistes .
104. Saint Matthieu reprend
ainsi : « Jésus étant sorti de là , vint près de la mer de Galilée ; puis
ayant gagné le haut d'une montagne il s'y assit. Or de grandes troupes de
peuple vinrent le trouver, amenant des muets, des aveugles, des boiteux , des
estropiés et beaucoup d'autres malades, qui furent mis aux pieds de Jésus; et
il les guérit. De sorte que tout le monde était dans l'admiration en voyant
que les muets parlaient, que les boiteux marchaient, que les aveugles avaient
recouvré la vue; et tous rendaient gloire au Dieu d'Israël. Mais Jésus ayant
appelé ses disciples leur dit: J'ai compassion de ce peuple, « parce que déjà
depuis trois jours il demeure avec moi et n'a rien à manger; » et le reste,
jusqu'à l'endroit où nous lisons: « Or le nombre de ceux qui mangèrent était
de quatre mille hommes, sans compter ni les petits enfants ni les femmes (1).
» Ce nouveau miracle d'une foule nombreuse nourrie avec sept pains et quelques
poissons, saint Marc le rappelle aussi, et à-peu-près dans le même ordre;
seulement il en fait précéder le récit d'une action dont nul autre que lui ne
dit rien; c'est la guérison du
184
sourd à qui Notre Seigneur ouvrit les oreilles en
crachant et en disant : « Effet, ouvrez-vous (1). »
105. A propos de ce miracle
des sept pains, raconté par deux évangélistes, saint Matthieu et saint Marc,
il ne sera pas inutile de faire observer, que si l'un d'eux en avait parlé
sans avoir rien dit de celui des cinq pains, on le croirait en opposition avec
les autres. Aussi bien qui n'aurait pas alors l'idée qu'il s'agit d'un seul et
même fait, rapporté d'une manière inexacte soit par un des évangélistes, soit
par les trois autres, soit par tous en même temps ? Qui ne croirait que
celui-ci a dit sept pains au lieu de cinq, ou ceux-là cinq au lieu de sept, ou
enfin que tous ensemble ont voulu tromper ou ont été trompés par une mémoire
infidèle? pour le nombre des corbeilles, les uns en comptant douze et l'autre
sept, on estimerait aussi qu'il y a contradiction; on ferait de même pour le
nombre des hommes qui, suivant les uns, serait de cinq mille et suivant
l'autre de quatre mille. Mais, comme les évangélistes qui ont rapporté ce
miracle des sept pains n'ont p as omis celui des cinq pains , il ne peut y
avoir de difficulté, et tout le monde comprend qu'il s'agit d'un double
miracle. Nous faisons cette remarque, afin que si l'on trouve ailleurs, entre
deux évangélistes, et pour certains faits de la vie du Sauveur, la même
apparence de contradiction et qu'il soit également impossible de la faire
disparaître, on comprenne qu'il s'agit alors de deux choses distinctes, dont
chacune est rapportée séparément par un des écrivains sacrés. C'est ce que
nous avons déjà dit plus haut, quand il a été question des groupes de
cinquante et de cent personnes, parce que là aussi nous pourrions croire
opposés l'un à l'autre les évangélistes, si l'un en faisant mention des
groupes de cent, ne parlait encore des groupes de cinquante (2).
106. Saint Matthieu dit
ensuite: « Après cela Jésus ayant renvoyé le peuple monta sur une barque et
vint au pays de Magédan, » et le reste, jusqu'à l'endroit où nous lisons: «
Cette nation corrompue et adultère demande un prodige, et il ne lui en sera
point donné d'autre que celui du prophète Jonas (3).
C'est une réponse que déjà nous avons trouvée dans le
texte du même saint Matthieu (1). Il faut donc rappeler de plus en plus que
Notre-Seigneur a souvent redit les mêmes choses, et que si certaine
circonstance est tellement opposée à une autre, c'est qu'il s'agit d'une
pensée exprimée plusieurs fois. Saint Marc suit le même ordre; et, après avoir
parlé du miracle des sept pains, lui aussi rapporte ce que dit ici saint
Matthieu. Il est vrai que dans ce dernier nous lisons Magédan et non
Dalmanutha, comme dans quelques exemplaires de saint Marc (2). Mais il ne
faut pas douter que les deux noms désignent le même lieu; puisque la plupart
des exemplaires de saint Matthieu ne portent que Magédan. Si dans la
réponse du Sauveur à ceux qui lui demandaient un prodige dans le ciel, saint
Marc ne parle pas de Jonas, comme saint Matthieu; s'il dit simplement: « Il ne
lui sera point donné de prodige; » à il n'y a pas là non plus matière à
difficulté; car il s'agit d'un prodige tel qu'on le demandait, c'est-à-dire un
prodige dans le ciel; et ce qui regarde Jonas, n'est qu'une omission.
107. Saint Matthieu continue
ainsi: « Et les laissant là il s'en alla. Or ses disciples, étant passés à
l'autre bord du lac, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit:
Gardez
vous du levain des Pharisiens et des Sadducéens , » et le
reste, jusqu'à ces mots: « Alors ils comprirent que Jésus ne leur avait pas
dit de se garder du levain qui entre dans le pain, mais de la doctrine des
Pharisiens et des Sadducéens (3). » Le texte de saint Marc nous offre le même
récit dans le même ordre (4).
108. Saint Matthieu poursuit
ainsi: « Or Jésus vint aux environs de Césarée de Philippe; et il demanda à
ses disciples: Que disent les hommes du Fils de l'homme? Et les disciples lui
répondirent: Les uns disent que c'est Jean-Baptiste; les autres, Elie; les
autres, Jérémie ou quelqu'un des prophètes; » et le
185
reste, jusqu'à l'endroit où nous lisons: « Ce que vous
délierez sur la terre sera aussi délié dans le ciel (1). » Saint Marc rapporte
le même événement à-peu-près dans le même ordre; mais il expose auparavant un
fait dont lui seul a parlé, savoir, la guérison de cet aveugle qui répondit au
Seigneur: « Je vois les hommes qui marchent semblables à des arbres (2). »
C'est après avoir parlé du miracle des cinq pains que saint Luc rappelle à sa
mémoire et rapporte la question du Sauveur et la réponse des disciples (3).
Mais en suivant l'ordre de ses souvenirs,, il ne contredit nullement l'ordre
des autres évangélistes. On pourrait, il est vrai, se demander comment,
d'après saint Luc, le Seigneur priait et se trouvait seul avec ses disciples
quand il leur demanda ce que les hommes disaient de lui; tandis que selon
saint Marc; ce fut dans le chemin. Mais ceci n'est une difficulté que pour
celui qui ne prie jamais en marchant.
109. J'ai, du reste, il m'en
souvient, averti plus haut le lecteur de ne pas croire que Simon reçut le nom
de Pierre quand Jésus lui dit : « Tu es Pierre et sur cette Pierre je bâtirai
mon Eglise (4). » Car il est certain que ce nom lui fut donné lorsque, d'après
saint Jean, le Sauveur lui dit: « Tu t'appelleras Céphas ; c'est-à-dire Pierre
(5). » Il ne faut donc pas croire non plus que ce fut au moment où en
rappelant les noms des douze Apôtres, saint Marc dit que Jacques et Jean
furent appelés fils du tonnerre (6). C'est bien là que l'évangéliste parle du
nom de Pierre donné à Simon ;mais il le dit parce qu'il se le rappelle et non
parce que le fait vient d'avoir lieu.
110. On lit ensuite dans saint
Matthieu ; « En même temps Jésus défendit à ses disciples de dire à personne
qu'il fût le Christ. Puis il commença à leur découvrir qu'il lui fallait aller
à Jérusalem et y souffrir beaucoup de la part des anciens et des docteurs de
la loi ; » et le reste, jusqu'à ces mots : « Tu ne goûtes point les choses de
Dieu, mais celles des hommes (7). »
Saint Marc et saint Luc rapportent les mêmes faits dans le même ordre
(8) : seulement saint Luc omet de dire que Pierre s'opposa à la passion du
Christ.
111. Saint Matthieu continue
ainsi : « Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive : » et le reste,
jusqu'à ces mots: « Et il rendra à chacun selon ses oeuvres (1). » Ceci est
exposé par saint Marc dans le même ordre: mais cet évangéliste ne relève pas
ce qui est dit du Fils de l'homme, qu'il doit venir avec ses anges pour rendre
à chacun selon ses œuvres. Pourtant il nous fait lire dans le discours de
Notre-Seigneur : « Quiconque. aura rougi de moi et de ma parole au milieu de
cette nation adultère et corrompue, le Fils de l'homme de son côté rougira de
lui quand il viendra dans sa gloire accompagné des saints anges (2). » Ce
qu'on peut rapporter à cette pensée du texte de saint Matthieu . « Alors le
Fils de l'homme rendra à chacun selon ses oeuvres. » Saint Luc aussi rapporte
tout cela dans le même ordre. Il diffère peu de saint Marc dans la forme du
récit : et quant au fond il n'en diffère nullement (3).
112. Saint Matthieu poursuit
ainsi : « Je vous le dis en vérité, plusieurs de ceux qui m'en«: tendent ne
goûteront point la mort qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir en son
règne. Six jours après; Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère
et les mena à l'écart sur une haute montagne ; » et le reste, jusqu'à
l'endroit où nous lisons : « Ne parlez à personne de ce que vous venez de
voir, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts (4). »
Cette transfiguration du Seigneur sur une montagne, devant les trois
disciples, Pierre, Jacques et Jean, avec le témoignage que lui rendit la voix
de son Père, se trouve également racontée par les trois évangélistes, dans le
même ordre et saris nulle différence pour le fond (5). D'après ce que nous
avons dit et répété plusieurs fois, on peut en lisant les trois récits
remarquer que les expressions différentes ne changent rien aux pensées.
186
113. Néanmoins il est des
esprits qui ne voient pas comment saint Matthieu et saint Marc disent que le
fait arriva six jours après, quand il s'agit de huit jours dans le texte de
saint Luc. Nous ne devons pas leur répondre par le mépris ; mais les instruire
en leur faisant connaître la raison de cette différence. En effet, quand on
dit qu'une chose arrivera dans tant de jours, quelquefois on ne compte ni le
jour présent ni celui où elle doit avoir lieu, mais seulement les jours
intermédiaires, les jours pleins et entiers après lesquels elle arrivera.
C'est ce qu'ont fait saint Matthieu et saint Marc. Ils ont exclu et le jour où
le Sauveur parlait et celui de l'événement, et n'ayant égard qu'aux jours
intermédiaires ils disent : « Six jours après; » tandis que saint Luc en
comptant les deux jours exceptés par eux, savoir le premier et le dernier, et
en suivant le mode de langage où la partie se prend pour le tout, nous fait
lire : « Huit jours après. »
114. De même quand saint Luc
dit en parlant de Moïse et d'Elie : « Comme ils se séparaient de Jésus, Pierre
lui dit : Maître, nous sommes bien ici, » et le reste ; il ne faut point
penser qu'il est contredit par les textes de saint Matthieu et de saint Marc,
qui sembleraient indiquer que Moïse et Elie s'entretenaient encore avec le
Seigneur lorsque l'Apôtre tint ce langage. Car leur texte ne dit pas que ce
fut alors, et il permet de croire, comme le rappelle saint Luc, que ce fut au
moment de la retraite de Moïse et d'Elfe, que Pierre par la à Jésus des trois
tentes. Saint Luc ajoute aussi que Moïse et Elie entraient dans la nuée,
lorsque la voix du ciel se fit entendre. Saint Matthieu et saint Marc n'en
parlent pas, mais ils ne disent rien non plus de contraire.
115. On lit ensuite dans saint
Matthieu : « Alors ses disciples l'interrogèrent et lui dirent : Pourquoi donc
les Scribes disent-ils qu'il faut qu'Elfe vienne d'abord ? Jésus leur répondit
: Il est vrai qu'Elfe doit venir et qu'il rétablira toutes choses. Mais je
vous déclare aussi qu'Elie est déjà venu, et ils ne l'ont point connu, mais
ils l'ont traité comme il leur a plu.
Ils feront de même souffrir le Fils de l'homme. Alors les disciples
comprirent que c'était de Jean-Baptiste qu'il leur avait parlé (1). » Saint
Marc relève ce trait en gardant le même ordre. Il offre
bien quelque différence pour les termes, mais il exprime exactement les mêmes
pensées (1). Seulement il ne rapporte pas que les disciples comprirent que le
Sauveur avait voulu désigner Jean-Baptiste en leur disant : « Elie est déjà
venu. »
116. Saint Matthieu continue
ainsi: « Lorsqu'il fut retourné vers le peuple, un homme s'approcha de lui, et
tombant à genoux devant lui Seigneur, dit-il, ayez pitié de mon fils qui est
lunatique et souffre beaucoup, » et le reste, jusqu'à l'endroit où nous lisons
: « Cette sorte de démons ne se chasse que par la prière et par le jeûne (2).
» C'est ce que rapportent également saint Marc et saint Luc, sans donner lieu
à la moindre difficulté (3).
117. Saint Matthieu continue
ainsi : « Comme ils étaient dans la Galilée, Jésus leur dit : Le Fils de
l’homme doit être livré aux mains des hommes ; et ils le feront mourir, et il
ressuscitera le troisième jour : ce qui les affligea extrêmement (4). » C'est
ce que rappellent aussi, dans le même ordre saint Marc et saint Luc (5).
118. Saint Matthieu dit
ensuite : « Comme ils étaient arrivés à Capharnaüm, ceux qui levaient le
tribut des deux dragmes vinrent dire à Pierre :
Votre maître ne paie-t-il pas le tribut ? Il leur répondit : Oui; » et
le reste, jusqu'à l'endroit où nous lisons : « Tu y trouveras un statère, que
tu prendras et que tu leur donneras pour moi et pour toi (6). » Il est seul
pour rapporter ce fait ; il reprend ensuite la même route que saint Marc et
saint Luc.
187
119. Saint Matthieu continue
donc ainsi : «En ce même temps les disciples s'approchèrent de Jésus et lui
dirent : Quel est selon vous le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus
ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux ; et il leur parla de
cette manière : Je vous dis en vérité que si vous ne changez et si vous ne
devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des
cieux, » et le reste, jusqu'aux mots : « C'est ainsi que vous traitera mon
Père qui est dans le ciel, si chacun de vous ne pardonne à son frère du fond
du coeur (1). » Ce discours dépasse un peu l'étendue ordinaire: saint Marc en
reproduit quelques pensées, dans le même ordre que saint Matthieu ; il y en
ajoute d'autres que celui-ci a négligées (2). Il est certain, en effet, que le
discours de Jésus-Christ en cette rencontre s'étend, dans le texte de saint
Matthieu, jusqu'à l'endroit marqué par notre citation, et ne se trouve
interrompu que par cette demande de Pierre : « Combien de fois pardonnerai-je
à mon frère quand il aura c péché contre moi ? » Car le sujet traité ici par
le Seigneur indique assez clairement que la question de Pierre et la réponse
que lui fit le Sauveur font partie de ce discours. Si ce n'est la circonstance
du petit enfant proposé à l'imitation des disciples, quand il leur vint dans
l'esprit de se demander quel était le plus grand parmi eux, saint Luc ne
rapporte rien, dans la même suite, de ce que nous offre le texte de saint
Matthieu (3). S'il rapporte ailleurs des pensées analogues à ce que nous
rencontrons ici, il les cite comme ayant été exprimées dans des occasions
différentes. Ainsi encore, d'après saint Jean, c'est après sa résurrection que
le Sauveur parla à ses Apôtres du pardon des péchés, du pouvoir de les
remettre ou de les relever (4) ; quand d'après saint Matthieu ce fut dans le
discours qui nous occupe, et quand il en avait déjà parlé précédemment à
Pierre (5). Comme nous l'avons fait observer tant de fois jusqu'ici, et afin
qu'il ne soit pas toujours nécessaire d'en avertir, nous devons nous rappeler
que Jésus a souvent et en différentes circonstances répété les mêmes choses ;
et ne nous inquiétons pas s'il arrive aux évangélistes de les présenter
quelquefois dans un ordre qui semble contradictoire.
120. Saint Matthieu continue
ainsi : « Il arriva , lorsque Jésus eut achevé ces discours, qu'il partit de
Galilée et vint aux confins de la Judée, au-delà du Jourdain ; et de grandes
troupes le suivirent, et il les guérit. Et les Pharisiens s'approchèrent de
lui pour le tenter disant. Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour
quelque cause que ce soit? » et le reste, jusqu'à ces mots : « Que celui qui
peut comprendre comprenne (1). » Saint Marc rappelle les mêmes faits dans le
même ordre (2). Voici comment il faut examiner ce passage, pour n'y voir
aucune contradiction . D'après saint Marc, de Seigneur demande aux Pharisiens
ce que Moïse leur a ordonné, et ceux-ci lui répondent que l'acte de
répudiation leur a été permis : dans saint Matthieu le Seigneur cite d'abord
les paroles de la Loi, pour montrer que Dieu à uni l’homme et la femme et que
pour cette raison nul ne peut les séparer, puis les autres lui adressent cette
question : « Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de lui donner un acte de
répudiation et de la renvoyer ? » Alors il ajoute : « C'est à cause de la
dureté de vos coeurs que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes, mais au
commencement il n'en fut pas ainsi. » Saint Marc n'a point omis cette réponse
du Seigneur, mais elle vient seulement après qu'on a répondu à sa question sur
l'acte de divorce.
121. Dans quel ordre, pour
l'intelligence du récit, faut-il disposer ces différentes expressions?
N'ont-ils interrogé le Seigneur, qu'après qu'il eut condamné la séparation en
s'appuyant sur le témoignage de la Loi ? est-ce alors qu'ils l'ont questionné
sur l'acte de répudiation qu'avait permis Moïse, après avoir écrit toutefois
que Dieu avait uni l'homme et la femme 3 ? Ou bien ont ils eux-mêmes parlé de
cet acte quand le Seigneur leur demanda ce qu'avait commandé Moïse ? Ceci
importe peu à la vérité ici établie. En effet, le Seigneur ne voulait point
leur expliquer pourquoi Moïse avait accordé ce droit, avant qu'ils ne lui en
eussent eux-mêmes parlé, et cette intention, saint Marc la fait connaître par
la question qu'il lui fait poser : pour eux leur droit était de s'appuyer sur
l'autorité de
188
Moïse qui avait ordonné l'acte de répudiation, afin de
surprendre Jésus lorsqu'il condamnerait la séparation des époux: voilà ce
qu'ils se proposent quand ils s'approchent de lui pour le tenter. Cette
intention est si nettement exprimée en saint Matthieu, qu'il ne dit rien de la
question qui leur est faite, mais ils provoquent eux-mêmes une explication sur
la permission donnée par Moïse afin de pouvoir accuser le Seigneur lorsqu'il
condamnera la séparation des époux. Puisque les expressions, dans chaque
évangéliste, rendent exactement la pensée des interlocuteurs, et elles ne
doivent tendre qu'à ce but, il est de nulle importance que l'ordre dans les
différents récits ne soit point le même, puisque ni l'un ni l'autre ne
s'écarte de la vérité
122. Ou peut aussi expliquer
ce passage de la manière suivante : après avoir été questionné sur le renvoi
de la femme, comme saint Marc le raconte, le Seigneur de son côté leur demande
ce qu'a ordonné Moïse. Quand ils ont répondu que Moïse a permis de donner
l'acte de répudiation et de la renvoyer, alors il s'appuie sur la Loi donnée
par Moïse pour expliquer comment Dieu institua le mariage de l'homme et de la
femme; il dit alors ce qui est écrit en saint Matthieu : « N'avez-vous pas lu
que celui qui fit l'homme au commencement les fit mâle et femelle ? » etc. A
ces mots ils insistent de nouveau sur ce qu'ils ont répondu à sa première
question : « Pourquoi donc, disent-ils, Moïse a-t-il ordonné de lui donner
l'acte de répudiation et de la renvoyer? » Jésus alors en découvre la cause
dans la dureté de leur coeur. Saint Marc, pour abréger, exprime d'abord cette
idée comme si elle eût été donnée immédiatement après leur première réponse,
que saint Matthieu a divisée ; et il ne jugeait point que la vérité dût
souffrir, quelle que fût la place qu'occuperait cette raison, puisque les
paroles qui la provoquaient étaient répétées et que d'ailleurs le Sauveur
l'avait exprimée en termes formels.
123. Saint Matthieu continué :
« Alors on lui présenta de petits enfants pour qu'il leur imposât les mains et
priât. Orles disciples les repoussaient, » etc, jusqu'à ces paroles : « Car
beaucoup sont appelés, mais peu sont élus (1). Saint Marc
a gardé le même ordre (2) que saint Matthieu ; mais ce dernier seul fait
mention des ouvriers loués pour la vigne. Saint Luc, après avoir rapporté la
réponse faite par Jésus à ses disciples lorsqu'ils cherchaient à savoir quel
était le plus grand d'entre eux, parle de celui qu'on avait vu chassant les
démons sans être à la suite de Jésus . Désormais il s'écarte des deux autres
Evangélistes à l'endroit où il dit que le Sauveur avait fixé son visage pour
aller à Jérusalem (3). Longtemps après, il s'en rapproche pour parler de ce
riche à qui il fut dit: « Vends tout ce que tu possèdes (4).» Les deux autres
en parlent également et dans le même ordre, qu'ils observent désormais; car
saint Luc fait paraître comme eux les petits enfants avant de parler du riche.
Quand ce dernier demande quel bien il doit accomplir pour posséder la vie
éternelle, on pourrait constater une différence entre ce qui est dit en saint
Matthieu : « Pourquoi
m'interroges-tu sur ce qui est bon » ? et ce que les autres ont écrit :
« Pourquoi m'appelles-tu bon ? » Car ces mots : « Pourquoi m'interroges-tu sur
ce qui est bon ? » paraissent mieux répondre à cette question qui est faite à
Jésus : « Que ferai-je de bon ? » puisque dans cette question se trouve le
terme de bon. Mais ces mots : « Bon maître, » n'annoncent par eux-mêmes aucune
interrogation. Le plus simple est donc de croire
que le Sauveur a dit tout à la fois : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? »
et : « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? »
124. Saint Matthieu continue
ainsi : « Or Jésus montant à Jérusalem prit à part les douze disciples et leur
dit : Voilà que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux
princes des prêtres et aux Scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le
livreront aux Gentils, pour être moqué, et flagellé, et crucifié; et le
troisième jour il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha
de lui avec ses fils, l'adorant et lui demandant quelque chose, et le reste,
jusqu'à ces mots : « Comme le fils de l'homme n'est point venu pour être
servi, mais pour servir, et donner sa vie pour la
189
rédemption d'un grand nombre (1). » C'est en suivant cet
ordre que saint Marc fait dire aux fils de Zébédée ce qu'en saint.Matthieu ils
expriment non point par eux-mêmes mais par leur mère, lorsque celle-ci expose
leur désir au Seigneur. Aussi saint Marc, pour abréger, les fait-il parler
plutôt que leur mère , et dans saint Matthieu comme dans saint Marc, c'est à
eux plutôt qu'à la mère que le Seigneur répond. Quant à saint Luc, il rapporte
dans le même ordre les prédictions faites aux douze disciples sur la Passion
et la Résurrection; mais il omet ce qui vient à la suite dans les autres, qui
après ces détails se retrouvent avec lui devant Jéricho (2). Ce que saint
Matthieu et saint Marc disent des chefs des nations qui dominent leurs sujets,
tandis qu'il n'en sera pas ainsi parmi eux où le plus grand devra être le
serviteur des autres, saint
Luc, le rapporte dans les mêmes termes, mais non pas au même endroit
(3), et la marche même indique suffisamment que le Seigneur a exprimé cette
pensée à deux reprises différentes.
125. Saint Matthieu continue :
« Lorsqu'ils sortaient de Jéricho une grande foule le suivit: et voilà quo
deux aveugles, assis sur le bord du chemin, entendirent que Jésus passait. Et
ils élevèrent la voix, disant: Seigneur, fils de David, ayez pitié de nous, ».
etc, jusqu'à, ces paroles : « Et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et le
suivirent (4). » Saint Marc rapporte le même fait, mais ne mentionne qu'un
seul aveugle (5). A cette difficulté nous répondrons, comme déjà nous avons
répondu, au sujet des deux possédés que tourmentait une légion de démons au
pays des Géraséniens (6). De. ces deux aveugles qui paraissent ici, l'un était
en effet très-connu dans la ville, son nom était dans toutes les bouches ;
c'est ce que saint Marc donne à entendre en le nommant ainsi que son père ; ce
qui s'est fait rarement, car malgré le grand nombre de malades précédemment
guéris parle Seigneur, l'Évangile n'appelle par son nom que Jaïre, dont Jésus
ressuscita la fille (7) : et ceci confirme notre sentiment, puisque ce chef de
synagogue était un grand du pays. Donc sans aucun doute, ce Bartimée fils de
Timée avait été autrefois dans la
prospérité, et la misère dans laquelle il était tombé
avait eu un grand retentissement, non-seulement parce qu'il était devenu
aveugle, mais parce qu'il était assis demandant l'aumône. Tel est le motif
pour lequel saint Marc n'a désigné que lui par son nom. Le miracle qui lui
rendait la vue dût avoir d'autant plus d'éclat, que son malheur était partout
connu.
126. Quoique saint Luc raconte
un fait entièrement semblable, il faut cependant croire qu'il s'agit d'un
autre miracle, accompli dans les mêmes circonstances, mais sur un autre
personnage. En effet, saint Luc dit que le prodige eut lieu lorsqu'on
approchait de Jéricho (1) ; et les autres, quand on en sortait. D'après le nom
de la ville et la parfaite ressemblance du fait on pourrait croire à un seul
miracle, mais ce serait établir une contradiction entre les Evangélistes,
puisque l'un dit: « Lorsqu'il approchait de Jéricho, » elles autres : «
Lorsqu'il sortait de Jéricho. » Il n'y aurait pour le croire que ceux qui
préfèrent trouver l'Évangile en défaut, plutôt que de convenir que Jésus a
fait dans les mêmes circonstances deux miracles parfaitement semblables. Mais
tout enfant fidèle de l'Évangile saura facilement ce qu'il doit croire, ce qui
est plus conforme à la vérité ; et celui qui aime à contester devra se taire
devant ces explications ou au moins réfléchir s'il ne sait garder le silence.
127. Saint Matthieu continue :
« Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent venus à Bethphagé,
près du mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples, leur disant : Allez au
village qui est devant vous, et soudain vous trouverez une ânesse attachée, et
son ânon avec elle; » etc, jusqu'à ces paroles : « Béni celui qui vient au nom
du Seigneur (2). » Saint Marc suit la même marche dans son récit (3). Saint
Luc s'arrête à Jéricho et raconte ce que les autres ont ici passé sous
silence, savoir l'histoire de Zachée, chef des publicains, et quelques
paraboles : puis avec eux il parle de l'ânon sur lequel s'assit Jésus (4). Ne
soyons point embarrassés de ce qu'il y a dans saint Matthieu une ânesse et son
ânon, tandis que les autres ne font aucune mention de l'ânesse. Mais
rappelons-nous la
190
règle que nous avons indiquée plus haut, au sujet des
personnes que l'on fit asseoir par groupes de cent et de cinquante, lorsque la
foule fut nourrie avec cinq pains (1). Le lecteur guidé par cette règle ne
devra éprouver aucune difficulté, quand même saint Matthieu aurait passé
l'ânon sous silence comme les autres y ont passé l'ânesse . Si l'un avait
seulement désigné celle-ci, et l'autre celui-là, on ne devrait y voir aucune
contradiction. La difficulté ne sera-t-elle pas moindre encore, si l'un nomme
l'ânesse dont les autres ne font point mention et désigne en même temps l'ânon
mentionné par ceux-ci ? Dès lors que deux choses ont pu avoir lieu en même
temps, il n'y a plus d'objection à faire si l'un raconte la première et
l'autre la seconde ; à plus forte raison si l'un raconte l'une des deux et
l'autre toutes les deux à la fois.
128. Saint Jean ne dit point
comment le Seigneur envoya chercher ces deux animaux; cependant il indique en
peu de mots qu'il y avait un ânon, et cite le passage du prophète également
rapporté par saint Matthieu (2). Si donc le texte du prophète présente une
légère différence avec celui des Evangélistes, on peut dire que la pensée
n'est point différente. Mais la difficulté est plus sérieuse, parce que saint
Matthieu fait paraître l'ânesse dans le passage qu'il cite du prophète, tandis
qu'il n'en est pas question dans la même citation qu'en fait saint Jean, ni
dans les manuscrits dont se servent les Eglises. On peut, je crois, expliquer
cette différence, par la raison que saint Matthieu, comme on le sait, écrivit
en hébreu son Evangile. Or il est certain que la version des Septante ne
s'accorde pas toujours avec le texte hébraïque, comme ont pu le constater ceux
qui connaissent cette langue et qui ont entrepris de traduire chacun en
particulier ces mêmes livres écrits en hébreu. Veut-on savoir encore la raison
de cette différence, et chercher pourquoi cette version des Septante, qui
jouit d'une si grande autorité, s'écarte en tant d'endroits du sens rigoureux
exprimé dans les manuscrits hébraïques? Voici la raison qui me parait la plus
probable. Les Septante ont été inspirés dans ce travail par le même Esprit qui
a révélé les vérités contenues dans le texte à traduire : la preuve en est
dans leur accord si admirable, attesté par l'histoire. Aussi, malgré quelques
variétés d'expressions, comme ils ne se
sont point écartés de la pensée divine, écrite en ces
livres et à laquelle doit se plier le langage, ils nous offrent un nouvel
exemple de ce que nous admirons aujourd'hui dans le récit à la fois si varié
et si uniforme des quatre évangélistes car on ne peut accuser de fausseté un
auteur dont les expressions diffèrent de celles d'un autre, s'il ne s'écarte
point de sa pensée lorsqu'il doit exprimer les mêmes faits, les mêmes idées.
Ce principe, très-utile dans le cours de la vie pour éviter ou condamner
l'imposture, ne l'est pas moins en matière de foi. Ne croyons pas, en effet,
que la vérité soit attachée à des sons qui seraient comme consacrés et que
Dieu nous recommande les mots comme la pensée qu'ils doivent exprimer : bien
loin de là, les vérités sont tellement supérieures aux formes de langage qui
doivent les reproduire, que nous ne devrions point nous mettre en peine de
chercher ces formes, si nous pouvions, sans elles, connaître la vérité comme
Dieu la connaît et comme les anges la connaissent en lui.
129. Saint Matthieu continue,
ainsi : « Lorsqu'il fut entré dans Jérusalem, toute la ville s'émut,
demandant: Qui est celui-ci? Et la multitude répondait : C'est Jésus, le
Prophète, de Nazareth en Galilée. Et Jésus entra dans le temple de Dieu, et
chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, » etc, jusqu'à
cet endroit : « Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Tous
les évangélistes parlent de cette troupe de vendeurs chassés du temple, mais
saint Jean suit un ordre bien différent (1). Après avoir rapporté le
témoignage que saint Jean-Baptiste rendit à Jésus, il fait aller le Seigneur
en Galilée, où il change l'eau en vin; puis, après s'être arrêté quelques
jours à Capharnaüm, le Seigneur vient à Jérusalem, au temps de la Pâque des
Juifs, et là, ayant fait un fouet avec des cordes; il chasse les vendeurs du
temple. D'où il faut conclure que le fait n'eut pas lieu une seule fois, et
que le Seigneur le renouvela ensuite. Saint Jean raconte le premier de ces
événements, et les autres le dernier.
191
130. Saint Matthieu continue
ainsi: « Et des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple,
et il les guérit. Mais les princes des prêtres et les Scribes, voyant les
merveilles qu'il faisait, et les enfants qui criaient dans le temple et
disaient : Hosanna au fils de David, s'indignèrent et lui dirent :
Entendez-vous ce que disent ceux-ci? Jésus leur répondit : Oui. « N'avez-vous
jamais lu : C'est de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle,
que vous avez tiré la louange la plus parfaite ? Et les ayant quittés, il s'en
alla hors de la ville, à Béthanie, et s'y arrêta. Le lendemain matin, comme il
revenait à la ville, il eut faim. Or apercevant un figuier près du chemin, il
s'en approcha, et n'y trouvant rien que des feuilles, il lui dit : Que jamais
fruit ne naisse de toi à l'avenir. Et à l'instant le figuier sécha. Ce
qu'ayant vu, les disciples s'étonnèrent, disant Comment a-t-il séché sur le
champ? Alors Jésus, prenant la parole, leur dit : En vérité, je vous le
déclare, si vous avez de la foi, et que vous n'hésitiez point, non-seulement
vous ferez comme à ce figuier, mais môme si vous,
dites à cette montagne : Lève-toi, et jette-toi à la mer,
cela. se fera : et tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous
l'obtiendrez (1). »
131. Nous retrouvons le môme
fait dans saint Marc, mais il n'y est point raconté dans le même ordre.
D'abord saint Matthieu fait entrer Jésus dans le temple, d'où il chasse les
vendeurs et les acheteurs : saint Marc, sans parler de cette circonstance, dit
qu'ayant regardé toutes choses, comme le soir était venu, il se retira à
Béthanie avec les douze. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut
faim, et maudit le figuier c'est ce que dit saint Matthieu ; mais saint Marc
ajoute qu'étant vent à Jérusalem et étant entré dans le temple, il en chassa
les vendeurs et les acheteurs, comme si le fait avait eu lieu ce jour-là et
non la veille (2). Saint Matthieu précise mieux la suite des événements : « Et
les ayant quittés, dit-il, il s'en alla hors de la ville à Béthanie, et s'y
arrêta; » et c'est en revenant le lendemain à la ville, qu'il maudit le
figuier. C'est donc saint Matthieu qui parait avoir
mieux fixé le moment véritable où les acheteurs furent
chassés du temple. En effet, lorsqu'il dit : « Et les ayant quittés, il s'en
alla dehors, » ces mots : « les ayant quittés, » ne peuvent s'entendre que de
ceux à qui il venait de parler, et qui s'indignaient d'entendre les enfants
crier : « Hosanna au fils de David. » Saint Marc a donc passé sous silence ce
qui avait eu lieu le premier jour, lorsque Jésus entra dans le temple; mais se
l'étant ensuite rappelé, il le raconte après avoir dit que Jésus n'avait
trouvé sur le figuier que des feuilles; ce qui arriva le second jour, comme
tous deux l'affirment.
L'étonnement des disciples à
la vue de l'arbre desséché, et la réponse du Seigneur sur la foi qui
transporte les montagnes, ne se rapportent point au second jour, où il est dit
à l'arbre : « Que jamais personne ne mange plus de fruit venant de toi; » mais
bien au troisième jour. En effet, le même saint Marc fait au second jour
l'histoire des vendeurs chassés du temple, laquelle appartient évidemment au
premier. Et en ce même jour il dit expressément que, le soir étant venu, Jésus
sortit de la ville, et comme le lendemain matin ses disciples passaient, ils
virent le figuier desséché jusqu'à la racine; c'est alors que Pierre se
souvenant de ce qui s'était passé, dit au Seigneur : « Maître, comme a séché
le figuier que vous avez maudit! » Alors Jésus lui parla de la puissance de la
foi. D'après saint Matthieu on pourrait croire que tout ceci s'est passé le
second jour, quand il fut dit à l'arbre : « Jamais fruit ne naîtra de toi à
l'avenir; » qu'à l'instant cet arbre sécha, et que, comme les disciples le
voyaient et s'en étonnaient, ils entendirent immédiatement la réponse sur la
puissance de la foi.
Il faut conclure de tout ceci
que saint Marc a rapporté au second jour ce qu'il avait omis dans le récit du
premier, l'histoire des vendeurs et des acheteurs chassés du temple. Saint
Matthieu, de son côté, ayant dit que le figuier avait été maudit le second
jour, quand le matin Jésus retournait de Béthanie à la ville, passe sous
silence ce qu'ajoute saint Marc, savoir que le Seigneur vint encore à la
ville, qu'il en sortit de nouveau le soir, et que le lendemain matin, en
passant, les disciples s'étonnèrent de voir cet arbre desséché. Mais ayant
rapporté ce qui avait eu lieu le second jour, la malédiction prononcée contre
le figuier, il ajoute immédiatement ce qui n'eut lieu que le troisième,
l'étonnement des disciples (192) en le voyant desséché, et la réponse du
Seigneur sur la puissance de la foi. Ces faits sont tellement rapprochés, que
sans le récit de saint Marc qui fixe notre attention, on ne pourrait découvrir
ni les faits omis par saint Matthieu, ni l'époque où ils se sont accomplis.
Voici d'ailleurs comment ce dernier s'exprime, « Et les ayant quittés, il s'en
alla hors de la ville à Béthanie, et s'y arrêta. Le lendemain matin, comme il
revenait à la ville, il eut faim. Or, apercevant un figuier près du chemin, il
s'en approcha; et n'y trouvant rien que des feuilles il lui dit : Que jamais
fruit ne naisse de toi à l'avenir. Et à l'instant le figuier sécha. » Puis,
omettant les autres événements du jour, il ajoute : « Ce qu'ayant vu, les
disciples s'étonnèrent, disant : Comment a-t-il séché sur le champ? » quoique
ceux-ci n'aient remarqué et admiré cela qu'un autre jour. On le comprend;
l'arbre ne s'est point desséché quand ils l'ont vu, mais aussitôt après qu'il
fut maudit, car ils ne le virent point se dessécher, mais complètement
desséché, et ils comprirent qu'il avait commencé à sécher à la parole du
Seigneur.
132. Saint Matthieu continue
ainsi : « Or quand il fut dans le temple, les princes des prêtres et les
anciens du peuple s'approchèrent de lui tandis qu'il enseignait, et dirent :
Par quelle autorité faites-vous ces choses? Et qui vous a donné ce pouvoir?
Jésus répondant leur dit : Je vous ferai, moi aussi, une demande; si vous y
répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de
Jean, d'où était-il ? » etc ; jusqu'à ces mots : « Ni moi non plus je ne vous
dirai par quelle autorité je fais ces choses (1). » Tout ceci est rapporté
presque dans les mêmes termes en saint Marc et en saint Luc (2); il n'y a dans
leur récit que quelques légères différences. Comme je viens de le faire
remarquer, saint Matthieu, en passant sous silence quelques faits du second
jour, a tellement enchaîné son récit qu'on pourrait, si l'on n'y prenait
garde, le croire encore à ce second jour, tandis que saint Marc est arrivé au
troisième. Saint Luc semble ne pas distinguer les jours : il trace l'histoire
des vendeurs et des
acheteurs chassés du temple, mais il passe sous silence
les différentes courses de la ville à Béthanie, et de Béthanie à la ville, le
figuier maudit, l'étonnement des disciples et la réponse sur la puissance de
la foi ; il dit seulement ceci : « Il enseignait tous les jours dans le temple
Cependant, les princes des prêtres les Scribes et les principaux du peuple
cherchaient à le perdre; mais ils ne trouvaient pas que lui faire, parce . que
tout le peuple était ravi en l'écoutant. Or il arriva qu'un de ces jours-là,
comme il enseignait le peuple dans le temple, et qu'il annonçait l'Evangile,
les princes des prêtres et les Scribes y vinrent avec les anciens. Et ils lui
adressèrent la parole en disant : Dites-nous par quelle autorité vous faites
ces choses ? » etc. C'est ce que nous retrouvons dans les autres évangélistes.
Evidemment il n'y a ici rien à reprendre dans l'ordre suivi, puisque si l'un
affirme que le fait s'est passé un de ces jours- là, » on peut le
rapporter, au jour fixé par les deux autres qui rapportent le même événement.
133. Saint Matthieu continue
ainsi : « Mais que vous en semble? Un homme avait deux fils; s'approchant du
premier, il lui dit : Mon fils, va aujourd'hui travailler à ma vigne.
Celui-ci, répondant, dit : Je ne veux pas. Mais après, touché de repentir, il
y alla. S'approchant ensuite de l'autre, il dit de même. Et celui-ci
répondant, dit . J'y vais, Seigneur, et il n'y alla point, » etc, jusqu'à ces
paroles: « Celui qui tombera sur cette pierre se brisera ; et celui sur qui
elle tombera, elle l'écrasera (1). » Ni saint Marc, ni saint Luc ne parlent de
ces deux fils qui reçurent l'ordre d'aller à la vigne, pour y travailler.
Saint Matthieu fait ensuite l'histoire de la vigne louée à des vignerons,
raconte les mauvais traitements qu'ils font subir aux serviteurs envoyés vers
eux, et le meurtre du fils bien-aimé qu'ils jettent hors de la . vigne. Le
deux autres évangélistes mentionnent ces faits exactement dans le même ordre
(2); c'est-à-dire, après que les Juifs, interrogés sur le baptême de Jean,
furent réduits au silence et que Jésus leur eut dit : « Ni moi non plus je ne
vous dirai point par quelle autorité je fais ces choses. »
193
134. Il n'y a donc ici aucune
apparence de contradiction. Il est vrai qu'en saint Matthieu, après que le
Seigneur eut fait cette question aux Juifs: « Lorsque le maître de la vigne
viendra, « que fera-t-il à ces vignerons ? » ceux-ci lui répondirent aussitôt
: « Il fera mourir misérablement ces misérables, et il louera la vigne à
d'autres vignerons, qui lui en rendront le fruit en son temps. » Saint Marc,
au contraire, ne met point cette réponse dans la bouche des Juifs; c'est le
Seigneur qui parle ainsi, comme se répondant à lui-même: « Que fera donc le
maître de la vigne? Il viendra, exterminera les vignerons, et donnera la vigne
à d'autres. » Mais il faut admettre, ou bien que c'est leur réponse même qui a
été insérée sans être précédée de ces mots: Ils dirent, ou : Ils répondirent;
ou bien encore que cette réponse est attribuée au Seigneur parce que les
Juifs, disant la vérité, n'étaient que les interprètes de la Vérité même.
135. Mais il y a une
difficulté plus sérieuse non-seulement saint Luc ne fait point ainsi répondre
les Juifs, et comme saint Marc il attribue au Seigneur les paroles qui nous
occupent, mais il leur prête une réponse tout-à-fait contraire et leur fait
dire: « A Dieu ne plaise (1) » Voici d'ailleurs son texte : « Que leur fera
donc le maître de la vigne? Il viendra et perdra ces vignerons, et donnera la
vigne à d'autres. Ce qu'ayant entendu, ils lui dirent: A Dieu ne plaise ! Mais
Jésus les regardant, dit : Qu'est-ce donc que ce qui est écrit : La pierre
qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue un.sommet d'angle? » Comment
ceux à qui s'adressent ces paroles peuvent-ils dire en saint Matthieu : « Il
fera mourir misérablement ces misérables, et il louera sa vigne à d'autres
vignerons, qui lui en rendront le fruit. en son temps; » tandis qu'en saint
Luc ils contredisent ces mêmes paroles et disent : « A Dieu ne plaise ? »
D'ailleurs ce qui suit, ce que dit le Seigneur de la pierre mise de côté par
ceux qui bâtissent et devenue un sommet d'angle, est destinée à réfuter les
ennemis de cette parabole ; aussi saint Matthieu suppose-t-il que le Seigneur
avait affaire à des contradicteurs, lorsqu'il lui fait dire : « N'avez-vous
jamais là dans les Ecritures: La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est
devenue un sommet d'angle ? » Car que signifient ces mots: « N'avez-vous
jamais lu, » si ce n'est que ces hommes avaient répondu le contraire de ce
qu'il avait dit ? Saint Marc l'indique également en citant ainsi les mêmes
paroles : « N'avez-vous pas lu dans l'Ecriture : La pierre rejetée par ceux
qui bâtissaient est devenue un sommet d'angle? » Cette réflexion d'ans saint
Luc vient plus naturellement au moment où ils ont réclamé en s'écriant : « A
Dieu ne plaise ! » Elle équivaut en effet à ces expressions qu'on lit dans son
texte : « Qu'est-ce r donc que ce qui est écrit : La pierre qu'ont rejetée
ceux qui bâtissaient est devenue un sommet d'angle? » Qu'on dise : «
N'avez-vous jamais lu, » ou bien: « N'avez-vous pas lu, » ou encore: «
Qu'est-ce donc que ce qui est écrit ? » c'est toujours la même pensée.
136. Nous devons donc
reconnaître que dans la foule des auditeurs, quelques-uns répondirent,
comme.le rapporte saint Matthieu : « Il fera mourir misérablement ces
misérables, et il louera sa vigne à d'autres vignerons; » d'autres, le mot
qu'on trouve en saint Luc : « A Dieu ne plaise! » Quand donc les premiers
eurent répondu au Seigneur, ces autres leur répliquèrent: « A Dieu ne plaise !
» Si saint Marc et saint Luc mettent dans la bouche du Seigneur la réponse de
ceux à qui on répliqua : « A Dieu ne plaise! » c'est que, comme je l'ai déjà
dit, la Vérité même parlait par eux; soit à leur insu, s'ils étaient mauvais,
comme Caïphe qui prophétisa sans le savoir, lorsqu'il était grand-prêtre (1);
soit à bon escient, s'ils comprenaient et avaient la foi. Car parmi eux se
trouvait aussi la multitude qui avait accompli cette prédiction du prophète,
en venant avec grande pompe à la rencontre du Fils de Dieu, et en criant: «
Hosanna au fils de David. »
137. Voici une autre
circonstance qui ne doit soulever aucune difficulté. D'après saint Matthieu,
les princes des prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent du Seigneur et
lui demandèrent au nom de qui il agissait, et qui lui avait donné ce pouvoir;
il leur demanda à son tour d'où était le baptême de Jean, du ciel ou des
hommes ; et comme ils lui dirent qu'ils rie le savaient pas, il répondit: « Ni
moi non plus je ne vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. »
Immédiatement il ajoute: « Que vous en semble ? Un homme avait deux fils, »
etc. Le récit de saint Matthieu continue ainsi sans changer ni les
interlocuteurs, ni le lieu de la scène, jusqu'au moment où il est question de
la vigne louée aux vignerons. Or, on pourrait en conclure que tout ceci a été
dit aux princes des prêtres et aux anciens
194
du peuple qui l'avaient questionné sur sa puissance.
Cependant s'ils venaient vers lui comme des ennemis pour le tenter, comment
les compter parmi ceux qui avaient cru et rendu au Seigneur le témoignage
prédit par le prophète ; parmi,ceux aussi qui avaient pu répondre, non par
ignorance, mais avec la lumière de la foi : « Il perdra misérablement ces
misérables, et il louera sa vigne à d'autres vignerons ? » Tout ceci, dis-je,
ne doit nullement nous embarrasser, ni nous faire supposer que dans cette
foule qui écoutait les paraboles du Seigneur, il n'y ait eu personne pour
croire en lui. En effet, saint Matthieu pour abréger a omis ce que nous
trouvons dans saint Luc, savoir, que cette parabole s'adressait non-seulement
à ceux qui l'avaient questionné sur sa puissance, mais encore à tout le
peuple. Voici comment s'exprime ce dernier : « Alors il se mit à dire au
peuple cette parabole : Un homme planta une vigne, » etc. Il faut donc croire
que parmi ce peuple il y en avait pour l'écouter, comme il y en avait eu pour
dire auparavant : « Béni celui qui vient au nom du Seigneur ; » et que ce
furent eux ou quelques-uns d'entre eux qui répondirent : « Il perdra
misérablement ces misérables, et il louera sa vigne à d'autres vignerons. »
Si saint Marc et saint Luc
attribuent cette réponse au Seigneur, ce n'est pas seulement parce qu'étant la
Vérité même, il parle quelquefois par la bouche des méchants qui l'ignorent,
lorsqu'il dispose secrètement leur esprit sans que leur vertu l'ait mérité, et
par un effet de sa Toute-Puissance : mais encore, parce qu'il pouvait y avoir
là des hommes en état d'être
considérés déjà comme les membres de son corps. A ce titre leurs paroles
étaient les siennes. D'ailleurs, il avait déjà baptisé un plus grand nombre
d'hommes que Jean (1) ; des disciples le suivaient en foule, comme l'attestent
souvent les évangélistes ; parmi eux se trouvaient les cinq cents frères à qui
il apparut après sa résurrection, d'après le témoignage de l'Apôtre saint Paul
(2). Ajoutons à l'appui de ceci qu'en saint Matthieu ces paroles : Aiunt
illi, ne doivent pas s'entendre comme si illi était au pluriel,
pour indiquer que c'était la réponse de ceux qui l'avaient questionné sur sa
puissance. Mais dans: Aiunt illi, illi est au singulier; ce qui
signifie: « On lui répond; » on répond au Seigneur; les manuscrits grecs ne
laissent là-dessus aucun doute.
§138. Il y a dans l'évangéliste saint Jean un discours du
Seigneur qui aidera à saisir ma pensée ; le voici : « Jésus disait donc à ceux
des Juifs qui croyaient en lui : Pour vous, si vous demeurez dans ma parole,
vous serez vraiment mes disciples; et vous connaîtrez la vérité, et la vérité
vous rendra libres. Ils lui répondirent : Nous sommes la race d'Abraham, et
nous n'avons jamais été esclaves de personne : comment dis-tu, toi : Vous
serez libres ? Jésus leur répartit : En vérité, en vérité je vous le dis,
quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure point
toujours dans la maison, mais le fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous
met en liberté, vous serez vraiment libres. Je sais que vous êtes fils
d'Abraham ; mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne prend
point en vous (1). » Assurément il n'adressait point ces mots : « Vous
cherchez à me faire mourir, » à ceux qui déjà croyaient en lui, et à qui il
venait de dire: « Pour vous, si vous demeurez dans ma parole, vous serez
vraiment mes disciples. » C'était aux premiers croyants qu'il disait ceci;
mais parmi la foule qui était là, il y avait aussi beaucoup d'ennemis, et
quoique l'évangéliste ne désigne point les différents interlocuteurs, on voit
assez par le caractère de ce qu'ils disent, et par la réplique de Jésus, à
quel genre de personnes il faut attribuer chacune de ces réponses. Or, de même
que dans cette foule dont parle saint Jean, il y en avait qui croyaient en
Jésus, d'autres qui cherchaient à le faire mourir; ainsi dans celle dont il
est ici question, les uns demandaient malicieusement au Seigneur au nom de qui
il agissait ainsi ; il y en avait aussi qui s'étaient écriés, non pas avec
hypocrisie, mais avec toute la sincérité de leur foi : « Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur, » et qui conséquemment animés du même esprit
pouvaient dire encore « Il les perdra,
et donnera sa vigne à d'autres.» On peut ajouter que cette réponse est du
Seigneur, soit parce qu'il est lui-même la vérité quelle exprime, soit à cause
de l’union des membres avec leur chef. Il y en avait enfin qui disaient à ces
derniers : « A Dieu ne plaise ! » parce qu'ils sentaient que cette parabole
était à leur adresse.
195
139. Saint Matthieu continue :
« Or, lorsque .les princes des prêtres et les Pharisiens eurent entendu ses
paraboles, ils comprirent que c'était d'eux qu'il parlait, et cherchant à se
saisir de lui, ils craignaient le. peuple, parce qu'il le regardait comme un
prophète. Jésus, reprenant, leur parla de nouveau en paraboles; il disait Le
royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Or, il
envoya ses serviteurs appeler les conviés aux noces, mais ils ne voulurent
point venir, » etc, jusqu'à ces mots: « Car beaucoup sont appelés, mais peu
sont élus (1). » Saint Matthieu est le seul qui mentionne cette parabole des
invités aux noces quelque chose de semblable est raconté dans saint Luc, mais
ce n'est point la même parabole, comme la suite du récit l'indique, quoiqu'il
y ait entre les deux quelques points de ressemblance (2). Après la parabole de
la vigne, et le meurtre du fils, du père de famille,
saint Matthieu ajoute que les Juifs sentirent l'application de tout
ceci à leur conduite et qu'ils commencèrent à tramer leurs complots. Saint
Marc et saint Luc racontent également cela dans le même ordre l'un que l'autre
(3). Ils passent ensuite à. un autre sujet, que saint Matthieu traite comme
eux, mais seulement après avoir rapporté seul la parabole des noces : à part
cela, la marche est pour tous la même.
140. Saint Matthieu continue
ainsi : « Alors les Pharisiens s'en allant se concertèrent pour le surprendre
dans ses paroles. Ils envoyèrent donc leurs disciples avec les Hérodiens,
disant : Maître, nous savons que vous êtes vrai, que vous enseignez la voie de
Dieu dans la vérité, et que vous n'avez égard à qui que ce soit; car vous ne
considérez point la face des hommes. Dites-nous donc ce qui vous en semble :
Est-il permis de payer le tribut à César, ou non ? » etc, jusqu'à ces mots : «
Et le peuple l'entendant admirait sa doctrine (4). » Nous avons ici deux
réponses du Seigneur, l'une sur la pièce de monnaie que l'on doit payer à
César, l'autre sur la
résurrection, à propos de cette femme qui eut pour maris
sept frères successivement. Ces deux réponses sont mentionnées eu saint Marc
et en saint Luc, et on n'y découvre aucune différence (1). En effet, après que
les trois Evangélistes ont rapporté la parabole de la vigne louée, et les
complots des Juifs à qui cette parabole s'adresse, saint Marc et saint Luc
passent sous silence celle des invités aux noces, citée seulement par saint
Matthieu, et se retrouvent avec lui pour ces deux histoires, celle du tribut
dû à César, et celle de la femme aux sept maris; c'est chez tous le même
ordre, et le passage ne présente aucune difficulté.
141. Saint Matthieu dit
ensuite : « Mais les Pharisiens, apprenant qu'il avait réduit les Sadducéens
au silence, s'assemblèrent , et l'un d'eux, docteur de la Loi, l'interrogea
pour le tenter: Maître, quel est le plus grand commandement de la Loi ?Jésus
lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton
âme,et de tout ton esprit. C'est le premier et le plus grand commandement. Le
second lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. A ces deux
commandements: se rattachent toute la Loi et les Prophètes (2). » Saint Marc
dit ceci dans le même ordre (3). Ne soyons pas embarrassés de ce qu'en saint
Matthieu celui qui interrogea,le Seigneur voulut le tenter, tandis que saint
Marc omet cette circonstance et rapporte même que Jésus-Christ finit par dire
à cet homme, qui avait sagement répondu : « Tu n'es pas loin du royaume de
Dieu. » Il est bien possible que venant avec l'intention de tenter le
Seigneur, il ait été converti par . sa réponse. Ou bien ce n'était pas avec
une intention coupable qu'il cherchait à le tenter, comme s'il eût voulu
surprendre son ennemi; la prudence même pouvait le porter à connaître de plus
en plus celui qu'il ne connaissait point encore. Car ce n'est pas sans raison
qu'il est écrit : « Celui qui croit trop facilement est léger de coeur et il y
perdra (4). »
142. En saint Luc il est
question d'un fait semblable, mais ailleurs et bien loin de là (5). Est-ce le
même fait, en est-ce un autre où le Seigneur rappelle également les deux
préceptes de la Loi?
196
On ne saurait le décider. Néanmoins il parait plus
probable que c'en est un autre, non-seulement parce que ce trait est placé à
une grande distance, mais encore parce qu'en saint Luc le scribe répond
lui-même à la question du Seigneur et expose dans sa réponse les deux
commandements. De plus, quand le Seigneur. lui a dit : « Fais cela et tu
vivras, » pour l'exciter à accomplir ce qu'il avait lui-même reconnu comme le
plus important de la Loi, l'évangéliste continue et dit : « Mais lui, voulant
se justifier, dit à Jésus : Qui est donc mon prochain? » Et le Seigneur lui
fit alors l'histoire de cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho et qui
tomba entre les mains des voleurs. Il est donc dit que ce dernier chercha à le
tenter, qu'il exposa lui-même les deux commandements, et quand le Seigneur
voulut l'encourager par ces mots : « Fais cela et tu vivras; » l'évangéliste
ne loue point sa vertu, car il ajoute : « Mais lui, voulant se justifier. »
L'autre au contraire, dont il est question an même endroit dans saint Matthieu
et dans saint Marc, se montre tellement digne d'éloges que le Seigneur lui dit
: « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Il est donc très-probable que ce
n'est point ici le même personnage.
143. Saint Matthieu continue:
« Or, les Pharisiens étant assemblés, Jésus leur demanda Que vous semble du
Christ? De qui est-il fils ? Ils lui répondirent : De David. Il leur répliqua:
« Comment donc David l'appelle-t-il en esprit son Seigneur, disant : Le
Seigneur a dit à mon Seigneur : Asseyez-vous à 'ma droite jusqu'à ce que je
fasse de vos ennemis l'escabeau de vos pieds? Si donc David l'appelle son
Seigneur, comment est-il son fils? Et personne ne pouvait lui répondre, et
depuis ce jour nul n'osa plus l'interroger (1). » Ce trait se présente à la
suite de ce qui précède dans saint Marc, comme dans saint Matthieu (2) . Saint
Luc omet seulement l'histoire de celui qui demanda au Seigneur quel était le
plus grand commandement de la Loi: à part cette omission, il suit le même
ordre, et dit comme eux que le Seigneur demanda aux Juifs comment le Christ
est Fils de David (3). Toutefois signalons une différence qui
ne change rien à la pensée. D'après saint Matthieu Jésus
leur demande d'abord ce qui leur semble du Christ, de qui est-il fils. Ceux-ci
répondent « De David; » alors il ajoute: « Comment David peut-il l'appeler son
Seigneur? » D'après saint Marc et saint Luc, au contraire, aucune question ne
leur est adressée, ils ne font aucune réponse. Mais nous devons entendre que
c'est seulement après leur réponse que le Seigneur dit ce que lui prêtent ces
deux évangélises; et s'il parle devant le peuple qu'il voulait gagner à ses
enseignements et détourner des fausses doctrines des scribes; c'est que
ceux-ci ne voyaient dans le Christ qu'un fils de David selon la chair, et ne
reconnaissaient point en lui la nature divine, qui le rend le Seigneur de
David lui-même. Voilà pourquoi, d'après ces deux évangélistes, en parlant de
ceux qui égaraient le peuple, il s'adressait au peuple même qu'il voulait
préserver de l'erreur; et si, dans saint Matthieu, il s'adresse aux premiers;
ces paroles : « Comment dites-vous ? » étaient plutôt destinées aux âmes qu'il
cherchait à instruire.
144. Saint Matthieu poursuit
son récit de cette manière : « Alors Jésus parla au peuple et à ses disciples
en disant : C'est sur la chaire de Moïse que sont assis les Scribes et les
Pharisiens. Ainsi, tout ce qu'ils disent, observez-le et faites-le; mais
n'agissez pas selon leurs oeuvres; car ils disent et ne font point, » jusqu'à
ces paroles : « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur (1) !» Saint Luc rapporte un semblable
discours du Sauveur contre les Pharisiens, les Scribes et les docteurs de la
Loi; mais c'est dans la maison d'un Pharisien qui l'avait invité à dîner : et
pour relater ce discours, il quitte saint Matthieu. D'abord ils exposent l'un
comme l'autre les enseignements du Seigneur sur le signe de Jonas, durant
trois jours et trois nuits, sur la reine du Midi, les Ninivites, enfin sur
l'esprit impur qui revient et trouve la maison purifiée. Ces discours
terminés, saint Matthieu ajoute : « Lorsqu'il parlait au peuple, voilà que sa
mère et ses frères étaient dehors, cherchant à lui parler (2). » Saint Luc
après avoir ajouté au discours quelques réflexions du Seigneur
197
omises par saint Matthieu, s'écarte de la marche suivie
par ce dernier et continue ainsi Pendant qu'il parlait, un Pharisien le pria
de dîner chez lui. Etant donc entré, il se mit à table. Or le Pharisien,
pensant en lui-même, « commença à demander pourquoi il ne s'était point lavé
avant le repas. Et le Seigneur lui dit : Vous autres Pharisiens, vous nettoyez
le dehors de la coupe et du plat. » Puis viennent contre les Pharisiens, les
Scribes et les anciens du peuple, les mêmes reproches que ceux du passage de
saint Matthieu qui nous occupe (1). Quoique saint Matthieu rapporte ce
discours sans désigner la demeure du Pharisien, comme il ne dit pas non plus
que ce fut ailleurs, rien n'empêcherait de croire que ce fut dans cette maison
même. Cependant le Seigneur était déjà arrivé de la Galilée à Jérusalem; et si
l'on examine l'ordre des événements qui précèdent ce discours, on est porté à
croire qu'ils se sont passés dans cette dernière ville. Saint Luc au contraire
suppose dans son récit que le Seigneur était toujours sur le chemin de
Jérusalem. Aussi suis-je porté à croire que ce sont deux discours différents,
cités, le premier par un Evangéliste, et le second par un autre.
145. Il y a cependant ici une
parole qui demande quelques explications : « Vous ne me verrez plus, déclare
le Seigneur, jusqu'à ce que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur. » Or, d'après le même saint Matthieu, on a déjà dit cela (2). Aussi,
d'après saint Luc, le Seigneur répond ainsi quand on le prie de s'éloigner,
parce qu'Hérode cherche à le faire mourir. Au même endroit encore saint Luc
lui fait prononcer contre Jérusalem les mêmes menaces que saint Matthieu ;
voici comment il s'exprime : « Le même jour quelques-uns des Pharisiens
s'approchèrent, disant: Sortez, retirez-vous d'ici, car.Hérode veut vous
l'aire mourir; et il leur dit : Allez, et dites à ce renard : Voilà que je
chasse les démons, et guéris les malades aujourd'hui et demain, et c'est le
troisième jour que je dois être consommé. Cependant il faut que je marche
aujourd'hui et demain et le jour suivant, parce qu'il ne peut se faire qu'un
prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tues les
prophètes, et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je
voulu rassembler tes enfants, comme un oiseau rassemble sa couvée sous ses
ailes, et
tu ne l'as point voulu ? Voici que votre maison vous sera
laissée déserte. Je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce qu'il
arrive que vous disiez : Béni Celui qui vient au nom du Seigneur (1) ! » Il
n'y a, il est vrai, aucune contradiction entre le récit de saint Luc, et ce
que la foule fit entendre quand le Seigneur arriva à Jérusalem; car la suite
des événements nous montre qu'il n'y était pas encore arrivé, et que ces
paroles n'avaient pas encore été répétées. La difficulté vient plutôt de ce
que Jésus n'est point parti de manière à n'arriver qu'à l'époque où on
l'exalterait ainsi. En effet, il continue sa route jusqu'à ce qu'il arrive à
Jérusalem, et ce ,qu'il dit : « Voilà que je chasse les démons, et guéris les
malades aujourd'hui et demain, et après demain je dois être consommé, » doit
s'entendre dans un sens mystique et figuré; car il n'a point souffert le
surlendemain, puisqu'aussitôt il ajoute : « Il faut que je marche aujourd'hui
et demain et le jour suivant. » Nous devons donc aussi entendre dans un sens
mystique ce passage : « Vous ne me verrez plus, « jusqu'à ce qu'il arrive que
vous disiez : Béni Celui qui vient au nom du Seigneur, » et l'appliquer à
l'avènement où il doit manifester sa gloire. D'après cela, ce qu'il ajoute : «
Je chasse les démons, et guéris les malades aujourd'hui et demain, et le jour
suivant je dois être consommé, » se rapporte à son corps, c'est-à-dire à
l'Église. Les démons sont chassés, quand les Gentils abandonnent les pratiques
superstitieuses de leurs pères pour croire en lui. Les malades sont guéris ,
lorsque les hommes vivent dans l'accomplissement de ses préceptes, et qu'après
avoir renoncé au démon et à ce monde ils arrivent au terme de la résurrection.
C'est comme le troisième jour; celui où l'Église sera consommée, c'est-à-dire
élevée par l'immortalité jusqu'à la perfection des anges. La marche suivie par
saint Matthieu n'offre donc rien d'irrégulier. Il faut plutôt admettre ou bien
que saint Luc intervertit l'ordre des événements, si en écrivant d'après ses
souvenirs, il raconte ce qui s'est passé à Jérusalem avant que la suite de son
récit n'y fasse arriver le Seigneur;. ou bien qu'en approchant de la ville, et
quand on le prévenait de se tenir en garde contre Hérode, le Sauveur fit une
réponse semblable à celle que d'après saint Matthieu il adressa à la foule
quand il arriva, et quand étaient accomplis les faits racontés auparavant.
198
146. Saint Matthieu continue
en ces termes Et Jésus étant sorti du temple s'en alla. Alors ses disciples
s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Mais
lui-même prenant la parole, leur dit: Vous voyez toutes ces choses ? É'n
vérité je vous le dis : Il ne restera pas là pierre sur pierre, qui ne soit
détruite (1). » Saint Marc observe pour ceci à-peu-près le même ordre, ne
s'écartant de saint Matthieu que. pour raconter l'histoire de la veuve qui
déposa deux deniers dans le tronc (2) ; fait qui ne se retrouve que dans saint
Luc. D'après saint Marc, lorsqu'il a demandé aux Juifs comment ils entendent
que le Christ est le fils David, le Seigneur enseigne qu'il faut se garder des
Pharisiens et de leur hypocrisie. Saint Matthieu s'étend davantage et cite un
très-long discours sur le même sujet. Après ce passage ainsi abrégé par saint
Marc, très-développé en saint Matthieu, le premier ne raconte plus, ai-je dit,
que l'histoire de cette veuve à la fois si pauvre et si généreuse, puis il
reprend l'ordre suivi par saint Matthieu, et parle avec lui de la future
destruction du temple. Saint Luc aussi; après avoir rapporté cette discussion
au sujet du Christ, fils de David, dit quelques mots de l'hypocrisie des
Pharisiens, arrive à parler, avec saint Marc, de cette veuve qui verse deux
deniers dans le tronc, et enfin décrit comme saint Matthieu et saint Marc, la
future destruction du temple (3).
147. Saint Matthieu continue
ainsi : « Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples
s'approchèrent de lui en particulier, disant : Dites-nous quand ces choses
arriveront ? Et quel sera le signe de votre avènement et de la consommation du
siècle ? Et Jésus répondant leur dit : Prenez garde que quelqu'un ne vous
séduise. Car beaucoup viendront en mon nom, disant : « Je suis le Christ, et
ils en séduiront un grand nombre, » etc ; jusqu'à ce passage : « Et ceux-ci
s'en iront à l'éternel supplice, et les justes dans la vie éternelle. » Nous
avons donc à examiner ici
ce
long discours du Seigneur, que les trois évangélistes
saint Matthieu, saint Marc et saint Luc retracent exactement dans le même
ordre (1). Chacun d'eux y mentionne des traits qui lui sont propres, sans
qu'il en résulte la moindre apparence de contradiction ; examinons s'ils ne se
contredisent point dans les passages qu'ils reproduisent également, car s'il y
avait la quelque désaccord, on ne pourrait l'expliquer en disant que c'est la
même pensée répétée par le Seigneur en d'autres circonstances, puisque tous
les trois assignent à ce fait le même lieu et la même époque. Si toutefois les
mêmes pensées exprimées par le Seigneur ne sont point rapportées partout dans
le même ordre, cela ne change rien au sens des vérités à comprendre ou à
connaître, puisque les paroles qui les expriment ne se contredisent en aucune
manière.
148. Il est dit dans saint
Matthieu : « Et cet Evangile du royaume sera prêché dans le monde entier, en
témoignage à toutes les nations; et alors viendra la fin. » Saint Marc suit le
même ordre : « Mais il faut d'abord que l'Evangile soit prêché à toutes les
nations. » Il n'ajoute point : « Et alors viendra la fin; » mais cette
expression d'abord, » le donne suffisamment à entendre; car on avait
questionné le Sauveur sur la fin des temps. Lors donc qu'il dit : « Il faut
d'abord que l'Evangile soit prêché à toutes les nations, » ce mot: « d'abord,
» signifie évidemment avant la consommation.
149. Saint Matthieu dit
ensuite : « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, prédite par
le prophète Daniel, régnant dans le lieu saint; que celui qui lit, entende.»
Saint Marc s'exprime en ces termes : « Quand vous verrez l'abomination de la
désolation, là où elle ne doit pas être, que celui qui lit, entende, » et
quoiqu'il change quelques mots, il n'exprime que la même pensée. « Là où elle
ne doit pas être, » dit-il, parce qu'elle ne doit pas être dans le lieu saint.
Saint Luc, au lieu de dire : « Lorsque vous verrez l'abomination de la
désolation régnant dans le lieu saint, » ou bien : « Là où elle ne doit pas
être, » s'exprime ainsi: « Or, quand vous verrez Jérusalem investie par une
armée, sachez que sa désolation est proche. » C'est qu'alors aura lieu
l'abomination de la désolation.
150. Saint Matthieu dit
ensuite: « Alors, que
199
ceux qui sont dans la Judée fuient sur les montagnes; que
celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quelque chose de sa
maison, et que celui qui sera dans les champs ne revienne pas pour prendre sa
tunique. » Ce sont presque les mêmes expressions en saint Marc. Saint Luc
commence d'abord comme eux: « Alors, que ceux qui sont dans la Judée fuient
vers les montagnes ; » mais ce qui suit est différent, car il continue ainsi :
Que ceux qui sont au milieu d'elle s'en éloignent, et que ceux qui sont dans
les environs n'y entrent point; parce que ce sont là des jours de vengeance
pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Il y a quelque différence
entre cette phrase des uns: « Que celui qui est sur le toit ne descende pas
pour emporter quelque chose de sa maison, » et celle-ci : « Que ceux qui sont
au milieu d'elle s'en éloignent, » à moins cependant que dans le trouble
subitement causé par un si grand péril, les assiégés, désignés par ces mots :
« Ceux qui sont au milieu d'elle, » ne soient sur le toit saisis de frayeur,
cherchant à voir les maux dont ils sont menacés, et à découvrir la voie par où
ils pourront s'échapper. Mais comment saint Luc peut-il dire : « Qu'ils s'en
aillent, » après avoir dit plus haut : « Quand vous verrez Jérusalem investie
par une armée ? » Ce qui suit : « Que ceux qui sont dans les environs n'y
entrent point, » vient ici bien naturellement ; on peut recommander à ceux qui
sont dehors de ne pas entrer en cette ville. Mais comment peut-on dire de
s'éloigner à ceux qui y sont renfermés, quand l'ennemi la tient assiégée ? Ne
pourrait-on dire qu'on
sera au milieu d'elle, » quand le danger sera si pressant, que l'on ne
pourra plus se mettre en sûreté pour la vie présente ? Comme alors .l'âme doit
être libre et prête au sacrifice, que le poids des inquiétudes charnelles ne
doit plus l'accabler; les deux évangélistes ont dit, pour faire connaître ce
devoir, qu'elle serait : « Sur
le toit. » Le mot de saint Luc: « Qu'ils s'éloignent, » signifie donc:
Qu'ils ne s'attachent plus aux séductions de la vie présente, mais qu'ils
soient prêts à passer dans une autre. C'est ce qu'ont dit les deux autres
évangélistes: « Qu'il ne descende pas pour emporter quelque chose de sa
maison; » c'est-à-dire, que la créature n'ait pour lui aucun attrait, comme
s'il devait y trouver son bien; et quand saint Luc ajoute : « Que ceux qui
sont dans les environs n'y entrent point, » cela veut dire : Que ceux dont le
coeur a su s'en détacher, ne s'y laissent plus entraîner par aucun désir
charnel. C'est la même pensée dans les autres évangélistes : « Que celui qui
est dans les champs ne revienne point pour prendre sa tunique, » pour retomber
dans les inquiétudes dont il a été délivré.
151. Saint Matthieu dit
ensuite: « Mais priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en un
jour de sabbat. » Saint Marc cite une partie de ces paroles, omet les autres.
« Priez, dit-il, pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. » Ce passage ne
se retrouve pas en saint Luc; mais ce que lui seul ajoute ici.me paraît
expliquer clairement la pensée que les autres expriment d'une manière assez
obscure. « Faites donc attention à vous, dit-il, de peur que vos coeurs ne
s'appesantissent dans la crapule, l'ivresse et les soins de cette vie, et que
ce jour ne vienne soudainement sur vous : car comme un filet, il enveloppera
tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout
temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui
doivent arriver. » Voilà donc en quoi consiste cette fuite, qui d'après saint
Matthieu, ne doit pas arriver en hiver ni en un jour de sabbat. Par l'hiver il
faut entendre les soins de cette vie : le sabbat figure la crapule et
l'ivresse. En effet ces soins, comme l'hiver, inspirent la tristesse ; la
crapule et l'ivresse abrutissent le coeur `en le plongeant dans les joies
impures de la chair, et ces vices honteux sont figurés par le sabbat, parce
que déjà à cette époque comme aujourd'hui les Juifs avaient la pernicieuse
habitude de passer ce jour dans les plaisirs profanes, et ne connaissaient pas
les joies d'un sabbat spirituel. On pourrait peut-être entendre dans un autre
sens la pensée exprimée en saint Matthieu et en saint Marc; mais il faudrait
donner aussi à celle de saint Luc une autre signification, pourvu qu'il n'en
résulte aucune contradiction. D'ailleurs notre but n'est point d'expliquer le
vrai sens des évangiles, mais de prouver qu'ils ne renferment ni erreur ni
imposture. Les autres passages de ce discours qui se ressemblent en saint
Matthieu et en saint Marc ne peuvent soulever aucune difficulté. Quant à ceux
que l'on retrouve en saint Luc, celui-ci ne les reproduit point dans le
discours où il suit le même ordre que saint Matthieu, il les rapporte ailleurs
comme s'il écrivait au fur et à mesure que les faits lui reviennent à (200) la
mémoire énonçant d'abord ce qui n'a été dit que plus tard; ou bien il nous
donne à entendre que deux fois le Seigneur a prononcé la même parole, d'abord
comme saint Marc l'a citée, puis comme il la répète lui-même.
152. Saint Matthieu continue :
« Or il arriva que Jésus, ayant achevé tous ces discours, « dit à ses
disciples : Vous savez que la Pâque se fera dans deux jours et que le Fils de
l'homme sera livré pour être crucifié. (1) » Saint Marc et saint Luc se
trouvent ici d'accord avec lui, et suivent exactement la même marche (2).
Toutefois ils ne mettent point ces paroles dans la bouche du Seigneur; au lieu
de les citer, ils parlent d'eux-mêmes. « Or c'était la Pâque,
dit saint Marc, et les azymes deux
jours après. » Et saint Luc: «Cependant approchait la fête des azymes qu'on
appelle la Pâque. » Elle approchait,puisque c'était deux jours après, comme le
disent clairement les deux autres. Saint Jean à trois reprises différentes
nous annonce que cette fête est proche : deux fois précédemment, en
mentionnant d'autres faits; la troisième fois son récit parait être arrivé à
l'époque où nous ont conduits les trois autres Evangélistes, c'est-à-dire aux
approches de la passion de notre Seigneur (3).
153 Les moins attentifs
pourraient voir ici une contradiction ; car saint Matthieu et saint Marc,
ayant dit que la Pâque était deux jours après, font arriver Jésus à Béthanie,
où ils parlent d'un parfum précieux : saint Jean dit au contraire que six
jours avant la Pâque Jésus vint à Béthanie, puis il parle du même parfum (4).
Comment donc, d'après les premiers, la Pâque pouvait-elle arriver deux jours
après, puisqu'après l'avoir affirmé, ils se retrouvent avec saint Jean à
Béthanie pour l'histoire du parfum, et que d'après ce dernier la fête devait
seulement arriver dans six jours ?
Nous ne ferons qu'une
observation à ceux que cette difficulté pourrait arrêter. Saint Matthieu et
saint Marc parlent du parfum de Béthanie, comme d'une chose passée; elle n'a
point eu lieu après qu'ils ont annoncé que la Pâque arrivait dans deux jours,
mais
auparavant, lorsqu'il y avait encore six jours d'intervalle jusqu'à
cette fête. Car ni l'un ni l'autre, après avoir annoncé la Pâque dans deux
jours, ne donne comme la suite de ce qu'il vient de rapporter les événements
de Béthanie. Ils ne disent point : Après cela, lorsqu'il était à Béthanie. On
lit, il est vrai, dans saint Matthieu Comme Jésus était à Béthanie ; n et en
saint Marc: « Comme il était à Béthanie. » Mais il y était déjà avant les
événements qui précédèrent de deux jours la fête de Pâque. D'après le récit de
saint Jean, Jésus arriva donc à Béthanie six jours avant la Pâque. Là eut lieu
le festin, où il est question du parfum précieux. Il se rendit ensuite à
Jérusalem, monté sur un ânon; puis vient le récit des événements accomplis
après son arrivée en cette ville. Par conséquent, depuis le jour où il arrive
à Béthanie et où il est question du parfum, ,jusqu'à celui où s'accomplissent
les événements qui nous occupent, nous voyons, sans que les évangélistes nous
le disent, qu'il s'écoule un intervalle de quatre jours alors nous arrivons au
moment où ils écrivent que la Pâque arrive dans deux jours. Saint Luc, en
disant;: « Cependant la fête des azymes approchait » ne mentionne pas
l'intervalle de deux jours, mais ses paroles touchant la proximité de la fête,
ne peuvent s'entendre que de ce court intervalle. Quant à saint Jean,
lorsqu'il écrit que,la Pâque des Juifs était proche (1), il n'est point
question de ces deux jours, mais bien de six jours avant la fête Aussi, après
ces mots, il rapporte quelques événements ; puis voulant fixer avec plus de
précision cette proximité de la fête de Pâque, il ajoute: « Jésus donc, six
jours avant la Pâque, vint à Béthanie, où était mort Lazare, que Jésus avait
ressuscité. On lui prépara là un souper (2). » C'est cette dernière
circonstance que saint Matthieu et saint Marc rappellent en passant, après
avoir dit que la fête de Pâque arrivait dans deux jours. De cette manière, ils
reviennent au moment où l'on était
à Béthanie six jours avant cette fête, et rappellent en peu de mots le festin
et le parfum mentionnés en saint Jean. De là Jésus devait venir à Jérusalem
accomplir ce qui est ensuite raconté, puis arrivait le second jour avant la
Pâque. C'est en ce jour qu'ils suspendent leur récit, pour dire brièvement ce
qui s'est passé à Béthanie à l'occasion du parfum. Cela fait, ils reprennent
le
201
cours un instant interrompu de. leur narration, et
relatent le discours que prononça le Seigneur deux jours avant la fête de
Pâque.
En effet, supprimons un
instant les événements de Béthanie, rapportés comme en passant et rétablissons
la suite du récit un moment suspendu ; voici comment tout s'enchaîne dans
saint Matthieu: « Vous savez que la Pâque se fera dans deux jours et que le
Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les princes des prêtres
et les anciens du peuple s'assemblèrent dans la salle du grand-prêtre appelé
Caïphe, et tinrent conseil pour se saisir de Jésus par ruse, et le faire
mourir. Mais ils disaient que ce ne fût pas au jour de la fête, « de peur
qu'il ne s'élevât du tumulte parmi le peuple. Alors un des douze, appelé Judas
Iscariote, alla vers les princes des prêtres » etc. Entre ces mots: « De peur
qu'il ne s'élevât du tumulte parmi le peuple », et les autres : « Alors un des
douze, appelé Judas Iscariote, s'en alla, » se trouvent rappelés, en passant,
les faits accomplis à Béthanie; nous les avons supprimés dans ce nouveau
récit, afin de prouver que la suite des événements ne présente rien de
contradictoire. Si nous supprimons également dans saint Marc le même festin de
Béthanie, qu'il reprend aussi de plus haut, nous aurons les faits dans le même
ordre :
« Or, c'était la Pâque et les
azymes deux jours après, et les princes des prêtres et les Scribes cherchaient
comment ils se saisiraient de lui par ruse et le feraient mourir. Mais ils
disaient que ce ne fût pas au jour de la fête, de peur qu'il ne s'élevât
quelque tumulte parmi le peuple... Alors Judas Iscariote, un des douze, alla
trouver les princes des prêtres (1), » etc. Et, après ces paroles : « De peur
qu'il ne s'élevât quelque tumulte parmi le peuple, » que nous faisons suivre
de ces autres : « Alors Judas Iscariote, un des douze, » se trouve également
intercalée l'histoire de Béthanie, reprise de plus haut. Saint Luc ne dit rien
de Béthanie.
Nous avons donné ces explications, parce que saint Jean,
en racontant ce qui s'est passé à Béthanie, dit que ce fut six jours avant la
Pâque; tandis que saint Matthieu et saint Marc, après avoir rapporté qu'on
était au second jour avant la fête, rappellent cette histoire de Béthanie
mentionnée en saint Jean.
154. Saint Matthieu continue
ainsi le passage déjà cité à la fin de l'examen que nous venons de faire: «
Alors les princes des prêtres et les anciens du peuple s'assemblèrent dans la
salle du grand-prêtre appelé Caïphe, et tinrent conseil pour se saisir de
Jésus par ruse et le faire mourir. Mais ils disaient que ce ne fût pas au jour
de la fête, de peur qu'il ne s'élevât du tumulte parmi le peuple. Or, comme
Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, vint auprès de lui
une femme ayant un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix, et elle le
répandit sur sa tète lorsqu'il était à table, » etc, jusqu'à ces mots: « On
dira même, en mémoire d'elle, ce qu'elle vient de faire (1). » Examinons
maintenant l'histoire de cette femme qui vint à Béthanie, avec son parfum d'un
grand prix.
Saint Luc raconte un fait
semblable; c'est le même nom donné à celui chez qui vint manger le Seigneur,
il l'appelle Simon. Mais s'il n'est point impossible ni contraire à l'usage
que le même homme porte deux noms à la fois, il est moins étonnant encore que
le même nom soit donné à deux hommes différents. Aussi me paraît-il plus
probable que Simon, dont parle saint Luc, n'est point le même que le lépreux
chez qui eut lieu la scène de Béthanie. En effet, saint Luc ne dit nullement
que ce qu'il raconte se passait en cette localité, et quoiqu'il ne désigne
aucune autre ville, ni aucun autre bourg, son récit lui-même semble indiquer
un endroit différent. C'est tout ce que je veux démontrer. Mais il ne faudrait
pas voir une autre femme dans cette pécheresse qui vint aux pieds de Jésus,
les baisa, les arrosa de ses larmes, les essuya avec ses cheveux, et y
répandit son parfum , alors que le Seigneur, par la parabole des deux
débiteurs, déclara que beaucoup de péchés lui avaient été remis, parce qu'elle
avait beaucoup aimé. La même femme, Marie, répandit deux fois des parfums; la
première fois, lorsque, comme saint Luc le raconte, son humilité et ses larmes
lui méritèrent le pardon de ses péchés (2). Saint Jean ne rapporte point,
comme saint Luc, les circonstances de ce fait, mais il fait connaître
également que cette femme était Marie. En commençant
202
l'histoire de la résurrection de Lazare, et avant de nous
faire arriver à Béthanie; il s'exprime ainsi : « Or, il y avait un certain
malade; Lazare, de Béthanie, du, bourg où demeuraient Marie et Marthe sa
soeur. Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfums, et lui essuya les
pieds avec ses cheveux ; or, Lazare, alors malade, était son frère (1). »
Saint Jean confirme ainsi le récit de saint Luc, qui place le fait dans la
maison d'un Pharisien nommé Simon. Ainsi donc Marie avait déjà répandu des
parfums; elle en répandit de nouveau à Béthanie, et il n'y a rien de commun
entre le. récit de saint Luc et ce qui est ensuite raconté par les trois
autres évangélistes, saint Jean, saint Matthieu et saint Marc (2).
155. Examinons donc s'il règne
un accord parfait entre ces trois différents récits de saint Matthieu, de
saint Marc et de saint Jean ; car c'est bien le même fait, qui eut lieu à
Béthanie, où le: disciples, d'après les trois évangélistes, murmurèrent contre
cette femme de ce qu'elle prodiguait inutilement un parfum d'un si grand prix.
Saint Matthieu et saint Marc font répandre ce parfum sur la tête du Seigneur,
saint Jean sur ses pieds; mais une telle différence n'implique aucune
contradiction, comme déjà nous l'avons démontré au sujet des cinq pains dont
fut nourrie la multitude. De ce que dans l'un il est dit qu'on s'assit par
groupes de cinquante et de cent, et dans l'autre par groupes de cinquante, les
deux passages ne peuvent se contredire. L'un aurait dit qu'ils étaient par
centaines, et l'autre par cinquantaines, qu'il eût encore fallu en` conclure
qu'on avait formé ces deux sortes de groupes. Ce fait nous apprend, comme je
l'ai fait observer alors, que si les évangélistes racontent, celui-ci un fait,
celui-là un autre, nous devons en conclure que les deux faits ont eu lieu (3).
Disons donc aussi que cette femme répandit son parfum, non seulement sur la
tête du Seigneur, mais encore sur ses pieds.
Il est vrai que d'après saint
Marc elle brisa son vase pour oindre la tête : voudra-t-on, pour ce motif,
pousser l'absurdité jusqu'à nier que dans un vase brisé il puisse rester assez
de parfum pour oindre les pieds? Si pourtant un soutenait, afin de mettre en
défaut le récit évangélique, que le vase fut tellement brisé, qu'il n'en resta
rien ; un autre ne montrerait-il pas plus de logique,
et plus de vraie piété, en soutenant, pour appuyer la
véracité des Evangiles, qu'après que le vase fut brisé tout ne fut pas
immédiatement répandu? Enfin, si l'on s'opiniâtrait dans cette lutte aveugle
et de mauvaise foi, et qu'on voulût en brisant le vase, briser l'accord des
évangélistes, je répondrais L'onction des pieds eut lieu avant que le vase fut
brisé, et il était encore intact, quand on répandit le parfum sur la tête;
alors seulement le vase fut, brisé, et tout fut entièrement répandu. Sans
doute il est dans l'ordre de commencer parla tète; mais c'est agir également
avec ordre de monter des pieds à la tête.
156. Le reste de l'histoire ne
peut soulever aucune difficulté. D'après les autres évangélistes, ce sont les
disciples qui se plaignent de voir ainsi répandu un parfum d'aussi grand prix,
tandis que saint Jean attribue cette plainte à Judas, parce qu'il était
voleur. Or, il est évident, selon moi, que Judas se trouve désigné par ce nom
de disciples au pluriel. C'est une manière de parler que nous avons déjà
signalée dans l'histoire des cinq pains au sujet de l'apôtre Phi; lippe, où le
pluriel est employé pour le singulier (1). On pourrait croire aussi que les
autres Apôtres ont pensé ou parlé comme lui, ou bien encore se sont laissé
persuader par Judas, et qu'ainsi saint Matthieu et saint Marc ont pu mettre
cette réflexion dans la bouche de tous, comme l'expression de leur conviction;
que Judas a parlé parce qu'il était voleur, et les autres, par compassion pour
les pauvres, et que saint Jean, en ne désignant que celui-là, a voulu faire
connaître à cette occasion sa funeste habitude de dérober.
157. Saint Matthieu continue:
« Alors un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les princes des
prêtres; et il leur dit : Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ?
Et ceux-ci lui assurèrent trente pièces d'argent, » etc, jusqu'à ces mots : «
Et les disciples firent comme Jésus leur commanda, et ils préparèrent la Pâque
(2). » Rien dans ce passage ne paraît contredire le récit de saint Marc ni
celui de saint Luc, qui contiennent tous deux le même fait (3). Quand saint
Matthieu dit : « Allez dans la ville, « chez un tel, et dites-lui: Le Maître
dit : Mon
203
temps est proche; je veux faire chez toi la Pâque avec
mes disciples, » il désigne évidemment celui que saint Marc et saint Luc
appellent le père de famille, le maître de la maison dans laquelle on leur
montra une salle pour y préparer la Pâque. Si donc saint Matthieu dit
chez un tel, » c'est évidemment une expression qu'il
emploie de lui-même pour abréger le récit. Car s'il eût fait ainsi parler le
Seigneur : Allez à la ville, et dites-lui: Mon temps est proche, je veux faire
la Pâque chez toi; on aurait certainement pu croire que ceci s'adressait à la
ville même. Il ne prête donc point cette parole au Seigneur, en rapportant ses
ordres, mais il dit de lui-même que le Seigneur ordonna l'aller vers un tel .
Cette expression lui paraît suffisante pour faire connaître ce que Jésus
commanda, sans répéter toutes ses paroles. En effet, on ne dit jamais
réellement: Allez vers un tel; qui pourrait le contester ? Si le Seigneur eût
dit : Allez vers le premier venu, vers qui vous voudrez, ces mots auraient
exprimé par eux-mêmes une idée complète, mais ils ne désignaient point vers
qui il les envoyait ; tandis que saint Marc et saint Luc font parfaitement
connaître cet homme sans désigner son nom. Car le Seigneur savait bien vers
qui il les envoyait; et afin qu'ils le pussent trouver eux-mêmes, il leur
indique à quel signe ils le reconnaîtront. C'est un homme portant une cruche
ou une amphore remplie d'eau: c'est lui qu'ils ;doivent suivre jusqu'à la
maison qu'il veut occuper:
On ne pouvait donc pas dire
ici: Allez vers le premier venu : le sens de la phrase eût été complet, mais
la pensée ainsi exprimée n'était plus vraie; et en disant: Allez vers un tel,
n'était-ce pas se servir d'une expression encore plus vague et moins
admissible ? Évidemment les disciples ne furent point envoyés vers le premier
venu, mais vers tel homme, c'est-à-dire, vers un homme qui leur fut clairement
désigné. L'Évangéliste pouvait donc, sans citer textuellement, faire ainsi
connaître et en son nom, ce qui avait été dit: Il les. envoya vers un tel,
pour lui dire : Je veux faire la Pâque chez toi. Il eût pu aussi écrire: Il
les envoya vers un tel, en disant: Allez et dites-lui: Je veux faire la Pâque
chez toi. Il fait donc parler le Sauveur, il cite ses paroles : «Allez dans la
ville, » puis il ajoute : « vers un tel; » non pas que le Seigneur ait dit ce
mot, mais l'évangéliste nous fait entendre, par là, qu'il y avait dans la
ville un homme dont il ne cite point le nom, vers qui furent envoyés les
disciples du Seigneur,
afin de préparer la Pâque. L'auteur écrit donc ici deux
mots de lui-même, puis il reprend la suite des paroles du Seigneur : « Et
dites-lui : Le Maître dit. » Si quelqu'un voulait savoir à qui, on pourrait
lui répondre : A un homme vers qui l'évangéliste indique clairement qu'ils
furent envoyés, quand il dit : « Vers un tel.» Cette manière de parler est peu
usitée ; mais elle a ici un sens complet: Peut-être la langue hébraïque, dans
laquelle on prétend qu'écrivit saint Matthieu, permet-elle de mettre toutes
ces expressions dans la bouche du Seigneur, sans violer les règles: ceux qui
connaissent cette langue, peuvent s'en rendre compte. On eût encore pu
s'exprimer ainsi en latin : Allez dans la ville, vers celui que vous désignera
un homme venant à vous portant une cruche d'eau : car un ordre semblable
pourrait s'exécuter sans embarras. Si l'on disait également: Allez dans la
ville, vers tel homme, qui demeure à tel ou tel endroit, dans cette maison, ou
dans une autre, la désignation du lieu ou de la maison ferait comprendre ces
paroles; on pourrait faire ce qu'elles expriment. Mais si on ne donnait pas
ces signes distinctifs, ou d'autres semblables, et qu'on dît: Allez vers un
tel, et dites-lui; on ne pourrait être compris; car on voudrait, par ces
mots : vers un tel, désigner quelqu'un en particulier sans rien
exprimer qui le distingue. Si donc nous regardons cette expression comme
venant de l'évangéliste lui même, elle pourra paraître un peu obscure, en
énonçant plus brièvement la pensée; mais elle renfermera un seps complet. Si
saint Marc appelle la gène ce que saint Luc nomme amphore, l'un
indique l'espèce de vase, l'autre la manière de le porter; mais tous deux
rendent exactement le fond de la pensée.
158. Saint Matthieu continue:
« Le soir donc étant venu, il était à table avec ses douze disciples, et
pendant qu'ils mangeaient, il dit: En vérité, je vous déclare qu'un de vous
doit me trahir. Alors grandement contristés, ils commencèrent à lui demander
chacun en particulier : Est-ce moi, Seigneur? » etc, jusqu'à ces mots : « Mais
prenant la parole, Judas, qui le trahit, dit : Est-ce moi, Maître ? Il lui
répondit Tu l'as dit (1). » Si nous voulons examiner ce passage, nous n'y
rencontrerons aucune difficulté, non plus que dans les trois autres
évangélistes qui rapportent le même fait (2).
1. Dans cette dernière partie
du récit des évangélistes, nous devons trouver, comme précédemment, l'accord
le plus parfait, sauf certaines divergences qui consistent uniquement dans le
silence gardé par tel auteur sur un événement ou une parole relatés par les
autres. Afin de mieux faire ressortir cet accord; il m'a paru plus naturel et
plus simple de fondre ces quatre narrés en un seul, où seront coordonnés les
témoignages de chaque évangéliste. De cette manière on jutera mieux de
l'ensemble et de l'harmonie générale.
2. Voici d'abord les paroles
de Saint Mathieu : « Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit,
le rompit, le donna à ses disciples et dit : Prenez et mangez; ceci est mon
corps (1). » Saint Marc et Saint Luc s'expriment de la même manière (2). Il
est à remarquer cependant que saint Luc parle deux fois du calice ; la
première avant que le Sauveur donnât le pain, et la seconde après. La première
fois qu'il en parle, c'est en intervertissant l'ordre,ce qui arrive
fréquemment; la seconde fois, c'est en rapportant au moment où elles ont été
prononcées les paroles qu'il n'avait point relatées d'abord; ces deux
citations réunies présentent le même sens que chez les autres évangélistes.
Saint Jean garde ici le silence le plus absolu sur le corps elle sang du
Seigneur; mais il avait rapporté au long les paroles du Sauveur sur le même
sujet, dans un autre endroit de son Evangile (3). Quand donc Il a raconté ici
que le Seigneur s'est levé de table et a lavé les pieds à ses disciples; quand
il a même formulé la raison de ce profond abaissement de son maître, sans
oublier les passages de l'Écriture qui annonçaient la trahison de Judas, il
arrive à cette circonstance, insinuée
1 Matt. XXVI. 20-26. —
2 Marc, XIV, 17-22; Luc, XXII, 14-23, - 3 Jean, vi, 32-64.
seulement par les
trois autres évangélistes : « Jésus, dit-il , ayant ainsi parlé, fut troublé
dans sors esprit, manifesta complètement sa pensée et dit : En vérité, je vous
l'affirme, l'un d'entre vous me trahira. Or, « ajoute saint Jean, les apôtres
se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui Jésus parlait 1. » Ou
bien, comme le rapportent saint Matthieu et saint Marc : « Ils furent plongés
dans la consternation et se mirent à dire.les uns après les autres : Est-ce
que c'est moi ? Jésus, « continue saint .Matthieu, laur répondit : Celui qui
met avec moi la main dans le plat, celui là me trahira : » Le même évangéliste
ajoute : «Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va,
selon ce qui a été écrit de lui; mais malheur à l'homme par qui le Fils de
l'homme sera trahi il eût été mieux pour lui de n'être pas né. » Saint Marc
présente ici avec saint Mathieu une similitude parfaite. Ce dernier ajoute: «
Là dessus Judas, qui fut celui qui le trahit, s'écria : Maître, est-ce que
c'est moi ? C'est toi qui l'as dit, lui répondit Jésus.» Mais ces
dernières paroles ne révélaient pas clairement que Judas fut le traître. En
effet, ne pouvait-on pas les interpréter comme si le Sauveur avait répondu: Je
n'ai pas dit cela? Du reste il est permis de supposer que les autres Apôtres
restèrent étrangers à cet échange de paroles, entre le Seigneur et Judas.
3. C'est après cela que saint
Matthieu, comme saint Marc et saint Luc, nous montre Jésus donnant à ses
disciples son corps et son sang. A peine le Sauveur avait-il présenté le
calice, qu'il parla de nouveau du traître qui devait le livrer; saint Luc
s'exprime ainsi : « Voici que la main de celui qui me trahit est avec moi sur
cette table. « Quant au Fils de l'homme, il s'en va, ainsi que cela a été
décidé; mais malheur à l'homme par qui il sera livré! » Il faut observer que
ces paroles furent suivies de celles que saint Jean rapporte et qui sont
omises par les autres évangélistes. De son côté, saint Jean en omet
quelques-unes qui nous sont rapportées par eux.
204
Lors donc qu'après avoir donné
le calice le Seigneur eut dit, comme le rapporte saint Luc Cependant voici que
la main de celui qui me trahit est avec moi sur cette table, etc, » il faut
ajouter immédiatement ces paroles de saint Jean: « Cependant un des disciples
était penché sur le sein de Jésus; c'était celui que Jésus aimait. Simon
Pierre lui fit signe et lui dit : De qui veut-il donc parler? Ce disciple,
étant penché sur le sein de Jésus, lui dit : Seigneur, qui est-ce? Jésus lui
répondit : C'est celui à qui je présenterai le pain que j'aurai trempé. Et. «.
quand il eut trempé le pain, il le donna à Judas, fils de Simon Iscarioth. Et
après qu'il eut pris une bouchée, Satan entra en lui. »
4. Il semble que ces dernières
paroles sont en contradiction avec celles de saint Luc, qui nous dit, que
satan entra dans le coeur de Judas, quand il conclut son pacte avec les Juifs
et s'engagea à leur livrer son maître pour de l'argent, Il y a plus, car dans
ces mêmes paroles saint Jean semble se mettre en contradiction avec lui-même.
En effet, quelques versets plus haut, avant que Judas eut pris ce pain qui lui
était présenté, saint Jean avait déjà dit de lui : « Et le repas étant fini,
quand déjà le démon s'était emparé du cœur de Judas pour le porter à livrer
son maître. » Comment, en effet, le démon entre-t-il dans le coeur des
méchants, si ce n'est en les remplissant de desseins et de pensées
criminelles? Pour concilier ces deux. passages, il suffit de dire que cette
seconde fois Judas fut complètement possédé du démon. N'est-il.pas vrai, de
même que, après avoir
reçu le Saint-Esprit
à la suite de la résurrection, quand le Sauveur souffla sur eux en leur
disant : « Recevez le Saint-Esprit (1), » les Apôtres plus tard le reçurent de
nouveau le jour de la Pentecôte, dans toute sa plénitude? Donc après le repas,
satan entre en Judas et, suivant le texte de saint Jean, Jésus lui dit : « Ce
que tu fais; fais-le au plus tôt, : Mais aucun de ceux qui étaient à table ne
comprit pourquoi il lui avait ainsi parlé. Parce que Judas portait la bourse,
quelques uns pensèrent que par ces paroles Jésus avait voulu lui dire : Achète
ce dont nous avons besoin pour le jour de la. fête, ou bien qu'il lui
commandait de distribuer quelque chose aux pauvres. Pour Judas, il sortit
aussitôt qu'il eut pris ce morceau, mais alors il faisait nuit. Et quand il
fut sorti, Jésus leur dit : Voici que le Fils de l'homme va être
glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Et si Dieu a été
glorifié en lui, Dieu le glorifiera aussi en lui-même, et c'est de suite qu'il
va le glorifier. »
5. « Mes chers petits enfants,
je ne suis plus que pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez; et comme
je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous fais un
commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez
réciproquement, et qu'ainsi que je vous ai aimés, vous vous aimiez les uns les
autres. Simon Pierre lui dit : Seigneur, où allez-vous? Jésus lui répondit :
Là où je vais, tu ne peux venir maintenant, mais tu y viendras plus tard.
Pierre ajouta : Pourquoi ne pourrais-je vous suivre maintenant? je
donnerai ma vie pour vous. Jésus lui répondit : Tu donneras ta vie pour moi?
En vérité, en vérité je te le dis, le coq n'aura pas encore chanté que tu
m'auras renié trois fois (1). » Cette prédiction du reniement de saint Pierre,
formulée par saint Jean dans les termes que je viens de rapporter, est aussi
mentionnée par les trois autres évangélistes (2). Il faut reconnaître,
cependant, que dans tous ces auteurs, cette prédiction n'est pas faite dans la
même circonstance. Ainsi, saint Matthieu et saint Marc qui se suivent ici
absolument, ne font mention de cette prophétie que quand le Sauveur fut sorti
du cénacle même. Mais on peut facilement tout concilier en supposant que saint
Matthieu et saint Marc ne font que récapituler ce qui s'était dit
précédemment. Ne pourrait-on pas supposer aussi, en voyant les protestations
de Pierre précédées de paroles et de réflexions si diverses faites par le
Sauveur, que frappé des prédictions de son maître, Pierre lui attesta, par
trois fois différentes, qu'il était disposé à donner sa vie pour lui ou avec
lui, et qu'à chacune de ses attestations présomptueuses, le Sauveur lui
répondit, qu'avant le chant du coq il aurait trois fois renié son maître?
6. En effet tout porte à
croire que dans trois moments différents, quoique peu séparés, Pierre fut
victime de la présomption comme il devait par trois fois différentes, renier
Jésus-Christ, et que, trois fois il reçut du Seigneur une réponse
206
pareille; comme après la résurrection il s'entendit
demander par trois fois s'il aimait, et par trois fois, sans qu'aucune autre
parole fut échangée, il reçut l'ordre de paître les agneaux et les brebis (1).
Dans cette interprétation, on s'explique parfaitement l'espèce de variété que
l'on remarque dans les récits évangéliques, au sujet des paroles de saint
Pierre et de celles du Sauveur, paroles citées assez diversement et dans des
circonstances différentes.
Rappelons-nous la suite du
récit, tel que nous le trouvons en saint Jean : « Mes chers petits enfants, je
ne suis plus que pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez; et comme
j'ai déjà dit aux Juifs : vous ne pourrez venir où je vais, je vous le dis
maintenant à vous-mêmes. Je vous fais un commandement nouveau, c'est que vous
vous aimiez réciproquement, et qu'ainsi que je vous ai aimés, vous vous aimiez
les uns les autres.Chacun pourra reconnaître que vous êtes mes disciples, si
vous vous aimez les uns les autres. Simon Pierre lui dit : Seigneur, où
allez-vous? » Rien de si naturel que ce mouvement qui pousse saint Pierre à
demander : « Seigneur, où allez vous? » puisqu'il venait d'entendre ces mots :
« Où je vais, vous ne pouvez pas venir vous-mêmes. » Jésus lui répondit : « Là
où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. »
Et Pierre de répliquer: « Pourquoi ne pourrais-je pas vous suivre maintenant?
je donnerai ma vie pour vous. » A cette présomption, le Sauveur répond en lui
prédisant son- renoncement. Quant à saint Luc, il rappelle d'abord ces paroles
de Jésus-Christ: « Simon, voici que satan vous à convoités pour vous cribler,
comme on crible le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne
défaille pas. Lors donc que tu seras revenu, confirme tes frères. » Puis, il
ajoute que saint Pierre répondit : « Seigneur, je suis prêt à aller avec vous
et en prison et à la mort. Jésus lui dit: Je t'affirme, Pierre, qu'avant que
le coq ait chanté aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » On voit que ce qui
a provoqué la présomption de Pierre, est bien différent dans le récit de saint
Jean et dans celui de saint Luc. Voici maintenant le texte de saint Matthieu :
« Et l'hymme étant achevée, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors
Jésus leur dit : Cette nuit, vous serez tous scandalisés à mon sujet, car il
est écrit : Je frapperai le pasteur
et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais lorsque
je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » C'est à peu près le
texte de saint Marc. Or qu'elle ressemblance trouver entre ce texte et le
langage présomptueux de Pierre dans saint Jean ou dans saint Luc? Saint
Matthieu continue : « Et Pierre répondit: Lors même que tous seraient
scandalisés à votre sujet, pour moi, je ne le serai jamais. Jésus lui répliqua
: Je te dis, en vérité, que dans cette nuit même, avant que le coq chante, tu
me renieras trois fois. Pierre lui répondit : Quand il me faudrait mourir avec
vous, je ne vous renierai pas. Les autres disciples en dirent autant. »
7. Saint Marc se sert à peu
près des mêmes expressions, mais avec plus de précision encore sur la manière
dont les choses devront se. passer: « En vérité je te déclare, dit le
Seigneur, que toi même, aujourd'hui, dans cette nuit, avant que le coq ait
chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Les autres évangélistes
avaient annoncé que Pierre renierait son maître avant le chant du coq, sans
préciser combien de fois le coq chanterait. Saint Marc est le seul qui se soit
montré aussi explicite. De là certains auteurs ont prétendu que . saint Marc
était en désaccord avec les autres écrivains sacrés; mais cette prétention ne
peut être que l'effet, ou d'une grande légèreté, ou d'un profond aveuglement,
fruit de leur haine contre l'Evangile. En effet, il est certain que Pierre
renia trois fois son Maître. Il resta sous la peur dont il était saisi, et
dans sa résolution de nier jusqu'au moment où le Sauveur lui rappelant ce qui
lui avait été prédit, il trouva sa guérison dans des larmes amères et dans le
repentir du coeur. Or, si ce triple reniement n'eut lieu qu'après le premier
chant du coq, les trois Évangélistes peuvent être accusés d'erreur. Saint
Matthieu dit: « En vérité je te déclare que, dans cette nuit, avant que le coq
ait chanté, tu me renieras trois fois. » Saint Luc : « Je te dis, Pierre,
qu'avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois; » et saint
Jean : « En vérité, en vérité je t'affirme que le coq ne chantera pas que tu
ne me renies trois fois. » On voit que ce n'est pas dans les mêmes termes ni
dans le même ordre, que les évangélistes rapportent cette sentence du Sauveur,
annonçant qu'avant le chant du coq Pierre l'aurait renié trois fois. Or
pourquoi préciser les deux chants du coq, si le triple reniement devait être
accompli avant le premier, et, (207) par là même, avant le second, avant le
troisième et avant tous les autres chants du coq durant cette nuit? Observons
qu'avant le premier chant du coq, la série des reniements était commencée; or
les trois évangélistes ne se sont pas proposé de nous dire à quel moment saint
Pierre compléta cet acte de lâcheté; il leur a suffi de nous révéler l'heure
avant laquelle il le commença, et le nombre de fois qu'il le renouvela. Il le
renouvela trois fois et il le commença avant le chant du coq.
Bien plus, il est certain que
dans sa
pensée il consomma son crime avant le premier chant du coq; qu'importe
alors qu'il ait commencé, avant le premier chant, sa triple négation, et qu'il
ne l'ait achevée qu'avant le second chant? Sa faute était voulue et consommée
avant le premier chant du coq. Qu'importe aussi que ses négations eussent été
séparées par des intervalles plus ou moins longs? Avant le premier chant, il
était tellement victime de la crainte et de la lâcheté, qu'il était disposé à
renier son maître, une première, une seconde, une troisième fois si on
l'interrogeait encore. Il réalisait une parole du Sauveur qui déclare que
jeter, sur une femme, un regard adultère , c'est déjà avoir commis l'adultère
dans son coeur (1). Par la même raison, quand Pierre exhalait dans ses paroles
cette crainte étrange, à laquelle il était en proie, et dont il subit
l'influence jusqu'à une seconde et une troisième négation, on peut dire que
tout son crime lui devint imputable, au moment même où il se laissa dominer
par cette frayeur qui devait le faire apostasier trois fois. En admettant dès
lors, que ce ne fut qu'après le premier chant du coq, que tourmenté par les
questions qui lui étaient faites, il commença cette triste série de
dénégations, même alors serait-il donc si absurde de dire qu'il a renié trois
fois avant le chant du coq, puisque avant ce chant du coq il était déjà tout
entier sous le coup de cette crainte qui devait l'amener à un triple
reniement? Or cette assertion est d'autant plus naturelle que ce reniement fut
commencé réellement avant le premier chant du coq, quoiqu'il n'ait été complet
qu'avant le second. Je dis à quelqu'un: cette nuit, avant que le coq chante,
tu m'écriras une lettre dans laquelle tu m'insulteras trois fois. Aurai-je
fait une fausse prophétie, parce que cette lettre, commencée avant le premier
chant du coq, n'a été terminée qu'après? Toute la différence présentée par
saint Marc vient
donc de l'énonciation formelle des intervalles qui
marquèrent les protestations de l'Apôtre infidèle : « Avant que le coq ait
chanté deux fois, « tu me renieras trois fois. » Du reste, quand nous serons
en face du récit lui-même, nous montrerons le parfait accord des évangélistes.
8. Chercher à connaître toutes
les paroles que le Seigneur adressa à Pierre, est une prétention vaine et
inutile. Il suffit de connaître la pensée générale, qui fut comme le résumé de
ces paroles; et cette pensée nous est révélée dans les différents récits des
évangélistes. Soit donc qu'on admette que ce fut à diverses reprises, pendant
les discours du Seigneur, que Pierre ému laissa échapper cette triple .et
présomptueuse protestation qui provoqua la triple. prophétie de son reniement,
et c'est là le plus . probable; soit que l'on coordonne le récit des
Evangélistes, de telle manière, qu'il en résulte que le Seigneur ne prédit
qu'une seule fois à Pierre, trop présomptueux, qu'il le renierait la nuit
même; toujours est-il que l'on ne peut surprendre dans ces textes différents
aucune contradiction; et en effet il n'y en a aucune.
9. Suivons maintenant, autant
que nous le pourrons, l'ordre chronologique d'après tous les évangélistes.
Après avoir rapporté la triste prédiction faite à Pierre, saint Jean nous
représente le Sauveur continuant à s'entretenir avec ses apôtres et leur
disant : « Que votre coeur ne se trouble point; vous croyez en Dieu, croyez
aussi en moi. Il y a bien des demeures dans la maison de mon Père; » etc. Le
texte de ce discours sublime et magnifique va jusqu'à cet endroit où le
Seigneur s'écrie : « Père juste, le monde ne vous connaît pas, mais moi je
vous connais, et ceux-ci savent que vous m'avez envoyé, et je leur ai fait
connaître votre nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour
dont vous m'avez aimé soit en eux et que je sois aussi en eux (1). —
Or, comme le raconte saint Luc, il s'éleva entre eux une contestation
sur la question de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le
plus grand. Mais Jésus leur dit : Les rois des nations exercent sur elles leur
autorité, et ceux qui les dominent prennent le nom de bienfaiteurs. Il n'en
sera pas ainsi pour vous ; il faut que le plus grand soit comme le plus petit,
et celui qui est à la tête comme celui qui obéit.
208
Et en effet,lequel est le plus grand, de celui qui est à
table ou de celui qui le sert? Mais pourtant me voici au milieu de vous dans
l'attitude de celui qui sert. Pour vous, vous êtes demeurés fermes avec moi au
milieu de mes tentations. Et voici que je vous prépare le royaume comme mon
Père me l'a préparé, afin que vous y mangiez et que vous y buviez à ma table,
« et que vous y soyez assis sur des trônes pour juger les douze tribus
d'Israël. Or, ajoute saint Luc, le Seigneur dit à Simon: Voilà que satan vous
a convoités pour vous cribler comme on crible le froment; mais j'ai prié pour
toi, afin que la foi ne défaille point; toi donc, lorsque tu seras revenu,
confirme tes frères. Pierre lui répondit: Seigneur, je suis prêt à aller avec
vous et en prison et à la mort. Et le Seigneur lui dit : Je te l'assure,
Pierre, le coq n'aura pas chanté aujourd'hui, que déjà tu m'auras renié trois
fois. Puis il leur dit à tous : Quand je vous ai envoyés sans sac de voyage,
sans bourse et sans chaussure, est-ce que quelque chose vous a manqué? Non,
répondirent-ils. Le Seigneur ajouta: Mais, maintenant, que celui qui a un sac
le prenne, qu'il prenne aussi sa bourse, « et que celui qui n'en a point,
vende sa tunique pour acheter une épée. Car je vous assure qu'il faut encore
que l'on voie s'accomplir en moi cette parole de l'Écriture : Il a été mis au
rang des criminels, et ce qui me concerne touche à son accomplissement. Ils
lui dirent : Voici deux épées, Seigneur. C'est assez, leur répondit-il (1).
Et l'hymne étant dite, ajoutent saint Matthieu et saint Marc, ils se
rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : Vous serez tous
scandalisés cette nuit, à mon sujet, car il est écrit : Je frapperai le
pasteur, et les brebis du troupeau seront dispersées; mais quand je serai
ressuscité, je vous précèderai en Galilée. Pierre prenant la parole lui dit:
Lors même que tous seraient scandalisés à votre sujet, moi je ne me
scandaliserai jamais. Jésus lui répondit: « Je te déclare en vérité, que dans
cette nuit, « avant que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois. Pierre
répliqua: Lors même qu'il me faudrait mourir avec vous, je ne vous renierai
pas. Les autres disciples en dirent autant (2). » Nous avons inséré ici les
paroles de saint Matthieu, mais saint Marc s'exprime d'une manière à peu près
identique (3); la seule différence est celle que nous avons signalée plus
haut, relativement au chant du coq.
10. Saint Matthieu, continuant
son récit, ajoute : « Alors Jésus entra avec eux dans une villa dite de
Gethsémani (1). » Saint Marc s'exprime de même (2); saint Luc, sans désigner
le nom de la villa, se contente de dire : « Et étant sorti il allait, selon
son habitude, au mont des Oliviers, « et ses disciples le suivirent. Or, quand
il y fut arrivé, il leur dit : Priez, afin que vous n'entriez pas en tentation
(3). » Ce lieu est celui qui est appelé Gethsémani par les deux autres
évangélistes. Il y avait là un jardin dont parle saint Jean en ces termes : «
Lorsqu'il eut achevé ces dernières paroles, il traversa avec ses disciples le
torrent de Cédron, au de là duquel se trouvait un jardin où il entra, lui et
ses disciples (4). » Ensuite, d'après saint Matthieu, « il dit à ses disciples
: Arrêtez-vous ici pendant que je vais aller là, pour .prier. Et prenant avec
lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il se mit à éprouver de la tristesse
et une grande affliction. Puis il leur dit : Mon âme est triste à la mort.
Demeurez ici et veillez avec moi. « Et s'avançant un peu plus loin, il se
prosterna la face contre terre, priant et disant : Mon Père, si c'est
possible, que ce calice passe loin de moi, mais qu'il en soit comme vous le
voua lez et non comme je veux. Puis il vint vers ses disciples, les trouva
endormis et dit à Pierre : N'avez-vous donc pu veiller une heure avec moi?
Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation, Car l'esprit est
prompt, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois Et pria en ces
termes : Mon Père, si ce calice ne peut passer loin de moi sans que je le
boive, que votre volonté se fasse. Ensuite il retourna vers eux, et les trouva
encore endormis, car ils avaient les yeux appesantis. Il les quitta donc,
s'éloigna de nouveau et pria une troisième fois en prononçant toujours les
mêmes paroles. Enfin il revint auprès de ses disciples et leur dit : Dormez
maintenant et prenez du repos! Voici que l'heure approche, et le Fils de
l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous,
marchons, voici que s'approche celui qui doit me livrer.
»
11. Saint Marc nous présente à
peu près le même récit, avec cette simple différence que quelquefois il est
plus court et quelquefois plus long, tout en exprimant les mêmes pensées.
Remarquons cependant que saint Matthieu semble en contradiction avec lui-même,
quand après la troisième prière, il met ces paroles sur les lèvres du Sauveur
: « Dormez maintenant et prenez du repos ! Voici que l'heure approché, et le
Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous,
marchons; voici que s'approche celui qui doit me livrer. » Pourquoi ces
paroles : « Dormez maintenant et prenez du repos, » suivies immédiatement de
ces autres : « Voici que l'heure approche, levez-vous, marchons ? » Sous le
coup de cette apparente contradiction, le lecteur s'efforce de donner à ces
mots : « Dormez maintenant et prenez du repos, » le ton du reproche et non
celui d'une véritable permission. A la rigueur, sans doute, on pourrait
accepter cette interprétation. Mais si l'on observe que saint Marc, après ces
paroles : « Dormez maintenant et prenez du repos, » ajoute : « Cela suffit, »
pour reprendre ensuite : « Voici l'heure qui approche, où le Fils de l'homme
sera livré, » on conclut naturellement qu'après ces mots : « Dormez maintenant
et prenez du repos, » le Seigneur garda le silence pendant quelque temps, afin
de laisser faire ce qu'il avait permis; ce n'est qu'après cela qu'il ajouta :
« Voici que l'heure approche. » C'est ce qui nous explique ce mot de saint
Marc : « Cela suffit, » c'est-à-dire le repos que vous venez de prendre est
suffisant. Néanmoins, comme il n'est fait aucune mention du silence gardé
pendant quelque temps par Jésus-Christ, on s'efforce d'aider l'intelligence,
par une prononciation particulière donnée au texte.
12. Saint Luc ne parle pas de
la réitération de la prière; mais il mentionne des détails qui ont été passés
sous silence par les autres évangélistes: ainsi le secours apporté au Sauveur
par l'Ange, la sueur de sang dont les gouttes, découlaient jusqu'à terre. Il
se contente donc de dire : « Quand il se fut relevé de sa prière et qu'il fut
arrivé auprès de ses disciples, » sans dire après laquelle de ses prières.
Cependant son récit n'est nullement en contradiction avec les deux précédents.
Quant à saint Jean, il nous raconte, il est vrai, l'entrée du Sauveur et de
ses disciples dans le jardin ; mais il ne dit absolument rien de ce qui s'y
passa jusqu'au moment où arriva le traître avec les Juifs pour se saisir de sa
personne.
13. Les trois évangélistes ont
donc raconté ce même événement, avec autant de conformité et d'accord qu'il
serait possible à un seul homme d'en mettre, s'il avait trois fois à faire le
même récit, en y mêlant toutefois quelque variété. Saint Luc nous précise la
distance à laquelle le Sauveur s'éloigna de ses disciples : « à la distance
d'un jet de pierre. » Saint Marc parle d'abord en son nom de la prière du
Sauveur et dit qu'il demanda : « que s'il était possible l'heure passât loin
de lui; » c'est l'heure de sa passion, qu'il désigne bientôt sous le nom de
calice. Il met ensuite dans la bouche du Seigneur les paroles suivantes : «
Abba, mon Père, tout vous est possible, éloignez de moi ce calice. » En
rapprochant ces expressions des expressions employées par les deux autres
évangélistes, et par saint Marc lui-même, parlant en son propre nom, on aura
le texte suivant : « Mon Père, si c'est possible, or tout vous est possible,
éloignez de moi ce calice: » Afin qu'on ne pût avoir même la pensée qu'il
diminuât la puissance de son Père, il ne dit pas : si vous pouvez, mais : « si
cela est possible, » ce qui revient à dire : « si vous voulez, » car ce que
Dieu veut, est possible. Saint Marc s'est chargé lui-même de nous donner
l'explication de ces mots : « Si cela est possible, » quand il ajoute : « Or
tout vous est possible. » Enfin ces autres paroles : « Cependant, qu'il
advienne, non ce que je veux, « mais ce que vous voulez, » ou en d'autres
termes : « Que votre volonté se fasse et non la mienne, » nous indiquent
clairement que ces mots : « si cela est possible, » s'appliquent, non pas à
une impossibilité réelle, mais uniquement à la volonté de son Père. Aussi
saint Luc est plus explicite encore, car il met uniquement sur les lèvres du
Sauveur ces paroles : « Mon Père, si vous voulez. » Rapprochons ces mots du
texte de saint Marc, et nous aurons : « Mon Père, si vous voulez, car tout
vous est possible, éloignez de moi ce calice. »
14. Saint Marc ne se contente
pas du mot Mon Père, » il y ajoute le mot Abba, qui, en hébreu, a absolument
la même signification. Peut-être que pour indiquer un profond mystère, le
Sauveur a en effet prononcé ces deux mots. Il aurait voulu nous faire
comprendre, qu'en se
210
faisant victime de cette tristesse profonde, il
représentait son corps mystique, l'Église, dont il est la pierre angulaire, et
qui devait se composer, soit d'Hébreux dont le cri est : Abba, soit de,
Gentils, figurés par le mot qu'ils prononcent Père (1). Saint Paul a saisi ce
mystère, puisqu'il dit lui-même, en parlant de Dieu : « En qui nous crions
Abba, Père (2); » ailleurs il ajoute : « Dieu a envoyé dans vos coeurs son
Esprit, criant : « Abba, Père. (3) » Ne fallait-il pas que Jésus, le bon
maître et le véritable Sauveur, tout compatissant pour les faibles, prouvât
dans sa propre personne, que les martyrs ne doivent pas désespérer, quand au
moment de leurs souffrances ils sentent la tristesse s'emparer de leur coeur;
et qu'ils s'efforcent d'en triompher par la soumission de leur volonté à la
volonté de Dieu, en se rappellant que Dieu sait les besoins de ceux qu'il
protège? Mais -ce n'est pas le lieu de développer plus longuement cette
pensée; le sujet qui nous occupe, c'est l'accord des évangélistes; et si nous
remarquons entre eux une certaine diversité, cette diversité nous apprend à ne
chercher la vérité, que dans la pensée de celui qui parle. C'est ainsi que ces
deux mots : « Abba, Père, » ont la même signification; mais si nous avons
spécialement en vue le mystère, les d'eux réunis, « Abba, Père, » semblent
mieux appropriés; si nous voulons signifier l'unité, le mot Père suffit. Nous
devons croire que le Sauveur a prononcé ces deux mois; cependant il manquerait
quelque chose à l'idée exprimée, si les autres évangélistes, en se contentant
du mot Père, n'avaient montré clairement, que ces deux Eglises des Juifs et
des Gentils maintenant n'en forment plus qu'une. En prononçant ces deux termes
: « Abba, Père, » le Seigneur énonçait ce qu'il a dit formellement ailleurs :
« J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau; » ces brebis, ce sont
les Gentils, car le peu qu'il en avait alors appartenaient au peuple d'Israël.
En ajoutant : « Il faut que je les amène, afin qu'il n'y ait qu'un seul
troupeau et un seul pasteur (4), » il formulait plus longuement ce qui est
renfermé dans ce seul mot : « Père, » l'unité de troupeau et de société, comme
il avait exprimé la pluralité par ces deux mots : « Abba, Père, » l'un Hébreu,
l'autre Gentil,
15. « Le Sauveur parlait
encore, disent saint Matthieu et saint Marc, et voici que Judas, l'un des
douze, se présenta, accompagné d'une foule nombreuse, armée de glaives et de
bâtons, et envoyée par les princes des prêtres et par les anciens du peuple.
Or, celui qui le livra, leur avait donné ce signal : Celui que j'embrasserai,
c'est lui-même, emparez-vous de lui. Et s'approchant de Jésus, il lui dit : Je
vous salue, maître, et il l'embrassa (1). » La première parole que Jésus
prononça, c'est celle-ci, rapportée par saint Luc : « Judas, tu trahis le Fils
de l'homme par un baiser (2) ; » la seconde est celle de saint Matthieu.: «
Mon ami, pourquoi est tu vend? » Enfin une troisième parole nous est conservée
par saint Jean : « Qui cherchez-vous? Il lui répondirent: Jésus de Nazareth.
Jésus leur dit : C'est moi. Or, au milieu d'eux se trouvait Judas, qui le
livrait. Quand donc il leur eut dit : C'est moi; ils allèrent à la renverse et
tombèrent à terre. Après cela, il leur demanda encore une fois : Qui
cherchez-vous? Ils lui dirent : Jésus de Nazareth. Jésus leur répondit : Je
vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller
ceux-ci. Afin que cette parole qu'il avait.prononcée, fut accomplie : Je n'ai
perdu aucun de ceux que vous m'avez donnés (3). »
16. « Or, dit saint Luc, ceux
qui l'environnaient, voyant ce qui allait arriver, lui dirent : Seigneur, si
nous- frappions de l'épée? Et l'un d'eux, » les quatre évangélistes sont
unanimes sur ce point, « frappa un serviteur du grand-prêtre et lui coupa
l'oreille droite, » disent saint Luc et saint Jean. Or, selon saint Jean,
celui qui frappa ainsi, ce fut saint Pierre, et celui qu'il frappa, se nommait
Malchus. D'après saint Luc, « Jésus élevant la voix leur dit : Laissez aller
jusque là, » et d'après saint Matthieu il continua ainsi : « Remets ton épée
dans le fourreau. Car tous ceux qui. auront pris l'épée, périront par l'épée.
Crois-tu que je ne puisse pas prier mon Père, qui m'enverrait aussitôt plus de
douze légions d'anges? Comment donc s'accompliront les Écritures, qui ont
annoncé qu'il doit en être ainsi? » On peut ajouter à cela ce que rapporte
saint Jean: « Ce calice que mon Père
211
m'a donné, ne veux-tu pas que je le boive? » Saint Luc
continue son récit en disant que Jésus toucha l'oreille de celui qui avait été
frappé, et le guérit.
17. On soulève des difficultés
au sujet de ce passage de saint Luc, où le Seigneur interrogé par ses apôtres,
s'ils devaient frapper de l'épée, répondit : « Laissez aller jusque-là, »
comme s'il eût approuvé ce qui venait de se passer, tout en défendant d'aller
plus loin. Dans saint Matthieu, au contraire, on voit clairement que ce coup
de hardiesse de saint Pierre a déplu au Sauveur. Voici la vérité, je crois. A
cette question des apôtres : « Maître, si nous frappions de l'épée? » le
Sauveur répondit : « Laissez aller jusque-là, » c'est-à-dire, ne vous opposez
point à ce qui va arriver, car je dois permettre à mes ennemis de pousser la
haine envers moi, jusqu'à s'emparer de ma personne, afin que les Ecritures
s'accomplissent. Mais dans l'intervalle qui suivit la demande et précéda la
réponse, Pierre, saisi d'un enthousiasme plus vif pour son Maître et du désir
de le défendre, frappe le serviteur du grand-prêtre. Or, il est évident qu'il
fallut plus de temps pour poser la question et y répondre qu'il n'en fallut a
saint Pierre pour frapper son ennemi. En effet, le texte porte : « Et Jésus
répondit, »c'était donc à la question qu'il répondit et non à l'acte de
Pierre. Saint Matthieu, seul, nous fait connaître la pensée du Sauveur, sur
l'empressement de son disciple. Dans ce passage, saint Matthieu ne dit pas de
Jésus : « Il répondit à Pierre : Remets ton épée dans le fourreau; » nous
lisons : « Alors il dit à Pierre : Remets ton épée; » ce qui n'a pu être dit
qu'après l'acte de Pierre. Si saint Luc porte : « Jésus répondit . Laissez
aller jusque là; » cette réponse dut évidemment être faite à ceux qui
l'avaient interrogé; mais parce que, comme nous l'avons observé, le coup fut
porté dans l'intervalle de la demande et de la réponse, l'écrivain sacré,
polir suivre l'ordre des faits, a cru devoir mentionner l'action entre la
demande et ta réponse. Il n'y a donc aucune contradiction à tirer de ces
paroles de saint Matthieu : « Tous ceux qui prendront l'épée, qui en feront
usage périront par l'épée. » Il en serait autrement si le Seigneur, dans sa
réponse, avait paru approuver l'usage spontané du glaive, ne fût-ce que pour
une seule blessure, et ne fût-elle pas mortelle. Enfin, rien ne s'oppose à ce
que l'on applique à saint Pierre la réponse tout entière, telle que nous la
trouvons dans saint Luc et saint Matthieu : « Laissez aller jusque-là; remets
a ton glaive dans le fourreau. Tous ceux qui prendront l'épée périront par
l'épée, etc. » J'ai expliqué le sens de ces expressions : « Laissez aller
jusque-là; » si l'on peut en donner une meilleure interprétation, j'y consens;
Pourvu cependant qu'on n'ébranle pas la vérité ni l'accord des récits
évangéliques.
18. Saint Matthieu continue,
et- met sur les lèvres du Sauveur ces autres paroles, prononcées à l'heure
même : « Vous êtes venus, armés d'épées et de bâtons, pour me prendre, comme
un larron. Cependant, je me suis trouvé tous les jours au milieu de vous,
siégeant et enseignant dans le temple ; et vous n'avez pas mis la main sur
moi. Mais, selon le texte de saint Luc, voici votre heure et celle de la
puissance des ténèbres. Or, selon saint Matthieu, tout cela se passa afin que
toutes les prophéties fussent accomplies. Alors tous les disciples
l'abandonnèrent et s'enfuirent, » comme l'atteste aussi saint Marc, qui
continue ainsi : « Jésus était suivi par un jeune homme couvert d'un linceul ;
et comme on voulait le saisir, il abandonna son linceul aux mains de ceux qui
le tenaient et s'enfuit sans aucun vêtement. »
19. « Ces gens, s'étant donc
saisis de Jésus, le conduisirent chez Caïphe, prince des prêtres, où les
Scribes et les anciens du peuple s'étaient rassemblés (1). » Mais, d'après
saint Jean, Jésus fut d'abord conduit chez Anne beau-père de Caïphe (2). Saint
Marc et saint Luc ne désignent pas le nom du pontife (3). Or Jésus frit
conduit garrotté, parce que, d'après saint Jean, il y avait dans la foule un
tribun, une cohorte et les ministres des Juifs.
« Cependant Pierre le suivait
de loin, jusque dans la cour du palais du grand-prêtre, et étant entré il se
tenait assis au milieu des serviteurs, afin de voir le dénouement. » A ce
récit de saint Matthieu, saint Marc ajoute, que « Pierre se chauffait auprès
du feu. » Saint Luc signale le même fait: « Pierre suivait de loin, dit-il ;
or, il y avait du feu allumé au milieu de la cour, une grande
212
foule s'assit tout autour, et Pierre était au milieu
d'eux. » D'après saint Jean : « Pierre le suivait de loin, ainsi qu'un autre
disciple. Or ce disciple était de la connaissance du grand-prêtre, et il entra
avec Jésus dans la cour du pontife. « Quant à Pierre, il demeura en dehors, à
la porte. Alors cet autre disciple qui était commis du grand-prêtre, sortit,
parla à la portière et introduisit Pierre dans la cour. » Voilà ce qui nous
explique pourquoi saint Pierre pénétra dans l'intérieur de la cour, comme nous
l'attestent les autres évangélistes.
20. « Or, dit saint Matthieu,
les princes des prêtres et tout le conseil, cherchaient un faux témoignage
contre Jésus, afin de pouvoir le livrer à la mort. Mais il ne s'en trouvait
point. « Il se présenta bien plusieurs faux témoins qui déposaient
mensongèrement contre lui, mais leurs dépositions ne s'accordaient pas. »
C'est saint Marc qui en fait l'observation, en rapportant ce passage. « Enfin
il se trouva deux faux témoins, dit saint Matthieu, qui déposèrent contre lui
en ces termes : Il a dit : Je puis détruire le temple de Dieu et je le
relèverai après trois jours. » Saint Marc signale d'autres témoins qui dirent.
« Nous l'avons entendu s'écriant : Je renverserai ce temple, fait de main
d'homme, et après trois jours j'en bâtirai un autre, qui ne sera pas fait de
main d'homme, et il n'y avait pas accord dans leurs dépositions. Alors le
grand-prêtre se leva et dit à Jésus. Vous n'avez rien à répondre à ce que ces
gens déposent contre vous ? Mais Jésus gardait le silence. Et le prince des
prêtres lui dit : Je vous adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si vous
êtes le Christ, Fils de Dieu. « Jésus lui répondit: Vous l'avez dit. » Ces
paroles sont de saint Matthieu. Saint Marc exprime les mêmes pensées avec
d'autres termes, seulement il ne parle pas de l'adjuration portée par le
grand-prêtre ; mais cette réponse du Sauveur : « Tu l'as dit, » revient
à celle-ci : « Je le suis. » Cet auteur ajoute : « Jésus lui répondit : Je le
suis, et vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance
divine, venir sur les nuées du ciel. » Saint Matthieu s'exprime de même, mais
il ne dit pas que Jésus eut répondu : « Je le suis. Alors le grand-prêtre
déchira ses vêtements en s'écriant : Il a blasphémé ; qu'avons nous encore
besoin de témoins ? » Après ces paroles, saint Matthieu ajoute : « Vous venez
d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Et tous de répondre : Il est
digne de mort. »
Saint Marc s'exprime de même,
et saint Matthieu continue : « Alors ils lui crachèrent au visage et
l'accablèrent de soufflets. D'autres lui portant des coups sur la face, lui
disaient : Christ, prophétise, et dis-nous qui t'a frappé. » Saint Marc ajoute
à cela qu'ils lui voilèrent la face. Saint Luc s'exprime de la même manière.
21. Cette scène d'outrages se
passa dans la maison du grand-prêtre, où le Sauveur avait d'abord été conduit
et dura jusqu'au matin ; et c'est pendant ce même temps que Pierre fut tenté.
Quant à cette tentation, qui eut lieu pendant que le Seigneur était couvert
d'outrages, les évangélistes ne la racontent pas tous dans le même ordre:
Saint Matthieu et saint Marc décrivent d'abord toutes les injures lancées à
Jésus-Christ ; puis seulement ils racontent la tentation. Saint Luc parle
d'abord de cette tentation ; de là il passe aux souffrances du Seigneur. Quant
à saint Jean, il commence à décrire la tentation, puis il intercale quelque
chose des humiliations du Sauveur chez Anne, ensuite il nous le montre conduit
chez Caïphe. Avant de nous dire ce qui se passa devant ce second tribunal, il
revient sur ses pas, pour reprendre la description déjà commencée de la
tentation de Pierre dans la maison où il avait d'abord été conduit; puis il
remonte à la suite naturelle des événements, en commentant par l'arrivée du
Sauveur chez Caïphe.
22. Saint Matthieu continue :
« Or, Pierre était assis au dehors dans la cour, une servante s'approcha de
lui, en disant : Et toi aussi lu étais avec Jésus de Nazareth ? Pierre nia en
face de toute la foule, en disant : Je ne sais ce que tu dis. Il sortit alors
et comme il franchissait la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui
étaient là : Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il nia de nouveau
avec serment, « et dit: Je ne connais pas- cet homme. Peu de temps après, ceux
qui étaient d'abord assis s'approchèrent et dirent à Pierre : Assurément tu es
de ces gens-là, car ton accent te fait assez connaître. Alors Pierre se prit à
faire des exécrations et des serments, et dit qu'il ne connaissait pas cet
homme. Et aussitôt le coq chanta. » Il ne faut pas oublier que quand Pierre
sortit et eut nié une première fois, le coq chanta aussi pour la première fois
; saint Matthieu n'en dit rien, mais saint Marc signale expressément cette
circonstance.
23. Remarquons aussi qu'il n'y
eut aucun reniement prononcé en dehors de la cour, mais bien (213) dans
l'intérieur et quand Pierre fut revenu près du feu. Il est vrai qu'il n'est
pas dit à quel moment Pierre y rentra; mais quel besoin y avait-il de nous
marquer ce détail? Voici le narré de saint Marc : « Il sortit en dehors de la
cour et le coq chanta. Il fut aperçu de nouveau par une servante, qui se mit à
dire à ceux qui étaient là : Celui-ci est aussi d'avec eux. Et Pierre protesta
de nouveau. » Cette servante n'est pas la même que la première, saint Matthieu
en fait la remarque. Cela se comprend d'autant mieux que dans le second
reniement, Pierre fut interpellé par deux témoins; d'abord par la servante
dont parlent saint Matthieu et saint Marc, et aussi par un autre témoin
mentionné par saint Luc. Voici comment ce dernier s'exprime: « Or, Pierre
suivait de loin. On avait allumé du feu dans la cour, la foule prit place
auprès, et Pierre se tenait parmi eux. Une servante le voyant assis près du
foyer, le fixa attentivement et s'écria: Celui-ci était aussi à sa suite.
Pierre le renia en disant : Femme, je ne le connais pas. Peu de temps après,
un autre homme l'aperçut et lui dit : Toi aussi tu es d'avec eux. » C'est
pendant cet intervalle, mentionné par saint Luc, que Pierre était sorti et
qu'on avait entendu le premier chant du coq; il était rentré aussitôt, s'était
rapproché du foyer, et c'est là qu'il était, quand, comme le dit saint Jean,
il énonça sa seconde protestation. Dans le premier reniement de Pierre, saint
Jean ne dit pas que le coq ait chanté ni même qu'une servante ait reconnu
l'Apôtre auprès du feu ; il se contente de dire : « La portière dit à Pierre:
n'es-tu pas aussi l'un des disciples de cet homme ? Non, répondit-il. »
Ensuite cet évangéliste nous raconte ainsi ce qu'il a cru devoir rapporter de
ce qui se passa à l'égard de Jésus, dans cette même maison : « Or les
serviteurs se tenaient auprès du feu et se chauffaient, parce qu'il faisait
froid; Pierre était avec eux et se chauffait aussi. » Il faut supposer
qu'avant ceci Pierre était sorti et rentré ; avant sa sortie il était assis
auprès du feu; après son retour il se tenait debout.
24. On m'objectera peut-être
qu'il n'était pas sorti, mais qu'il s'était levé pour sortir. Pour soutenir
cette assertion, il faut admettre que ce fut en dehors de la cour que Pierre
fut interrogé et répondit -pour la seconde fois. Voyons la suite du récit de
saint Jean : « Or, le grand-prêtre interrogea Jésus au sujet de ses disciples
et de sa doctrine ; Jésus lui répondit : J'ai parlé publiquement au monde,
j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs
se rassemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ?
Interroge ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit : ceux-ci savent ce que
j'ai dit. Il avait à peine prononcé ces paroles, que l'un des serviteurs lui
donna un soufflet en disant : Est-ce ainsi que tu réponds au grand-prêtre ?
Jésus lui dit : Si j'ai mal parlé, rends témoignage du mal que ,j'ai dit; mais
si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Anne le fit donc garrotter et
conduire à Caïphe. » On voit ici qu'Anne était grand-prêtre, car Caïphe
n'était pas là, quand il fut dit au Sauveur : « Est-ce ainsi que tu réponds au
grand-prêtre ? » Saint Luc, au commencement de son Evangile, parle aussi
d'Anne et de Caïphe comme étant tous deux grands-prêtres (1). Après ces
paroles, saint Jean reprend le récit du reniement de saint Pierre et nous
reporte ainsi à la maison où tout ce qu'il vient de dire s'est passé, et d'où
Jésus fut envoyé chez Caïphe, vers qui on le conduisait dès le début, au
rapport de saint Matthieu. Après avoir fait une sorte de récapitulation, saint
Jean complète ainsi le narré du troisième reniement: « Or, Simon Pierre se
tenait debout et se chauffait. Ils lui dirent : N'es-tu pas aussi l'un de ses
disciples ? Pierre nia et répondit : Je ne le suis pas. » Il suit de là que ce
n'est pas au dehors, mais auprès du feu qu'eut lieu cette seconde négation ;
et puisqu'il était sorti, il avait donc dû rentrer. Ce n'est pas après sa
sortie et au dehors, que la servante le vit, c'est quand il était déjà levé
pour sortir ; c'est alors qu'elle l'aperçut et dit à ceux qui étaient là,
c’est-à-dire auprès du feu dans la cour : « Celui-ci était aussi avec Jésus de
Nazareth. » Pierrequi sortait alors, entendant cette apostrophe, rentra et dit
avec serment à ceux qui l'entouraient, et prenaient parti pour la servante : «
Je jure que je ne connais pas cet homme. » Saint Marc, parlant de la même
servante, raconte qu'elle dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci est du nombre
de ses disciples. » Ce n'est pas à Pierre qu'elle s'adressait, mais à ceux qui
pendant son départ restaient, et elle le disait de manière que l'apôtre pût
entendre. Pierre rentra, s'approcha du feu sans s'asseoir et réfutait les
attaques par des négations. Saint Jean raconte : « Ils lui dirent
N'es-tu pas un de ses disciples? » Au moment où cette
question lui était faite, Pierre rentrait et se tenait debout, et voilà ce qui
nous explique
pourquoi à cette seconde question il n'y avait pas
seulement la servante dont parlent saint Matthieu et saint Marc, mais encore
un autre accusateur signalé par saint Luc. Saint Jean écrit de même: « Ils lui
dirent. » On peut donc admettre que ce fut après le départ de saint Pierre,que
la servante dit à ceux qui étaient avec elle dans la cour : « Celui-ci est un
des disciples, » parole qui fit rentrer saint Pierre pour se justifier de
l'accusation portée contre lui ; mais il est plus vraisemblable de penser
qu'il n'entendit pas ce que l'on disait et que ce ne fut qu'après son retour,
qu'une servante et une autre assistant, dont parle saint Luc, lui dirent : «
N'es tu pas un de ses disciples ? Non, répondit-il ; » l'autre insista plus
fortement et lui dit : « Mais tu es un d'entre eux. O homme, je n'en suis pas,
répliqua Pierre. » Quoiqu'il en soit ; il est un point qui résulte clairement
du contexte des Evangiles, c'est que ce ne fut pas en dehors de la cour, mais
dans l'intérieur, et auprès du feu, que Pierre formula sa seconde négation. Si
donc saint Matthieu et saint Marc ont mentionné sa sortie, sans relater son
retour, c'est uniquement pour éviter les longueurs.
25. Examinons maintenant la
troisième. négation que nous n'avons rapportée que d'après saint Matthieu.
Voici la récit de saint Marc: « Peu de temps après, ceux qui étaient là,
disaient à Pierre : Assurément tu es un des disciples, car tu es Galiléen. Et
Pierre se prit à répéter, avec force anathèmes et serments: Je ne connais pas
cet homme dont tu parles. Et aussitôt le coq chanta pour la seconde fois. »
Saint Luc raconte : « Et après une heure environ d'intervalle, un autre
affirmait et disait : Assurément tu es son disciple, car tu es Galiléen. O
homme, répondit Pierre, je ne sais ce que tu dis. Et il parlait encore quand
le coq chanta. » Saint Jean s'explique ainsi, sur cette troisième négation: «
Un des serviteurs du grand-prêtre, et parent de celui à qui Pierre avait coupé
l'oreille, lui dit: Est-ce que je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui?
Pierre nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. » Saint Matthieu et saint Luc
se contentent de dire: « Peu de temps après; » saint Luc mesure cet intervalle
en disant qu'il fut d'une heure à peu près. Saint Jean n'en dit rien.
De même saint Matthieu et saint Marc supposent que la troisième
interrogation fut faite par plusieurs personnes; saint Luc n'énonce qu'un
interrogateur, et saint Jean le désigne, en disant qu'il était parent de celui
à qui Pierre coupa l'oreille. Or, cette apparente diversité s'explique
facilement, ou en admettant que saint Matthieu et saint Marc ont suivi
l'usage, assez général, de prendre le pluriel pour le.singulier; ou en
supposant que l'un des témoins, par ce qu'il avait vu et qu'il connaissait,
commençait l’attaque à laquelle les autres prenaient part. aussitôt; deux
évangélistes ont suivi la première voie, les autres ont voulu seulement
signaler celui qui paraissait le plus ardent. Enfin saint Matthieu affirme
qu'il fut dit à Pierre: « Assurément tu es un des disciples, car ton langage
te fait connaître; » saint Jean assure qu'il fut dit à Pierre: « Est-ce que je
ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ? » Saint Marc raconte que les
assistants se disaient: « Il est vraiment un d'entre eux, car il est aussi
Galiléen; » de même, saint Luc nous représente un Juif disant, non pas à
Pierre, mais de lui: « Un autre affirmait et disait: Assurément il était avec
lui, car il est Galiléen. » Cela nous fait entendre qu'on s'est attaché à la
pensée seulement en rapportant que Pierre avait été apostrophé; en effet quand
on parlait de lui, et devant lui, c'était comme si on se fût adressé à
lui-même. On peut dire également que ses accusateurs tantôt s'adressaient à
lui directement, tantôt échangeaient entre eux leurs accusations. Chacune des
deux interprétations peut être admise. Quant au chant du coq qui suivit le
troisième reniement, saint Marc nous dit expressément que c'était la seconde
fois qu'il se faisait entendre.
26. Saint Matthieu poursuit
ainsi: « Et Pierre se souvint de là parole que Jésus avait dite: Avant que le
coq chante, tu me renieras trois fois; et étant sorti il pleura amèrement. »
Saint Marc écrit: « Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: Avant
que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois : et il commença à
pleurer. » D'après saint Luc: « Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre,
et Pierre se souvint de la parole du Seigneur qui avait dit: Avant que le coq
chante, tu me renieras trois fois; et étant sorti, Pierre pleura amèrement. »
Saint Jean ne dit rien ni du souvenir ni des larmes de Pierre. Mais ce qui
mérite une attention particulière, ce sont ces paroles de saint Luc : « Et
Jésus, s'étant retourné, regarda Pierre. » Quoiqu'il y ait aussi des cours
intérieures, c'était dans la cour extérieure que Pierre était avec les Juifs
alors occupés à se chauffer. Or, on ne peut pas supposer que Jésus (215) était
entendu dans cette cour extérieure par les Juifs, ni par conséquent que son
regard ait été un regard corporel. Ecoutons plutôt le récit de saint Matthieu:
«Alors ils lui crachèrent au visage et le couvrirent de soufflets; d'autres le
frappèrent en disant: Prophétise maintenant, ô Christ, et dis-nous quel est
celui qui t'a frappé. » Puis il ajoute immédiatement: « Or Pierre se tenait au
dehors dans la cour. » Il faut nécessairement en conclure que Jésus était à
l'intérieur. II faudrait même croire, d'après saint Mare, que Jésus était dans
la partie la plus élevée de l'habitation. En effet, voici ce que dit saint
Marc après avoir rapporté la scène décrite par saint Matthieu: « Et comme
Pierre se tenait dans la cour en bas. » En disant: « Pierre se tenait au
dehors, dans la cour, » saint Matthieu indique clairement que la scène
d'outrages avait lieu dans l'intérieur; de même en disant: « Et comme Pierre
était dans la cour en bas, » saint Marc montre que les faits qu'il vient de
raconter, se sont passés dans la partie supérieure. Comment donc le regard du
Seigneur sur Pierre a-t-il pu être un regard corporel ? Aussi me semble-t-il
que ce regard ne fut qu'un regard divin qui rappelait à l'apôtre le nombre de
ses reniements, la prédiction du Sauveur; et, par l'infinie miséricorde de
Dieu, ce regard amenait Pierre à la pénitence, et la lui rendait salutaire.
C'est ainsi que chaque jour nous disons : Seigneur regardez-moi; celui que le
Seigneur a regardé a été délivré par la miséricorde divine du danger, ou de la
souffrance. De même donc que nous lisons:
« Regardez et exaucez-moi (1), » et encore : « Tournez-vous, «
Seigneur, et délivrez mon âme (2), » dans le même sens il a été dit: « Le
Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole de
Jésus. » Il est à remarquer, enfin, que tandis que les évangélistes emploient
plus souvent le nom de Jésus que celui de Seigneur, saint Luc emploie ici
cette dernière expression: « Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et
Pierre se souvint de la parole du Seigneur. » Comme saint Matthieu et saint
Marc gardent le silence sur ce regard, il n'est pas étonnant de leur entendre
dire que Pierre se souvint de la parole, non pas du Seigneur, mais de Jésus.
Ne devons-nous donc pas comprendre que ce regard de Jésus fut tout divin et
nullement charnel?
27. Nous lisons dans saint
Matthieu: « Le lendemain, de grand matin, tous les princes des prêtres et les
anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, pour le livrer à mort. Puis
ils le garrottèrent, l'emmenèrent enchaîné, et le remirent au gouverneur
Ponce-Pilate (1). » Saint Marc raconte ainsi le même fait: « Dès le matin, les
princes des prêtres tinrent conseil avec les anciens du peuple et tout le
sanhédrin, conduisirent Jésus enchaîné et le livrèrent à Pilate (2). » Après
avoir raconté le reniement de Pierre, saint Luc récapitule ce qui s'est fait
dès le matin à l'égard de Jésus et lie ainsi sa narration. « Ceux qui le
gardaient se mirent à l'insulter et à le maltraiter; ils lui voilèrent la tête
et le frappant au visage ils lui disaient: « Prophétise; quel est celui qui
t'a frappé ? Et ils ajoutaient à cela beaucoup d'autres blasphèmes. Et dès que
le jour fut venu, les anciens du peuple, les princes des prêtres et les
Scribes se réunirent et le conduisirent au conseil, en disant: Si tu es le
Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit: Si je vous le dis, vous ne me
croirez pas, et si je vous . interroge, vous ne me répondrez rien et vous ne
me renverrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de
la majesté divine. Ils lui dirent tous: Tu es donc le Fils de Dieu ? Il leur
répondit: Vous le dites et je le suis. Ils s'écrièrent : Qu'avons nous encore
besoin d'autre témoignage, car nous venons d'entendre ses propres paroles ?
Toute la multitude se leva et ils le conduisirent à Pilate (3). » Tel est le
narré de saint Luc;
c'est la confirmation de ce qui est rapporté par saint Matthieu et par
saint Marc sur l'interrogation adressée au Seigneur au sujet de sa filiation
divine : « Je vous déclare, répond le Sauveur, que vous verrez le Fils de
l'homme assis à la droite de la majesté divine et venant sur les nuées du
ciel. » Ceci dut se passer au lever du jour, suivant cette parole de saint Luc
: « Dès qu'il fut jour. » Du reste son récit est le même que celui des autres
évangélistes, excepté qu'il mentionne certains détails sur lesquels les autres
gardent le silence. Toujours est-il que tout ce qui regarde
216
les dépositions des faux témoins s'est passé pendant la
nuit ; on peut en lire le récit dans saint Matthieu et saint Marc; quant à
saint Luc, omettant ce qui concerne les faux témoins, il nous a raconté se qui
s'est passé le matin . Les deux premiers, après avoir suivi les événements
jusqu'au matin, nous ont rapporté le reniement de saint Pierre, puis ils ont
repris la suite de leur récit sans mentionner les faits du matin (1). Quant à
saint Jean, après avoir raconté ce qui concerne le Seigneur et le reniement de
saint Pierre, il ajoute: « Ils conduiront donc Jésus au prétoire devant
Caïphe. Or c'était le matin (2). » De là nous sommes portés à conclure, ou
bien que quelque raison avait forcé Caïphe de se trouver au prétoire, au lieu
d'être présent à l'assemblée des princes des prêtres; ou bien qu'il y avait un
prétoire dans sa maison. Toujours est-il que le Seigneur, arriva enfin près de
lui et que dès le principe on voulait le lui présenter. Quoiqu'il en soit, les
ennemis du Sauveur le considèrent comme un accusé convaincu; de son côté
Caïphe depuis longtemps croit qu'il doit mourir; rien n'empêchait dès lors de
le conduire immédiatement à Pilate, pour le condamner au dernier supplice.
Voici comment saint Matthieu raconte ce qui s'est passé au tribunal de Pilate.
28. Il débute par le triste
sort de Judas, dont il a été seul à parler : « Alors Judas, dit-il, qui
l'avait livré, voyant que Jésus avait été condamné, rapporta, poussé parle
repentir, les trente pièces d'argent aux princes des prêtres et aux anciens du
peuple, en leur disant : J'ai péché en livrant le sang innocent. Mais ils lui
répondirent : Que nous importe ? c'est ton affaire. Jettant alors les pièces
d'argent dans le temple, il s'en alla et se pendit. Mais les princes des
prêtres après avoir recueilli l'argent se dirent: Il n'est pas permis de le
mettre dans le trésor du temple, parce que c'est le prix du sang. Ayant donc
délibéré à ce sujet, ils achetèrent le champ d'un potier, pour la sépulture
des étrangers. C'est pour cela que ce champ fut appelé Haceldama,
c'est-à-dire le champ du sang, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Alors fut
accomplie cette parole du prophète Jérémie: Ils ont reçu les trente pièces
d'argent, « somme donnée pour le paiement de celui qui a été mis à prix par
les enfants d'Israël, et ils
en ont acheté le champ d'un potier, ainsi
que le Seigneur me l'a fait entendre.
29. Peut-être va-t-on se
laisser ébranler par cette considération que ce passage ne se trouve nulle
part dans les prophéties de Jérémie et dès lors qu'on ne peut plus ajouter foi
à la véracité évangélique. Mais d'abord il ne faut pas oublier que le mot :
Jérémie, ne se trouve pas dans tous les exemplaires des Évangiles ; on n'y
voit que le mot prophète. Pourquoi ne pas admettre qu'on ne doit regarder en
ce point, comme dignes de confiance, que les exemplaires qui ne portent pas le
nom de Jérémie ? En effet, ce texte se trouve réellement dans la prophétie de
Zacharie. Il suit de là que les exemplaires quï portent le nom de Jérémie ont
été interpolés ; car ou bien ils doivent porter le nom de Zacharie, ou bien
ils doivent ne parler que d'un prophète en général, et ce prophète c'est
Zacharie. Ceux à qui ce moyen de défense sourit, peuvent s'en servir : pour
moi il ne me sourit point, précisément parce que je rencontre un trop grand
nombre d'exemplaires qui portent le nom de Jérémie. De plus, les auteurs qui
ont fait des manuscrits grecs une étude particulière, ont trouvé que même les
plus anciens portaient ce nom de Jérémie. Or, quel avantage pouvait-il y avoir
à commettre une interpolation mensongère, dans ce cas en particulier? Au
contraire l'impossibilité où l'on était de vérifier ce texte dans Jérémie a pu
déterminer une ignorance audacieuse à effacer le nom de ce prophète afin
d'enlever ainsi toute la difficulté.
30. Il est bien plus sage de
voir dans ce fait un secret dessein de la providence divine, qui dirige
l'intelligence des évangélistes. Il a pu se faire, en effet, que saint
Matthieu en écrivant son Evangile ait vu se présenter à son esprit le nom de
Jérémie au lieu de celui de Zacharie. Mais comment admettre qu'il n'ait pas
corrigé sa faute, ou qu'il n'ait pas été averti de la corriger par quelqu'un
des lecteurs, sous les yeux de qui son Evangile dut tomber de son vivant, s'il
n'avait été retenu par cette pensée qu'en
écrivant il était sous la direction du Saint-Esprit, que ce n'était pas
sans raison que le nom d'un prophète avait été substitué à celui d'un autre,
puisque Dieu l'avait ainsi permis ? Or, Dieu peut l'avoir permis pour faire
briller davantage le caractère divin des prophéties qui, dirigées par un seul
et même Esprit, se réunissent toutes dans un accord parfait bien plus
admirable qu'il ne serait si toutes ces prophéties étaient l'oeuvre d'un seul
(217) écrivain. Avec cette diversité de prophètes, le Saint-Esprit nous
apparaît dictant leurs révélations comme si chacune d'elles était l'oeuvre de
tous et comme si toutes étaient l'oeuvre de chacun. Il suit de là que les
prophéties écrites par Jérémie, sont autant de Zacharie que de Jérémie, et
celles de Zacharie autant de Jérémie que de Zacharie. Pourquoi, dès lors,
saint Matthieu eût-il attaché tant d'importance à corriger le nom d'un
prophète, qu'il avait cité pour un autre ? N'était-il par préférable que, se
soumettant d'une manière absolue à la direction du Saint-Esprit, dont il
sentait plus que nous l'action puissante, il laissât écrit ce qui était écrit,
pour nous rappeler qu'il règne entre tous les prophètes une concordance telle,
que loin devoir un absurdité on ne vit qu'une haute convenance à attribuer à
Jérémie, ce qui avait été réellement dit par Zacharie ? Je suppose
qu'aujourd'hui un auteur, voulant citer les paroles d'un autre, se trompe de
nom et prenne pour le nom de l'auteur véritable, le nom d'un homme qui lui est
très-lié par l'amitié et parles idées. S'apercevant de sa méprise, il se
recueille et pour toute correction, il s'écrie je ne me suis pas trompé, en ce
sens du moins qu'il a voulu
prononcer qu'il y avait une telle similitude de pensées entre le nom cité et
celui de l'auteur réel, que l'un est censé avoir dit ce que l'autre a dit
réellement. Une telle réponse ne
donnerait que plus de force à son témoignage. Or, combien cela n'est-il pas
plus vrai encore des prophètes, puisque les livres de chacun doivent être
envisagés par nous comme étant les livres d'un seul, ce qui leur donne un
caractère bien plus frappant d'unité et. de véracité qu'ils n'en auraient s'ils
étaient réellement l'oeuvre d'un seul ? Laissons donc aux infidèles et aux
ignorants le soin de profiter de cette circonstance pour publier le désaccord
des saints Evangiles ; que les fidèles et les chrétiens instruits y voient
clairement l'unité divine des saintes prophéties.
31. Pour expliquer pourquoi l'Esprit-Saint
a permis, ou plutôt a prescrit de substituer le nom de Jérémie à celui de
Zacharie, il y a une autre raison; je la développerai avec plus de soin
ailleurs, car je sens le besoin de terminer ce livre. Nous lisons dans Jérémie
qu'il acheta le champ du fils de son frère et lui en donna l'argent. Il ne
s'agit pas ici, sans doute, du prix dont il est parlé dans Zacharie,
c'est-à-dire de trente pièces d'argent; Irais ce dernier prophète ne parle pas
davantage de l'achat du champ, en sorte que c'est uniquement l'Évangéliste
qui, interprétant la prophétie a réuni et l'achat du champ et les trente
pièces de monnaie qui furent le prix de la trahison du Sauveur. Nous trouvons
ici l'accomplissement d'une double prophétie, celle de Jérémie parlant de
l'achat du champ, et celle de Zacharie parlant des trente pièces d'argent. Si
donc, après, avoir lu l'Evangile et y avoir rencontré le nom de Jérémie, on
est tenté de lire la prophétie
elle-même, on n'y trouvera aucune mention des trente pièces d'argent, mais
bien de l'achat du champ; le lecteur n'aura plus qu'à réunir ces différents
passages et à en chercher l'accomplissement dans la personne du Sauveur. Qu'on
n'oublie pas toutefois qu'on ne doit pas s'attendre à lire soit dans Zacharie,
soit dans Jérémie ces paroles qui terminent le passage de saint Matthieu : «
Celui qui a été mis à prix par les enfants d'Israël, et ils en ont acheté le
champ d'un potier, ainsi que le Seigneur me fa fait entendre. » Nous devons
donc voir, dans ces paroles, une interprétation élégante et mystique
de la prophétie, interprétation inspirée divinement et appliquant à
Jésus-Christ le prix dont parle le prophète. En lisant Jérémie nous voyons que
le prix d'achat du champ doit être jeté dans un vase de terre (1) ; ici le
prix de la trahison du Sauveur sert à acheter le champ d'un potier, lequel
champ est destiné à la sépulture des étrangers; image du repos réservé à ceux
qui, dans le voyage de cette vie, auront été ensevelis en Jésus-Christ par le
baptême. Aussi le Seigneur fait-il entendre à Jérémie que l'achat de ce champ
désignait le séjour qu'on ferait, même après la délivrance, sur la terre
étrangère. Tels sont les points de vue que je tenais à esquisser pour inviter
à examiner plus attentivement ces témoignages prophétiques en les rapprochant
l'un de l’autre et en les comparant au récit évangélique. —
Voilà ce qu'a dit saint Matthieu du traître Judas.
32. Voici la suite du récit
évangélique : « Jésus s'arrêta devant le préteur qui l'interrogea en ces
termes : Es-tu le Roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis. Et étant
accusé par les
218
princes des prêtres et les anciens du peuple, il ne
répondit rien. Alors Pilate lui dit: N'entends-tu pas de combien de choses on
t'accuse ? Mais il ne fit aucune réponse à ce qu'il put lui dire, en sorte que
le gouverneur en était tout étonné. Ce dernier avait coutume, au jour de la
fête, de remettre au peuple celui des prisonniers qu'ils voulaient. Or, il y
en avait alors un fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient donc tous
assemblés, Pilate leur dit : Lequel voulez-vous que je vous délivre, de
Barabbas, ou de Jésus qui est appelé le Christ ? Car il savait bien que
c'était par envie qu'ils l'avaient livré. Or, pendant qu'il était assis sur
son tribunal, sa femme toi envoya dire : Qu'il n'y ait rien entre toi et ce
juste, car j'ai été aujourd'hui
étrangement tourmentée en songe à son sujet. Mais les princes des prêtres et
les anciens persuadèrent au peuple de demander Barabbas et de faire mourir
Jésus. Alors le gouverneur reprenant la parole, leur dit : Lequel des deux
voulez-vous que je vous délivre? Mais ils répondirent : Barabbas. Pilate
répartit : Que ferai-je donc de Jésus, qui est appelé le Christ ? Ils
répondirent tous : Qu'il soit crucifié. Le gouverneur leur répliqua : Mais
quel mal a-t-il fait ? Et ils se mirent à crier encore plus fort : Qu'il soit
crucifié. Pilate voyant qu'il ne gagnait rien et que le tumulte croissait de
plus en plus, se fit apporter de l'eau, et se lavant les mains devant le
peuple, il leur dit : Je suis innocent du sang de ce juste, c'est votre
affaire. Et tout le peuple de répondre : Que son sang retombe sur nous et sur
nos enfants. Alors il leur délivra Barabbas, et ayant fait flageller Jésus, il
le leur abandonna pour être crucifié. » C'est ainsi que saint Matthieu raconte
la conduite de Pilate à l'égard du Seigneur (1).
33. Saint Marc rapporte les
mêmes événements et à peu près dans les mêmes termes. Quant aux paroles
adressées par Pilate à la multitude demandant la délivrance d'un prisonnier,
les voici telles que saint Marc les rapporte : « Pilate leur répondit :
Voulez-vous que je délivre le Roides Juifs? » Saint Matthieu avait dit : « La
foule s'étant rassemblée, Pilate leur dit : Lequel voulez-vous que je vous
délivre, de Barabbas ou de Jésus qui est appelé le Christ ? » On ne voit pas
ici qu'il y ait eu une demande formulée par le peuple pour obtenir la
délivrance d'un prisonnier,
mais ce n'est pas une difficulté; seulement on peut se
demander lequel de saint Matthieu ou de saint Marc rapporte exactement les
paroles de Pilate. Il semble en effet que ces mots : « Qui voulez-vous que je
vous délivre, de Barabbas on de Jésus qui est appelé le Christ? » soient bien
différents de ceux-ci : « Voulez-vous que je vous délivre le Roi des Juifs ? »
Mais cette différence n'est qu'apparente. En effet, tous les rois étaient
appelés Christs ou oints, et quelle que soit l'expression, il est clair que
Pilate leur demanda s'ils voulaient qu'on leur remit le Roi des Juifs ou le
Christ. Qu'importe que saint Marc ait tu le nom de Barabbas ! Il lui suffisait
de raconter ce qui concernait le Seigneur. Du reste on voit suffisamment, dans
leur réponse, que le choix leur avait été proposé entre Barabbas et Jésus: «
Les pontifes, dit saint Marc, soulevèrent la foule dans le but d'obtenir la
délivrance de Barabbas ; » il ajoute : « Pilate leur répondit: Que voulez-vous
donc que je fasse du roi des
Juifs ? » Ceci prouve évidemment que saint Marc, en parlant du Roi des Juifs,
exprimait la même pensée que saint Matthieu en disant : « Le Christ. » C'était
seulement chez les Juifs que les rois étaient nommés Christs ; et en effet,
dans le même passage, saint Matthieu ajoute : « Pilate leur dit : Que ferai-je
donc de Jésus qui est appelé le Christ ? » Mais voici la suite de saint Marc:
« Ils s'écrièrent de nouveau : Crucifie-le. » Saint Matthieu avait dit : «
Tous s'écrient : Qu'il soit crucifié. » Saint Marc : « Or Pilate leur disait :
Quel mal a-t-il donc fait ? Mais ils criaient encore plus fort : Crucifie-le.
» Saint Matthieu ne parle pas de cette insistance ; il ajoute seulement : «
Pilate voyant qu'il n'obtenait rien et que le tumulte allait toujours
croissant. » Il ajoute aussi que Pilate se lava les mains en présence du
peuple afin d'attester qu'il était innocent du sang du juste. Ce fait n'est
rapporté ni par saint Marc ni par aucun autre évangéliste ; mais on voit que
dans ta pensée de saint Matthieu, Pilate n'en agit ainsi que dans le but
d'obtenir plus facilement la délivrance de Jésus. On trouve la même idée dans
ces paroles de saint Marc : « Quel mal a-t-il donc fait ? » Enfin le même
évangéliste conclut : « Pilate voulant satisfaire le peuple, leur remit
Barabbas; et après avoir fait flageller Jésus il le leur abandonna pour le
crucifier. » C'est ainsi que Saint Marc rapporte ce qui se passa au prétoire
(1).
219
34. Voici le récit des mêmes
événements en saint Luc : « Ils se mirent donc à l'accuser en disant : Nous
l'avons trouvé soulevant le peuple, défendant de payer le tribut à César et
disant qu'il est le Christ-Roi. » Les deux premiers évangélistes s'étaient
contentés de dire, en général, que les Juifs accusaient le Sauveur ; saint Luc
va plus loin, il précise les chefs d'accusation portés contre lui. Puis,
taisant cette demande de Pilate : « Ne réponds-tu rien ? ne vois-tu pas toutes
les accusations formulées contre toi ? » il ajoute avec les autres
évangélistes
Pilate lui demanda : Es-tu le Roi des Juifs ? Et Jésus
lui répondit : Tu le dis. » Saint Matthieu et saint Marc relatent cette
réponse, avant de parler du silence gardé par Jésus en face de ses
accusateurs. Mais la vérité n'a pas à souffrir de ce que saint Luc raconte les
faits dans tel ou tel ordre, ou de ce que l'un tait ce que l'autre rapporte.
Saint Luc continue ainsi : « Pilate dit aux princes des prêtres et à la foule
: Je ne trouve aucun sujet de condamnation dans cet homme. Et les autres de
s'indigner plus fort en disant : Il soulève le peuple par les enseignements
qu'il répand dans toute la Judée, en commençant par la Galilée. A ce mot de
Galilée, Pilate demanda s'il était Galiléen ; et dès qu'il sut qu'il était de
la dépendance d'Hérode, il le lui renvoya, car Hérode était lui-même, dans ces
jours, à Jérusalem. Hérode fut très-content de voir Jésus ; car il y avait
longtemps qu'il désirait le rencontrer et qu'il espérait lui voir faire
quelque miracle. Il lui adressa donc une foule de que: fions ; mais Jésus ne
lui fit aucune réponse. Cependant les princes des prêtres et les scribes
étaient là qui l'accusaient avec une grande opiniâtreté. Hérode le méprisa,
imité en cela par toute son armée, le traita avec moquerie, le revêtit d'une
robe blanche et le renvoya à Pilate. Et dès ce moment Hérode et Pilate
devinrent amis,
car avant cela ils étaient ennemis. » Ce renvoi de Dilate à Hérode ne
nous est rapporté que par saint Luc, qui insère pourtant dans ce récit des
traits analogues à ce que rapportent ailleurs les autres évangélistes ; car
ceux-ci n'ont voulu nous raconter que ce qui s'est passé au tribunal de Pilate
jusqu’à la condamnation.
Après cette digression du
renvoi à Hérode, saint Luc reprend le récit de ce qui s'est passé an tribunal
de Pilate et continue ainsi : « Pilate ayant donc convoqué les princes de
prêtre, les magistrats et le peuple, leur dit : Vous m'avez présenté cet homme
comme pervertissant le peuple ; je l'ai interrogé moi-même en votre présence,
et dans tout ce que vous alléguez contre lui je ne trouve pas de quoi le
mettre eu cause. » On voit que saint Luc ne parle pas de la question posée au
Seigneur par Pilate pour lui demander ce qu'il avait à répondre. Saint Luc
continue : « Ni Hérode non plus, car je vous ai renvoyés à lui et on n'a rien
pu produire qui fût de nature à faire condamner cet homme à mort. Je vais donc
le faire flageller et je le renverrai. Or, il était obligé de délivrer, le
jour de la fête, un prisonnier. La foule s'écria comme un seul homme : Fais
mourir celui-ci et remets-nous Barabbas,. qui avait été jeté en prison comme
coupable d'avoir excité une sédition dans la ville, et commis homicide. Pilate
leur parla de nouveau, voulant renvoyer Jésus. Mais ils s'écriaient :
Crucifie,
crucifie-le. Il leur parla une troisième fois et leur dit
: Quel
mal a-t-il donc fait ? Car je ne trouve en lui aucune cause de mort; je
le châtierai donc et le mettrai en liberté. Mais la foule redoublait ses cris,
demandant qu'il fût crucifié, et leurs clameurs s'élevaient toujours
davantage. » Saint Matthieu à résumé en quelques mots les efforts tentés par
Hérode pour délivrer Jésus : « Pilate, dit-il, voyant qu'il ne gagnait rien,
et que le tumulte allait toujours croissant. » Ces paroles supposent en effet
que Pilate fit de violents efforts pour obtenir cette délivrance ; seulement
l'écrivain sacré ne nous dit pas le nombre de fois qu'il renouvela ses
tentatives. Saint Luc achève ainsi le récit de ce qui s'est passé chez Pilate
: « Celui-ci, dit-il, consentit à ce qui lui était demandé. Il leur remit
celui qui avait été jeté en prison, pour crime de sédition et de meurtre, et
il abandonna Jésus à leur volonté (1). »
35. Voyons maintenant comment
saint Jean raconte cette même scène du prétoire : « Ils n'entrèrent pas au
prétoire, de crainte de se souiller et afin de pouvoir manger la Pâque Pilate
s'avança donc vers eux et leur dit : « Quelle accusation portez-vous contre
cet homme ? Ils lui répondirent : Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te
l'aurions point livré. » N'y-a-t-il pas ici une contradiction entre saint Jean
et saint Luc ? Car ce dernier spécifie
220
les principaux chefs d'accusation, dans les paroles
suivantes : « Ils se mirent donc à l'accuser en disant : Nous l'avons surpris
soulevant le peuple, défendant de payer le tribut à César et disant qu'il est
le Christ-Roi. » Saint Jean, dans les paroles que nous avons citées, semble
nous faire croire que les Juifs ont refusé d'articuler crime et qu'à cette
question: «Quelle accusation apportez-vous contre cet homme, » ils se sont
contentés de répondre : « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te
l'aurions pas livré. » C'était lui dire clairement qu'il devait s'en remettre
absolument à leur autorité, ne plus s'occuper de chercher ce dont ils
l'accusaient et se contenter pour le croire coupable de savoir qu'il avait
mérité de lui être livré par eux. Concluons de là que le récit de saint Jean
est vrai, aussi bien que celui de saint Luc. Il y eut en effet un long échange
de questions et de réponses, parmi lesquelles chaque évangéliste fit son choix
et se contenta de ce qui lui parut suffisant. Saint Jean lui-même cite plus
loin certains chefs d'accusation, comme nous le verrons en son lieu et place.
Il continue : « Pilate leur dit : Prenez-le vous-mêmes et jugez le selon votre
loi. Les Juifs lui répondirent: Nous n'avons pas le droit de condamner à mort,
afin que s'accomplit la parole par laquelle Jésus avait annoncé, de quelle
mort il devait être frappé. Pilate rentra donc de nouveau dans le prétoire,
appela Jésus et lui dit: Es-tu le Roi des Juifs ? Jésus lui répondit : Dis-tu
cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? » Ceci ne paraît pas
conforme à cette réponse citée par les autres écrivains: « Jésus répondit: Tu
le dis. »Mais attendons la suite. Car saint Jean montre plutôt que ce qu'il
rapporte maintenant, a été omis par les autres auteurs, et prononcé réellement
par le Sauveur. Ecoutons ce qui suit : « Pilate répondit : Est-ce que je suis
Juif ? Ton peuple et les prêtres t'ont livré entre mes mains, qu'as-tu fait ?
Jésus répondit
Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était
de ce monde, mes ministres combattraient pour m'empêcher de tomber entre les
mains des Juifs ; mais mon royaume n'est par d'ici. Tu es donc roi ? reprit
Pilate. Jésus lui répondit : Tu le dis, Je suis roi. » Ces dernières paroles
nous amènent au récit déjà fait par les autres évangélistes, qui nous les ont
rapportées. Saint Jean continue et met pur les lèvres du Sauveur ces mots que
les autres
ont passés sous silence : «Voici pourquoi je suis venu
dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité ; quiconque appartient
à la vérité écoute ma voix. Pilate lui répondit
Qu'est-ce que la vérité ? Et après avoir dit ces mots, il
sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit: Je ne trouve rien en cet homme
qui puisse le faire mettre en cause. Or, c'est pour vous une coutume que je
vous délivre un prisonnier à la fête de Pâque : voulez-vous que je vous
remette le Roi des Juifs? Tous crièrent de nouveau : Non pas lui, mais
Barabbas ; or Barabbas était un scélérat. Pilate se saisit donc de Jésus, et
le fit flageller. Et les soldats, tressant une couronne d'épines, la lui
mirent sur la tète, le couvrirent d'un vêtement de pourpre, et s'approchant,
ils lui disaient :Salut, Roi des Juifs, et ils le souffletaient. Pilate sortit
de nouveau et dit aux Juifs: Voici que je vous le présente de nouveau afin que
vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus parut donc, portant la
couronne d'épines et le vêtement de pourpre, et Pilate dit aux Juifs: Voilà
l'homme. A cette vue les pontifes et les ministres criaient : Crucifie,
crucifie-le. Pilate leur répondit: Prenez le vous-mêmes et le crucifiez; car
pour moi je ne le trouve coupable d'aucun crime. Les Juifs répliquèrent :Nous
avons une
loi ; et selon
cette loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. »
Ceci se rapporte à cette accusation énumérée par saint Luc : « Nous l'avons
surpris soulevant notre nation ; » il aurait pu ajouter: «parce qu'il s'est
fait le Fils de Dieu. » Saint Jean continue : « En entendant ces paroles
Pilate eut peur ; il rentra aussitôt dans le prétoire et dit à Jésus : D'où es
tu ? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit : Tu ne me parle pas ?
Ignores-tu que j'ai le pouvoir de te crucifier comme aussi le pouvoir de te
renvoyer ? Jésus lui répondit : Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne
t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui m'a livré à toi, a
commis un plus grand péché. Depuis ce moment Pilate cherchait à le renvoyer.
Mais les Juifs criaient : Si tu le renvois, tu n'es pas l'ami de César ; car
quiconque se donne pour roi, se met en opposition. avec César. » On peut
rapprocher de ces paroles, les paroles suivantes de saint Luc : « Nous l'avons
surpris soulevant notre nation, empêchant de payer le tribut à César et disant
qu'il est le Christ-Roi. » C'est ainsi que se trouve (224) résolue la question
posée précédemment, à l'occasion de ces paroles : « S'il n'était pas un
malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré; » car on voulait en conclure que
dans l'Evangile de saint Jean, les Juifs ne formulaient aucun crime contre le
Sauveur. Saint Jean continue : « Pilate ayant entendu ces discours, fit sortir
Jésus et s'assit sur son tribunal, dans le lieu appelé Lithostrotos, en hébreu
Gabbata. Or, on était à la veille de Pâque, vers la sixième heure ;
et Pilate dit aux Juifs : Voici votre Roi. Ils s'écrièrent : Enlève,
enlève-le, crucifie-le. Pilate leur dit : Crucifierai-je votre roi ? Les
prêtres répondirent : Nous n'avons pas d'autre roi que César. Alors Pilate le
leur livra pour le crucifier.» Voilà, d'après saint Jean, ce qui se passa au
tribunal de Pilate (1).
36. Il nous reste à parcourir
les témoignages des quatre évangélistes, relatifs à la passion même du
Sauveur. Saint Matthieu commence ainsi : « Alors les soldats du gouverneur
ayant emmené Jésus dans le prétoire, rassemblèrent autour de lui toute la
cohorte, et après lui avoir ôté ses vêtements, ils le couvrirent d'un manteau
d'écarlate. Et entrelaçant une couronne d'épines, ils la lui mirent sur la
tête, avec un roseau dans la main droite, et fléchissant le genou devant lui,
ils le raillaient en disant : Salut, Roi des Juifs (2). » Saint Marc raconte
ainsi le même fait et au. même endroit de sa narration : « Les soldats le
conduisirent dans la cour intérieure du prétoire ; là ils convoquent toute la
cohorte ; puis ils le revêtent de pourpre, lui mettent sur la tête une
couronne d'épines, tressée par eux, et se mettent à le saluer
Salut, roi des Juifs ; et ils lui frappaient la tête avec
un roseau, et ils le couvraient de mépris, et ployant le genou ils l'adoraient
(3). » Ce que saint Matthieu appelle un manteau d'écarlate, saint Marc
l'appelle un vêtement de pourpre. A la place de la pourpre royale, on se
servit par dérision de ce vêtement d'écarlate ; la pourpre a en effet le rouge
de l'écarlate. Il peut se
faire aussi que saint Marc ait entendu désigner la pourpre, attachée au
manteau d'écarlate. Saint Luc n'a pas parlé de cette circonstance. Saint
Jean, avant de rapporter la sentence de Pilate livrant le
Sauveur au supplice de la croix, raconte le même fait en ces termes: « Pilate
se saisit donc de Jésus et le fit flageller. Les soldats, après avoir fait une
couronne d'épines, la lui mirent sur la tête, le couvrirent d'un manteau de
pourpre et s'approchaient de lui en disant : Salut, roi des Juifs, et ils le
souffletaient (1). » Il suit delà que saint Matthieu et saint Marc racontent
cet événement sous forme de récapitulation, et non pour marquer qu'il eut lieu
après la sentence de crucifiement, portée par Pilate. Aussi saint Jean annonce
clairement que ce fut chez Pilate que le Sauveur subit cette honteuse
humiliation, et les autres évangélistes ne font que rappeler ce qui s'était
j'ait. On doit aussi rapporter à cela ce qu'ajoute saint Matthieu : « Et le
couvrant de crachats, ils prirent un roseau et lui en frappaient la tête ; et
après qu'ils l'eurent tourné en dérision, ils le dépouillèrent de son manteau,
le couvrirent de ses propres vêtements et le conduisirent au lieu où il devait
être crucifié. » Ce dépouillement du manteau que devaient remplacer ses
vêtements, n'eut lieu qu'à la fin de cette scène, quand on allait le conduire
au supplice. Saint Marc rapporte le même fait en ces termes : « Et après
qu'ils l'eurent tourné en dérision, ils le dépouillèrent de la pourpre et le
couvrirent de ses vêtements. »
37. Nous lisons en saint
Matthieu : « Pendant qu'ils le conduisaient, ils rencontrèrent un homme de
Cyrène, nommé Simon, et le mirent en réquisition pour porter la croix de Jésus
(2). » En saint Marc : « Et ils le conduisent, pour le crucifier. Et voyant
passer un certain Simon de Cyrène, venant de sa villa, et père d'Alexandre et
de Rufus, ils le mirent en réquisition pour porter la croix de Jésus (3). » En
saint Luc : « Pendant qu'ils le conduisaient, ils se saisirent d'un certain
Simon de Cyrène, qui revenait de sa villa et le chargèrent de la croix pour la
porter après Jésus (4). » Voici le récit de saint Jean : « Ils prirent donc
Jésus et l'emmenèrent ; ainsi chargé de sa croix il se dirigea vers le lieu du
Calvaire, en hébreu Golgotha; c'est là qu'ils le crucifièrent (5). » Ces
paroles
222
nous font conclure que Jésus portait lui- même sa croix
quand il se dirigea vers cette montagne. Ce fut seulement en chemin que l'on
mit en réquisition ce Simon, dont le nom nous est cité par trois évangélistes,
et qu'on le chargea de porter la croix jusqu'au lieu désigné. C'est ainsi que
tout se concilie parfaitement ; Jésus porta d'abord seul sa croix, comme le
rapporte saint Jean ; puis il fut aidé par Simon de Cyrène, comme nous le
racontent les autres évangélistes.
38. Saint Matthieu continue :
« Ils arrivèrent à un lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le Calvaire. » Il n'y
a aucune différence dans la désignation de ce lieu; nous lisons ensuite: « Ils
lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il en eut goûté, il ne
voulut point en boire (1). » D'après saint Marc : « Ils lui donnaient à boire
du vin mêlé de myrrhe et il n'en voulut point (2). » Le texte de saint
Matthieu a la même signification; car le mot fiel désigne ici quelque chose de
très-amer, et cette amertume est le caractère du vin mêlé de myrrhe. Il peut
se faire cependant que le fiel et la myrrhe aient été mêlés pour rendre le vin
très-amer. Ce mot de saint Marc: « Il n'en le voulut pas, » doit s'entendre
dans ce sens que Jésus refusa de le boire. Il goûta néanmoins, selon le
témoignage de saint Matthieu ; mais il ne voulut point le prendre. Saint Marc
sans nous dire qu'il ait goûté, affirme seulement qu'il ne voulut point le
recevoir.
39. « Or, dit saint Matthieu,
après qu'ils l'eurent crucifié, ils partagèrent ses vêtements au moyen du
sort, et s'étant assis, ils le gardaient (3). Et le crucifiant, dit saint
Marc, ils partagèrent ses vêtements et firent la part à chacun au moyen du
sort (4). — Ils partagèrent ses
vêtements, dit saint Luc, et les tirèrent au sort, et le peuple les regardait
(5).» Ce fait ne nous est raconté que brièvement par ces trois évangélistes;
saint Jean est plus explicite : «Après, dit-il, qu'ils l'eurent crucifié, les
soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chacun
d'eux. Ils prirent aussi la tunique ; mais comme elle
était sans couture et d'un seul tissu du haut en bas, ils se dirent entre eux
: Ne la divisons pas, mais tirons au sort à qui de nous l'aura. C'est ainsi
que s'accomplit la parole de l'Écriture: Ils se sont partagé mes vêtements et
ils ont tiré ma robe au sort (1). »
40. « Ils mirent aussi sur sa
tête, dit saint Matthieu, la cause écrite de sa condamnation : Celui-ci est
Jésus, le roi des Juifs (2). » Saint Marc, immédiatement après avoir parlé du
partage des vêtements, ajoute : « Or, on était à la troisième heure et ils le
crucifièrent (3). » A moins de s'exposer à une grave erreur, on doit étudier
ce texte avec une attention sérieuse. En effet, certains auteurs veulent que
ce soit à la troisième heure que Jésus ait été crucifié; et comme les ténèbres
se répandirent sur la terre depuis la sixième jusqu'à .la neuvième, trois
heures se seraient écoulées depuis le crucifiement jusqu'à la diffusion des
ténèbres. On pourrait, à la rigueur, adopter cette opinion, si saint Jean ne
disait formellement qu'à la sixième heure Pilate s'assit sur son tribunal,
dans le lieu appelé Lithostrotos, en hébreu Gabbatha. Voici ses paroles : «
Or, on était à la veille de Pâque, vers la sixième heure, et Pilate dit aux
Juifs: Voilà votre roi. Et les Juifs s'écriaient: Enlève, enlève-le,
crucifie-le. Pilate leur dit . Que je crucifie votre roi ? Les pontifes
répondirent : Nous n'avons pas d'autre roi que César. Alors il le leur livra
pour le crucifier (4). » Si donc c'est à la sixième heure que Pilate, assis
sur son tribunal, livra Jésus-Christ aux Juifs pour le crucifier, comment le
Sauveur a-t-il pu être crucifié à la troisième heure, comme l'ont pensé
quelques auteurs, en s'appuyant sur un texte mal compris, de l'évangéliste
saint Marc ?
41. Voyons d'abord à quelle
heure le crucifiement a pu avoir lieu ; ensuite nous dirons pourquoi saint
Marc le met à la troisième heure. Il était environ la sixième heure, quand
Pilate assis sur son tribunal prononça la sentence. On dit qu'il était environ
la sixième heure, c’est-à-dire que la cinquième était passée et la sixième
seulement commencée. Jamais les écrivains sacrés
223
ne diraient cinq heures et un quart, cinq heures et trois
quarts, cinq heures et demie ; ces expressions ou autres semblables sont
contraires au style de l'Écriture, qui prend toujours la partie pour le tout,
spécialement quand il s'agit des divisons du temps. C'est ainsi qu'en saint
Luc nous lisons que le Sauveur gravit la montagne environ huit jours après
(1), tandis que saint Matthieu et saint Marc nous disent que ce fut six jours
après (2). Remarquons ensuite que saint Jean atténue, autant que possible, son
expression: car il ne dit pas: à la sixième heure, mais: « Vers la sixième
heure. » S'il n'eût pas mis cette restriction et qu'il se fût contenté de dire
: A la sixième heure, nous pourrions conclure, d'après le langage ordinaire de
l'Ecriture, qu'il a pris le tout pour la partie, en sorte que ce fût après la
cinquième heure écoulée et la sixième commencée qu'eut lieu le crucifiement du
Seigneur et qu'aussitôt la sixième heure achevée, quand Jésus fut suspendu à
la croix; les ténèbres dont parlent saint Matthieu saint Marc et saint Luc,
couvrirent la face de la terre (3).
42. Examinons maintenant
pourquoi saint Marc, après avoir raconté le partage des vêtements par la voie
du sort, ajoute : « C'était la troisième heure et il le crucifièrent. » Il
venait déjà de dire: « Et ceux qui le crucifiaient partagèrent ses vêtements
(4). » Les autres évangélistes remarquent également que ce fut après le
crucifiement que les bourreaux se partagèrent les vêtements. Si donc saint
Marc eût voulu préciser l'heure où tout cela se passait, il se serait contenté
de dire : « Or il était alors la troisième heure. » Pourquoi ajoute-t-il: « Et
ils le crucifièrent? » Ne voulait-il pas, par une sorte de récapitulation,
alors surtout que l'on savait fort bien, dans toute l'Eglise, à quelle heure
Jésus avait été suspendu à la croix, dissiper d'avance jusqu'à l'ombre
même de toute erreur et réfuter jusqu'aux plus faibles apparences du mensonge?
A savait que ce ne furent pas les Juifs, mais les soldats qui en réalité
suspendirent Jésus-Christ à la croix, comme l'atteste saint Jean; mais il a
voulu prouver que les véritables bourreaux furent plutôt ceux qui demandèrent
à grands cris la mort et le crucifiement, que ceux qui par les devoirs de leur
état préfèrent leur ministère à cette oeuvre coupable. Ce fut donc à la
troisième heure que les Juifs demandèrent le crucifiement,
et dès ce moment ce crime était moralement accompli;
d'autant plus qu'ils ne voulaient pas paraître tremper eux-mêmes dans cette
affaire, et que ce fut dans le but de se justifier de toute apparence de
complicité qu'ils remirent le Sauveur entre les mains de Pilate. Saint Jean
est formel à ce sujet ; voici ses paroles : « Quelle accusation présentez-vous
contre cet homme ? Ils répondirent : Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne
te l'aurions pas livré. Pilate leur dit : Prenez-le vous-mêmes et jugez-le
selon votre loi. Les Juifs répliquèrent: il ne nous est permis d'ôter la vie à
une personne (1). » Le crime qu'ils ne voulaient pas paraître avoir commis
eux-mêmes, saint Marc nous dit qu'ils l'avaient commis dès la troisième heure;
et, en effet, c'est justice de dire que le véritable meurtrier du Sauveur ce
fut la langue des Juifs et non la main des soldats.
43. Maintenant dira-t-on que
ce ne fut pas à la troisième heure que les Juifs commencèrent à vociférer leur
cris de mort ? Ce serait pousser la haine contre l'Évangile jusqu'à la folie,
à moins qu'on puisse découvrir une autre solution. Car on n'est pas en mesure
de prouver qu'il n'était pas alors la troisième heure ; d'où il suit qu'il est
plus sage de croire à la parole véridique d'un évangéliste qu'aux
interprétations contentieuses des hommes. Comment me prouver, dis-tu, qu'on
était à la troisième heure ? Je réponds: c'est parce que je crois à la parole
des évangélistes ; si lu y crois aussi, montre-moi qu'il a pu se faire que le
Sauveur fut crucifié à la sixième et à la troisième heure. Quant à la sixième,
saint Jean ne nous laisse pas l'ombre d'un doute à ce sujet; quant à la
troisième, elle est fixée par saint Marc. Si tu acceptes ces deux témoignages,
montre-moi comment ils peuvent être vrais l'un et l'autre, et alors je me
renferme dans un heureux silence. Ce que j'aime, en effet, ce n'est pas mon
opinion, mais la véracité de l'Évangile. Je souhaite, du resté, que l'on
trouve plusieurs solutions à cette question ; mais , jusqu'à ce qu'elles
soient découvertes, sache te contenter avec moi de celle que je te présente. A
défaut d'autres, elle suffit abondamment; nous choisirons quand nous en aurons
trouvé plusieurs, seulement ne, conclus pas qu'aucun des quatre évangélistes
puisse être convaincu de mensonge, ou même d'erreur; il jouit d'une autorité
trop sainte et trop élevée.
224
44. Mais, dira-t-on encore, ma
conviction n'est pas suffisamment établie; au sujet de cette troisième heure.
En effet saint Marc nous dit bien : « Pilate répondant leur dit : Que
voulez-vous donc que je fasse au roi des Juifs ? Ils s'écrièrent de nouveau:
Crucifie-le; » mais après ces paroles l'évangéliste ne met et ne suppose aucun
intervalle dans sa narration, et immédiatement il arrive à la condamnation
prononcée par Pilate; « à la sixième heure, » dit saint Jean. Avant de poser
cette objection, on ne doit pas oublier que les évangélistes ont omis beaucoup
de détails intermédiaires qui ont dû se produire pendant que Pilate cherchait,
par tous les moyens possibles, à soustraire Jésus à la fureur des Juifs.
Ecoutons saint Matthieu: « Pilate leur dit : Que ferai-je donc de Jésus, qui
est appelé le Christ? Tous de se récrier: Qu'il soit crucifié. » Il était
alors, selon nous, la troisième heure. Il continue : « Pilate voyant qu'il
n'obtenait rien, et qu'au contraire le tumulte allait toujours croissant. » Il
est bien facile d'admettre que pendant ces efforts tentés par Pilate pour
délivrer le Sauveur et pendant le tumulte soulevé par l'insistance des Juifs,
il se passa un intervalle d'environ.deux heures, et que la sixième était
commencée avant que Pilate eût livré le Seigneur, et que les ténèbres se
fussent répandues sur la terre.. Quant à ce fait raconté par saint Matthieu: «
Pilate était assis sur son tribunal et voici que sa femme lui envoie dire : Ne
te mêle pas des affaires de ce juste, car aujourd'hui, en songe, j'ai été
violemment tourmentée à son sujet (1), » il est certain que lorsque ceci se
passa, Pilate était pour la seconde fois assis sur son tribunal ; mais saint
Matthieu se rappelant ce qu'il avait dit de l'épouse de Pilate, mêla cet
événement à son texte, afin de montrer pourquoi le gouverneur s'obstinait à ne
point livrer Jésus entre les mains des Juifs.
45. Saint Luc, après ces
paroles de Pilate : « Je le corrigerai et le délivrerai, » ajoute que la foule
tout entière s'écria : « Fais-le disparaître et remets-nous Barabbas. » Mais
peut-être que jusque-là ils n'avaient pas encore dit: « Crucifie-le. » D'après
le même écrivain sacré, « Pilate leur parla de nouveau dans le but de délivrer
Jésus ; mais ils criaient : Crucifie, crucifie- le. » C'était à la troisième
heure. Enfin ajoute encore saint Luc: « Pilate leur parla une troisième fois
et leur dit: Quel mal a-t-il donc fait? je ne trouve en lui aucun crime qui
mérite la mort ; je le
corrigerai donc et le renverrai. Mais alors ils
poussaient des cris plus effroyables, demandant qu'il fut crucifié, et leurs
vociférations augmentaient (1). » Cela suffit pour nous donner une idée de la
grandeur du tumulte. Combien de temps s'écoula-t-il ensuite avant ces mots
répétés pour la troisième fois : « Quel mal a-t-il donc fait? » On peut le
supposer aussi long que le demande la découverte de la vérité. Enfin ces
instances à grands cris, ces vociférations toujours croissantes, quel motif
leur donner, si ce n'est la résolution où ils voyaient Pilate de ne pas leur
livrer le Sauveur ? Puisque telle était la disposition de Pilate, il est
évident qu'il ne dut pas céder si promptement et que deux heures, et peut-être
plus, se passèrent dans ces hésitations.
46. Interroge encore saint
Jean et vois à quelles hésitations Pilate se trouvait en proie et quelle
répulsion il éprouvait pour le honteux ministère qu'on voulait lui faire
remplir. Quoiqu'il ne dise pas tout ce qui a dû se dire et se passer, pendant
deux heures et le commencement de la sixième, cet évangéliste est beaucoup
plus explicite que les autres. Ainsi Jésus nous est montré victime de la
flagellation, revêtu d'un manteau dérisoire, le jouet de railleries et de
moqueries infâmes, ( je pense que Pilate ne permit toutes ces indignités que
pour calmer la fureur des Juifs et soustraire Jésus à la mort.) Après ces
détails, saint Jean continue : « Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs :
Voici que je vous l'amène, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun
crime. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le vêtement de
pourpre. Et Pilate leur dit: Voilà l'homme; » il espérait que son aspect
ignominieux calmerait leur fureur. L'Evangile continue : « En le voyant, les
pontifes et les ministres s'écrièrent: Crucifie, crucifie-le. » Nous avons dit
qu'il était alors la troisième heure. Remarquez ce qui suit : « Pilate leur
dit : Prenez-le vous-mêmes et le crucifiez; car pour moi je ne le trouve
coupable d'aucun crime. Les Juifs lui répondirent; Nous avons une loi, et
selon cette loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. En
entendant cette parole, Pilate fut saisit d'une crainte plus violente;
rentrant donc de nouveau dans le prétoire il dit à Jésus: Tu ne me réponds
pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, comme aussi de te
délivrer? Jésus lui répondit: Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne
t'avait été
225
donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui m'a livré entre
tes mains est coupable d'un plus grand crime. Et Pilate n'en chercha que
davantage l'occasion de le délivrer. » Puisque telle était la disposition de
Pilate, combien de temps, pensons-nous, ne dut pas se passer dans un échange
de propositions de la part de Pilate et de refus de la part des Juifs, jusqu'à
ce qu'enfin le gouverneur fut vaincu par leurs protestations et crut devoir
céder ? Nous lisons ensuite : « Les Juifs s'écriaient : Si tu le renvoies, tu
es pas l'ami de César, car quiconque se fait roi est l'ennemi de César. En
entendant ces paroles, Pilate fit sortir Jésus, et s'assit sur son tribunal,
dans un lieu appelé Lithostrotos, en hébreu Gabbatha. On était à la veille de
Pâque, vers la sixième heure. » Ainsi, depuis le moment où pour la première
fois les Juifs crièrent: « Crucifie-le, » jusqu'à celui où Pilate s'assit sur
son tribunal, deux heures se passèrent, en hésitation de la part de Pilate, et
en tumulte de la part des Juifs ; la cinquième heure était écoulée et la
sixième commencée. « Pilate dit donc aux Juifs: Voici votre roi. Ils
s'écriaient : Enlève-le crucifie-le. » Et cependant Pilate jusque là assez
insensible à la crainte de la calomnie persistait dans son refus. En effet,
c'est alors qu'il reçut le message de sa femme. Saint Matthieu a anticipé sur
le moment précis de ce fait, qui ne nous est raconté que par lui et qu'il a
glissé dans sa narration à l'endroit qui lui a paru le plus convenable.
Faisant donc un dernier effort, Pilate dit aux Juifs : « Que je crucifie votre
roi ? Les pontifes répondirent : Nous n'avons d'autre roi que César. C'est
alors qu'il le leur livra pour le crucifier (1). » Pendant que Jésus monte au
calvaire, pendant qu'il est crucifié avec les deux larrons, que ses vêtements
sont partagés, que sa robe est tirée au sort, et qu'il est couvert
d'ignominies, car les ignominies se mêlaient à ses autres souffrances, la
sixième heure se passa, et les ténèbres, dont parlent saint Matthieu, saint
Marc et saint Luc, se répandirent sur toute la terre.
47. Arrière donc toute
obstination impie; croyons que Notre-Seigneur Jésus-Christ a été crucifié à la
troisième heure par la langue des Juifs et à la sixième parla main des
soldats. En effet, grâce au tumulte de la foule et aux hésitations cruelles de
Pilate, deux heures et plus s'écoulèrent depuis
le premier cri : « Crucifie-le. » Saint Marc, qui se
distingue par une extrême concision, a voulu en quelques mots nous faire
connaître la volonté de Pilate et ses efforts pour délivrer le Sauveur. Après
avoir dit : « Ils crièrent de nouveau : Crucitie-le; » quand ils avaient déjà
crié pour qu'on leur remit Barrabas, il ajoute : « Pilate leur disait : Quel
mal a-t-il donc fait (1) ? » Ces quelques paroles résument tout ce qui s'est
fait. Et pour nous faire mieux comprendre sa pensée, au lieu de la formule :
Pilate leur dit, il s'exprime ainsi : « Pilate leur disait : Quel mal a-t-il
donc fait? » Ces mots : Pilate leur dit, laisseraient croire qu'il ne parla
qu'une fois, tandis que ceux-ci: « Il leur disait, » pour peu qu'on veuille
les comprendre, nous laissent voir que cet échange de paroles a duré jusqu'au
commencement de la sixième heure. Rappelons-nous donc la brièveté du récit de
saint Marc, en comparaison de celui de saint Matthieu ; la brièveté du récit
de saint Matthieu, en comparaison de celui de saint Luc, et enfin la brièveté
du récit de saint Luc, en comparaison de celui de saint Jean, quand surtout
chacun de ces évangélistes raconte des circonstances que les autres passent
sous silence. Et le récit même de saint Jean, qu'il est concis en comparaison
de ce qui s'est passé et du temps qu'il a fallu à ces événements pour se
dérouler! A moins donc de faire preuve de folie ou d'aveuglement, il faut
admettre que deux heures et plus ont pu s'écouler pendant cet intervalle.
48. Prétendre que saint Marc
aurait pu, s'il en était ainsi, assurer qu'il était trois heures quand il
était trois heures et que les Juifs demandaient à grands cris le crucifiement,
et rapporter que le Sauveur fut crucifié par eux dans ce moment-là même,
n'est-ce pas imposer trop orgueilleusement des lois aux historiens de la
vérité? Pourquoi ne pas dire que si on racontait soi-même ces événements, tous
les autres devraient les raconter dans le même ordre et de la même manière?
Celui qui en serait là, daignera du moins soumettre sa manière devoir à celle
de saint Marc, qui a cru devoir placer chaque fait à la place qui lui était
désignée par l'inspiration divine. Le souvenir des écrivains sacrés n'est-il
pas soumis à l’impulsion de Celui qui, d'après le témoignage de l'Ecriture,
gouverne à son gré l'Océan? La mémoire, en effet, est une
226
faculté qui flotte de pensées en pensées, et il n'est au
pouvoir de personne d'en rappeler les souvenirs comme et quand il le veut. Si
donc il est vrai de dire que ces écrivains, ;aussi saints que véridiques, se
sont entièrement abandonnés dans le récit de leurs souvenirs, à l'action toute
puissante de Dieu, pour qui le hasard n'est rien; est-ce à un homme encore
exilé et si éloigné du regard de Dieu, de soutenir que tel fait devait être
placé dans tel ordre, quand on ignore pourquoi Dieu a voulu le placer dans tel
autre ? Si, « dit saint Paul, notre Evangile est voilé, il ne l'est que pour
ceux qui périssent . » Après ces mots : « Pour les uns nous sommes une odeur
de vie pour la vie, et pour les autres une odeur de mort pour, la mort, » il
ajoute aussitôt : « Mais qui est capable de le comprendre (1)? » c’est-à-dire
: qui est capable de comprendre avec quelle justice tout cela s'opère? Le
Seigneur exprime la même pensée : « Je suis venu afin que ceux qui ne voient
pas, voient, et que ceux qui voient, deviennent aveugles (2) ? » Telle est, en
effet,la profondeur des richesses de la science et de la sagesse divines, que
le Tout-Puissant tire d'une seule et même masse des vases d'honneur et des
vases d'ignominie; et puis n'a-t-il pas été dit à la chair et au sang: « O
homme qui es-tu pour oser répondre à Dieu (3)? » Qui donc en ce point comme en
tout autre connaît la pensée de Dieu; qui a été son conseiller (4), quand il
dirigeait le coeur et les souvenirs des évangélistes, quand il les couronnait,
au faite de l'Eglise, d'une autorité si sublime, que ce qui peut paraître en
eux contradictoire, fait tomber les uns dans l'aveuglement, et les livre
justement aux horreurs de la concupiscence du coeur et du sens réprouvé (5);
et détermine les autres à réformer leur manière de voir, comme le vent de la
justice mystérieuse du Tout-Puissant? Aussi un prophète dit-il au Seigneur : «
Vos pensées sont devenues trop profondes; l'homme imprudent ne les connaîtra
pas et l'insensé n'y pourra rien comprendre (6).»
49. Ceux qui liront ces lignes
tracées par moi, avec l'aide du Tout-Puissant, et dont j'ai reconnu l'à propos
en cet endroit, je les prie de les rappeler à leur souvenir dans toutes les
difficultés de ce genre, afin de m'en épargner la répétition. Si donc on
étudie ce passage de l’évangile, sans aucun parti pris d'impiété, on
comprendra facilement qu'en y mentionnant la troisième
heure, saint Marc a voulu qu'on se souvint de l'heure précise à laquelle les
Juifs ont crucifié le Sauveur, eux qui voulaient rejeter la honte de ce crime
sur les Romains, sur leurs princes ou sur leurs soldats. Nous lisons : « Ils
le crucifièrent, partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort pour savoir
à qui ils appartiendraient. » De qui est-il question dans cet endroit ?
N'est-ce pas des soldats, comme saint Jean le déclare formellement? Afin donc
de faire retomber, non pas sur les soldats, mais sur les Juifs, la pensée d'un
si grand crime, saint Marc écrit ces paroles : « Il était la troisième heure
et ils le crucifièrent. » Comment ne pas voir alors que les auteurs véritables
dû crucifiement, ce sont ceux qui l'ont réclamé à la troisième heure par leurs
vociférations multipliées et non les soldats qui n'ont accompli le crime qu'à
la sixième heure
50. Dans ces paroles de saint
Jean : « On était à la veille de Pâque, à la sixième heure, » quelques auteurs
ont voulu voir la troisième heure, celle à laquelle Pilate s'assit sur son
tribunal. Dans cette opinion le crucifiement aurait eu lieu à l'expiration de
la troisième heure; trois heures se seraient écoulées pendant que Jésus était
suspendu à la croix, après quoi il rendit le dernier soupir; de cette manière
ce ne serait qu'à partir de l'heure de sa mort, ou la sixième heure, jusqu'à
la neuvième, que les ténèbres couvrirent toute la face de la terre. Voici
comment ils appuient leur système. Ce jour qui était suivi du sabbat était la
veille de la Pâque des Juifs, parce que les Azymes commençaient à ce sabbat.
Or, la Pâque véritable, non pas celle des Juifs, mais des chrétiens, celle qui
s'accomplissait dans la passion du Sauveur, avait déjà commencé sa préparation
ou sa vigile, à partir de la neuvième heure de la nuit, puisque c'est à partir
de ce moment que les Juifs se sont préparés à immoler le Sauveur. Et en effet,
le mot parasceve, que nous traduisons par la veille, signifie
préparation. Dès lors, à partir de la neuvième heure de la nuit jusqu'au
crucifiement, on arrive à la sixième heure de la préparation selon saint Jean,
et à la troisième heure du jour selon saint Marc. Il suit de là que la
troisième heure dont parle saint Marc, sous forme de récapitulation, ne l'ut
pas celle où les Juifs crièrent. « Crucifie, crucifie-le; » il appelle
troisième heure celle où Jésus fut attaché à la croix.
Quel fidèle n'adopterait pas
cette solution, si (227) quelque chose nous faisait clairement comprendre que
c'est à la neuvième heure de la nuit que commença la préparation de notre
Pâque, c'est-à-dire la préparation de la mort de Jésus-Christ? Dirons-nous que
cette préparation commença au moment où Jésus fut garrotté par les Juifs ?
Mais on n'était alors qu'à la première partie de la nuit? Est-ce quand le
Sauveur fut conduit à la maison de Caïphe, où il rendit témoignage en présence
du prince des prêtres ? Mais le coq n'avait pas encore chanté, et c'est au
moment où il chantait que Pierre renia son Maître ? Est-ce quand Jésus fut
traduit devant Pilate ? Nous savons par l'Ecriture que cette tradition ne se
fit que le matin. Il ne nous reste donc plus qu'à voir le commencement de la
préparationde la Pâque ou de la mort de Jésus-Christ, dans ce cri lancé par
les princes des prêtres : « Il est digne de mort. » Cette exclamation se
trouve à la fois en saint Marc et en saint Matthieu (1); ce qu'ils racontent
du reniement de saint Pierre n'est qu'une récapitulation de ce qui avait été
fait auparavant. En effet rien n'empêche de conclure qu'il pouvait être la
neuvième heure de la nuit, quand les Juifs, comme je l'ai dit, demandèrent la
mort du Sauveur; depuis ce moment jusqu'à celui où Pilate s'assit sur son
tribunal, il s'écoula environ six heures, non pas du jour mais de la
préparation à l'immolation du Sauveur ou à la véritable Pâque; cette sixième
heure, qui correspondait à la troisième heure du jour, était écoulée quand le
Sauveur fut suspendu à la croix. Quelle que soit donc l'opinion qu'on
embrasse, soit cette dernière, soit celle qui voit dans la troisième heure de
saint Marc l'heure à laquelle les Juifs demandèrent le crucifiement de
Jésus-Christ, et méritèrent ainsi d'être regardés comme les véritables auteurs
du crime, plutôt que les soldats qui l'exécutèrent de leurs propres mains ;
comme nous l'avons vu, ce fut plutôt le Centurion qui s'approcha du Sauveur,
que les amis qu'il avait envoyés à sa rencontre (2); il nous semble avoir
résolu suffisamment cette question de l'heure de la passion, question qui
soulève l'arrogance des raisonneurs orgueilleux et trouble l'ignorance des
faibles.
51. Saint Matthieu continue :
« Alors furent crucifiés avec lui deux larrons, l'un à droite, l'autre à
gauche (1). » Saint Marc et saint Luc rapportent le même fait (2). Saint
Jeanne laisse aucun doute sur ce point, quoiqu'il ne donne pas aux crucifiés
le nom de voleurs; voici ses paroles: « Et avec lui deux autres, l'un d'un
côté et l'autre de l'autre, et Jésus au milieu (3). » On ne pourrait voir de
contradiction que si saint Jean désignait comme innocents ceux que les autres
évangélistes flétrissent du nom de voleurs.
52. Saint Matthieu raconte : «
Les passants le blasphémaient et disaient en branlant la tête: Toi qui détruis
le temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même; si tu es le
Fils de Dieu, descends de la croix. » Saint Marc s'exprime à peu près dans les
mêmes termes. Saint Matthieu continue : « En même temps les princes des
prêtres, les scribes et les anciens du peuple raillaient, se disant entre eux
: Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi
d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il met sa
confiance en Dieu; s'il le veut, que Dieu le délivre maintenant, lui qui a dit
: Je suis le Fils de Dieu (4). » Saint Marc et saint Luc, sans employer les
mêmes termes expriment la même idée, l'un omettant ce que l'autre rapporte
(5). Quant aux princes des prêtres qui insultèrent Jésus crucifié, nous les
trouvons signalés dans ces, deux évangélistes, quoique d'une manière
différente saint Marc ne parle pas des anciens ; saint Luc parle en général
des princes, sans désigner les princes des prêtres en particulier ; d'un seul
mot il stigmatise aussi tous les principaux de la nation, prêtres, scribes et
anciens du peuple.
53. Nous lisons en saint
Matthieu : « Les larrons eux-mêmes, qui étaient crucifiés avec lui, « le
couvraient d'invectives (6). » Cette circonstance
228
ce est aussi rapportée par saint Marc, quoique dans des
termes un peu différents. La narration de saint Luc présenterait quelque
opposition, si l'on oubliait une manière de parler assez fréquente. « L'un des
deux voleurs, attachés comme lui à la croix, dit saint Luc, lui adressait ces
blasphèmes : Si tu es le Christ, sauve-toi, et nous aussi. Mais l'autre se mit
à réprimander son complice et à lui dire : Ni toi, non plus, tu n'as donc
aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation. Et encore pour
nous c'est justice, car nous n'avons que ce que nous avons mérité; pour lui,
il n'a fait aucun mal. Et il disait à Jésus : Seigneur, souvenez-vous de moi,
lorsque vous serez entré dans votre royaume. Jésus lui répondit : En vérité,
je te le dis, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis (1). » Saint
Matthieu avait dit: « Les voleurs qui étaient crucifiés avec lui, le
blasphémaient; » saint Marc: « Et ceux qui étaient crucifiés avec lui, lui
adressaient des injures; » comment donc se peut-il que saint Luc nous dise
qu'un seul des deux le blasphémait et que l'autre garda le silence et crut en
lui ? Ne devons-nous pas croire que saint Matthieu et saint Marc, dans le but
d'abréger le récit, emploient le pluriel pour le singulier? Nous trouvons
également, dans l'épître aux Hébreux, cette forme plurielle Ils fermèrent la
gueule des lions, » quand il n'est question que de Daniel; nous y lisons
également : « Ils ont été sciés (2), » quand il ne s'agit que d'Isaïe. Les
paroles mises au pluriel par le psalmiste : « Les rois de la terre se sont
levés et les princes se sont réunis, » etc, se retrouvent au pluriel dans es
Actes des Apôtres, quand l'idée exigeait le singulier; car les rois y
désignent Hérode , Pilate est désigné par le mot princes (3). Au lieu donc de
calomnier l'Evangile, que les païens se rappellent comment leurs auteurs ont
fait parler les Phèdre, les Médée et les Clytemnestre, qui auraient du
s'exprimer au singulier. Quoi de plus ordinaire, par exemple, que d'entendre
dire. à quelqu'un : Les paysans m'insultent, quand il n'y en a qu'un pour
l'insulter? Saint Luc serait assurément en contradiction avec les autres en
disant qu'un seul voleur lança des blasphèmes, si des paroles des autres
auteurs on était forcé de conclure que tous deux blasphémèrent Jésus. Mais il
faut remarquer que dans l'un il n'est question que des voleurs, et
dans l'autre, de ceux qui étaient crucifiés avec lui,
sans addition du mot : « Tous deux. » Sans doute cette formule aurait suffi
dans le cas où tous deux auraient réellement blasphémé; mais l'usage a permis
aussi d'employer la forme plurielle quoiqu'un seul ait commis ce crime.
54. Saint Matthieu continue :
« Or depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, toute la terre fut couverte
de ténèbres (1). » Ce fait nous est également attesté par les deux autres
évangélistes (2). Saint Luc explique même la cause de ces ténèbres,
c'est-à-dire que le soleil s'obscurcit. Saint Matthieu ajoute: « Vers la
neuvième heure Jésus poussa un grand cri en disant : Eli, Eli, lamina,
sabactani ; ce qui veut dire : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'avez-vous
abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là présents, entendant ces
paroles, disaient : Voilà qu'il appelle Elie. » Saint Marc n'emploie pas
exactement les mêmes mots, mais il exprime exactement la même pensée. Saint
Matthieu reprend : « Et l'un deux accourant, trempa une éponge dans du
vinaigre, la fixa au bout d'un roseau et lui offrait à boire. » Saint Marc
s'exprime ainsi : « L'un d'entre eux accourant, remplit une éponge de
vinaigre, la fixa sur un jonc et lui offrait à boire en disant: Attendons et
voyons si Elie viendra le délivrer. » Ce n'est pas sur les lèvres de celui qui
présentait l'éponge que saint Matthieu met ces paroles, mais sur les lèvres
des assistants : « Et les autres disaient : laisse, voyons si Elie viendra le
délivrer; » de là nous
pouvons conclure que tous ont tenu ce langage. Saint Luc avant de raconter les
insultes du voleur rapporte cette circonstance du vinaigre : « Ils se
raillaient de lui, dit-il, et les soldats s'approchant lui offrirent du
vinaigre en disant : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même (3). » Il
voulait ainsi exprimer ce qui avait été dit et fait par les soldats. Peu
importe du reste qu'il n'ait pas spécifié que ce vinaigre ne lui fut offert
que par un seul soldat ; nous avons vu plus haut que la coutume permettait
d'employer le pluriel pour le singulier. Saint Jean parle aussi du
229
vinaigre : « Ensuite Jésus sachant que tout le reste
était accompli, et voulant accomplir l'Ecriture s'écria: J'ai soif. Et il y
avait là un vase plein de vinaigre ; aussitôt ils en remplirent une éponge
qu'ils fixèrent autour d'une tige d'hyssope et l'approchèrent de sa bouche
(1). » Saint Jean rapporte de Jésus cette parole : « J'ai soif, » et parle
d'un vase rempli de vinaigre ; si les autres ont gardé le silence sur ces
détails, il n'y a pas là de quoi nous étonner. '
55. Nous lisons dans saint
Matthieu : « Jésus poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit (2). »
Saint Marc dit également: « Jésus ayant jeté un grand cri, expira (3). » Saint
Luc nous fait connaître les paroles prononcées par le Sauveur en jetant ce
grand cri : « Et jetant un grand cri, Jésus dit: Mon Père je remets mon âme
entre vos mains, et en disant ces mots il expira (4). » Saint Jean ne parle
pas de ces premières paroles prononcées par Jésus et rapportées par saint
Matthieu et par saint Marc : « Eli, Eli; » il omet également ces mots
rapportés par saint Luc: « Mon Père, je remets mon âme entre vos mains ; » ce
cri du reste n'est que celui dont parlent saint Matthieu et saint Marc, sans
préciser les paroles qui furent prononcées; et pour nous le faire comprendre,
saint Luc a eu soin de dire que Jésus prononça ces mots avec un grand cri.
Mais saint Jean est le seul qui
nous cite cette parole proférée par le Sauveur
après avoir trempé ses lèvres dans le vinaigre : « Tout est consommé. » Voici
comment s'exprime saint Jean : « Jésus, ayant pris le vinaigre, dit : Tout est
consommé, puis il inclina sa tête et rendit l'esprit (5). » C'est après avoir
dit : « Tout est consommé » et avant d'incliner la tête, que fut jeté ce grand
cri, omis par saint Jean, et cité par les trois autres évangélistes. En effet,
l'ordre naturel nous indique assez clairement que le Sauveur dut prononcer ce
mot: « Tout est consommé, » quand se furent accomplies en lui toutes les
prophéties dont il était l'objet et dont il attendait l'accomplissement avant
de mourir, lui qui mourait quand il le voulait; ce n'est qu'alors que se
recommandant à son Père il rendit l'esprit. Mais quel que soit l'ordre que
l'on croit devoir établir, il faut avant tout se garder
avec soin de voir entre les évangélistes la moindre opposition, parce que l'un
tait ce que l'autre dit, ou parce que l'un dit ce que l'autre tait.
56. « Et voici, dit saint
Matthieu, que le voile du temple se déchira en deux parties, de haut en bas
(1). » Saint Marc dit de même: « Et le voile du temple se déchira en deux,
depuis le haut jusqu'en bas (2). » Saint Luc dit aussi Et le voile du temple
se déchira dans le milieu (3); » mais cet évangéliste ne suit pas le même
ordre que les autres. En effet, voulant ajouter le miracle au miracle, après
avoir dit que le soleil s'obscurcit, il ajoute aussitôt : « Et le voile du
temple se rompit par le milieu. » Il anticipe ainsi sur ce qui se passa au
moment de la mort du Sauveur et dont il fait une récapitulation générale,
embrassant tout à la fois et le breuvage de vinaigre, et le grand cri et la
mort elle-même, toutes choses qui arrivèrent avant le déchirement du voile du
temple, après la diffusion des ténèbres. En effet, saint Matthieu après avoir
dit : « Jésus jetant de nouveau un grand cri rendit l'esprit, » ajoute
aussitôt : « Et voici que le voile du temple se rompit; » c'était affirmer
assez clairement que le voile ne se brisa que quand Jésus eut rendu l'esprit.
S'il n'eût pas dit : « Et voici; » s'il se fût contenté de dire
Et le voile du temple se rompit, » on ne saurait si le
texte de saint Matthieu et de saint Marc ne sont pas une simple
récapitulation, tandis que saint Luc aurait suivi l'ordre naturel, ou vice versa ;
mais ces expressions dissipent tous les doutes.
57. Saint Matthieu continue :
« Et la terre trembla, des rochers se fendirent, des sépulcres s'ouvrirent, et
les corps de plusieurs saints qui y étaient endormis ressuscitèrent; et étant
sortis de leurs tombeaux ils vinrent à la ville sainte après sa résurrection
et se firent voir de plusieurs. » Quoique saint Matthieu soit le seul
230
qui nous rapporte ces circonstances, nous n'avons pas à
craindre qu'il soit en contradiction avec les autres évangélistes. Il ajoute :
« Quant au Centurion et ceux qui gardaient Jésus avec lui, à la vue du
tremblement de terre et de tout ce qui se passait ils éprouvèrent une grande
crainte et s'écrièrent : Il était vraiment le Fils de Dieu (1). » Saint Marc
s'exprime ainsi : « Le Centurion , qui se tenait en face, voyant que Jésus
était mort en jetant un aussi grand cri, se dit : Vraiment cet homme était le
Fils de Dieu (2). » Saint Luc : « Le Centurion voyant ce qui s'était passé,
glorifia Dieu en disant : Vraiment cet homme était un juste (3). » D'après
saint Matthieu la cause de l'admiration du Centurion et de ceux qui
l'accompagnaient ce fut le tremblement,de terre ; d'après saint Luc, ce fut
d'entendre Jésus pousser un grand cri en expirant, ce qui montrait que le
moment de sa mort était en son plein pouvoir. Or, je dis qu'il n'y a en tout
cela aucune ombre de contradiction ; en effet, saint Matthieu ne mentionne pas
seulement le tremblement de terre, il ajoute : « Et ce qui s'était passé. » Or
rien ne pouvait mieux
confirmer le récit de saint Luc, puisque si, d'après ce dernier, le Centurion
admira la mort du Sauveur, c'est que cette mort devait compter parmi les
merveilles qui s'étaient passées. Saint Matthieu ne détaille pas tous ces
prodiges, admirés par le centurion et parles soldats; mais les narrateurs
n'étaient-ils pas libres de signaler à leur gré tel miracle plutôt que tel
autre? Quelle contradiction peut-il y avoir si l'un nous parle de tel prodige
et l'autre de tel autre, puisque ce sont tous ces prodiges qui ont soulevé
l'admiration ? Selon saint Matthieu le centurion dit: « Vraiment il était le
Fils de Dieu; » selon saint Marc, il se serait écrié : « Cet homme était
vraiment le Fils a de Dieu. » Mais il est facile de remarquer qu'il n'y a pas
plus de contradiction ici que nous n'en avons trouvé dans beaucoup de passages
examinés précédemment et que peut se rappeler le lecteur; que ces paroles
expriment la même pensée et qu'elle ne change pas, quoiqu'un des évangélistes
dise cet homme, tandis que l'autre ne le dit pas. Mais n'y a-t-il pas
une opposition véritable entre ces deux évangélistes et saint Luc qui prête au
Centurion les paroles suivantes : « Celui-ci était juste, » sans lui faire
dire qu'il était le Fils de Dieu? Et d'abord
rien n'empêche de croire que le Centurion a réellement
dit du Sauveur qu'il était juste et aussi Fils de Dieu, quoique chaque
évangéliste ait omis de citer ces paroles tout entières. Ou bien on peut
répondre aussi que saint Luc a voulu donner la raison qui a fait dire au
Centurion que Jésus était Fils de Dieu. Peut-être en effet qu'il ne le croyait
pas égal à son Père et qu'il ne voyait en lui qu'une filiation spirituelle et
morale à cause de sa sainteté même, comme on dit de beaucoup de justes qu'ils
sont les enfants de Dieu. D'un autre côté, saint Luc par cette expression
générale : « Le Centurion voyant ce qui s'était passé, » résume tous les
prodiges qui venaient de s'accomplir à l'heure même. Si donc il n'en spécifie
qu'un, c'est qu'il les regarde tous comme ne formant qu'un seul et même tout.
Saint Matthieu adjoint au Centurion les soldats qui l'accompagnaient, tandis
que les autres gardent le silence sur ce point ; mais nous avons déjà dit, que
sans impliquer aucune contradiction, l'un peut dire ce que l'autre tait. Enfin
saint Matthieu dit des assistants qu'ils furent saisis d'une grande crainte,
tandis que saint Luc dit du Centurion qu'il glorifia Dieu ; mais il est facile
de comprendre que c'est par sa crainte elle même, qu'il glorifia Dieu.
58. Selon Saint Matthieu: « Il
y avait aussi là, mais éloignées, plusieurs femmes qui étaient venues de la
Galilée avec Jésus, pour le servir; de ce nombre étaient Marie-Magdeleine,
Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée (1). »
Selon saint Marc : Il y avait là des femmes qui regardaient de loin; de ce
nombre étaient Marie-Magdeleine, Marie mère de Jacques le mineur et de Joseph
et Salomé. Pendant qu'il était dans la Galilée elles le suivirent pour le
servir ; et plusieurs autres encore qui étaient venues avec Jésus à Jérusalem
(2). » Je ne vois pas que l'on puisse relever la moindre contradiction entre
ces deux textes, car qu'importe que tel auteur se contenté de constater la
présence de certaines femmes, tandis qu'un autre les désigne par leur nom ? La
vérité n'a rien à y voir. Voici le récit de saint Luc : « Et la foule de ceux
qui assistaient à ce spectacle et qui voyaient ce qui ce passait, s'en
allait en se frappant la poitrine. Tous ceux qui étaient
de la connaissance de Jésus se tenaient aussi présents, ainsi que les femmes
qui l'avaient suivi depuis la Galilée, et tous contemplaient ce spectacle (1).
» On voit que sur la présence des femmes, saint Luc est parfaitement 'd'accord
avec les deux évangélistes précédents, quoique aucune d'elles ne soit ici
désignée par son nom. Quant à la foule de ceux qui étaient présents et qui se
frappaient la poitrine, saint Luc est d'accord, en cela, avec saint Matthieu,
quoique ce dernier ne parle que du centurion et de ceux qui étaient avec lui.
Il n'y a qu'un seul point qui particularise le récit de saint Luc, c'est celui
où il parle des connaissances ou amis de Jésus.; quant aux femmes, il avait
précédemment constaté leur présence, avant la mort du Sauveur: « Auprès de la
croix de Jésus, se tenaient, dit-il, la mère, de Jésus et la sœur de sa mère,
Marie de Cléophas et Marie-Magdeleine. En apercevant devant lui sa mère et le
disciple qu'il aimait, il dit à sa mère : Femme, voilà votre Fils. Ensuite il
dit au disciple : Voilà ta mère ; et dès cette heure le disciple la prit avec
lui (2). » Si saint Matthieu et saint Marc n'avaient pas désigné
nominativement Marie-Magdeleine, nous pourrions dire que parmi ces femmes les
unes se tenaient au loin et les autres assez près de la croix de Jésus; du
reste saint Jean est le seul qui mentionne la présence de la Sainte Vierge.
Mais comment admettre avec saint Matthieu et saint Marc que Marie-Magdeleine
se tenait au loin près des autres femmes, et avec saint Jean, qu'elle se
trouvait au pied de la croix? A moins qu'on n'admette que ces femmes étaient
tout près, parce qu'elles étaient assez rapprochés pourvoir Jésus et en être
vues, et qu'elles étaient éloignées en comparaison de la foule qui, avec le
Centurion, environnait la croix ? On pourrait peut-être dire aussi que les
femmes qui accompagnaient la mère du Sauveur, se retirèrent dès que Jésus eut
recommandé Marie à son disciple, pour se soustraire à la pression de la foule
et contempler de plus loin ce qui se passait. Voilà ce qui nous explique
pourquoi les autres évangélistes qui ont parlé de ces femmes après la mort du
Sauveur, nous les représentent debout, assez loin de la croix.
59. Saint Matthieu continue :
« Quand le soir fut venu, un homme riche de la ville d'Arimathie, nommé Joseph
et qui était aussi disciple de Jésus, vint trouer Pilate et lui demanda le
corps de Jésus ; Pilate commanda qu'on le lui donnât (1). » Voici le texte de
saint Marc : « Quand le soir fut venu, comme on était à la préparation qui
précède le sabbat, arriva Joseph d'Arimathie, noble décurion, qui, lui aussi,
altendait1e royaume de Dieu. Il alla sans crainte trouver Pilate et lui
demanda le corps de Jésus. Or, Pilate s'étonnait que Jésus fut déjà mort; il
appela donc le centurion et lui demanda si la mort était bien réelle ; sur
l'affirmation du centurion il donna le corps à Joseph (2). » Saint Luc raconte
ainsi le même fait : « Et voici qu'un homme appelé Joseph, lequel était
décurion, homme de bien et juste et n'avait pas consenti à leurs desseins et à
leurs actions, né à Arimathie, ville de Judée et attendant, lui aussi, le
royaume de Dieu, alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus (3). »
Après avoir parlé du brisement des jambes. infligé à ceux qui avaient été
crucifiés avec le Seigneur, et du coup de lance porté au côté du Sauveur,
saint Jean, qui seul nous apprend ces détails, rapporte en ces termes la suite
des événements : « Après cela Joseph d'Arimathie, qui
était disciple de Jésus, mais en secret, parce qu'il
craignait les Juifs, vint demander à Pilate l'autorisation d'enlever le corps
de Jésus. Il vint donc et enleva ce corps
(4). » Dans tout cela il n'y a lieu à aucune contradiction. Mais
peut-être serait-on tenté de demander pourquoi saint Jean seul fait la
remarque que Joseph d'Arimathie n'était que secrètement le disciple de Jésus,
parce qu'il craignait les Juifs: en effet s'il en était ainsi, on s'étonne
qu'il ait eu la hardiesse de demander le corps du Sauveur, ce que n'osa faire
aucun de ceux qui étaient ses disciples déclarés. Or cette démarche s'explique
facilement, si on se rappelle que la
dignité dont il était revêtu, lui donnait un libre accès auprès de
Pilate : d'un autre côté, comme il ne s'agissait que de rendre les derniers
devoirs à un mort, il né se crut obligé d'avoir aucun souci des Juifs, dont il
craignait la haine, toutes les
232
fois qu'il s'agissait, pour lui, d'aller entendre les
prédications de Jésus.
60. Saint Matthieu ajoute : «
Ayant reçu le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul propre et le plaça
dans un sépulcre neuf qu'il avait taillé dans la pierre ; il approcha ensuite
une grande pierre de l'ouverture du tombeau et se retira (1). » Voici saint
Marc: « Joseph acheta un linceul, en enveloppa le corps, qu'il déposa ainsi
dans un tombeau, taillé dans la pierre ; puis il en ferma l'entrée avec une
pierre (2). » Selon saint Luc : « Joseph ayant descendu le corps, l'enveloppa
d'un linceul et le plaça dans un tombeau taillé, qui n'avait encore servi à
personne (3). » Tous ces textes sont dans une harmonie parfaite; cependant
saint Jean nous apprend que Joseph fut aidé dans l'oeuvre de la sépulture, par
Nicodème. Voilà pourquoi il commence ainsi son récit : « Nicodème qui, dès le
commencement, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint aussi, apportant
environ cent livres d'une composition de myrrhe et d'aloës. » Parlant ensuite
des deux à la fois il continue: « Ils prirent ensemble le corps de Jésus, et
l'enveloppèrent de linceuls, avec des aromates, ainsi que les Juifs ont
coutume d'ensevelir. Or dans le lieu où Jésus avait été crucifié se trouvait
un jardin et dans ce jardin un sépulcre tout neuf, où nul n'avait encore été
mis. Comme c'était le jour de la préparation des Juifs pour le sabbat, et que
ce sépulcre était proche, ils y placèrent Jésus (4). » Quelle contradiction
peut-on trouver dans ce texte? Les Evangélistes, quine parlent pas de
Nicodème, ne disent pas non plus que Joseph d'Arimathie ait été seul pour
ensevelir le Sauveur. A moins qu'on ne prétende que, quand Joseph eut
enveloppé le corps dans un linceul, Nicodème se présenta à son tour, avec un
nouveau linceul et l'employa également; c'est là en effet ce qui semble
indiqué par saint Jean, quand il parle des linceuls ou linges. Mais en
supposant qu'on n'eût employé qu'un seul linceul, saint Jean aurait pu encore
mettre le mot linge au pluriel ; car outre le linceul il y avait le suaire qui
cachait la tête et les bandelettes qui enveloppaient le corps tout entier et
qui toutes devaient être de lin. De là le mot latin lintea, linges.
64. Nous lisons en saint
Matthieu : « Or il y avait là Marie-Magdeleine et l'autre Marie, assises
contre le sépulcre (1). » Saint Marc raconte ainsi le même fait : « Or
Marie-Magdeleine et Marie de Joseph regardaient où on plaçait Jésus (2).»
C'est absolument la même pensée sans des termes différents.
62. Saint Matthieu continue :
« Le lendemain, qui était le jour du Sabbat, les princes des prêtres et les
pharisiens se réunirent auprès de Pilate et lui dirent : Seigneur, nous nous
sommes rappelé que cet imposteur a dit, lorsqu'il était encore en vie: Je
ressusciterai après trois jours. Commandez donc que le sépulcre soit gardé
jusqu'au troisième jour, dans la crainte que, peut-être, ses disciples ne
viennent dérober son corps, et ne disent ensuite au peuple : Il est ressuscité
d'entre les morts, et qu'ainsi il ne s'accrédite une erreur pire que la
première. Pilate leur répondit: Vous avez une garde, allez donc et faites-le
garder comme vous l'entendrez. « Ils s'en allèrent ainsi, et s'assurèrent du
sépulcre en scellant la pierre qui en fermait l'entrée et en y laissant des
gardes (3). » Saint Matthieu seul nous fait connaître cette circonstance, mais
les autres Evangélistes ne disent rien qui puisse contredire.
63. Le même auteur ajoute :
«Cette semaine étant passée, lorsque le premier jour de la semaine suivante
commençait à luire, Marie-Magdeleine et l'autre Marie vinrent pour visiter le
sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre, car un Ange du
Seigneur descendit du ciel, vint renverser la pierre et s'assit dessus. Son
visage était brillant comme un éclair et ses vêtements blancs comme la neige.
Et les gardes on furent saisis de frayeur et devinrent comme morts. Mais
l'Ange s'adressant aux femmes, leur dit : Pour vous, ne
craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a
été crucifié. Il n'est point ici ; il est ressuscité, comme il l'avait dit.
Venez voir le lieu où le Seigneur avait été mis. Puis hâtez-vous d'aller dire
à ses disciples : Il est ressuscité et il vous précède en Galilée, c'est là
que vous le verrez. Voilà ce que je vous annonce. Elles
sortirent aussitôt du sépulcre,
233
saisies de crainte et transportées de joie, et elles
coururent porter ces nouvelles à ses disciples.
Et voilà que Jésus se présenta à elles et leur dit : Je vous salue. Et
elles s'approchèrent de lui, embrassèrent ses pieds et l'adorèrent. Alors
Jésus leur dit: Ne craignez point: « allez, dites à mes frères qu'ils se
rendent en Galilée : c'est là qu'ils me verront. Quand et les furent parties,
quelques-uns des gardes vinrent à la ville et rapportèrent aux princes des
prêtres tout ce qui s'était passé. Et s'étant assemblés avec les anciens, et
ayant
délibéré ensemble, ils donnèrent une grosse somme d'argent aux soldats et leur
dirent : Publiez que ses disciples sont venus la nuit, et l'ont dérobé pendant
que vous dormiez. Si cela vient à la connaissance du gouverneur, nous
l'apaiserons et nous vous mettrons en sûreté (1). » Saint Marc raconte le même
fait (2). Mais on peut demander comment, selon saint Matthieu, l'ange se
tenait assis sur la pierre du sépulcre après qu'elle eut été renversée. En
effet, saint Marc nous dit que les saintes femmes entrèrent dans le sépulcre
et y virent un jeune homme assis, vêtu d'une robe blanche, et qu'elles furent
saisies d'étonnement. On peut d'abord supposer que saint Matthieu ne dit rien
de ce second ange qu'elles virent en entrant, et que saint Marc ne dit rien de
celui qu'elles virent assis hors du tombeau. Dans cette interprétation il
faudrait admettre la présence de deux anges, qui tous deux leur parlèrent de
Jésus, l'un assis en dehors sur la pierre et l'autre assis à droite du
sépulcre dans l'intérieur du tombeau. Au moment où elles allaient entrer,
l'ange qui était assis au-dehors les encouragea en ces termes: « Venez et
voyez le lieu où le Seigneur avait été placé. » Etant donc entrées, elles
virent l'autre ange dont saint Matthieu ne parle pas et qui, selon saint Marc,
était assis à droite et devait leur adresser à peu près le même lamage.
Quoiqu'il en soit, il est certain que la pierre dans laquelle avait été creusé
l'endroit de la sépulture, était précédée d'une sorte de barrière à travers
laquelle on arrivait au tombeau ; de cette manière l'auge que saint Marc nous
représente assis à droite du sépulcre peut fort bien être celui que saint
Matthieu nous représente assis sur la pierre que le tremblement de terre avait
renversée à l'entrée du tombeau c'est-à-dire du sépulcre qui était creusé dans
la pierre.
64. On peut aussi se ,
demander comment saint Marc a pu dire, en parlant des saintes femmes n Elles
s'enfuirent hors du tombeau; car la crainte et la frayeur les avait saisies ;
elles ne parlèrent à personne parce qu'elles étaient tremblantes de crainte. »
Saint Matthieu dit, au contraire : « Elles sortirent aussitôt du sépulcre,
saisies de crainte et d'une grande joie et coururent tout annoncer aux
disciples. » Mais il nous semble que l'on concilie parfaitement ces deux
passages, en admettant que ces femmes n'osèrent rien répondre à ce que les
anges leur disaient, ni rien dire aux gardiens qu'elles voyaient morts de
frayeur. Quant à cette joie dont parle saint Matthieu, elle peut se concilier
facilement avec la crainte dont parle saint Mare . nous devons admettre que
ces deux sentiments envahirent simultanément leur coeur, lors même que saint
Matthieu ne parlerait pas de la crainte, ce qui n'est pas ; car il dit
expressément : « Elles sortirent aussitôt du sépulcre saisies de crainte et
d'une grande joie. » Cette question est ainsi parfaitement résolue.
65. Il y a aussi à examiner
une importante question relative à l'heure de l'arrivée des femmes au tombeau.
Voici le texte de saint Matthieu: « Le soir du sabbat, lorsque le premier jour
de «la semaine suivante commençait à luire, Marie-Magdeleine et l'autre Marie
vinrent pour visiter le sépulcre. » Saint Marc dit au contraire : « Et le
premier jour de la semaine, de grand matin, elles viennent au tombeau, au
moment où le soleil se levait. » Les deux autres Evangélistes,
saint Luc et saint Jean formulent la même pensée : « De grand matin, »
dit saint Luc ; « Le matin, quand les ténèbres régnaient encore, » dit saint
Jean. C'est absolument le sens de ces paroles de saint Marc : « De grand
matin, quand le soleil se levait, » c'est-à-dire, quand le ciel commençait à
blanchir du côté de l'Orient ; c'est ce qui a lieu à l'approche du soleil,
quand se produit le phénomène de l'aurore. Saint Jean a donc pu dire : « Quand
les ténèbres régnaient encore, » car ce n'est qu'à mesure que te soleil monte
à l'horizon, que les ténèbres se dissipent insensiblement et disparaissent.
Ces paroles : « De grand matin, » ne doivent donc pas s'entendre en ce sens
que le soleil eût déjà été sur la terre. C'est ainsi que nous parlons quand
nous voulons que quelque chose se fasse de très-bonne heure. Si nous disons le
matin, nous entendons que ce soit avant que le soleil (234) darde pleinement
ses rayons sur la terre ; nous ajoutons de grand matin, quand nous désignons
le moment où le ciel commence seulement à blanchir. De même après que le coq a
fait entendre tous ses chants du matin, nous disons; il est matin ; mais quand
le soleil ne fait encore que rougir ou blanchir, nous disons, de grand matin.
Il importe donc peu que saint Marc ait dit : « le matin : » Saint Luc: « au
premier rayon du jour, » ou qu'ils aient ajouté de grand matin, quand le jour
commençait seulement à poindre . Saint Jean a parfaitement exprimé cette
pensée en disant : « Le matin, quand les ténèbres n'avalent pas encore
disparu, au lever du soleil, » c'est-à-dire quand, à son lever, le ciel
commence à s'éclairer.
Mais comment concilier. avec
ces passages, celui de saint Matthieu qui sans parler du matin se contente de
dire : « Le soir du sabbat, quand le premier jour de la semaine suivante
commençait à luire? » Si saint Matthieu mentionne la première partie de la
nuit, c'est pour signifier la nuit même à la fin de laquelle les femmes
vinrent au tombeau. Et s'il donne ce nom à la nuit tout entière, c'est que dès
le soir il était permis d'apporter des aromates, puisque le sabbat était
passé. Comme elles ne pouvaient en apporter durant le sabbat, n'était-il pas
naturel de faire commencer la nuit au moment où elles reprenaient le droit de
faire ce qu'elles voulaient que fût d'ailleurs l'instant précis où elles le
feraient ? Ces mots : « Le soir du sabbat, » signifient donc la nuit du sabbat
ou la nuit qui suivit le jour du sabbat. C'est ce qu'exprime parfaitement le
texte : « Le soir du sabbat, quand le premier jour de la semaine suivante
commençait à luire. » Ce texte n'a de sens qu'autant qu'il désigne la nuit
tout entière et pas seulement le commencement de la nuit ; car ce n'est pas au
commencement de la nuit mais à la fin que commence à luire le premier jour de
la semaine. D'ailleurs, comme le commencement de la seconde moitié de la nuit
est la fin de la première moitié, ainsi le jour termine la nuit entière. Il en
résulte donc encore qu'à moins d'entendre par soir la nuit qui finit avec le
jour, on ne peut dire que le soir finit quand le jour commence à luire. » De
plus il est assez ordinaire, dans le langage de la Sainte Écriture, de prendre
la partie pour le tout ; de prendre le soir du jour précédent pour la nuit
tout entière qui se termine par le point du jour. Or, c'est au premier point
du jour que les femmes vinrent au tombeau, et par là même durant la nuit
désignée par le soir. Ce mot, nous l'avons dit, désigne la nuit tout entière ;
c'était donc venir pendant cette nuit que de venir à quelque moment que ce fût
de la nuit. Elles vinrent dans la seconde partie. Or le soir qui finit à
l'aube du premier jour de la semaine désignant la nuit tout entière, en venant
durant cette nuit, elles vinrent le soir ; et elles vinrent cette nuit,
puisqu’elles vinrent durant la dernière partie de cette nuit même.
66. N'en est-il pas ainsi des
trois jours qui s'écoulèrent depuis la mort jusqu'à la résurrection du Sauveur
? Pour que l'on puisse les compter; il faut, suivant l'usage assez ordinaire,
prendre la partie pour le tout. Jésus-Christ avait dit en personne : « Comme
Jonas a été trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, de même le
Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre (1).
» Que l'on compte depuis le moment de sa mort ou de sa sépulture, on n'arrive
pas à trouver les trois jours entiers. Mais il en est autrement si on suit la
règle déjà si souvent exposée : le jour intermédiaire ou le sabbat forme un
jour tout entier, la veille du sabbat ou préparation et le premier jour de la
semaine ou le dimanche sont également comptés comme deux jours, parce qu'on
prend la partie pour le tout. Ce principe résout sur le champ les difficultés
inextricables que rencontrent tous ceux qui veulent s'en tenir à la rigueur de
la lettre et qui ignorent combien de difficultés fait disparaître dans
l'Écriture-la locution qui prend la partie pour le tout. Ainsi, d'après. eux,
la première nuit comprendrait les trois heures, depuis la sixième jusqu'à la
neuvième, pendant lesquelles le soleil s'est obscurci ; les trois autres
heures, depuis la neuvième jusqu'au coucher du soleil, et durant lesquelles
cet astre se montra de nouveau à la terre constitueraient le premier jour.
Vient ensuite la nuit qui précède le sabbat, puis le sabbat tout entier, ce
qui constitue déjà deux nuits et deux jours. Après le sabbat vient la nuit du
premier jour de la semaine ou du dimanche, le jour même où le Sauveur est
ressuscité ; cela fait seulement deux nuits, deux jours et une nuit, quand
même on prendrait cette nuit dans toute son intégrité et quand nous n'aurions
pas démontré que le point du jour de la résurrection en est la dernière
partie. Ainsi donc, sans tenir compte des six heures de la passion, pendant
235
trois desquelles le soleil s'obscurcit, pour briller
pendant les trois autres, on.obtiendra mieux les trois jours et les trois
nuits. Car, en prenant, avec l'Ecriture, la partie pour le tout, nous comptons
la fin du jour de la mort et de la sépulture ou du vendredi avec la partie de
la nuit qui précède le sabbat, pour un jour et une nuit ; nous avons ensuite
le sabbat avec son jour tout entier et sa nuit tout entière ; enfin la 'nuit
du dimanche qui suit le samedi et commence le jour du dimanche, qui forme le
troisième jour, et ainsi nous obtenons trois jours et trois nuits. Nous
trouvons quelque chose de semblable dans une circonstance de la vie du
Sauveur, quand il monte sur la montagne. Saint Matthieu et saint Marc nous
disent : « Six jours après, » ils ne tiennent pas compte des parties de
jours ; saint Luc en tient compte et dit : « Huit jours après (1). »
67. Occupons-nous maintenant
de considérer comment tout le reste concorde avec saint Matthieu. Saint Luc
affirme clairement que les femmes virent deux anges, au moment où elles
vinrent au tombeau. Les deux autres Evangélistes nous en ont mentionné chacun
un ; saint Matthieu parle de celui qui était. assis en dehors du tombeau, et
saint Marc de celui qui était assis à droite dans l'intérieur du sépulcre.
Voici maintenant le récit de saint Luc : « Or, ce jour était celui de la
préparation, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de
Galilée avec Jésus, virent le sépulcre et comment on y avait placé le corps de
Jésus. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums
et elles se tinrent en repos le jour du sabbat, selon la loi. Mais le premier
jour de la semaine, ces femmes vinrent au tombeau de grand matin, et
apportèrent les parfums qu'elles avaient préparés. Et elles virent que la
pierre qui était au-devant du sépulcre en avait été ôtée. Et étant entrées,
elles ne trouvèrent point le corps du Seigneur Jésus. Elles en étaient dans la
consternation, quand deux hommes parurent tout-à-coup devant elles avec des
robes éclatantes. Et comme elles étaient saisies de frayeur, et qu’elles se
tenaient le front courbé vers la terre, ils leur dirent: Pourquoi
cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, il
est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il
était encore en Galilée, et qu'il disait : Il faut que le Fils de l'homme soit
livré entre les mains des pécheurs,
qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième
jour. Et elles se ressouvinrent en effet des paroles de Jésus. Et étant
revenues du sépulcre, elles racontèrent tout ceci aux onze et à tous les
autres (1). » Comment donc ces deux anges furent-ils vus assis, l'un au
dehors, selon saint Matthieu et l'autre à droite dans l'intérieur, selon saint
Marc, tandis que saint Luc nous les représente tous les deux en face des
saintes femmes, quoique tenant à peu près le même langage ? Nous pouvons
admettre qu'en arrivant auprès du tombeau elles virent, assis au dehors, sur
la pierre, l'ange dont nous parle saint Matthieu ; puis franchissant la
barrière qui faisait au tombeau une sorte de vestibule, et en séparait
l'entrée du tombeau lui-même, elles pénétrèrent dans le vestibule et
aperçurent l'ange assis à droite sur la pierre qui avait fermé le sépulcre,
c'est l'Ange de saint Marc ; enfin elles examinèrent attentivement le lieu où
avait été déposé le corps du Sauveur et alors, tout à fait dans l'intérieur,
elles aperçurent deux autres anges qui leur parlèrent à peu près de la même
manière, pour soutenir leur courage et affermir leur foi ; ce sont les deux
anges dont parle saint Luc.
68. Reste maintenant à voir si
le texte de saint Jean peut s'accorder avec ce qui précède. Le voici : « Le
premier jour de la semaine, Marie-Magdeleine vint au sépulcre de grand matin,
lorsqu'il faisait encore obscur; et elle vit que la pierre avait été ôtée.
Elle courut donc et vint trouver Simon Pierre et cet autre disciple que Jésus
aimait et elle leur dit : Ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre, et nous ne
savons où ils l'ont mis. Pierre sortit aussitôt, pour aller au sépulcre et cet
autre disciple avec lui. Ils couraient tous deux ensemble; mais cet autre
disciple devança Pierre et arriva le premier au tombeau. Et s'étant baissé, il
vit les linceuls qui étaient à terre ; mais il n'entra pas. Simon . Pierre qui
le suivait, arriva et entra dans le sépulcre ; il vit aussi les linceuls qui y
étaient, et le suaire qu'on lui avait mis sur la tête, lequel n'était pas avec
les linceuls, mais lié dans un lieu à part. Alors cet autre disciple qui était
arrivé le premier au sépulcre y entra aussi ; et il vit et il crut. Car ils ne
savaient pas encore, comme l'Ecriture l'enseigne, qu'il fallait qu'il
ressuscitât d'entre les morts. Les disciples après cela rentrèrent chez eux.
Mais Marie se tenait dehors, près du sépulcre, versant des larmes,
236
Comme elle pleurait ainsi, elle se baissa et regardant
dans le sépulcre, elle vit deux anges vêtus de blanc, assis au lieu où avait
été le corps de Jésus, l'un à sa tête et l'autre aux pieds. « Ils lui dirent :
Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon
Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. Ayant dit cela, elle se retourna et
elle vit Jésus qui se tenait là, sans qu'elle sût que ce fût lui. Jésus lui
dit: Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle, croyant que c'était
le jardinier, lui dit : Seigneur, si c'est vous qui l'avez enlevé, « dites-moi
où vous l'avez mis, et je l'emporterai. « Jésus lui dit : Marie. Elle, se
retournant, lui répondit : Rabboni ; c'est-à-dire Maître. Jésus lui dit : Ne
me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ; mais va
trouver mes frères et dis-leur : Je monte vers mon Père et votre Père, vers
mon Dieu et votre Dieu. Marie-Magdeleine vint donc dire aux disciples J'ai vu
le Seigneur et il m'a dit ces choses (1). » Dans ce narré de saint Jean, tout
est parfaitement d'accord quant au jour et au temps ou l'on vint au sépulcre ;
comme saint Luc, il nous parle aussi de deux anges. Néanmoins saint Jean nous
les représente debout, tandis que saint Luc nous les montre assis; en outre il
y a dans ce récit de saint Jean bien des circonstances dont ne parlent pas les
autres évangélistes, la suite des événements ne paraît pas la même ; sans un
examen plus approfondi on pourrait croire qu'il y a là contradiction.
69. Ainsi donc, ne faisant
qu'un seul récit des quatre Evangiles combinés, indiquons, autant que le
Seigneur nous en fera la grâce, dans quel ordre a pu se succéder tout ce qui
est arrivé dans les premiers moments qui ont suivi la résurrection. Tous
s'accordent à dire que c'est le premier jour de la semaine et de grand matin,
que l'on vint au tombeau. A ce moment s'était déjà accompli ce qui ne nous est
rapporté,que par saint Matthieu, le tremblement de terre, le renversement de
la pierre et la frayeur qui se saisit des gardes et les jeta à demi-morts
contre terre. D'après saint Jean on vit accourir au tombeau Marie-Magdeleine,
sans aucun doute la plus ardente de toutes les femmes qui avaient servi le
Sauveur ; c'est pour ce motif sans doute que saint Jean ne nomme qu'elle et ne
parle pas de celles qui l'accompagnaient. Elle vint donc et bientôt elle
s'aperçut que le tombeau était ouvert ; sans chercher à
se rendre un compte plus exact de l'état des choses, bien
persuadée qu'on a enlevé le corps de Jésus, elle court l'annoncer à Pierre et
à Jean. Saint Jean est en effet le disciple que Jésus aimait. Ces deux Apôtres
coururent aussitôt au sépulcre; saint Jean arriva le premier, se baissa,
reconnut les linceuls, mais n'entra pas. Pierre se présenta bientôt après,
pénétra dans le tombeau, vit les linceuls et à côté d'eux le suaire qui avait
été placé sur la tète de Jésus. Saint Jean entra ensuite, remarqua les mêmes
circonstances, et crut, comme Marie-Magdeleine, que le corps de Jésus avait
été enlevé. « Car ils ne savaient pas encore, comme l'enseigne l'Ecriture,
qu'il fallait qu'il ressuscitât d'entre les morts. Ils retournèrent ainsi dans
leur demeure.
Mais Marie-Magdeleine se
tenait auprès du sépulcre en versant de larmes. » Elle n'avait pas quitté cet
endroit qui précédait le sépulcre de pierre et dans lequel elles étaient
entrées. Or, il. y avait là un ,jardin, comme saint Jean nous l'atteste. C'est
alors qu'elles virent un ange assis à droite sur la pierre qui avait fermé le
tombeau; c'est de cet ange que nous parlent saint Matthieu et saint Marc. « Il
leur dit : Pour vous, « ne craignez rien; car je sais que vous cherchez Jésus
qui a été crucifié ; il n'est point ici ; il est ressuscité comme il l'a dit ;
venez et voyez le lieu où le Seigneur avait été placé. Allez vite et dites à
ses disciples qu'il est ressuscité, voilà qu'il vous précède en Galilée, c'est
là que vous le verrez, je vous l'assure. » Saint Marc s'exprime à peu près de
la même manière. A ces paroles Marie, qui pleurait, se courba, jeta ses
regards sur le tombeau et, comme le rapporte saint Jean, elle aperçut deux
anges, assis et vêtus de blanc; l'un était à la tète et l'autre au pied du
sépulcre où Jésus avait. été déposé. « Ils lui dirent : Femme, pourquoi
pleures-tu? Elle leur répond: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne
sais où ils l'ont mis. » On doit croire qu'alors les anges s’étaient levés, en
sorte qu'ils apparaissaient debout, comme saint Luc nous l'atteste. Or, comme
ces femmes étaient saisies de crainte et courbées vers la terre : « Pourquoi,
leur dirent les anges, cherchez-vous parmi les morts, celui qui est plein de
vie ; il n'est point ici, mais il est ressuscité: rappelez-vous ce qu'il vous
a dit, quand il était encore en Galilée : Il faut que le Fils de l'homme soit
livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié, mais il
ressuscitera le troisième jour. Et le souvenir de ces paroles leur (284)
revint à l'esprit. — C'est alors
que Magdeleine se retourna et aperçut Jésus, comme nous le dit saint Jean, et
elle ne savait pas que ce fût Jésus. Le Sauveur lui dit : Femme, pourquoi
pleures-tu? qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit:
Seigneur, si c'est vous qui l'avez enlevé, dites-moi où vous l'avez mis et je
l'emporterai. Jésus lui dit : Marie. Se retournant aussitôt, elle répondit :
Rabboni; c’est-à-dire : Maître. Jésus lui dit : Ne me touche pas, car je ne
suis pas encore monté à mon Père; va trouver mes frères et dis-leur : Je monte
vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
Elle sortit alors du tombeau,
c'est-à-dire du lieu particulier formé de la partie du jardin qui était en
avant de l'ouverture pratiquée dans la pierre. Elle fut suivie des autres
femmes, que saint Marc nous représente en proie à la crainte et à la frayeur,
et elles gardaient un profond silence. C'est alors, selon saint Matthieu, que
Jésus se présenta à leur rencontre et leur dit Je vous salue. Elles
s'approchèrent de lui, saisirent ses pieds et l'adorèrent. » Ainsi nous
pensons que ces femmes ouïrent deux fois les anges et deux fois Jésus ; une
première fois quand Magdeleine le prit pour le jardinier, et la seconde, quand
il se présenta à leur rencontre, voulant par là les affermir dans la foi et
dissiper leur crainte. « Il leur dit alors : Ne craignez rien, allez, dites à
mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. —
Marie-Magdeleine courut donc annoncer aux disciples qu'elle avait vu le
Seigneur et leur rapporta ses paroles ; » les autres femmes en firent autant,
car, selon saint Luc, « elles annoncèrent tout cela aux onze et à tous les
autres. Or les disciples ne virent dans tout cela que des rêveries de femmes
et ils refusaient d'y croire: » Saint Marc confirme tout cela. En effet, après
avoir raconté qu'elles sortirent toutes tremblantes du sépulcre et dans le
plus profond silence, il ajoute que le premier jour de la semaine, dès le
matin, le Seigneur apparut d'abord à Marie-Magdeleine qu'il avait délivrée de
sept démons ; qu'ensuite elle alla tout raconter aux disciples encore plongés
dans les larmes et la douleur ; mais qu'en apprenant que Jésus vivait et qu'il
avait apparu à Magdeleine, les disciples refusèrent d'y croire.
Saint Matthieu ajoute qu'après
le départ des femmes qui avaient tout vu et tout entendu, un certain nombre de
gardes qui avaient été jetés contre terre, à demi-morts, rentrèrent dans la
ville et annoncèrent aux princes des prêtres tout ce qui s'était passé,
c'est-à-dire tout ce dont ils avaient pu s'apercevoir; qu'aussitôt les princes
des prêtres et les anciens tinrent conseil, donnèrent une grosse somme
d'argent aux soldats, à condition qu'ils diraient que les disciples étaient
venus et qu'ils avaient profité de leur sommeil pour enlever son corps ; qu'en
même temps ils leur promirent qu'ils s'emploieraient auprès du gouverneur pour
leur épargner tout châtiment ; que les soldats reçurent l'argent, firent
exactement ce qui leur avait été recommandé ; et que cg fait est encore publié
aujourd'hui parmi les Juifs.
70. Il nous faut maintenant
étudier les diverses apparitions du Sauveur à ses disciples, après la
résurrection, pour faire ressortir l'accord qui existe non-seulement entre les
Evangélistes (1), mais encore entre les Evangiles et saint Paul, qui s'exprime
ainsi à ce sujet, dans sa première épître aux Corinthiens : « Je vous ai
rapporté tout d'abord ce que j'avais appris, savoir, que Jésus-Christ est mort
pour nos péchés, selon les Ecritures ; qu'il a été enseveli et que selon les
Ecritures encore, le troisième jour il est ressuscité; qu'il apparut ensuite à
Pierre, puis aux douze et ensuite à plus de cinq cents frères dont le plus
grand nombre est encore sur la terre, et dont quelques-uns se sont endormis;
il apparut plus tard à Jacques, puis à tous les apôtres ; enfin il m'apparut à
moi-même, qui ne suis au milieu d'eux que comme un avorton (2). » Cet ordre
d'apparitions n'est observé par aucun évangéliste; nous devons donc examiner
si l'ordre qu'ils ont suivi est en contradiction avec celui de saint Paul. Il
est certain, d'abord, que saint Paul n'a pas tout dit ; les évangélistes n'ont
pas tout raconté non plus ; nous allons voir seulement si dans ce que les uns
et les autres ont dit, on ne peut surprendre aucune contradiction.
Saint Luc est le seul des
évangélistes qui garde le silence. sur les apparitions du Sauveur aux saintes
femmes, il ne parle que de l'apparition des anges. Saint Matthieu dit que
Jésus leur apparut au moment.où elles revenaient du sépulcre ;
238
saint Marc, comme saint Jean, rapporte que le Seigneur se
montra d'abord à Marie-Magdeleine, mais il ne décrit pas cette apparition que
nous ne trouvons détaillée que dans saint Jean. Non-seulement saint Luc ne
nous dit pas que Jésus se montra aux saintes femmes, mais en nous rapportant
la conversation qu'eurent avec Jésus les deux disciples d'Emmaüs, dont l'un
s'appelait Cléophas, il laisse supposer que les femmes n'avaient vu que les
anges. «Ce jour là même, dit-il, deux d'entre eux s'en allaient à un bourg,
nommé Emmaüs, éloigné de soixante stades de Jérusalem. Et ils parlaient
ensemble de tout ce qui s'était passé. Or il arriva que pendant leur
entretien, Jésus lui-même les joignit et se mit à marcher avec eux, mais leurs
yeux étaient retenus, en sorte qu'ils ne pouvaient le reconnaître. Et il leur
dit : De quoi vous entretenez-vous ainsi, en marchant, et d'où vient que vous
êtes tristes ? L'un deux nommé Cléophas, lui répondit : Etes-vous seul si
étranger dans Jérusalem, que vous ne sachiez pas ce qui s'y est passé ces
jours-ci ? Quoi donc? leur dit-il. Ils répondirent : Relativement à Jésus de
Nazareth, qui a été un prophète puissant en oeuvres et en paroles, devant Dieu
et devant tout le peuple, et de quelle manière les princes des prêtres et les
anciens l'ont livré, pour être condamné à mort, et l'ont crucifié. Cependant
nous espérions que ce serait lui qui rachèterait Israël; et après tout cela
néanmoins, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai
que quelques femmes de celles qui étaient avec nous, nous ont effrayés; car
étant allées dès le grand matin à son sépulcre et n'y ayant point trouvé son
corps, elles sont venues dire qu'elles avaient vu même des anges qui disaient
qu'il est vivant. Et quelques uns des nôtres, étant aussi allés au sépulcre,
ont trouvé toutes ces choses comme les femmes les avaient rapportées, mais
pour lui ils ne l'ont point vu. » Voilà, selon saint Luc, comment ils
racontent les événements, c'est-à-dire selon que leur mémoire a pu leur
rappeler ce qu'avaient rapporté les femmes ou les disciples qui avaient couru
au sépulcre en apprenant que le corps de Jésus avait disparu. Saint Luc ne
cite même que saint Pierre qui ait couru au tombeau: il nous le représente se
courbant à l'entrée du sépulcre, n'y voyant plus que les linceuls, et s'en
retournant tout préoccupé de ce qui s'était passé. Saint Luc nous
raconte ce fait de saint Pierre, avant de parler de
l'apparition aux disciples d'Emmaüs, et après avoir rapporté l'histoire des
saintes femmes, qui avaient vu les anges et qui en avaient appris que Jésus
était ressuscité ; mais il ne faut voir ici qu'une sorte de récapitulation de
la part de saint Luc, au sujet de saint Pierre. En effet, Pierre courut au
tombeau avec.saint Jean, aussitôt qu'ils apprirent des saintes femmes, et
surtout de Marie-Magdeleine, que le corps avait été enlevé ; or elle vint le
leur annoncer aussitôt qu'elle eut aperçu que la pierre ne fermait plus le
tombeau; ce n'est qu'après cela qu'eut lieu la vision des anges et la double
apparition du Sauveur aux femmes, la première quand elles étaient auprès du
tombeau et la secondé au moment où elles retournaient à Jérusalem. Tout cela
se passa avant l'événement des disciples d'Emmaüs,dont l'un était Cléophas. En
effet Cléophas, s'adressant à Jésus, qu'il ne reconnaissait point, ne dit
pasque Pierre alla au sépulcre, mais: «Quelques-uns des nôtres se sont rendus
au tombeau et ont reconnu la vérité de ce que les femmes avaient dit. » Ce
n'est donc que par forme de récapitulation qu'il rapporte ce que les femmes
avaient annoncé à Pierre et à Jean sur l'enlèvement du corps de Jésus.
Ainsi donc saint Luc nous dit
d'abord que saint Pierre courut au sépulcre, puis il fait dire à Cléophas que
quelques-uns d'entre eux étaient allés au tombeau, évidemment c'est de saint
Jean qu'il est ici question; saint Pierre avait été nommé seul la première
fois, uniquement parce que c'était d'abord à lui que Magdeleine avait annoncé
ce qu'elle avait vu. D'un autre côté saint Luc ne dit pas que Pierre soit
entré dans le tombeau ; il se contente de dire qu'il s'inclina, aperçut les
linceuls et s'en retourna, en proie à un grand étonnement. Saint Jean, au
contraire, dit du disciple bien-aimé ou de lui-même, qu'il n'entra pas
d'abord; mais qu'il se courba et vit les linceuls pliés; pendant ce temps,
Pierre arrivait, regardait, entrait ensuite et était suivi du disciple
bien-aimé. Ainsi nous devons conclure que Pierre, à son arrivée, regarda
d'abord, comme l'affirme saint Luc, saint Jean n'en disant rien, ensuite il
entra, mais il entra avant saint Jean; de cette manière tout se concilie
parfaitement.
71. En admettant que les
femmes eurent les premières l'honneur de voir et d'entendre Jésus, on peut
ainsi, d'après les évangélistes et d'après (239) saint Paul, établir l'ordre
des apparitions aux disciples. Le, contexte de tous ces auteurs prouve que le
Sauveur apparut d'abord à Pierre. Qui néanmoins oserait avancer ou nier en
face du silence de l'Ecriture, qu'un autre que Pierre eut la préférence? Saint
Paul ne dit pas : Jésus. apparut d'abord, mais : « Jésus apparut à Pierre,
ensuite aux douze et enfin à plus de cinq cents de nos frères en même temps. »
L'Apôtre ne dit ni quels étaient les onze auxquels il apparut, ni quels
étaient ces cinq cents. Il peut se faire que ces douze ont été du nombre des
disciples , je ne sais lesquels, car les apôtres n'étaient plus douze, mais
onze; aussi quelques exemplaires ne portent que le chiffre onze; ce que
j'explique assez facilement en supposant que les copistes se souvenant. que la
mort de Judas réduisait à onze 1e nombre des disciples, auront corrigé dans ce
sens le texte primitif. Cependant, soit que les véritables exemplaires soient
ceux qui écrivent onze, soit que saint Paul ait voulu désigner par ce nombre
de douze des disciples différents des Apôtres, ou même ces onze apôtres par le
nombre de douze, car le nombre douze était pour eux si sacré et si mystérieux
qu'il fallut pour eu conserver la signification profonde, le compléter par
l'élection de saint Matthias, en remplacement de Judas (1); toujours est-il
que l'on ne peut signaler entre tous ces textes aucune contradiction réelle.
Disons néanmoins qu'il est assez probable que Jésus apparut d'abord à Pierre,
puis aux deux disciples d'Emmaüs dont l'un s'appelait Cléophas, et dont nous a
parlé saint Luc, et auxquels saint Marc fait allusion dans les paroles
suivantes : « Après cela il apparut dans une autre forme à deux d'entre eux
qui se dirigeaient vers une villa. » Rien n'empêche, en effet, de désigner le
bourg sous le nom de villa ou maison des champs. N'est-ce pas sous ce nom que
l'on désigne aujourd'hui Bethléem qui autrefois portait le nom de cité? et
cependant jamais Bethléem ne fut entourée d'autant de gloire et de renommée
que depuis la naissance du Messie, dont le nom est si hautement célébré dans
toutes les Eglises. Les exemplaires grecs emploient plutôt le nom de champ que
le nom de villa; or ce mot champ désigne non-seulement les châteaux ou maisons
détachées, mais aussi les municipes et les colonies, situées en dehors de la
ville, qui en est comme le chef et la mère, d'où lui vient le nom de
métropole.
72. Saint Marc nous dit que
Jésus apparut sous une autre forme aux deux disciples; saint Luc a exprimé la
même pensée en disant que leurs yeux étaient retenus pour qu'ils ne le
reconnussent pas. En effet, quelque chose était venu affecter leurs yeux et y
resta jusqu'à la fraction du pain, en sorte que, jusqu'à ce moment, ils ne
virent le Sauveur que sous une forme étrangère qui disparut à la fraction du
pain, comme le rapporte saint Luc. C'était par une sorte d'aveuglement
d'esprit qu'ils ignoraient qu'il fallait que le Christ mourût et ressuscitât;
et pour ce motif quelque chose de semblable affecta leurs yeux et les rendit
incapables de découvrir la vérité; ce n'était pas la vérité qui les trompait,
c'était eux qui voyaient autre chose que ce qui était. De même que personne ne
se flatte de connaître Jésus-Christ, s'il ne participe pas à son corps,
c'est-à-dire à l'Eglise dont l'unité nous est figurée dans le sacrement du
pain, d'après ce témoignage de l'Apôtre : « Tout nombreux que nous soyons,
nous sommes un seul pain, un seul corps (1). » Aussi, c'est quand Jésus leur
présenta le pain consacré, que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils le reconnurent
; ils s'ouvrirent à sa connaissance, parce que l'obstacle qui les empêchait de
le reconnaître, disparut aussitôt. Ils ne marchaient pas les yeux fermés, mais
quelque chose les empêchait de reconnaître ce qu'ils voyaient : un brouillard
ou une humeur produisent d'ordinaire des effets semblables. Je ne veux pas
dire cependant que le Seigneur ne pouvait pas transformer son corps et se
revêtir d'un autre extérieur que celui sous lequel ils avaient coutume de le
contempler; avant sa passion, il s'était ainsi transformé, et son visage
brillait de tout l'éclat du soleil (2). Celui qui a le pouvoir de changer
l'eau en vin ne pouvait-il pas faire d'un corps véritable un autre corps
véritable (3)? Mais ce n'est pas ce changement que le Sauveur avait opéré, en
apparaissant d'une autre manière aux deux disciples. Comme leurs yeux étaient
retenus, afin qu'ils ne le reconnussent pas, il ne leur apparut pas réellement
ce qu'il était. Rien n'empêche d'admettre que ce fut le démon lui-même qui
plaça devant leurs yeux un obstacle qui les empêcha de reconnaître Jésus; mais
le Sauveur ne le permit que jusqu'à la fraction du pain sacramentel; aussitôt
qu'on a participé à l'unité de son corps, tout obstacle ennemi doit
disparaître et on peut reconnaître Jésus.
240
73. Nous devons regarder les
deux disciples dont parle saint Marc comme étant les deux disciples d'Emmaüs;
cet auteur en effet ajoute qu'ils allèrent aussitôt raconter à leurs frères ce
qu'ils avaient vu ; comme saint Luc rapporte de son côté qu'ils se levèrent
aussitôt, rentrèrent à Jérusalem, et trouvèrent les onze réunis et les autres
qui étaient avec eux, disant que le Seigneur était ressuscité, et qu'il avait
apparu à Pierre; ils racontèrent de leur côté ce qui leur était arrivé en
route et comment ils avaient.reconnu Jésus à la fraction du. pain. En ce
moment donc, il n'était plus question que de la résurrection, qu'attestaient
les saintes femmes ainsi que Pierre qui avait déjà eu le bonheur de voir
Jésus; et c'est de cela qu'ils s'entretenaient tous, quand arrivèrent au
milieu d'eux les deux disciples d'Emmaüs. Il peut se faire que retentis par la
crainte, ils n'aient pas osé avouer, dans leur voyage, qu'ils avaient appris
que Jésus était ressuscité, et se contentèrent de dire que les femmes avaient
vu des anges; comme ils ne connaissaient pas celui qui s'entretenait ainsi
avec eux, le long du chemin, ils pouvaient craindre d'avoir affaire à
un ennemi, et de tomber entre les mains des Juifs s'ils proclamaient hautement
la résurrection de Jésus-Christ. Saint Marc ajoute : « Ils vinrent l'annoncer
aux autres, quine les crurent pas; » de son côté, saint Luc fait entendre que
les disciples réunis s'entretenaient de la résurrection de Jésus et de son
apparition à Pierre; pour dissiper toute apparence de contradiction entre ces
deux textes, il suffit de dire que dans la foule des disciples quelques-uns
refusèrent de croire. II n'est pas moins évident, que saint Marc a omis de
parler de la conversation, que le Sauveur engagea avec les deux disciples le
long du chemin, et de la manière dont ils le reconnurent à la fraction du
pain. Il n'y a là qu'une omission, car immédiatement après avoir rapporté
qu'il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux, qui allaient à une
maison des champs, l'auteur ajoute : « Et ils vinrent le dire aux autres,
quine les crurent pas. » Or pouvaient-ils annoncer un homme qu'ils n'avaient
pas connu, ou pouvaient-ils reconnaître un homme sous une autre forme Saint
Marc a donc omis de nous dire comment ils étaient arrivés à le connaître. Et
ceci est d'autant plus important à remarquer, que nous avons besoin d'admettre
que les Evangélistes sont réellement dans l'usage de passer ainsi sous silence
une multitude de détails, et de continuer
sans aucune autre transition, leur récit, en sorte qu'il
suffit de méconnaître cet usage pour s'exposer à voir des contradictions là où
il n'y en a aucune.
74. Saint Luc continue : «
Pendant qu'ils parlaient ainsi, Jésus se présenta debout au milieu d'eux et
leur dit : La paix soit avec vous, c'est moi, ne craignez pas. Ils furent tout
troublés et effrayés et croyaient voir un fantôme. Jésus leur dit: Pourquoi
vous troublez-vous et pourquoi ces pensées montent-elles dans votre coeur?
Voyez mes mains et mes pieds et reconnaissez que c'est bien moi : palpez et
voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous m'en voyez. Après avoir dit
ces paroles, il leur montra ses mains et ses pieds. » C'est à cette apparition
du Sauveur après sa résurrection que nous devons rapporter les paroles
suivantes de saint Jean : « Le soir du premier jour de la semaine étant venu,
les portes de la salle où les disciples étaient réunis avaient été fermées
parce qu'on craignait les Juifs ; Jésus se présenta, se tint de bout au milieu
d'eux, et leur dit : La paix soit avec vous. Et après avoir ainsi parlé il
leur montra ses mains et son côté. » A ces paroles de saint Jean on peut
ajouter ce que dit ensuite saint Luc, quoique saint Jean n'en parle pas : «
Mais comme ils ne croyaient, point encore, tant ils étaient transportés de
joie et d'admiration, il leur dit Avez-vous là quelque chose à manger? Ils lui
présentèrent un morceau de poisson rôti et un rayon de miel. Après qu'il eut
mangé devant eux, prenant les restes il les leur donna. » Il faut ajouter ici
avec saint Jean : « La vue du Seigneur remplit les disciples d'une grande
joie. Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous : comme mon Père m'a
envoyé je vous envoie. Ayant dit ces paroles, il souffla sur eux et ajouta :
Recevez le Saint-Esprit : les péchés seront remis à qui vous les remettrez, et
ils seront retenus à qui vous les retiendrez. » Continuons avec saint Luc: «
Il leur dit encore : Voilà ce que je vous disais, étant encore avec vous,
qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi, dans les psaumes,
s'accomplit. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils entendissent les
Ecritures, et il leur dit : Il est ainsi écrit et il fallait que le Christ
souffrit de la sorte, qu'il ressuscitât le troisième jour et qu'on prêchât en
son nom la pénitence et la rémission des péchés, parmi toutes les nations, en
commençant par Jérusalem. Or vous êtes témoins de ces choses. Et (241) je vais
vous envoyer le don que mon Père vous a promis; cependant tenez-vous dans la
ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. » C'est ainsi
que saint Luc mentionne la promesse du Saint-Esprit, que nous ne trouvons
faite par le Seigneur que dans l'Evangile de saint Jean (1). Ceci nous prouve
de nouveau que les Evangélistes s'appuyent l'un l'autre, même dans ce qu'ils
ne disent pas personnellement, quoiqu'ils sachent que telle parole a été dite,
ou telle action faite. Saint Luc ne dit plus rien des apparitions du Sauveur,
il transporte subitement son récit à l'ascension de Jésus au ciel. Et
cependant ce récit continue sans aucune suspension, quoiqu'il sût fort bien
que ce qu'il venait de raconter s'était passé le jour même de la résurrection
et que l'ascension n'eut lieu que quarante jours après, comme il l'atteste
lui-même dans le livre des Actes 9. Quant à saint Jean, il nous rapporte que
Thomas n'était pas avec les autres, à cette apparition du Sauveur, et saint
Luc nous avait dit qu'à leur retour à Jérusalem, les deux disciples d'Emmaüs
avaient trouvé réunis les onze et ceux qui étaient avec eux. Il faut en
conclure que Thomas sortit avant que se montrât le Sauveur.
75. Saint Jean nous décrit
ensuite une autre apparition du Sauveur à ses disciples. Elle eut lieu huit
jours après, et cette fois Thomas était présent : « Huit jours après, dit-il,
les disciples étaient de nouveau enfermés et Thomas avec eux. Jésus apparut,
les portes étant closes, se tint au milieu d'eux, et leur dit : La paix soit
avec vous. Il dit ensuite à Thomas : Avance ton doigt ici, et vois mes mains ;
avance ta main et plonge-la dans mon côté, et ne sois point incrédule, mais
fidèle. Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu ! Jésus lui dit
Parce que tu m'as vu, tu as cru; bienheureux ceux qui
n'ont pas vu et qui ont cru. » Cette apparition, que saint Jean nous présente
comme étant la seconde du Sauveur, se trouverait brièvement rapportée par
saint Marc quand il dit, avec sa: concision ordinaire : « Comme les onze
étaient à table, Jésus leur apparut une dernière fois. » Sans doute saint Jean
ne dit pas que les disciples étaient à table, mais il a pu omettre cette
circonstance. Quant au mot : « Une dernière fois » ce qui supposerait que le
Sauveur ne leur apparut plus, doit-il nous empêcher de
rapporter cette apparition à la seconde de saint Jean,
qui en décrit une troisième auprès de la mer de Tibériade ? Du reste saint
Marc ajoute Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur coeur, par
ce qu'ils n'avaient point cru au témoignage de ceux qui l'avaient vu
ressuscité. » Il s'agit ici du témoignage des deux disciples d'Emmaüs, de
Pierre à qui le Sauveur apparut d'abord, selon saint Luc, et peut-être aussi
de celui de Marie-Magdeleine et des autres femmes qui étaient avec elle quand
elles virent le Sauveur auprès du tombeau et pendant leur retour à Jérusalem.
Enfin l'auteur unit étroitement ce récit à ce qu'il vient de dire des
disciples d'Emmaüs : « En dernier lieu, dit-il, il apparut aux onze lorsqu'ils
étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur coeur,
parce qu'ils n'avaient point cru au témoignage de ceux qui l'avaient vu
ressuscité. » Ce mot : « en dernier lieu, » ne doit pas s'appliquer à une
dernière apparition; car la dernière apparition eut lieu seulement quarante
jours après la résurrection, le jour même de l'ascension. Ce jour là le
Sauveur devait-il leur reprocher de n'avoir pas cru au témoignage de ceux qui
l'avaient vu ressuscité, quand ils l'avaient vu eux-mêmes si souvent depuis,
quanti ils l'avaient vu surtout le soir même du jour de la résurrection, le
premier jour de la semaine, comme saint Luc et saint Jean nous -l'attestent ?
Par conséquent, c'est le jour même de la résurrection ou le premier jour de la
semaine, le jour où Marie-Magdeleine et les autres femmes virent le Sauveur de
grand matin; le jour où le virent saint Pierre d'abord, puis les deux
disciples d'Emmaüs dont semble parler saint Marc, enfin vers le soir les onze,
excepté Thomas, et ceux qui étaient réunis avec eux quand ces disciples leur
racontaient ce qu'ils avaient vu, que Saint Marc a voulu désigner brièvement à
son ordinaire, dans les paroles que nous examinons. Ce mot employé par lui : «
en dernier lieu, » signifie seulement que ce fut là le dernier événement du
jour, et que la nuit commençait déjà, ce qui suivit d'assez près le retour des
disciples d'Emmaüs. Ceux-ci, en rentrant à Jérusalem, trouvèrent les disciples
réunis et s'entretenant de la résurrection et de l'apparition faite à Pierre;
ils racontèrent eux-mêmes avec empressement ce qui leur était arrivé en
chemin, et comment ils avaient reconnu Jésus à la fraction du pain. Malgré
tous ces témoignages il s'en trouvait encore qui refusaient de croire, et de
(242) là ce mot de saint Mare: « Ils ne le crurent pas. » C'est alors qu'eut
lieu la dernière apparition du jour; les disciples étaient à table, d'après
saint Marc, ils s'entretenaient entre eux, nous dit saint Luc ; le Sauveur se
tint de bout au milieu d'eux et leur dit : La paix soit avec vous, disent
également saint Luc et saint Jean ; de plus les portes étaient fermées, c'est
saint Jean seul qui nous en fait la remarque. Aux paroles que nous avons
citées de saint Luc et de saint Jean, il faut donc joindre encore les
reproches que leur attira, selon saint Marc, le refus qu'ils firent de croire
au témoignage de ceux qui avaient vu Jésus ressuscité.
76. Mais voici une nouvelle
difficulté. Comment saint Marc peut-il dire que le Sauveur apparut aux onze
apôtres, quand ils étaient à table, si cette apparition se confond avec celle
dont parlent saint Luc et saint Jean. et qui eut lieu le soir du jour de la
résurrection ? En effet, saint Jean dit clairement qu'au moment de cette
apparition Thomas était absent; et en réalité nous croyons qu'il quitta ses
frères après l'arrivée des deux disciples d'Emmaüs, et avant l'apparition de
Jésus-Christ. Saint Luc dans sa narration laisse croire, de même, que Thomas
était parti, pendant que les deux disciples parlaient, et avant que le Sauveur
entrât. Et voici saint Marc qui affirme qu'en dernier lieu Jésus apparut aux
onze réunis à table, ce qui nous force de conclure que Thomas était avec eux.
A cela on peut d'abord répondre que malgré cette précision du nombre onze, on
peut admettre l'absence de saint Thomas, parce que ce nombre était alors la
dénomination reçue pour désigner le collège apostolique, avant l'élection de
saint Matthias en remplacement de Judas. Si cette interprétation parait
forcée, regardons cette apparition dont parle saint Marc comme ayant eu lieu,
après une multitude d'autres, le quarantième jour qui suivit la résurrection.
Comme alors le Sauveur était sur le point de monter au ciel, il saisit
l'occasion pour adresser publiquement un reproche d'incrédulité à ceux qui
avaient refusé de croire à sa résurrection avant de l'avoir vu ressuscité; et
pour rendre ce reproche encore plus vif, il leur annonce: que quand ils
prêcheront l'Évangile, ils verront les nations croire sans avoir vu. Et en
effet, le reproche est immédiatement suivi de ces paroles : « Et Jésus leur
dit : Allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à toute créature ; celui qui
croira et sera baptisé sera sauvé; mais celui qui ne croira pas sera condamné.
» Bientôt ils vont prêcher que celui qui ne croira pas sera condamné, même en
refusant de croire ce qu'il n'a pas vu; comment d'abord ne pas leur reprocher
à eux-mêmes, d'avoir refusé de croire au témoignage de ceux qui avaient vu le
Seigneur, avant de l'avoir vu?
77. Ce qui nous détermine
encore à croire que cette apparition de saint Marc a été réellement la
dernière apparition corporelle de Jésus, ce sont les paroles dont saint Marc
la fait suivre: « Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront
cru: ils chasseront les démons en mon nom; ils parleront de nouvelles langues;
ils enlèveront les serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne
leur fera point de mal ; ils imposeront les mains sur les malades, et ceux-ci
seront guéris. » L'Évangéliste ajoute immédiatement : « Et le Seigneur Jésus,
après leur avoir parlé, « fut élevé au ciel, où il est assis à la droite de
Dieu. Et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux
et confirmant sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. » En disant: «
Et le Seigneur Jésus, « après leur avoir parlé, fut élevé au ciel, »
l'évangéliste veut-il nous faire entendre que ce fut là le dernier discours
qu'il leur adressa sur la terre? C’est plus naturel de le croire; cependant
rien ne force absolument à tirer cette conclusion. En effet, l'auteur ne dit
pas: Après que Jésus leur eut ainsi parlé ; mais seulement : « Après qu'il
leur eut parlé. » Si la nécessité y contraignait, on pourrait donc encore,
malgré ces paroles, croire que ce ne fut pas là le dernier entretien du
Sauveur, ni le dernier jour qu'il passa sur la terre; l'Évangile, par ces
expressions: « Après qu'il leur eut parlé, » aurait seulement fait allusion à
tous les entretiens qu'eut Jésus avec ses disciples pendant ces quarante
jours. Mais nous avons dit précédemment que la clarté avec laquelle saint Marc
suppose la présence de saint Thomas à cette apparition et à cet entretien,
nous amène à conclure qu'il est vraiment question ici des derniers moments que
le Sauveur passa sur la terre. C'est donc après ces paroles et les autres
détails, que nous rapportent les Actes des Apôtres (1), que le Sauveur monta
au ciel, le quarantième jour qui suivit sa résurrection.
78. Saint Jean, tout en
avouant qu'il a
243
passé sous silence un grand nombre des actions de Jésus,
nous décrit cependant une troisième apparition du Sauveur à ses disciples;
auprès de la mer de Tibériade. Ces disciples étaient au nombre de sept :
Pierre, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée et deux autres qui ne font pas
désignés parleur nom et qui étaient aussi occupés à pêcher. D'après son ordre,
ils jetèrent les filets sur la droite et retirèrent cent-cinquante trois
grands poissons; c'est dans cette circonstance aussi qu'il fut trois fois
demandé à Pierre s'il aimait son Maître et que, sur sa réponse affirmative, il
lui fut dit de paître les agneaux et les brebis; Jésus lui prédit aussi son
martyre et dit de saint Jean: « Je veux qu'il reste ainsi jusqu'à ce que je
vienne. » C'est par là que saint Jean termine son Évangile.
79. Il nous reste encore à
rechercher à quel moment Jésus se montra pour la première fois en Galilée à
ses disciples. En effet cette troisième apparition racontée par saint Jean eut
lieu en Galilée, comme on le voit facilement par le récit du miracle des cinq
pains, que saint Jean commence par ces paroles : « Après cela Jésus c se
rendit au delà de la mer de Galilée ou la mer de Tibériade (1). » Il
est certain que c'est en Galilée que l'on s'attend à voir le Sauveur
apparaître tout d'abord à ses disciples, surtout si l'on se rappelle les
paroles adressées par l'ange aux femmes venues au sépulcre. Voici le texte de
saint Matthieu: « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez
Jésus qui a été crucifié ; il n'est point ici, il est ressuscité, comme il
l'avait dit; venez donc et voyez le lieu où le Seigneur avait été placé. Puis
allez et dites à ses disciples qu'il est ressuscité, et voici qu'il vous
précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, je l'assure. » Saint Marc
nous montre le même Ange ou un autre disant également: «.Ne craignez rien;
vous cherchez Jésus de Nazareth, crucifié; il est ressuscité, il n'est point
ici; « voici le lieu où ils l'ont placé. Allez donc et dites à ses disciples.
et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée; vous l'y verrez, comme il vous l'a
annoncé. » La teneur de ces paroles semble devoir nous faire conclure,
qu'après sa résurrection, le Sauveur ne devait apparaître à ses disciples,
qu'en Galilée. Mais le contraire nous est attesté d'abord par saint Marc
lui-même, d'après le récit duquel Jésus apparut à Marie-Magdeleine,
de grand matin, le premier jour de la semaine; elle
raconta cette apparition aux disciples et à tous ceux qui, comme eux, étaient
livrés à la tristesse et aux larmes, mais ils ne la crurent point; il apparut
ensuite aux deux disciples d'Emmaüs, dont le narré ne fut pas cru davantage,
et, d'après saint Luc et saint Jean, se fit à Jérusalem, le jour de la
résurrection, quand la nuit commençait à étendre son voile. Saint Marc nous
raconte ensuite cette dernière apparition aux onze qui étaient à table et
après laquelle Jésus monta au ciel; or nous savons que ceci se passa sur le
mont des Oliviers, non loin de Jérusalem. Il suit de là que saint Marc ne nous
montre nulle part l'accomplissement de la parole de l'Ange.
Quant à saint Matthieu, il ne
mentionne d'autre apparition du Sauveur à ses disciples que celle qui eut lieu
en Galilée selon la prédiction de l'Ange. Aussi, après avoir rappelé ce qui
fut dit par l'Ange aux femmes, et après avoir rapporté comment, après leur
départ, les soldats furent corrompus à prix d'argent et excités à l'imposture;
aussitôt, et comme si aucun événement n'était intervenu ( de fait il avait été
dit sans interruption: « Il est ressuscité, voilà qu'il vous précède en
Galilée c'est là que vous le verrez) » l'Évangéliste continue: « Cependant les
onze s'en allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée.
Et le voyant, ils l'adorèrent; quelques-uns néanmoins doutèrent r encore. Et
Jésus s'approchant d'eux, leur parla ainsi: Toute puissance m'a été donnée
dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez tous les peuples, les
baptisant au nom du Père, « et du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant
à observer tout ce que je vous ai ordonné; et voici que je suis tous les jours
avec r vous jusqu'à la consommation des siècles. » C'est ainsi que saint
Matthieu termine son Evangile.
80. Après cela, si les autres
Evangiles n'étaient pas là pour nous inviter à un examen plus attentif, nous
conclurions facilement que depuis sa résurrection le Seigneur n'apparut à ses
disciples que dans le pays de Galilée. Bien plus, si saint Marc avait gardé le
silence sur la prophétie de l'ange, on serait tenté de conclure, que si saint
Matthieu nous représente les disciples se retirant sur une montagne de la
Galilée et y adorant le Seigneur, c'est pour montrer l'accomplissement de
l'ordre qui d'après lui avait (244) été donné par l'ange. Mais voici que saint
Luc et saint Jean nous affirment clairement que le jour même de la
résurrection le Seigneur apparut à ses disciples, dans la ville même de
Jérusalem : or à la distance qui sépare la Galilée de Jérusalem, comment
admettre que les disciples le virent, le même jour, dans chacun des deux pays
? Enfin saint Marc, qui cependant rapporte la prédiction de l'Ange, ne nous
parle d'aucune apparition en Galilée. Tout cela dès lors nous impose la
nécessité d'examiner le sens de ces paroles : « Voici qu'il vous précède en
Galilée, et là vous le verrez.»
Si saint Matthieu ne nous
disait pas que les onze disciples se retirèrent sur une montagne en Galilée,
que le Sauveur leur apparut et qu'ils l'adorèrent, nous jugerions que la
prophétie ne reçut aucun accomplissement littéral et dès lors qu'elle doit
être interprétée dans un sens figuré. Nous raisonnerions sur cette prophétie
comme sur celle-ci, rapportée pas saint Luc: « Voici qu'aujourd'hui et demain
je chasse les démons et rends la santé, et le troisième jour je suis consommé;
» ce qui ne s'est pas accompli à la lettre (1). De même, si l'Ange avait dit:
Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez d'abord; ou bien: Là
seulement vous le verrez, ou erre: Vous ne le verrez que là; saint Matthieu
serait évidemment en contradiction avec les autres Évangélistes. Mais il dit,
sans aucune espèce d'exclusion: « Voilà qu'il vous précède en Galilée, là vous
le verrez; » il ne précise pas le temps où cette prophétie doit s'accomplir,
si ce sera immédiatement et avant que Jésus leur apparaisse ailleurs; ou bien
si ce sera après qu'ils l'auront déjà vu en dehors de la Galilée. Enfin, en
racontant que les disciples sont allés sur une montagne en Galilée, saint
Matthieu n'indique pas le jour où ce voyage s'est accompli, et il n'y a rien
dans sa narration qui force à croire que ce fut là le premier acte et la
première démarche après la résurrection. De là je conclus que la narration de
saint Matthieu n'est point en contradiction réelle avec celle des autres
Évangélistes, et donne toute faculté pour les interpréter et les expliquer.
Cependant s'il n'est pas dit explicitement en quel endroit le Seigneur doit
d'abord apparaître en Galilée, comme l'ange l'avait annoncé positivement : «
Voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez; »Jésus avait dit
lui-même: « Allez, dites à mes frères qu'il saillent en Galilée, là ils me
verront. » Il
est naturel, après cela, pour peu qu'on y réfléchisse, de
se demander quel mystère est renfermé dans ces paroles.
81. Mais voyons d'abord quand
le Sauveur a pu se montrer corporellement en Galilée, d'après ces paroles de
saint Matthieu: « Or onze disciples se retirèrent en Galilée sur la montagne
que Jésus leur avait déterminée; en le voyant ils l'adorèrent ; quelques uns
cependant doutèrent encore. » Il est d'abord certain que ceci n'eut pas lieu
le jour même de la résurrection, car saint Luc et saint Marc nous disent d'une
manière formelle, que le jour de la résurrection, à la nuit tombante, Jésus
apparut à set disciples dans la ville même de Jérusalem. Saint Marc n'est pas
aussi explicite. Quand donc le Seigneur apparut-il en Galilée ? Il ne peut
être question ici de l'apparition qui eut lieu auprès de la mer de Tibériade
et que nous rapporte saint Jean ; car les apôtres n'étaient alors qu'au nombre
de sept et se livraient à la pêche; tandis que dans l'apparition dont il nous
parle, saint Matthieu déclare qu'ils étaient onze sur la montagne, où Jésus
les avait précédés, selon la prédiction de l'Ange. En effet, la narration fait
supposer qu'ils y trouvèrent Jésus et qu'il les y avait précédés, comme on en
était convenu par avance. Cette apparition n'eut donc pas lieu le jour même de
la résurrection ; elle ne se fit pas davantage dans les huit jours qui
suivirent, car saint Jean nous raconte que, le huitième jour, le Seigneur
apparut à ses disciples, et qu'il rencontra pour la première fois saint Thomas
qui ne l'avait pas vu le jour de sa résurrection. Or, si cette apparition eut
lieu pendant les huit jours qui suivirent la résurrection, comment expliquer
que saint Thomas qui était un des onze ne l'avait pas vu ? A moins qu'on ne
réponde que onze personnes se trouvaient en effet sur 1a montagne, mais que ce
nombre était formé d'apôtres et de disciples. Il n'y avait que onze apôtres,
mais les apôtres n'étaient pas les seuls disciples de Jésus. Si donc il y
avait des Apôtres et des disciples pour former ce nombre onze, il est possible
que saint Thomas eût encore été absent et que ce fut seulement le huitième
jour qu'il vit Jésus pour la première fois. D'ailleurs quand saint Marc parle
des onze apôtres il particularise: les onze. » Saint Luc dit de même :
«Ils rentrèrent à Jérusalem et y trouvèrent les onze assemblés et ceux qui
étaient avec eux. » C'est dire clairement que par ces onze il entend parler
des apôtres, à qui, (245) dans sa narration il donne la place d'honneur, en
les distinguant des autres. Jusque-là on pourrait donc admettre que parmi les
onze, dont parle saint Matthieu, d'une manière générale, il y avait à la fois
des apôtres et des disciples.
82. Mais voici une autre
difficulté contre cette interprétation. Quand saint Jean nous raconte
l'apparition de Jésus à sept disciples, auprès de la mer de Tibériade, il
ajoute : « Et ce fut là la troisième manifestation de Jésus à ses disciples, «
après sa résurrection. » Si donc on veut que l'apparition de Jésus aux onze
disciples, racontée par saint Matthieu, ait eu lieu dans les huit jours qui
suivirent la résurrection, et avant que saint Thomas eut vu le Sauveur,
celle-ci n'est plus la troisième mais la quatrième. Une observation,
toutefois: Quand saint Jean ajoute : « Ce fut la troisième fois que Jésus
apparut à ses disciples, » il ne dit pas qu'il ne leur apparut que trois fois,
il indique seulement l'ordre et les jours où se firent ces apparitions; il ne
dit pas, non plus, qu'elles,se firent successivement, d'un jour à l'autre,
mais par intervalle. En effet le jour même de la résurrection, Jésus apparut
trois fois, sans compter les apparitions aux saintes femmes; une première
fois, à Pierre, une seconde aux deux disciples d'Emmaüs, et une troisième, au
commencement de la nuit, aux apôtres et aux disciples réunis. Or, toutes ces
manifestations ne sont comptées, par saint Jean, que comme une seule, parce
qu'elles se firent dans un seul et même jour. La seconde fat celle à laquelle
assistait saint Thomas et où il vit le Seigneur pour la première fois ; la
troisième eut lieu auprès de la merde Tibériade. C'est donc ici le troisième
jour de manifestation ou la troisième manifestation ; et ce n'est que plus
tard, sur la montagne de Galilée, qu'eut lieu l'apparition dont parle saint
Matthieu, apparition où se trouvèrent onze disciples que le Sauveur avait
devancés sur la montagne, pour accomplir même à la lettre ce qu'il avait
prédit par lui-même ou par l'ange.
83. Si donc nous résumons
toutes les apparitions consignées dans les Evangiles, nous les trouvons au
nombre de dix. La première auprès du tombeau, aux saintes femmes (1) ; la
seconde, à ces mêmes femmes, au moment où elles revenaient du sépulcre (2) ;
la troisième, à saint Pierre (3) ; la quatrième, aux deux disciples d'Emmaüs
(4) ; la cinquième, aux Apôtres et
aux disciples, pendant l'absence de saint Thomas (1) ; la
sixième,'quand saint Thomas vit Jésus, pour la première fois (2); la septième,
auprès de la mer de Tibériade (3) ; la huitième, d'après saint Matthieu, sur
la montagne de Galilée (4) ; la neuvième, dont nous parle saint Marc, au
moment où les apôtres étaient à table , car ils ne devaient plus manger avec
Jésus sur la terre (5) ; la dixième eut lieu le même jour, au moment où Jésus
quitta la terre pour monter au ciel. Cette dernière apparition nous est
rapportée par saint Marc et par saint Luc. Saint Marc, après avoir raconté
l'apparition de Jésus aux apôtres qui étaient à table, ajoute immédiatement: «
Et après que le Seigneur eut parlé, il monta au ciel (6). » Saint Luc, après
avoir gardé le silence sur tout ce qui s'accomplit pendant les quarante jours
qui suivirent la résurrection, passe immédiatement, sans, en avertir, de la
résurrection, au jour de l'ascension; voici ses paroles : « Il les conduisit
hors de Béthanie, et levant ses mains, il les bénit, et pendant qu'il les
bénissait, il s'éloigna d'eux et était porté vers le ciel (7). » Les disciples
le virent donc encore, après qu'il eut quitté la terre, et pendant qu'il
s'élevait vers le ciel. Ainsi les Livres saints nous apprennent que Jésus se
fit voir à ses disciples neuf fois sur la terre, depuis sa résurrection, et
une dixième fois, au moment où il montait au ciel.
84. Mais, comme le dit saint
Jean (8), tout n'a pas été écrit. En effet, pendant ces quarante jours, avant
de monter au ciel, Jésus s'entretenait fréquemment avec ses apôtres (9), sans
cependant que nous prétendions qu'il leur eut apparu chaque jour. Ainsi,
depuis le; jour même de la résurrection, huit jours se passèrent sans aucune
apparition de sa part. Le huitième jour, il leur apparut de nouveau et
peut-être que ce fut dès le lendemain qu'il se montra à eux sur les bords de
la mer de Tibériade. Depuis, il leur apparut sur la montagne de Galilée, où il
leur avait annoncé qu'il les précéderait, et pendant le reste du temps il
apparut aussi, souvent, à qui et comme il voulut. Saint Pierre disait
effectivement à Corneille et à ceux qui l'accompagnaient : « Nous avons mangé
et bu avec lui pendant quarante jours, après qu'il fut ressuscité d'entre les
morts (10).» Saint Pierre ne dit pas qu'ils ont mangé et bu avec lui chaque
jour, depuis la résurrection ;
246
rection ;car il serait en contradiction avec saint Jean,
qui ne suppose aucune apparition pendant les huit jours qui suivirent la
résurrection. A partir de l'apparition aux bords du lac de Tibériade, rien
n'empêche d'admettre qu'il se montra à eux, et mangea avec eux chaque jour.
L'expression: « Pendant quarante jours, » peut donc être ici comme une formule
mystérieuse, figurant par les deux termes
qui la composent, quatre et dix, le monde tout entier ou la durée
temporelle du siècle, et dans la première dizaine qui contient les huit
premières jours de la résurrection, on peut prendre facilement la partie pour
le tout, selon le langage de l'Écriture.
85. On peut maintenant
rapprocher de ces textes, celui de saint Paul, pour voir s'il s'y rencontre
quelque difficulté. « Jésus-Christ, dit-il, est ressuscité le troisième jour,
conformément à l'Écriture et il a
apparu à Pierre. » Saint Paul ne dit pas : il a apparu d'abord à Pierre, car
il serait en opposition avec l'Évangile, qui déclare que Jésus est d'abord
apparu aux saintes femmes. « Il apparut ensuite à douze, dit encore saint
Paul. » Quels étaient ces douze; à quelle heure ? L'Apôtre ne le dit pas, il
affirme seulement que ce fut le jour même de la résurrection. « Ensuite à plus
de cinq cents frères en même temps;» étaient-ils réunis avec les onze, les
portes fermées, par crainte des Juifs, quand Jésus se présenta après le départ
de saint Thomas ? Est-ce après les huit jours qui suivirent la résurrection ?
Toutes ces suppositions sont admissibles. « Ensuite à
Jacques; » ici nous ne. devons pas supposer que Jésus apparut d'abord à
cet apôtre ; mais seulement qu'il jouit d'une manifestation particulière. «
Ensuite encore à tous les apôtres; » cette apparition n'eut lieu non plus que
dans la suite, quand Jésus voulut converser jusqu'à l'Ascension plus
familièrement avec eux. « Enfin il m'a apparu à moi-même, qui ne suis entre
tous que comme un avorton (1). » Mais cette apparition se fit du haut du ciel,
longtemps après l'ascension.
86. Nous avons dit enfin qu'il
y avait un mystère caché dans ces paroles rapportées par saint Matthieu et par
saint Marc : « Je vous précèderai en Galilée, et là vous me verrez (2). »
C'est ce mystère qu'il nous reste à étudier. Cet ordre du Sauveur a été
accompli, mais il ne l'a pas été immédiatement; beaucoup de choses se sont
passées auparavant, : et néanmoins, sans toutefois
imposer de nécessité, ces apparitions en Galilée étaient annoncées, comme
devant avoir lieu seules ou du moins avant toute autre. Cependant comme ces
paroles ne viennent pas de l'Évangéliste lui-même, mais de l'Ange, qui en cela
ne faisait qu'accomplir t'ordre du Seigneur; et comme le Seigneur en personne
les a redites peu de temps après, nous devons y voir un sens mystérieux et
prophétique.
Le mot Galilée signifie
transmigration ou révélation. Prenons d'abord ce mot dans le sens de
transmigration et cherchons-en l'explication. «Il vous précède en Galilée, là
vous le verrez: » n'est-ce pas annoncer que la grâce de Jésus-Christ quittera
le peuple d'Israël pour passer ou émigrer chez les Gentils ? La prédiction de
l'Évangile faite par les Apôtres eût-elle été reçue parles païens, si le
Seigneur ne lui avait préparé la voie dans le coeur des hommes ? Et c'est là
ce que signifient ces mots : «Il vous précède en Galilée. » La joie
qu'éprouvèrent les Apôtres, en voyant que les obstacles de toute sorte se
levaient si aisément et qu'ils trouvaient eux-mêmes une entrée si facile pour
éclairer les intelligences, cette joie est prédite par ces mots: « Là vous le
verrez, » c'est-à-dire, là vous trouverez ses membres, là vous reconnaîtrez
son corps vivant dans la personne de ceux qui vous recevront.
Si maintenant nous
interprétons le mot Galilée dans le sens de révélation,; if ne s'agit plus
d'une manifestation faite sous la forme d'un esclave, mais dans la gloire d'un
Fils, en tout semblable à son Père (1); manifestation promise, en saint Jean,
à ceux qui sont ses amis: « Et je l'aimerai, dit-il, et je me manifesterai à
lui (2). » Il ne s'agit donc plus seulement de le voir, après sa résurrection,
portant la cicatrice de ses blessures, ni de le toucher; mais on le verra dans
cette lumière ineffable dont il illumine tout homme venant en ce monde, et
dont il brille dans les ténèbres, mais dans les ténèbres qui ne le comprennent
point (3). C'est là qu'il nous précède, quoi qu'en venant à nous il n'en soit
point sorti, comme en nous précédant il ne nous abandonne pas. Cette
révélation, véritable Galilée, s'opérera quand nous lui serons semblables et
que nous le verrons comme il est en. lui-même (4). Ce sera aussi notre
transmigration de ce monde à l'éternité ; elle sera heureuse si nous nous
dévouons à
247
l'accomplisse ment. de ses préceptes jusqu'à mériter
d'être rangés à sa droite à l'heure du jugement. Alors en effet ceux qui
seront à la gauche seront précipités dans les flammes éternelles, tandis que,
les justes entreront dans l'éternelle vie (1). Là ceux-ci le verront, comme ne
le voient pas les impies; car l'impie disparaîtra pour ne point voir la clarté
du Seigneur (2) ; ces impies n'en
verront pas même le reflet. « Or, est-il, dit voici la
vie éternelle, vous connaître, vous, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que
vous avez envoyé (1) ; » vous connaître et le connaître comme on connaîtra
dans cette éternité, où sous la forme d'esclave il conduira les esclaves, afin
que, devenus libres, ils contemplent en lui sa nature de Seigneur.
1. Nous avons étudié d'une
manière très détaillée le texte de saint Matthieu en lui comparant jusqu'à la
fin les passages correspondants des autres évangélistes; et jamais nous
n'avons rencontré la plus légère contradiction. Nous allons maintenant faire
du texte de saint Marc une étude spéciale; nous passerons sous silence tous
les passages que nous avons examinés au sujet de saint Matthieu et nous
montrerons que les:autres n'impliquent aucune contradiction dans les récits
évangéliques jusqu'à la cène du Seigneur. Tout ce qui suit la cène jusqu'à la
fin, nous l'avons examiné et nous avons trouvé une concordance parfaite entre
les quatre évangélistes.
2. Saint Marc débute ainsi: «
Commencement de l'Evangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu comme il est écrit
dans le prophète Isaïe, » etc, jusqu'à ces mots: « Et il vinrent à Capharnaüm
et, le jour du sabbat, entrant aussitôt dans la synagogue, il les enseignait
(1). » Tout ce qui précède l'arrivée de Jésus à Capharnaüm a été comparé au
texte de saint Matthieu ; quant à cette entrée à Capharnaüm et à
l'enseignement que Jésus y donnait, dans la synagogue, le jour du sabbat,
saint Marc est ici d'accord avec saint Luc (2) ; et on ne peut y trouver place
à aucune difficulté.
3. Saint Marc continue: « Et
ils s'étonnaient de sa doctrine, et en effet il les instruisait comme ayant
autorité et non comme les scribes. Or, il se trouva dans leur synagogue un
homme possédé d'un esprit impur, qui s'écria : Qu'y a-t-il entre vous et nous,
Jésus de Nazareth ? êtes-vous venu pour nous perdre, » etc, jusqu'à l'endroit
où il est dit : « Il prêchait donc dans leurs synagogues et par toute la
Galilée, et chassait les démons (1). » Il y a dans ce passage certains détails
que nous ne trouvons que dans saint Marc et saint Luc ; cependant nous les
avons déjà traités, en examinant l'Evangile de saint Matthieu ; car ils se
présentaient d'une manière si naturelle, que je n'ai pas cru devoir les
laisser de côté. Cependant, en parlant de cet esprit immonde, saint Luc dit
qu'il sortit du possédé, sans lui faire aucun mal ; tandis que saint Marc
affirme que « l'esprit impur ne sortit de lui qu'en le tourmentant
horriblement et en jetant un grand cri. » Comment ne pas voir ici une
contradiction: l'un nous disant que l'esprit tourmentait horriblement sa
victime, et l'autre, qu'il ne lui fit aucun mal? Mais observons bien le texte
de saint Luc: « Et quand le démon eut jeté cet homme au milieu de l'assemblée,
il sortit de lui sans lui faire aucun mal. » Ces mots de saint Marc: « Il le
tourmenta horriblement, » ne sont-ils pas le pendant de ceux-ci de saint Luc:
« Il le précipita au milieu de l'assemblée, « et malgré cela le possédé n'en
éprouva aucun
248
mal? » c'est-à-dire que malgré cette chute et ces
tourments, ses membres ne furent nullement brisés, il n'en ressentit aucune
prostration, tandis que les démons en sortant d'un possédé lui laissent
souvent les membres meurtris.
4. Saint Marc continue: « Il
vit venir à lui un lépreux, qui le suppliait, et, se jetant à genoux, lui
disait. Si vous le voulez, vous pouvez me guérir, » etc, jusqu'à ces mots: «
Et ils s'écriaient : Vous êtes le Fils de Dieu, mais jésus leur défendait,
avec menace, de dire qui il était (1). » Cette dernière phrase est reproduite
à peu près textuellement par saint Luc, et sans aucune apparence de
contradiction (2). Saint Marc ajoute Et gravissant la montagne il appela à lui
ceux qu'il voulut; et ils vinrent à lui, et il les réunit au nombre de douze
pour les envoyer prêcher; « il leur donna aussi le pouvoir de guérir les
maladies et de chasser les démons. Et il donna à Simon le nom de Pierre, » etc,
jusqu'à ces mots: « Et il commença à proclamer hautement dans la Décapole ce
que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'admiration (3). » En
suivant la narration de saint Matthieu, je me suis expliqué au sujet des noms
des Apôtres (4). Qu'il me suffise de le rappeler ici: ce serait un terreur de
croire que c'est seulement à partir de ce jour que Simon porta le nom de
Pierre; ce serait contredire formellement ce passage de saint Jean Tu seras
appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre (5); » où sont citées les expressions même
du Seigneur. Saint Marc ne fait donc qu'une simple récapitulation quand il dit
: « Et Jésus donna à Simon le nom de Pierre. » En effet il se proposait
d'énumérer le nom de tous les apôtres, et par là même celui de Pierre; alors
il insinue brièvement que ce nom n'est pas celui qu'il portait précédemment,
et qu'il lui fut imposé par le Seigneur, non pas à ce moment même, mais dans
la circonstance que rapporte saint Jean. Le reste ne présente aucune
contradiction et nous en avons déjà parlé précédemment.
5. Nous lisons dans saint Marc
: « Jésus étant repassé dans la barque à l'autre bord, comme il était auprès
de lamer, une grande multitude de peuple s'assembla autour de lui, » etc,
jusqu'à ces mots : « Et les apôtres se réunirent à Jésus, et lui racontèrent
ce qu'ils avaient fait et enseigné (1). » Ce dernier trait est aussi reproduit
par saint Luc sans aucune discordance (2) ; ce qui précède a été expliqué
précédemment. Saint Marc continue : « Et Jésus leur dit: Venez dans un lieu
écarté et reposez-vous un peu, » etc, jusqu'à ces mots : « Or, plus il le leur
défendait, plus ils le proclamaient hautement, et leur admiration redoublant,
ils disaient : Il a bien fait toutes choses, il a fait entendre les sourds et
parler les muets (3). » Saint Luc et saint Marc sont encore en ce point
parfaitement d'accord, et tout ce qui précède a déjà été expliqué et confronté
avec l'Evangile de saint Matthieu. Mais gardons-nous de voir dans les
dernières paroles de saint Marc, la négation d'une vérité qui résulte de
toutes les actions et des paroles du Sauveur, vérité proclamée par l'Evangile,
à savoir que Jésus-Christ lisait, au fond des coeurs, les pensées et les
volontés des hommes. En Voici un témoignage explicite rendu par saint Jean:
«En Jésus ne se confiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce
qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage sur qui que ce fût, car
il savait ce qui est dans l'homme (4). » Et comment s'étonner qu'il eût connu
les dispositions présentes des hommes, quand nous l'entendons prédire à saint
Pierre une volonté qu'il n'avait assurément pas au moment même, celle de le
renier, alors que Pierre attestait qu'il était prêt à mourir pour lui ou avec
lui (5) ? Or, n'est-ce pas nier cette connaissance et cette prescience, que de
dire avec saint Marc : « Il leur défendit de le révéler; mais plus il le leur
défendait, plus ils le proclamaient hautement? » Puisqu'il savait; lui qui
connaît toutes les pensées présentes et futures des hommes, que plus il leur
défendrait d'en parler, plus ils en parleraient, pourquoi donc le leur
défendait-il? Il voulait sans doute montrer aux tièdes, à qui il prescrit de
prêcher son nom, avec quel zèle et quelle ferveur ils doivent le prêcher,
puisque ceux à qui il le défendait, ne pouvaient garder le silence.
249
6. Saint Marc continue : «
Dans ces jours, comme de nouveau la foule était très-nombreuse et qu'ils
n'avaient rien à manger, » etc, jusqu'à ces mots: « Jean lui répondit: Maître,
nous avons trouvé quelqu'un qui chassait les démons en votre nom, il ne vous
suit pas avec nous, et nous l'en avons empêché. Jésus répondit : Ne l'empêchez
pas, car personne ne peut opérer des prodiges, en mon nom, et parler sitôt mal
de moi; celui en effet qui n'est pas contre vous est pour vous (1). » Saint
Luc raconte le même fait, mais il ne dit pas: « Personne ne peut opérer de
prodige en mon nom et aussitôt parler mal de moi. » Ce silence ne saurait être
regardé comme une contradiction. Mais en est-il de môme par rapport à cette
maxime du Seigneur lui-même: « Qui n'est pas avec moi, est contre moi; et qui
ne recueille pas avec moi, dissipe (2) ? Si celui-là est contre lui, qui n'est
pas avec lui, comment ne pas regarder comme étant contre lui, cet homme qui
n'était pas avec lui, et dont saint Jean nous dit qu'il ne le suivait pas ?
D'un autre côté, s'il était contre lui, comment le Sauveur dit-il à ses
disciples: « Ne l'empêchez pas, car celui qui n'est pas contre vous, est pour
vous? » Comment ne pas voir une différence entre ces paroles: « Qui n'est pas
contre vous est pour vous, » et ces autres, qu'il s'applique à lui-même: « Qui
n'est pas avec moi est contre moi? » Celui qui est associé à ses disciples,
comme étant ses membres, peut-il ne pas être avec lui ? autrement où serait la
vérité de ces paroles: « Qui vous reçoit me reçoit (3); ce que vous faites au
plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites (4)? » Ou bien celui
qui est contre ses disciples peut-il ne pas être contre lui ? N'est-il pas
dit: «Qui vous méprise me méprise (5); quand vous ne l'avez pas fait au plus
petit de mes frères, c'est à moi que vous avez refusé de le faire (6); Saul,
Saul, pourquoi me
persécutes-tu (7);» quand ce n'était que ses disciples qu'il
persécutait? Ce que le Sauveur a voulu exprimer, c'est qu'on ne peut-être avec
lui, en tant que l'on est contre lui, et qu'en tant qu'on n'est pas contre
lui, on est avec lui. Prenons pour exemple celui qui opérait des prodiges au
nom de Jésus-
Christ et cependant ne faisait pas partie de la société
de ses disciples ; en tant qu'il opérait des prodiges 'en son nom, il était
avec eux, et n'était pas contre eux; mais en tant qu'il ne faisait pas partie
de leur société, il n'était pas avec eux, il était contre eux. Voici donc que
les apôtres lui interdisent ce qui seul le mettait avec eux, aussitôt
Jésus-Christ de leur dire: « Ne l'empêchez pas. » Ils devaient empêcher ce qui
en lui l'excluait de leur société, afin de l'amener à entrer dans l'unité de
l'Église ;mais ils ne devaient pas empêcher ce qui le rapprochait d'eux,
c'est-à-dire, de chasser les démons, au nom de leur Maître et Seigneur. Ainsi
l'Église ne désapprouve pas, dans les hérétiques, les sacrements qui leur sont
communs avec nous, car en cela ils sont avec nous et non pas contre nous; mais
elle improuve et défend la division jet la séparation ainsi que toute maxime
contraire à la paix et à la vérité, car en cela ils sont contre nous, ils ne
recueillent pas avec nous et par conséquent ils dissipent.
7. Saint Marc ajoute: « Car
quiconque vous donnera un verre d'eau, en mon nom, parce que vous appartenez
au Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si
quelqu'un:est un sujet de scandale à l'un de ces petits, qui croient en moi,
il vaudrait mieux, pour lui, qu'on lui attachât une meule de moulin au cou, et
qu'on le jetât dans la mer. Et si votre main vous est un sujet de scandale,
coupez-la; mieux vaut pour vous entrer dans la vie, n'ayant qu'une main, que
d'en avoir deux et d'aller en enfer, dans ce feu inextinguible, où le ver ne
meurt pas et où le feu ne s'éteint pas, » etc, jusqu'à ces mots: « Ayez du sel
en vous, et conservez la paix entre vous (1). » Ces paroles, dans l'Évangile
de saint Marc, suivent immédiatement l'histoire de celui qui chassait les
démons, sans être à la suite de Jésus, et que Jésus ordonne de laisser faire.
Certaines pensées ne se trouvent dans aucun autre Évangéliste certaines autres
se rencontrent en saint Matthieu et en saint Marc; mais ces Évangélistes les
rapportent dans des circonstances différentes,
250
dans un autre ordre, dans d'autres occasions; et non à
propos de celui qui n'était pas à la suite du Sauveur et chassait les démons
en son nom. Quant à moi, je crois, sur l'autorité de saint Marc, que
Jésus-Christ a réellement répété ici des vérités déjà exprimées ailleurs; car
elles s'appropriaient parfaitement à la défense adressée à ses disciples
d'empêcher de faire des prodiges en son nom, quand on ne comptait pas parmi
eux. Voici en effet l’enchaînement de ces paroles: «Qui n'est pas contre vous,
est pour vous; car quiconque R vous donnera un verre d'eau en mon nom, parce
que vous appartenez au Christ, je vous le dis r en vérité, il ne perdra pas sa
récompense. r On doit tirer cette conclusion, déjà suggérée par saint Jean,
que celui qui a fourni le sujet de cet entretien n'était pas tellement éloigné
de la société des disciples, qu'il l'eût réprouvée comme l'aurait fait un
hérétique ; il ressemblait à ces hommes qui n'osent recevoir les sacrements de
Jésus-Christ et sont cependant remplis de respect pour le nom chrétien ;;qui
reçoivent les chrétiens, et leur rendent des services précisément parce qu'ils
sont chrétiens; et de qui le Sauveur a dit qu'ils ne perdent pas leur
récompense. Non pas qu'ils doivent se croire en parfaite sûreté à cause de la
bienveillance dont ils entourent les chrétiens, tout en refusant de se
purifier dans le baptême de Jésus-Christ et de s'incorporer à (unité de son
Eglise ; seulement la miséricorde de Dieu les gouverne, elle les amène à ces
moyens de salut et ils sortiront en paix de ce monde. Avant même de faire
partie de la société chrétienne, ces hommes sont plus utiles que ceux qui,
déjà baptisés et initiés aux sacrements chrétiens, prodiguent les mauvais
conseils jusqu'à entraîner avec eux dans les flammes éternelles, ceux à qui
ils persuadent le mal. Sous la figure des membres corporels, de la main à
couper ou de l'œil à arracher, Jésus-Christ les désigne comme devant être
retranchés de la société chrétienne, afin que l'on entre dans la vie après
s'être séparés d'eux plutôt que d'être précipités avec eux en enfer. Or, pour
se séparer d'eux, il suffit, comme il est nécessaire, de n'écouter pas et de
ne pas suivre leurs conseils scandalisateurs. De plus, si le scandale dont ils
sont le principe est connu de toute la société chrétienne , ils doivent en
être impitoyablement retranchés, et privés de toute participation aux
sacrements. Si le scandale n'est connu que d'un petit nombre, et que la
majorité ignore leur perversité, on doit les tolérer, comme avant de vanner le
grain on tolère la paille dans faire; pourvu toutefois qu'on ne participe
point à leur iniquité en y consentant et qu'à cause d'eux on ne se sépare
point de la société des bons. Telle est la conduite que tiennent ceux qui ont
le sel en eux-mêmes et qui conservent la paix entre eux.
8. Saint Marc continue : «
Jésus étant parti de ce lieu vint sur les confins de la Judée, au delà du
Jourdain ; le peuple s'assembla encore autour de lui, et il se mit de nouveau
à les instruire selon sa coutume, A etc, jusqu'à ces mots . « Car tous n'ont
fait que donner de leur abondance ; tandis que cette femme a pris sur sa
pauvreté et donné toute sa subsistance (1). » Tout ce récita déjà été examiné
quand nous l'avons rapproché de celui de saint Matthieu, et nous avons reconnu
qu'il était en parfait accord avec celui de tous les autres évangélistes.
Quant à l'histoire de cette pauvre veuve, qui jette dans le trésor du temple
ses deux petites pièces de monnaie, elle ne nous est rapportée que par saint
Marc et saint Luc (2), et sans aucune apparence de contradiction. Depuis ce
passage jusqu'à celui où est racontée la cène du Seigneur, et à partir duquel
nous avons examiné successivement tous les textes, on peut comparer l’Evangile
de saint Marc à n'importe quel autre, on y trouvera l'harmonie la plus
parfaite.
9. Occupons-nous maintenant de
l’Evangile de saint Luc, du moins quant aux passages qui ne lui sont pas
communs avec saint Matthieu et saint Marc; car les autres ont déjà été étudiés
précédemment. Saint Luc commence ainsi son récit : « Plusieurs ont déjà
entrepris d'écrire l'histoire des événements qui ont été accomplis parmi nous,
suivant le rapport que nous r en ont fait ceux qui, dès le commencement, « les
ont vus de leurs propres yeux, et qui ont été les ministres de la parole. J'ai
donc cru à mon tour, très-excellent Théophile, qu'après avoir été exactement
informé de toutes ces choses depuis le commencement, je devais
251
en représenter par écrit toute la suite, afin que tu
reconnaisses la vérité de ce qui a été annoncé (1). » Ce début ne fait pas, à
`proprement parler, partie de l'Evangile. Cependant il suffit pour nous faire
conclure que c'est ce même saint Luc qui a écrit un autre livre sacré, les
Actes des Apôtres. Cette conclusion toutefois ne découle pas uniquement de ce
que nous y trouvons écrit le même nom de Théophile ; car il aurait pu se faire
qu'il y eût un autre Théophile, ou que s'il est le même dans les deux
ouvrages : il les eût reçus de deux auteurs différents ; la principale raison
vient du début même du livre des Actes: « J'ai écrit, ô Théophile, ce que
Jésus a fait et enseigné jusqu'au jour où il ordonna aux Apôtres qu'il avait
choisis par le Saint-Esprit, de prêcher l'Evangile (2). » Ces paroles
prouvent évidemment que saint Luc avait déjà écrit un des quatre Evangiles
dont l'autorité est si haute aux yeux de l'Eglise. Si cet auteur dit ensuite
qu'il a parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné jusqu'à ce jour où il a
chargé les Apôtres de prêcher l'Evangile, assurément il ne veut pas nous faire
croire qu'il a rapporté absolument toutes les actions et toutes les paroles du
Sauveur, car ce serait démentir saint Jean. Celui-ci affirme, en effet, que si
tout ce qu'a fait et dit le Seigneur était écrit dans des livres ces livres
rempliraient le monde tout entier (3). D'ailleurs nous trouvons dans les autres évangélistes des détails que saint Luc a passés sous silence.
Il a donc parlé de tout, c'est-à-dire qu'il a choisi dans toutes ces actions
et toutes ces paroles ce qui lui a paru convenable et suffisant pour remplir
le ministère qui lui était confié. Il ajoute que «plusieurs ont entrepris
d'écrire l'histoire des événements qui se sont accomplis parmi nous; » par là,
il fait allusion à ceux qui ayant commencé ce travail, n'ont pu le mener à
terme; il dit encore : « J'ai cru à mon tour écrire avec soin, parce, que
plusieurs ont essayé; etc, » ces derniers sont ceux qui ne jouissent dans l'Eglise
d'aucune autorité, parce qu'ils n'ont pu atteindre le but qu'ils avaient en
vue. D'un autre côté saint Luc ne s'est pas contenté de conduire sa narration
jusqu'à la résurrection et l'ascension du Sauveur, ce qui pourtant lui aurait.
déjà mérité de prendre place parmi les Evangélistes ; il a encore raconté les
Actes des Apôtres, ou au moins parmi ces actes, ce qu'il a cru devoir suffire
pour affermir la foi des lecteurs
ou des auditeurs ; et maintenant son travail est le seul
qui fasse autorité dans l'Eglise en ce qui concerne les Actes des Apôtres; on
a rejeté comme ne méritant aucune confiance tous les autres récits que l'on a
osé entreprendre sur le même sujet. Enfin quand saint Marc et saint Luc ont
écrit, leurs travaux. ont pu être contrôlés, non-seulement par l'Eglise de
Jésus Christ, mais aussi par les Apôtres, puisque c'est de leur vivants que
ces deux évangélistes ont composé leur récits.
10. Saint Luc commence ainsi
son Evangile Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre nommé
Zacharie, de la famille d'Abia, « et sa femme était aussi de la race d'Aaron
et s'appelait Elisabeth » etc, jusqu'à ces mots : « Dès qu'il eut cessé de
parler, Jésus dit à Simon Prends la pleine mer et jette tes filets pour la
pêche (1). » Dans toute cette suite de chapitres, on ne trouve matière à
aucune contradiction. Saint Jean rapporte un fait semblable, mais ce n'est pas
le même puisqu'il s'est accompli sur la mer de Tibériade, après la
résurrection du Sauveur (2). Le temps est tout autre elles circonstances
elles-mêmes sont toutes différentes. Dans le fait rapporté par saint Jean,
nous voyons que les filets furent jetés à droite et enveloppèrent
cent-cinquante trois grands poissons; l'évangéliste insiste sur leur grandeur
et fait remarquer que les filets ne se rompirent pas, car ils s'étaient rompus
dans la pêche dont parle saint Luc. Quant au reste, l'histoire de saint Luc ne
rapporte pas ce que rapporte celle de saint Jean, excepté lorsqu'il s'agit de
la passion et de la résurrection du Sauveur. Mais nous avons déjà traité de
tout ce qui suit la cène jusqu'à la fin, et après
avoir rapproché tous les textes, nous avons reconnu que nulle part on
ne peut surprendre de contradiction.
11. Il ne nous reste plus à
examiner que l'Evangile de saint Jean que nous ne pouvons désormais rapprocher
d'aucun autre. Comment trouver
252
quelque contradiction dans un passage qui n'est rapporté
que par un seul évangéliste et sur lequel les autres gardent le silence ? Or
il est certain que saint Matthieu, saint Marc et saint Luc ont surtout
envisagé dans la personne de Notre-Seigneur Jésus-Christ son humanité sainte.
Comme homme en effet le Christ est en même temps roi et prêtre. Aussi saint
Marc, qui dans le mystère des quatre animaux, semble figuré par l'image de
l'homme (1), ne nous apparaît pour ainsi dire que comme le compagnon de saint
Matthieu; car il dit souvent les mêmes choses que lui, afin d'honorer la
personne du Roi, qui ne marche jamais seul comme je l'ai prouvé dans, le
premier livre (2) ; ou plus vraisemblablement encore il marche en compagnie de
saint Matthieu et de saint Luc. Car si dans beaucoup de passages il ne fait
que reproduire l'Evangile de saint Matthieu, il se rapproche de saint Luc dans
un certain nombre d'autres. Ainsi se rapproche-t-il tout à la fois et du lion
et du boeuf, c'est-à-dire de la personne royale dépeinte par saint Matthieu et
de la personne sacerdotale dépeinte par saint Luc, et qui toutes deux se
confondent en Jésus-Christ. Mais s'agit-il de la Divinité, de l'égalité de
Jésus-Christ avec son Père, du Verbe qui est Dieu en Dieu, du Verbe fait chair
et. habitant parmi nous (3), du Verbe qui est un avec son Père (4)? c'est
surtout saint Jean qui a entrepris d'en parler. Comme un aigle hardi, il fixe
ses regards sur les paroles les plus sublimes prononcées par le Christ, et
rarement il descend vers la terre. Qui, mieux que lui, connaissait la mère de
Jésus? et cependant, contrairement à saint Matthieu et à saint Luc, il ne
parle pas de la naissance du Sauveur, il passe sous silence son baptême
raconté par les trois autres. Appliqué tout entier au témoignage rendu par le
Précurseur, il s'élance d'un seul trait au récit des noces de Cana. Là il lui
faut parler de la mère de Jésus, et voici de quelle manière il s'exprime: «
Femme, qu'y a-t-il entre vous et moi (5)? » Jésus ne repousse pas celle dont
il a reçu son corps, mais il se préoccupe surtout de sa Divinité avant de
changer l'eau en vin; comme Dieu en effet il avait créé sa mère, il ne lui
devait pas l'existence.
12. Après quelques jours
passés à Capharnaüm, Jésus revient au temple et c'est là que fut prononcée
cette parole, que nous rapporte saint Jean : « Détruisez ce temple et je le
rebâtirai en
trois jours (1). » Il proclamait par là, non seulement
que dans ce temple il était Dieu, le Verbe fait chair ; mais aussi qu'il a
ressuscité cette chair, uniquement en ce sens qu'il ne fait qu'un avec son
Père et qu'ils ne peuvent agir séparément. Dans tous les autres passages de l'Ecriture
nous lisons toujours que Dieu l'a ressuscité; nulle part nous ne voyons rien
qui annonce .
aussi clairement que, malgré cela, il s'est aussi
ressuscité lui-même, comme étant un seul Dieu avec son Père : c'est là ce
qu'exprime cette parole : « Détruisez ce temple et je le réédifierai en trois
jours. »
13. Dites ensuite la grandeur,
la divinité de son entretien avec Nicodème ! De là l'Evangéliste revient
encore au témoignage de saint Jean et proclame que l'ami de l'époux ne goûte
d'autre joie que d'entendre la voix de l'époux. C'est nous enseigner que l'âme
humaine n'est à elle-même ni sa propre lumière ni son propre bonheur ; et que
tout cela lui vient de sa participation à l'immuable sagesse. Vient ensuite
l'histoire de la Samaritaine, avec la promesse de cette eau qui rassasiera
éternellement celui qui en boira. De là, il se transporte de nouveau à Cana en
Galilée, où s'était opéré le changement de l'eau en vin ; c'est là qu'il fut
dit à l'officier dont le fils était malade : « Si vous ne voyez des miracles
et des prodiges, vous ne croyez pas (2). » Il voulait par là élever tellement
l'esprit du fidèle au-dessus des choses muables de ce monde, qu'on n'eût même
plus à demander des miracles, quoiqu'ils soient le sceau de la divinité gravé
sur la mobilité des corps.
14. De là Jésus revient à
Jérusalem, où il guérit un malheureux, malade depuis trente-huit ans. Et à
cette occasion que ne dit-il pas ! Combien ne dure pas son discours ! Ecoutons
Les Juifs cherchaient l'occasion de le faire mourir, parce que non-seulement
il ne gardait pas le sabbat, mais parce qu'il appelait pieu son Père en se
faisant son égal. » On voit clairement qu'en se proclamant le Fils de Dieu il
ne le faisait pas dans le même sens que les hommes justes, il se disait égal à
son Père. Aussi pour répondre à l'accusation de profaner le sabbat venait-il
de dire : « Mon Père agit toujours,
il en est de même de moi. » Ses ennemis entrèrent alors en fureur, non
pas précisément parce qu'il appelait Dieu son Père, mais parce
253
qu'il se proclamait l'égal de Dieu en disant : Mon Père
agit toujours, il en est de même de moi. » De là, en effet, il fallait
conclure que le Fils fait ce que fait le Père ; car le Père n'agit pas sans le
Fils. Malgré l'exaspération de ses persécuteurs, il leur dit au même moment et
leur répète un peu après : « Tout ce que fait le Père, le Fils le fait
également (1). »
15. Saint Jean quitte enfin
ces hautes sphères de la Divinité pour descendre un instant sur la terre avec
les autres Evangélistes, à l'occasion de la multiplication des cinq pains pour
cinq mille personnes. Et encore il est seul à nous apprendre que ces hommes
voulant proclamer Jésus Roi, il s'enfuit seul sur la montagne. Je crois que,
par cette conduite, le Sauveur a voulu nous montrer que s'il veut régner sur
notre esprit et sur notre raison, c'est parce qu'il a pour séjour les hautes
régions du ciel, où il n'a avec les hommes aucune communauté de nature ; où il
est seul, parce qu'il est le Fils unique du Père. Ce mystère à cause de sa
sublimité même échappe aux hommes charnels qui rampent sur la terre; voilà
pourquoi Jésus fuit sur la montagne pour se soustraire à ceux qui n'aspiraient
qu'à un royaume de la terre ; du reste il dit ailleurs : « Mon royaume n'est
pas de ce monde (2) ;» et si nous ne trouvons ces détails que dans l'Évangile
de saint Jean, c'est que dans son vol sublime il s'élève bien au dessus de la
terre, et fixe avec bonheur la lumière du soleil de justice. Après le miracle
de la multiplication des pains, Jésus demeura quelque temps sur la montagne
avec ses trois apôtres, puis ses disciples repassèrent la mer et Jésus se
réunit à eux. C'est alors que l'Évangéliste s'élance de nouveau vers les
paroles sublimes
et divines, vers le long et incomparable discours que le Sauveur
prononça à l'occasion de la multiplication des pains, après avoir dit à la
foule : « En vérité, en vérité je vous le déclare, vous me cherchez, non parce
que vous avez été témoins de miracles, mais parce que vous avez été nourris et
rassasiés de pain; travaillez donc, non pas pour le pain qui périt, mais pour
celui qui demeure jusqu'à la vie éternelle. » Il se maintient longtemps à
cette prodigieuse hauteur d'idées. Mais de cette élévation tombèrent bientôt
les malheureux qui ne continuèrent pas à le suivre ; tandis que restèrent avec
lui ceux
qui purent saisir la portée de cette parole : « C'est
l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien (1); » en effet, l'esprit sert
parla chair, il sert aussi par lui-même ; mais la chair ne sert à rien sans
l'esprit.
16. Les frères de Jésus,
c'est-à-dire ses parents selon la chair, lui conseillant ensuite de se rendre
à la fête de Pâques afin de se manifester à la multitude; quelle sublime
réponse il leur fait ! Mon heure n'est point encore venue, dit-il, tandis que
la vôtre est toujours prête. Le monde ne peut vous haïr, mais moi il me hait
parce que je rends de lui ce témoignage, que ses oeuvres sont mauvaises. » En
d'autres termes : « Votre heure est toujours prête, » parce que vous désirez
ce jour dont le prophète a dit : « Je n'ai pas souffert à votre suite,
Seigneur, et je n'ai pas désiré le jour de l'homme : vous le savez (2). » Ah !
c'est voler vers la lumière du Verbe, et désirer le jour après lequel Abraham
soupirait, le jour qu'il a vu et qui l'a rempli de joie (3). Cependant Jésus
s'étant rendu à la solennité , quelles paroles admirables, divines et
profondes saint Jean nous rapporte de lui! Les Juifs ne peuvent venir là où il
ira ; ils le connaissent et ils savent d'où il est ; celui qui l'a envoyé est
la vérité même et ils l'ignorent; comme s'il leur eût dit : vous savez d'où je
suis et vous ne savez pas d'où je suis.
Qu'est-ce à dire encore, sinon qu'ils savaient d'où il était quant à son
corps, quant à sa famille et à sa patrie ; mais quant à sa divinité, le
savaient-ils ? En parlant aussi, dans la même circonstance, du don de l'Esprit-Saint
, il révèle ce qu'il est, puisqu'il peut accorder ce Don au dessus de tout don
(4).
17. Jésus quittait le mont des
Oliviers, il venait de pardonner à la femme adultère qui lui avait été
présentée par de perfides ennemis afin qu'il la fit lapider. Alors encore
quelles paroles ne lui prête pas saint Jean ! Il nous montre comment de son
doigt il écrivait sur la terre, comme pour faire comprendre à ses ennemis que
c'était seulement sur la terre et non dans le ciel que leurs noms devaient
être écrits; tandis que ses disciples devaient se réjouir devoir les leurs
gravés sur le livre ale la vie éternelle (5); ou bien, en s'inclinant et en
,baissant la tête, il annonçait qu'il ferait des prodiges sur la terre ; ou
bien encore il proclamait qu'il était temps que sa toi fût écrite, non pas
comme autrefois sur une pierre
254
stérile, mais sur une terre qui pût rapporter du fruit !
C'est donc après cela qu'il se dit la lumière du monde, et qu'il assure que
ceux qui le suivront ne marcheront point dans le% ténèbres, mais qu'ils auront
la lumière de la vie. Il affirme aussi qu'il est le principe, lui, qui leur
parle. Par ces paroles, il établit une différence essentielle entre lui, lumière
éternelle par laquelle tout a été fait, et la lumière qu'il a faite . Quand
donc il se disait la lumière du monde, il parlait dans un autre sens que quand
il disait à ses apôtres : « Vous êtes la lumière du monde. » Les apôtres
n'étaient que le flambeau qui ne doit pas être mis sous le boisseau mais sur
le chandelier (1); saint Jean le précurseur n'était lui-même que la lampe
ardente et luisante (2) ; quant à Jésus il est le principe dont il est dit : «
Nous avons tous reçu de sa plénitude (3). » Jésus affirme aussi qu'il est le
Fils, la Vérité; et qu'en dehors de la liberté qu'il donne il n'y a pas de
liberté véritable (4).
18. A l'occasion de la
guérison de l'aveugle-né, saint Jean nous rapporte longuement les paroles que
Jésus prononça sur les brebis, sur le pasteur, sur la porte, sur le pouvoir
qu'il avait de donner sa vie et de la reprendre, puissance dans laquelle
brille au plus haut point sa divinité. Ensuite il nous apprend que les Juifs
dirent à Jésus pendant les fêtes de la Dédicace à Jérusalem : « Jusques à
quand tiens-tu notre âme dans l’indécision ? Si tu es le Christ, dis-le-nous
clairement. » A cette question quelle sublime réponse! Jésus dit : « Moi et
mon Père nous sommes un. » Plus tard, au moment de la résurrection de Lazare,
il s'écrie : « Je suis la résurrection et la vie; celui qui croit en moi,
fût-il mort, vivra; tout homme qui vit et croit en moi, ne mourra jamais. »
Que chercherions-nous ici autre chose que la révélation de sa divinité, dont
la participation nous fera vivre éternellement ? Saint Jean vient ensuite, à
Béthanie, à la rencontre de saint Matthieu et de saint Marc (5); c'est là que
des parfums furent versés par Marie-Magdeleine sur les pieds et sur la tête de
Jésus (6). A partir de ce moment jusqu'à la passion etla résurrection, les
trois Evangélistes marchent de concert et parcourent les mêmes lieux.
19. Du reste, toutes les fois
qu'il s'agit des discours du Sauveur, saint Jean ne cesse de s'élever
à des auteurs où il plane longtemps. Quand les Gentils
témoignent, par l'intermédiaire de Philippe et d'André, le désir de. le voir,
Jésus saisit alors l'occasion de prononcer un profond discours, que saint Jean
seul nous rapporte; il y est de nouveau question de la lumière qui répand ses
rayons et crée les enfants de la lumière (1). De plus, à l'occasion de la cène
dont tous les évangélistes ont parlé, quelles belles et sublimes paroles
prononcés par Jésus et que saint Jean seul nous fait connaître! C'est
non-seulement l'humilité à l'occasion du lavement des pieds; mais, quand après
le repas le traître a disparu, et qu'il ne reste plus avec lui que les onze
apôtres fidèles, quel long, admirable et saisissant discours saint Jean nous
rapporte! C'est là que nous trouvons cette parole : « Celui qui me voit , voit
aussi mon Père; » c'est là que Jésus parle longuement du Saint-Esprit, qu'il
devait leur envoyer; de la gloire dont il jouissait en son Père avant la
création du monde; de l'unité qu'il veut former avec nous, comme il ne fait
qu'un avec son Père; il ne dit pas que lui, son Père et nous, nous ne devons
faire qu'un, mais que nous devons être un comme lui et son Père sont un. Et
puis combien d'autres choses non moins profondes et 'non moins admirables dont
ne nous pourrions parler convenablement dans cet ouvrage, en fussions-nous
capables; puisque nous l'avons entrepris dans un autre dessein (2) ! Nous
pourrons le faire ailleurs; il ne faut pas y aspirer ici. Voici seulement ce
que nous voulons rappeler à ceux qui aiment la parole de Dieu et qui
recherchent la sainte vérité. Quoique saint Jean , dans son Evangile, ait
annoncé et fait connaître le Christ véritable et véridique dont les trois
autres évangélistes ont écrit la vie et dont les autres Apôtres, sans avoir
entrepris de faire son histoire, n'ont pas moins publié les grandeurs comme
l'exigeait leur ministère; cependant après s'être élevé bien plus haut qu'eux
dès le début de son Evangile, il ne se rencontre que rarement avec eux dans le
cours de son ouvrage. C'est premièrement quand il s'agit du témoignage rendu
parle Précurseur sur les rives du Jourdain ; secondement au-delà de la mer de
Tibériade, quand Jésus nourrit la foule avec les cinq pains et sur les eaux;
troisièmement, à Béthanie, où une femme fidèle répand sur lui des parfums
précieux. Ainsi arrive-t-il avec eux à la passion, où tous devaient
255
se rencontrer; et cependant ne rend-il pas plus splendide
que les autres la cène dernière, pour laquelle il semble avoir puisé dans le
sanctuaire même du Seigneur, sur lequel il avait l'habitude de reposer.
N'est-ce pas lui encore qui nous montre Jésus frappant Pilate de paroles plus
profondes; déclarant que son royaume n'est pas de ce monde, qu'il est né Roi,
qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité (1); écartant
Marie elle-même après la résurrection, et lui adressant ces mots mystérieux et
profonds : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père
(2); » donnant le Saint-Esprit à ses disciples en soufflant sur eux (3),
prévenant ainsi l'erreur qui aurait pu faire croire, que le Saint-Esprit, qui
est consubstantiel et coéternel à la Trinité, était seulement l'Esprit du Père
et non celui du Fils
20. Enfin après avoir confié
la garde de ses brebis à Pierre, à qui il venait de demander une triple
protestation d'amour, Jésus dit de saint Jean qu'il veut qu'il demeure ainsi
jusqu'à ce qu'il vienne (4). Je crois voir ici la révélation d'un profond
mystère. Ce récit évangélique de saint Jean, lequel jette de si vives lumières
sur la nature du Verbe, nous enseigne l'égalité et l'incommutabilité de la
Trinité, nous révèle la distance infinie qui existe entre nous et le Verbe
fait chair; je dis que cet évangile de saint Jean, ne pourra être saisi et
parfaitement compris que quand le Seigneur apparaîtra parmi nous. Voilà
pourquoi il restera tel jusqu'à ce qu'il vienne; maintenant il restera pour
diriger et affermir la foi des croyants; mais alors nous le contemplerons face
à face (5), quand notre vie aura apparu et quand nous aurons apparu avec lui
dans la gloire (6). Si donc traînant encore après lui les chaînes de notre
misérable mortalité, un homme se flatte d'écarter toutes les ténèbres
qu'engendrent dans son esprit les représentations corporelles et charnelles ;
de jouir de l'éclat serein de l'incommuable vérité ; et d'y attacher
indissolublement son intelligence, rendue entièrement étrangère aux habitudes
et aux nécessités de cette vie : je déclare qu'il ne comprend pas ce qu'il
cherche et qu'il ne se connaît pas lui-même. Qu'il croie plutôt, d'après une
autorité sublime et infaillible, que tant que nous sommes dans ce corps, nous
sommes loin de Dieu, que nous marchons à la lueur de la foi et non à l'éclat
éblouissant de la réalité (1). De cette manière, gardant
précieusement dans son âme la foi, l'espérance et la charité, qu'il aspire à
la contemplation face à face, appuyé sur le gage de l'Esprit-Saint qu'il a
reçu (2), et qui nous enseignera toute vérité, quand Celui qui a ressuscité
Jésus-Christ d'entre les morts, vivifiera aussi nos corps mortels par son
Esprit qui habite en nous (3). Mais avant que ce corps, qui est mort par le
péché, ne soit vivifié, sachons qu'il est de plus un fardeau bien lourd pour
notre âme (4). Et si quelquefois, aidé par la grâce d'en haut, on perce ce
nuage qui couvre toute la terre (5), c'est-à-dire les ténèbres charnelles qui
obscurcissent la vie terrestre, n'oublions pas que ce n'est qu'un éclair
rapide qui fend la nue, mais que bientôt on retombe dans sa faiblesse, malgré
le désir qui porte à s'élever de nouveau dans les hauteurs, et parce qu'on
n'est pas pur pour y rester fixé. La grandeur d'un homme dépend de la grandeur
de ses efforts pour s'élever; et sa petitesse est proportionnée à la faiblesse
de ses efforts.
Si une âme n'a encore éprouvé
aucune des ces aspirations, quoique Jésus-Christ habite en elle par la foi :
qu'elle s'attache à vaincre et à détruire les passions de ce siècle, et cela
par l'action de la vertu morale, qu'elle pratiquera en marchant avec
Jésus-Christ, son médiateur, dans la compagnie des trois premiers Evangélistes
; qu'elle conserve fidèlement avec toute la joie d'une vive espérance, la foi
en Celui qui est toujours le Fils de Dieu et qui, pour nous, s'est fait fils
de l'homme, afin que sa force éternelle et sa divinité préparent à notre
faiblesse et à notre mortalité, qu'il a partagées, une voie sûre pour marcher
en lui et vers lui. Pour éviter le péché, qu'elle se laisse diriger par
Jésus-Christ Roi ; si par malheur elle y tombe, qu'elle cherche l'expiation en
ce même Jésus-Christ souverain prêtre. Quand enfin elle aura trouvé un aliment
suffisant dans l'action d'une vie pure et sainte, s'élevant sur les deux
préceptes de la charité comme sur deux ailes puissantes, au-dessus des choses
de la terre, elle pourra se plonger dans la source même de la lumière,
Jésus-Christ, le Verbe qui était au commencement, le Verbe qui était en Dieu
et qui était Dieu (6). Elle ne verra sans doute encore que comme dans un
miroir et en énigme; mais beaucoup mieux qu'à l'aide des images corporelles.
Si donc les esprits qui en sont capables voient dans
256
les trois autres Evangélistes l'image de la vie active et
dans l'Evangile de saint Jean les dons de la puissance contemplative ;
toujours est-il vrai de dire, qu'au moins d'une certaine manière, cet Evangile
de saint Jean restera jusqu'à ce que toute perfection soit accomplie (1). Aux
uns le Saint-Esprit donne le langage de la sagesse, aux autres le langage de
la science (2); celui-ci goûte le jour du Seigneur (3); l'autre boit à la
source plus pure de la poitrine du Sauveur; celui-là, ravi jusqu'au troisième
ciel, entend des paroles ineffables (4); tous cependant, voyagent loin du
Seigneur, tout le temps qu'ils sont dans ce corps mortel (5), et ceux qui
gardant fidèlement les biens de l'espérance, sont écrits au livre de vie,
verront l'accomplissement de cette parole : « Et moi aussi,
Je l'aimerai et je me manifesterai moi-même à lui (1). »
Toutefois pendant le
pèlerinage d'ici-bas, plus on fera de progrès dans l'intelligence, ou la
connaissance de cette vérité, plus on évitera avec soin les deux vices qui
forment le caractère du démon: l'orgueil et la jalousie. On se souviendra que
si l'Evangile de saint Jean élève si haut dans la contemplation de la vérité,
c'est qu'il commande d'une manière plus pressante la douceur de la charité; et
comme rien n'est plus vrai ni plus salutaire que ce précepte du sage : « Plus
tu es grand, plus tu dois t'humilier en tout (2), » l'Evangéliste qui,
beaucoup mieux que les autres, a fait briller la gloire
de Jésus-Christ, c'est celui qui nous le représente lavant les pieds à
ses disciples (3).
Les deux premiers livres ont été traduits par M.
l'abbé TASSIN, les deux derniers par M. l'Abbé BURLERAUX.
Haut du document