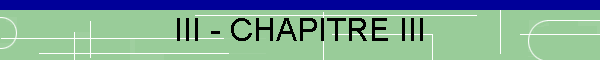
|
|
CHAPITRE III : DE LA LANGUE DES LIVRES LITURGIQUES.Si les livres liturgiques ont, d'après la tradition, un style, une forme de rédaction qui leur est propre, c'est un fait non moins réel qu'ils ne sont point écrits en toute langue. Doit-on attribuer ce fait au hasard, ou à une intention? L'Église, en maintenant le principe d'une langue liturgique et non vulgaire, dans le service divin, a-t-elle manqué à ses devoirs envers le peuple fidèle ? Le présent chapitre a pour but de répondre à la première de ces questions ; quant à la seconde, elle a été résolue par l'Église elle-même, au concile de Trente, où elle s'exprime ainsi : « Si quelqu'un dit que la messe ne doit être célébrée qu'en langue vulgaire, qu'il soit anathème (1) ! » Le calvinisme mitigé, qui a produit tant de maux en France sous le nom de jansénisme, ayant ramené sur cette matière les mêmes principes qui avaient été foudroyés à Trente, l'Église, dans la Constitution Unigenitus, a condamné cette doucereuse proposition de Quesnel : « Arracher au simple peuple la consolation de joindre sa voix à celle de toute l'Église, c'est un usage con traire à la pratique des apôtres et à l'intention de Dieu (2). » (1) Si quis
dixerit lingua tantum vulgari missam celebrari debere, anathema sit. (Sess.
XXII, Can. IX.) (2)
Propositio 86. Eripere simplici populo hoc solarium jungendi vocem suam
voci totius Ecclesi, est usus contrarius praxi apostolicae et intentioni Dei. 52 Nous laissons donc aux controversistes le soin d'établir théologiquement la légitimité des motifs qui ont porté l'Église à adopter des langues liturgiques, et à exclure les langues vulgaires du service divin. La question est jugée et décidée par l'Eglise; c'est à la science des théologiens à déduire les motifs de la sentence, et cette tâche d'ailleurs est facile, en marchant sur les traces des Bellarmin, des du Perron et de leurs successeurs. Le droit des langues liturgiques étant admis, nous avons à examiner, au point de vue de ces Institutions, l'origine de cette loi et les motifs qui ont fait exclure les langues vulgaires du service divin; cette question se présentait tout naturellement dans la partie de notre travail où nous traitons des livres liturgiques. Nous dirons en premier lieu qu'il est complètement faux que la Liturgie ait été célébrée dans la langue vulgaire de tous les peuples chez lesquels la foi a été annoncée, même à l'origine du Christianisme. Nous n'entendons pas cependant embrasser l'opinion de Jean Eckius, qui soutenait gravement contre les luthériens, que les Apôtres et leurs successeurs, jusqu'à l'empereur Adrien, avaient célébré la Liturgie en hébreu, après quoi on avait adopté la langue grecque dans le service divin. Ce sentiment n'est pas sérieux, et nous ne perdrons pas le temps à le discuter. Nous ne dirons pas non plus que la Liturgie n'a jamais été célébrée que dans les trois langues qui parurent sur la Croix du Sauveur, hébreu ou syriaque, grec et latin; car il y a plus de mille ans qu'on la célèbre dans des Idiomes différents de ces trois langues privilégiées. Mais nous oserons affirmer que, jusqu'au quatrième siècle du christianisme, ces trois langues, syriaque, grecque et latine, ont été les seules dont on se soit servi à l'autel ; ce qui leur donne une dignité liturgique toute particulière, et confirme merveilleusement le principe des langues sacrées et non vulgaires dans ja Liturgie. 53 L'importance et l'existence même de ce fait ont été contestées par plusieurs écrivains des XVII° et XVIII° siècles, qui ont semblé ne regarder l'interdiction des langues vulgaires dans la Liturgie que comme un usage ecclésiastique auquel on doit se soumettre, mais non comme une loi fondée sur l'esprit même de l'Église catholique. Dans l'impuissance de changer cette institution qu'ils respectaient d'ailleurs, ils en entreprirent l'apologie savante, mais timide. Sur ce point comme sur un grand nombre d'autres, ils se bornèrent à faire de la polémique, et perdirent de vue les hautes considérations qui donnent la raison suprême des lois de l'Église. On est frappé de cette remarque, en lisant l'excellente dissertation du P. Le Brun(1)sur la question qui nous occupe; il justifie l'Église, mais il ne cache pas son désir de voir les chrétiens chinois dispensés de la langue latine. Nous verrons bientôt le P. Papebrok témoigner la même indifférence, et fournir son autorité au P. Le Brun. Dom Martène est plus désespérant encore, et ne paraît avoir eu d'autre but que de réunir des arguments contre la pratique de l'Église en ce point (2). Renaudot traite la matière avec assez de solidité, mais sans rattacher ses conclusions à aucun principe général, et il se donne le tort de s'amuser doctement aux dépens de ceux qui ont prétendu, dans leur innocente exagération, que la Liturgie n'avait jamais été, et ne pouvait être célébrée que dans les trois langues du titre de la Croix (3). Bocquillot discute la question sans élévation, comme toujours, et au point de vue d'un homme qui a devant lui un auditoire protestant auquel il veut surtout fermer la bouche (4). Cependant l'enseignement haut et ferme de Bellarmin et (1) Explication de la Messe, tom. IV, pag. 201-243. (2) De antiquis Ecclesi ritibus, tom. I, cap. III, art. 2. (3) Liturgi orientales, tom. I, dissertat, praelimin., pag. 40. (4) Liturgie sacrée, livre I, chap. XI, pag. 246-270. 54 des graves théologiens du XVI° siècle, celui de la Sorbonne, dans sa remarquable censure d'Érasme, en 1526 (1), ne laissait pas de recueillir de temps en temps le suffrage de quelques hommes aussi doctes qu'énergiques. Le grand Cardinal Bona soutint toujours en principe la pratique de l'Église, comme un point de doctrine qui doit être enseigné par affirmation, et non simplement défendu. Sala suivit courageusement son maître dans cette voie. De Merbes appuya sa thèse sur l'esprit môme de l'Église, et sur la nature des mystères que renferme et protège la Liturgie (2). Le P. Honoré de Sainte-Marie se montra intrépide sur ce point, comme sur beaucoup d'autres (3). Son confrère, Chérubin de Sainte-Marie, ne faillit pas non plus au devoir qu'il s'était imposé d'expliquer franchement la pensée de l'Église sur cette grande question (4); mais il faut bien reconnaître que, à partir d'une certaine époque, les auteurs qui ont traité la matière avec une complète aisance, deviennent rares de plus en plus. Il eût été cependant facile de se rendre compte des motifs de l'Église dans l'usage des langues sacrées à l'autel, en se rappelant l'ancienne discipline du secret des mystères. Sans doute, l'Église a modifié ses usages sur ce point; mais elle ne pouvait abandonner le principe. Elle n'a plus de catéchumènes à instruire graduellement, pour les disposer au baptême; le même jour peut nous voir naître à la vie naturelle, du sein de nos mères, et à la vie de la grâce sur les fonts baptismaux. Il n'y a plus de pénitents publics à expulser de l'église, au moment où va commencer la célébration du sacrifice; mais il y a toujours la même profondeur dans les mystères, la même faiblesse, et les mêmes dangers dans le cur de l'homme (1) D'Argentré. Collectio judiciorum , tom. II, pag. 61. (2) Summa Christiana, tom. II, part. III, quaest. 54. (3) Règles de la Critique, tom. III, dissert. IV, pag. 258-32.3. (4) Bibliotheca critic sacr, tom. IV, pag. 597-647. 55 courbé vers la terre. C'est un spectacle étrange que celui de ces sectaires qui rêvaient de rendre à l'Église les pénitents publics, le rideau qui voilait l'autel au moment suprême; qui aspiraient à abolir l'exposition de la divine Eucharistie aux regards des fidèles prosternés, jaloux qu'ils étaient des bénédictions que le Sauveur des hommes répand sur eux, du milieu d'un nuage d'encens ; et qui, en même temps, auraient voulu que le prêtre prononçât à voix haute les redoutables paroles du Canon, et qu'il le fit dans la langue du vulgaire. Contradiction qui n'a pas droit de surprendre dans des hommes voués à la plus obstinée de toutes les erreurs, et qui ne rougissaient pas de s'allier par leurs sympathies à peine dissimulées aux prétendus réformateurs du XVI° siècle. Et les orthodoxes ont tremblé devant eux, et on cherchait à répondre à leurs perfides insinuations, en donnant à l'Église de Dieu l'attitude d'une accusée devant ses juges. Qu'il eût été bien plus à propos de les mettre en face de ces puissants docteurs de l'Église primitive dont ils se prétendaient si faussement les disciples, et dont les oracles les condamnent! On eût dû rappeler la doctrine de ce savant maître, le fils du martyr Léonide, le grand Origène qui disait, au IIIe siècle, en expliquant un passage du livre des Nombres : « Quand le moment était venu pour les enfants d'Israël de lever le camp, on défaisait le tabernacle. Aaron et les prêtres ses fils, pénétrant dans le Saint des saints, couvraient chaque chose de ses voiles, et la laissant ainsi couverte en la place qu'elle occupait, ils introduisaient les fils de Caath, députés pour cet office, et leur mettaient sur les épaules ce que la main sacerdotale avait voilé. Si vous comprenez le fait historique, élevez-vous maintenant à la splendeur du mystère, et si l'il de votre âme est pur, contemplez la lumière de la loi spirituelle. Que celui à qui les mystères sont confiés, sache qu'il n'est pas sûr pour 56 lui de les découvrir à ceux auxquels ils ne doivent pas être dévoilés ; mais qu'il les couvre, et les ayant couverts, qu'il les place sur les épaules de ceux qui n'étant pas capables de les contempler, doivent simplement les porter. Or, dans les observances de l'Église, il est beau-ce coup de choses de cette nature, qu'il faut faire, mais dont la raison n'est pas manifestée à tous. Ces rites couverts et voilés, nous les portons sur nos épaules ; en les accomplissant, nous les recevons du grand Pontife et de ses fils. Ils nous demeurent cachés, à moins que nous n'ayons au milieu de nous Aaron, ou les fils d'Aaron, auxquels seuls il est accordé de les contempler à nu et sans voiles (1). » On aurait bien dû aussi leur rappeler l'enseignement de saint Basile qui, dans son livre du Saint-Esprit, formule si énergiquement la pensée de l'Église sur la nécessité d'environner de mystère les choses saintes : « Moïse, dans sa sagesse, dit-il, savait que les choses familières et faciles à découvrir, sont exposées au mépris ; que celles qui sont rares et isolées du contact, excitent comme naturellement l'admiration et le zèle. A son imitation, les Apôtres et les Pères ont établi, dès le commencement, certains rites de l'Église, et ont con serve la dignité aux mystères, par le secret et le silence ; car ce qui est porté aux oreilles du vulgaire n'est déjà plus un mystère (2). » Pour nous qui acceptons les institutions de l'Église (1) Voir le texte entier à la fin de ce chapitre, note A. (2) Probe sciens (Moyses) pro sua sapientia, res
usu tritas et ex se obvias, expositas esse contemptui : rebus vero quae
seposit sunt ac rarae, quodammodo naturaliter conjunctam esse summam
admirationem ac studium. Ad eumdem profecto modum, et qui initio certos
Ecclesias ritus praescripserunt Apostoli et patres, in occulto silentioque
mysteriis suam servavere dignitatem. Neque enim omnino mysterium est, quod ad
populares ac vulgares aures effertur. (De Spiritu Sancto, cap. XXVII, n. 66.) 57 comme l'uvre d'une sagesse surhumaine, nous n'avons garde de descendre à l'excuse sur ses intentions dans les mesures qu'elle a prises pour isoler du vulgaire les prières de la Liturgie. Nous partons donc hardiment de ce fait qu'il y a des langues sacrées et séparées des autres par un choix divin, pour servir d'intermédiaire entre le ciel et la terre. La dignité des trois qui proclamèrent sur le calvaire la royauté du crucifié n'a pas seulement frappé les auteurs mystiques du moyen âge. Joseph de Maistre reconnaît cette consécration (1), tout aussi bien que le dévot Honorius d'Autun (2), et l'un et l'autre n'ont fait que répéter ce qu'avait dit, dès le IV° siècle, saint Hilaire de Poitiers. C'est principalement dans ces trois langues (hébraïque, grecque et latine), dit le saint évêque, que le mystère de la volonté de Dieu est manifesté ; et le ministère de Pilate fut d'écrire par avance, en ces trois langues, que le Seigneur Jésus-Christ est le Roi des Juifs (3). » Dieu avait donc conduit la main du gouverneur romain dans le choix des langues qui parurent sur l'inscription, aussi bien que pour les termes dans lesquels elle était conçue, et son divin Esprit, parlant aux hommes dans les saintes Écritures, devait aussi consacrer trois langues, les mêmes que le peuple juif, réuni des quatre vents du ciel pour la fête de Pâques, put lire sur le titre arboré au-dessus de la tête du Rédempteur. La langue hébraïque, après la captivité de Babylone, se perdit dans le chaldéen qui est une des formes du syriaque. Le même corps d'Écritures sacrées réunit les livres de Moïse, de Samuel, de David, de Salomon et des (1) Soirées
de Saint-Pétersbourg, tom. II,
VII° entretien. (2) Gemma animae, lib. I, cap. XCII. (3) His maxime tribus linguis sacramentum voluntatis Dei, et beati regni
expectatio prdicatur : ex quo illud Pilati fuit, ut in his tribus linguis
regem Judaeorum Dominum Jesum Christum esse prscriberet. (Prologus in librum Psalmorum, n. 15.) 58 prophètes, et les livres de Daniel et d'Esdras ; les premiers parlant le pur hébreu; les seconds donnant une partie de leurs écrits en syro-chaldéen. Le Christ, annoncé par les prophètes, vint enfin, et c'est dans la langue que parlait alors son peuple, dans l'hébreu devenu syro-chaldéen, qu'il prêcha sa doctrine. Mais déjà, avant l'accomplissement des oracles prophétiques, une seconde langue avait été sanctifiée et admise à servir d'organe à l'Esprit-Saint. Non seulement la langue grecque avait été élevée au rang d'interprète de la parole divine, dans la fameuse version des Septante, mais l'Esprit-Saint annonçant déjà l'écoulement futur de la grâce d'adoption vers la gentilité, dictait en grec le livre même de la Sagesse, et le second des Machabées. Le Christ étant descendu pour nous racheter, et son testament en notre faveur étant ouvert par sa mort, selon la pensée de l'Apôtre, le divin Esprit, inspirateur des Écritures, donna dans les trois langues du titre de la Croix les livres de la nouvelle alliance. Saint Matthieu écrivit son Évangile en syriaque, l'hébreu vulgaire de son temps ; Papias, disciple des Apôtres, saint Irénée, saint Pantène, Origène, Eusèbe, saint Athanase, saint Épiphane, saint Jérôme, saint Augustin, nous l'attestent. La langue grecque eut l'honneur de recevoir dans son idiome les Évangiles de saint Luc et de saint Jean, les Actes et les Épîtres des Apôtres, sauf peut-être l'Épître de saint Paul aux Hébreux, qui aurait été écrite dans leur langue. Le christianisme, après avoir été prêché dans Jérusalem, et dans la langue d'Israël, devait s'étendre d'abord aux gentils de la langue grecque. Mais comme le siège du Prince des Apôtres allait être bientôt transféré dans la capitale de la langue latine, et que cette langue était celle de l'empire romain, et destinée à exercer la principauté sur les autres langues sacrées, et par son étendue, et par son usage dans les décisions de 59 la foi, elle ne fut pas non plus dédaignée par l'Esprit-Saint, dans ces jours où les écrivains du Nouveau Testament rédigeaient sous sa dictée la vie et la doctrine du Verbe incarné. Le Liber pontificalis enseigne positivement que saint Marc, composant son Évangile à Rome, sous les yeux de saint Pierre qui le confirma, au rapport d'Eusèbe et de saint Jérôme, l'écrivit dans la langue latine. Saint Grégoire de Nazianze déclare expressément que saint Marc rédigea son Évangile pour les latins (1) ; n'est-ce pas dire assez clairement qu'il l'écrivit dans leur langue? C'est aussi la tradition de l'Orient,comme l'atteste la suscription des versions syriaque et arabe. On a objecté que le texte latin de saint Marc ne se trouve plus. Si cet argument avait de la valeur, on devrait nier par là même que saint Matthieu ait écrit son Évangile en hébreu, ou syro-chaldéen, puisque nous ne le possédons plus qu'en grec, depuis bien des siècles, et que la version syriaque de cet Évangile a elle-même été faite sur le grec. Nous croyons donc pouvoir maintenir notre assertion, au moins sous forme de grande probabilité; mais, quand nous n'aurions aucune preuve que la langue latine ait figuré primitivement dans les Écritures inspirées du Nouveau Testament, il lui resterait encore la gloire d'avoir reçu la première traduction chrétienne des livres saints, dans cette vénérable version Italique qui fut composée au temps des Apôtres, et reçut l'approbation de saint Pierre, comme chef de l'Église (2) ; version qui servit de base à la traduction de saint Jérôme, et qui figure encore d'une (1) Poema
XII, XXI. (2) Petrus
Romanae Ecclesiae per viginti et quatuor annos praefuit : dubitandum non est
quin sicut caetera quae ad instructionem pertinent, etiam librorum instrumenta
EcclesiaD ipse tradiderit, quae utique jam tum ipso sedente et docente
recitabantur. (Rufin. Aquil. Apolog.,
lib. II, n. 33, pag. 38g. Edit. Vallarsi, 1745.) 60 manière notable dans la Vulgate actuelle, proclamée par le concile de Trente comme contenant la pure parole de Dieu, pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais les trois langues sacrées rendues ainsi dépositaires des oracles divins, à l'origine du christianisme, ne s'enrichirent que successivement, au moyen des versions, de la totalité de cet incomparable trésor. La langue grecque si répandue dans tout l'empire romain , fut probablement la première à posséder une traduction complète. Déjà elle avait tous les livres de l'Ancien Testament, et, parmi ces livres, celui de la Sagesse et le second des Machabées lui appartenaient en propre. D'un autre côté, les auteurs sacrés du Nouveau Testament, l'avaient dotée de la presque universalité de leurs écrits divins. Restait à traduire du syro-chaldéen l'Évangile de saint Matthieu, et peut-être lEpître aux Hébreux ; ce travail ne dut pas se faire longtemps attendre. La langue latine eut de bonne heure sa version Italique, comme nous venons de le remarquer, et si l'Évangile latin de saint Marc disparut bientôt, de même que l'Évangile hébreu ou syro-chaldéen de saint Matthieu, il fut facile de le suppléer, en traduisant sur la version grecque. Quant à la langue des Juifs, ou plutôt de la Syrie, qui se lisait la première sur le titre de la Croix, comme celle de la nation au milieu de laquelle le Fils de l'homme était arboré sur l'arbre du salut, elle ne tarda pas longtemps à jouir d'une traduction des saintes Écritures. La version latine faite au premier siècle étant surtout destinée à l'Occident, la version grecque, quoique composée dans une langue très répandue même en Orient, n'étant pas d'un usage assez général, il devenait nécessaire de traduire les livres saints dans la langue syriaque, dont le syro-chaldéen n'était d'ailleurs qu'une branche assez peu étendue. Pour les livres de l'ancien Testament, les plus 61 savants exégètes, tels que Walton, Leusden, Kennicott, Jahn, en placent la version dès le premier, ou au plus tard dès le second siècle ; il est naturel de rapporter à la même époque la traduction du nouveau Testament, Les Églises avaient plus besoin encore des saints Évangiles et des autres écrits apostoliques que des livres de l'ancienne Alliance. Cette version était propre à tous les pays de la langue syriaque, dont le règne s'étendait depuis la Méditerranée et la Judée, jusqu'à la Médie, la Suziane et le golfe Persique (1). Voilà donc les trois premières versions des saintes Écritures, syriaque, grecque et latine, en possession des Églises de tous les pays auxquels le christianisme fut primitivement annoncé. Mais rien n'arrête la marche de l'Évangile ; la prédication étend bientôt à d'autres peuples la bonne nouvelle du salut. Saint Paul écrit aux Romains, vers l'an 58, que leur foi est célèbre dans le monde entier (2) : quatre ans après, il écrit aux fidèles de Colosse : « L'Évangile a été annoncé dans tout le monde, où il fructifie et s'accroît, comme il le fait parmi vous (3). » Veut-on juger en détail du progrès ? Saint Irénée, au milieu du ne siècle, énumère les Églises fondées chez les Germains et les Celtes, dans lEgypte et la Libye (4). Ailleurs, il parle de celles qui, en grand nombre, existent déjà chez les Barbares, et n'ont d'écritures que celles qui sont gravées dans leurs curs par l'Esprit-Saint, mais ne (1) Assemani dans sa Bibliotheca orientalis, tom. II, pag. 23, fondé sur l'autorité de divers manuscrits syriaques de la bibliothèque Vaticane, attribue cette version à un disciple des apôtres nommé Adasus. Il s'agit ici de la version dite Peschito, qui est la version officielle des Eglises syriaques et non pas des versions privées et postérieures de plusieurs siècles, telles que la Philoxénienne ou Héracléenne, composée par des hérétiques monophysites au commencement du VI° siècle. (2) (3) (4) Adv. Hreses, lib. I, cap. X. 62 gardent pas avec moins de fidélité la tradition chrétienne (1). Tertullien, un demi-siècle plus tard, ajoute aux nations qui ont cru en Jésus-Christ, les Parthes, les Mèdes, les Arméniens, les Africains au delà de Cyrène, les Gétules, les Maures, l'Espagne, une partie de la Gaule, les Bretons, les Daces, les Scythes, et une multitude d'autres nations, provinces et îles (2). Maintenant où sont les versions de l'Écriture à l'usage de toutes ces nations ? Nous en trouvons plusieurs, mais dans la langue grecque, entreprises dans le cours des trois premiers siècles ; saint Augustin nous atteste qu'il y en avait eu aussi plusieurs dans la langue latine, jusqu'à son temps, et témoigne en passant, que les langues en possession des oracles sacrés se réduisent encore à l'hébreu, au grec et au latin (3). Il y a eu de même plusieurs versions syriaques, comme le reconnaissent les exégètes. Le privilège des trois langues paraît ici dans tout son éclat ; mais il n'en est que plus évident que les peuples et les individus étrangers à ces trois langues ne lisaient pas l'Écriture sainte dans leur propre idiome. Jetons un coup d'il rapide sur la chrétienté dans les premiers siècles, nous sentirons mieux le grand principe des langues sacrées qui commence à se dégager de l'ensemble des faits que nous avons réunis jusqu'ici. En dehors des nations qui usaient des langues syriaque, grecque ou latine, nous consentons à placer l'Egypte, et nous allons constater volontiers l'existence d'une version des Écritures dans sa langue. Mais cette version (1) Adv.
Hreses lib. IV, cap.IV. (2) Adv. Judos, cap. VII. (3) Latin quidem linguae homines, quos nunc instruendos
suscepimus duabus aliis ad Scripturarum divinarum cognitionem opus habent,
hebra scilicet et grca, ut ad exemplaria prcedentia recurratur, siquam Jubitationem
attulerit latinorum interpretum infinita varietas. (De doctrina Christiana,
lib. III, cap. XI.) 63 n'appartient pas à la période des trois premiers siècles durant laquelle régnèrent seules les trois langues sacrées. Personne n'ignore que depuis l'établissement de la langue grecque dans ce pays, par les successeurs d'Alexandre, elle y était très florissante et proprement vulgaire. C'est ce qui fait que saint Jérôme parlant des versions de l'Écriture, considère celles de la langue grecque comme spécialement propres à l'Egypte: «Alexandrie et l'Egypte, dit-il, reconnaissent Hésychius pour leur interprète des Septante. » On sait que Hésychius avait fait une revision de cette version. Le saint docteur continue, et nous atteste, en passant, que la Syrie elle-même, encore au IV° siècle, usait beaucoup plus de la langue grecque que de la syriaque, dans la lecture des livres saints : « De Constantinople jusqu'à Antioche, on suit l'édition du martyr Lucien, » qui, comme Hésychius, avait revu la version grecque, Les provinces intermédiaires se servent des exemplaires de Palestine, que Eusèbe et Pamphile ont publiés d'après les travaux d'Origène (1). » Mais revenons à l'Egypte. Quoique le grec y fût depuis plusieurs siècles la langue usuelle, la Thébaïde avait cependant retenu assez fidèlement son ancien langage, connu sous le nom de copte. Une version des Écritures fut rédigée d'assez bonne heure dans cet idiome. Vossius prétend toutefois qu'elle ne serait pas antérieure à l'invasion des Arabes, au VII° siècle, parce qu'elle présente plusieurs éléments empruntés à leur langue. Le P. Kircher, au contraire, dont l'opinion est aujourd'hui reçue communément parmi les savants, la place vers le concile de Nicée, et s'appuie sur le (1)
Alexandria et Aegyptus in LXX suis Hesychium laudat auctorem. Constantinopolis
usque ad Antiochiam Luciani martyris exemplaria proboat. Mediae inter has
provincial Palstinos codices legunt, quos ab Origene elaboratos Eusebius et
Pamphilus vulgaverunt. (Proefat. in Lib. Paralipom.) 64 témoignage d'un martyrologe copte, qui se conserve à Rome dans la bibliothèque du collège des Maronites. On lit sur ce manuscrit, en tête du mois Thot, que la principale occupation des moines était de traduire les livres saints, du grec, du chaldéen et de l'hébreu, dans leur langue propre, qui était le copte (1) : d'où le savant jésuite conclut que la version copte serait l'ouvrage des moines. Or les moines n'ont fleuri dans la Thébaïde que dans le IV° siècle. D'un autre côté, l'Egypte avait été évangélisée par saint Marc, dès le premier siècle, et nous savons par saint Athanase, que saint Antoine naquit en Thébaïde de parents chrétiens, au 111e siècle. La foi chrétienne était donc antérieure, dans ce pays, à l'existence de la version copte, dont, au reste, aucun des Pères du IV° siècle n'a parlé, avant saint Jérôme et saint Jean Chrysostome, tant son origine était récente, et sa propagation incertaine. L'Église éthiopienne possède aussi sa version; mais on ne saurait faire remonter cette version plus haut que le IV° siècle, puisque ce fut seulement dans ce siècle que saint Frumentius reçut mission de saint Athanase, pour aller évangéliser ce pays. La version de l'Église arménienne fut faite sur les Septante, dans le V° siècle. L'auteur en est connu, c'est Mesrob, auquel on attribue l'invention des caractères arméniens. Les versions persane et arabe sont loin de contre- (1) Kircher. Prodromus coptus, sive Aegyptiacus, cap. VIII. En 1789, le P. Giorgi, de l'ordre des Augustins, publia à Rome un fragment de l'Evangile de saint Jean en langue thébaïdique. La forme des caractères, l'orthographe, les notes liturgiques ont conduit le savant orientaliste à croire que le manuscrit dont ce fragment a été détaché aurait été écrit à la fin du IV° siècle. Il faut avouer cependant que la traduction des Evangiles, ou même si, l'on veut, du Nouveau Testament, en copte, dès le IV° siècle, ne démontrerait pas l'existence d'une version complète de la Bible en cette langue, à cette époque. 65 dire notre thèse ; on convient qu'elles ne remontent pas plus haut, la première que le IX° siècle, la seconde que le X° (1). Telles sont les versions de l'Écriture dans les langues orientales (2) ; comme on le voit, elles sont loin de représenter la langue de tous les peuples d'Orient qui embrassèrent le christianisme. Si nous passons en Occident, nous trouvons la fameuse version gothique d'Ulphilas, qui est d'une assez belle antiquité, puisqu'elle remonte au IV° siècle, vers l'an 376 ; encore n'était-elle pas complète, puisque son auteur avait omis, comme on sait, de traduire les livres des Rois. Si on demande quelle était la version dont se servaient es Africains de la langue punique, nous sommes en mesure de conclure, de plusieurs passages de saint Augustin, quje cette chrétienté si nombreuse et si florissante ne posséda jamais les livres saints dans sa langue (3). Aussi n'en a-t-il jamais été fait mention nulle part. L'Espagne convertie de si bonne heure au christianisme, était partagée en plusieurs langues que la conquête des Romains n'éteignit pas, puisque, au VIII° siècle, selon (1) La plus célèbre version arabe est celle de Rabbi Saadia surnommé Gaon, qui, au dire des critiques les plus habiles, traduisit non pas sur le grec des Septante, comme on l'a affirmé souvent, mais sur l'hébreu et le syriaque. Des auteurs espagnols prétendent que des versions de l'Écriture en langue arabe furent faites dans leur pays dès le VIII° siècle, à l'intention des chrétiens mozarabes. Mariana atteste avoir vu manuscrite en plusieurs bibliothèques une version faite par Jean de Séville sur la Vulgate latine. On en conserve une autre dans la bibliothèque de l'Escurial, dont l'auteur est resté anonyme. Ces versions ne semblent pas avoir eu cours durant un long temps et elles n'empêchèrent pas la divulgation en Espagne de la version de Rabbi Saadia. Voir Mariana, Paul Esquinosa (Histor. Hispal., lib. VII, cap. III). Antonio (Bibliothec. hisp. vetus, t. III). (2) On sent que nous n'avons pas à parler ici des versions modernes dans les langues de l'Orient ; moins encore de celles que les sociétés bibliques ont fait exécuter de nos jours. (3) Opp., tom. II. Epist. LXXXIV. CCIX. 66 le rapport de Luitprand, on y parlait encore, outre le latin, lancienne langue espagnole, et les langues catabre, celtibérique, valentine et catalane (1). Il est certain que ces langues ne possédèrent jamais de version des Écritures. La plus ancienne, composée depuis la formation de la langue espagnole actuelle, ne remonte qu'au XV° siècle. L'Eglise des Bretons, fondée dès le II° siècle, n'eut jamais de version dans sa langue. L'Église des Anglo-Saxons que vint établir saint Augustin, à la fin du VI° siècle, attendit une traduction des psaumes jusqu'au VIII°, et l'existence d'une version complète de l'Écriture par le vénérable Bède n'est rien moins que démontrée. Ussérius parle de versions qui auraient été faites par Eadfrid, évêque de Lindisfarne vers 710, et plus tard, par les ordres et les soins d'Alfred le Grand. Il affirme même que le roi Athelstan en fit composer une par des rabbins sur l'hébreu; mais ces affirmations sont loin d'être démontrées. Peut-être même faut-il remonter jusqu'au XIII° siècle pour trouver la première version anglaise qui renferme tous les livres saints (2). Au IX° siècle, Louis le Débonnaire fit composer en vers théotisques un poème contenant toute l'histoire de l'ancien Testament, pour l'usage de ses nombreux sujets qui parlaient cette langue. Ce poème n'était pas une version ; il omettait beaucoup de choses, et donnait l'explication des sens mystiques et des allégories de la Bible. Si quelques autres traductions plus ou moins libres de l'Écriture sainte furent faites vers la même époque dans cette langue, elles n'eurent jamais pour objet le corps entier des livres saints. Ce ne fut que bien plus tard que l'Allemagne posséda une version dans sa langue. (1) Chronicon, ad ann. DCCCXXVIII, pag.
37-2. (2) J.-B. Malou. La Lecture de la sainte Bible en langue vulgaire. tom. II, pag. 313-315. 67 Il en fut de même pour la France. Jusqu'à la formation de la langue romane, il était impossible de songer à traduire les livres saints en langue vulgaire pour l'usage de nos pères, partagés qu'ils étaient entre les divers langages, celtique, gaulois, théotisque, limousin, aquitain, provençal et latin. Au XII° siècle seulement, on voit poindre une version en langue française à l'usage de la secte des Albigeois (1). Pour avoir un texte complet en français, il faut arriver jusqu'au siècle de saint Louis. Quant aux autres langues de l'Europe, elles ont attendu plus longtemps encore leur version des Écritures. Le flamand, le bohémien, le hongrois (2), l'allemand, litalien, n'en ont pas joui avant le XV° siècle. Les langues danoises et suédoises furent plus privilégiées. Ussérius assure qu'il y eut une version de la Bible en suédois, dès le XI° siècle; et le pieux dominicain Mathias, mort en 1352, traduisit toutes les saintes Écritures en suédois (3). Durant toute la longue période antérieure à la publication tardive de ces différentes versions, appelées, du reste, pour la plupart à une obscurité complète, la Vulgate latine régnait seule dans les Églises de l'Europe, depuis leur fondation. Il faut cependant excepter les Églises de la langue slavonne. Leur version fut faite, au IX° siècle, par les saints moines Cyrille et Methodius, pour l'usage des Slavons-Moraves, et elle a cela de remarquable qu'elle remonte à l'époque même de l'établissement de la foi chrétienne dans cette contrée par ces deux apôtres. Par là encore elle forme exception à toutes les autres de l'Occident, qui (1) Le Long. Bibliotheca sacra, tom. I, pag. 314. (2) La version hongroise fut exécutée au commencement du XV° siècle, par Ladislas Bathory, de l'ordre des Ermites de Saint-Paul. Voir Cuppon, Vindiciae vulgat latin editionis Bibliorum. Sect. IV, pag. 612. (3) A. Theiner. La Suède et le Saint-Siège, tom. I, traduction de M. Cohen, pag. 140. 68 n'ont vu le jour, dans chaque pays, que postérieurement à l'établissement du christianisme, et souvent bien des siècles après. De tout ceci on doit conclure que si les trois langues sacrées ont été les seules dépositaires des saintes Écritures, pendant la première période du christianisme, comme nous l'avons prouvé, les autres langues n'ont été admises que successivement, et souvent très tard à cet honneur. Rarement l'Église a favorisé ces versions ; souvent elles ont dû leur existence ou leur propagation à des hérétiques. Ainsi, il y a de fortes raisons de penser que l'Église arménienne se servait de la version syriaque dans les commencements, et qu'elle n'accepta celle de Mesrob, au moins dans la Liturgie, qu'après être tombée dans les erreurs du monophysisme (1). Ulphilas, auteur de la version gothique, était arien, ainsi que toute la nation des Goths. Il est probable que la version copte ne fut inaugurée dans les Églises de la haute Egypte qu'après l'envahissement de toute cette contrée par l'hérésie eutychienne. La première version en langue française, au XII° siècle, nous apparaît comme un produit de l'hérésie des Albigeois. Le principe des langues sacrées demeure donc reconnu pour ce qui touche les versions de l'Écriture sainte. Ces versions, réduites d'abord aux trois langues principales qui représentent le progrès primitif du christianisme, puisqu'elles sont celles des peuples auxquels il fut d'abord annoncé, ne se multiplient que lentement, et quelques-unes seulement, la copte, l'éthiopienne, l'arménienne, la slavonne, obtiennent l'honneur d'être lues dans l'église ; les autres sont destinées à l'usage privé des fidèles, quand toutefois elles ne sont pas l'uvre des hérétiques. (1) Honoré de Sainte-Marie. Réflexions sur les règles et sur l'usage, la critique, tom. III, pag. 311-313. 69 Ce point une fois établi, pour ce qui touche à l'Écriture sainte, on doit comprendre aisément que la Liturgie devait nécessairement et par les mêmes motifs prétendre au privilège des langues sacrées. D'abord, la Liturgie se compose en grande partie de passages de l'Écriture sainte, destinés à être lus dans 'l'assemblée des fidèles, et si, dans la pensée de l'Église, la majesté d'un texte immobile était nécessaire pour maintenir le respect des livres saints confiés aux fidèles, cette réserve mystérieuse ne convenait-elle pas davantage encore pour les fragments des saintes Écritures, lus du haut de l'ambon, dans la célébration des mystères ? Nous voyons même,à l'époque primitive, qu'on préféra quelquefois la version grecque pour la Liturgie, dans des Églises dont le peuple parlait la langue syriaque. Ainsi, au commencement du IV° siècle, l'Église de Palestine, bien qu'elle eut sa version syriaque, lisait en grec le texte sacré dans l'assemblée des fidèles, auxquels le lecteur ou le pontife l'interprétaient ensuite en syriaque. Saint Procope, qui souffrit le martyre en 3o3, était Lecteur dans l'église de Besan, qui est l'ancienne Scythopolis, métropole de la seconde Palestine, sous le patriarcat de Jérusalem, et ses Actes authentiques nous apprennent que sa fonction était d'interpréter, en syriaque, l'Écriture qu'il venait de lire en grec (1). Ceux qui ont objecté que saint Antoine, qui n'était pas lettré, prit le parti de se retirer au désert, après avoir entendu lire dans l'Église un passage de l'Évangile, ce qui prouverait selon eux que la Liturgie se célébrait dès lors en langue copte, dans la Thébaïde, n'ont pas réfléchi à deux choses : la première, que la version copte (1) Procopius génère Hierosolymitanus, domicilium in urbe Besan habebat, ac tria in iis
ecclesiis obibat munia; primum scilicet lectoris sacrorum librorum; alterum
interpretis linguae graecae in syriacam. (Acta S. Procopii, apud Assemani,
Acta Mart. oriental.) 70 n'existait pas encore; la seconde, que l'usage de l'Église était dès lors, comme il a été depuis, d'expliquer au peuple, en langue vulgaire, les fragments de l'Écriture choisis pour accompagner la célébration des saints Mystères. Nous ne tarderons pas à constater l'existence de plusieurs langues liturgiques dans l'Orient, différentes de la grecque et de la syriaque; mais nous ne trouverons ni une liturgie arabe, ni une liturgie persane, bien que nous venions de reconnaître l'existence de versions de l'Écriture en ces deux langues. Les Eglises de l'Occident n'ont que trois langues liturgiques, la latine, la grecque et la slavonne ; cependant, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, chaque nation de l'Europe a fini par avoir sa version de la Bible. Mais autre chose est la lecture privée des saintes Écritures, autre chose la lecture solennelle et liturgique. Cette,dernière doit être grave et mystérieuse comme les oracles divins; elle ne doit pas être sujette aux variations des langues, afin de ne pas devenir triviale et commune. Au reste, en lisant l'Écriture dans les langues sacrées, pendant le service divin, l'Église n'a fait que continuer les traditions de l'ancienne Loi. Personne n'ignore que la langue hébraïque cessa d'être vulgaire en Judée, peu après le retour de la captivité de Babylone ; ce qui n'empêcha pas qu'on ne continuât dans le temple et dans les synagogues, de lire la loi et de faire plusieurs prières en pur hébreu, quoique le peuple, qui n'usait que de l'idiome syro-chaldéen, n'entendît déjà plus la langue de ses pères. Après la lecture liturgique des passages déterminés, on lisait les paraphrases chaldaïques, sur ces mêmes passages; et cet usage de lire la loi et les diverses prières en hébreu non vulgaire était tellement inhérent aux traditions du temple de Jérusalem, que les juifs modernes s'y montrent encore fidèles, en quelques pays qu'ils soient dispersés, 71 De tout ceci nous concluons que les lectures de l'Écriture en langue non vulgaire faisant partie essentielle et considérable de la Liturgie, ainsi qu'il conste de la coutume de toutes les Églises, la Liturgie admet déjà par là même l'usage des langues sacrées. En second lieu, la Liturgie est un ensemble de formules destinées à accompagner la célébration du saint Sacrifice et l'administration des sacrements, toutes choses qui font partie du ministère propre et incommunicable des prêtres. Elle est donc de sa nature plus réservée au clergé que l'Écriture sainte elle-même. Le laïque peut quelquefois posséder une science exégétique supérieure à celle de beaucoup de prêtres ; la simplicité de sa foi peut aussi le disposer à retirer un grand fruit de la lecture des livres saints qui, comme l'enseigne l'Apôtre, ont été écrits pour notre instruction ; mais faut-il conclure de là que le commun des fidèles retirerait la même utilité de la connaissance personnelle des prières liturgiques ? L'Église a dû se montrer réservée dans son désir de communiquer au vulgaire le texte même de la parole de Dieu, quoique l'inspiration de cette divine parole soit un dogme fonda-' mental du christianisme ; serait-il raisonnable d'exposer aux interprétations indiscrètes et dangereuses de la multitude, des formules saintes qui contiennent assurément la foi de l'Église, mais qui n'ont cependant pas été dictées par l'Esprit-Saint ? Les jansénistes ont donc parfaitement senti et très justement signalé, à leur point de vue hétérodoxe, le nud véritable de la question, lorsqu'ils ont dit que l'Église, en soumettant la lecture de l'Écriture sainte en langue vulgaire à des restrictions, frustrait les fidèles d'un droit inaliénable, et qu'en célébrant les mystères dans une langue inconnue du peuple, elle leur enlevait simplement une consolation. Pour nous, catholiques, il n'en faut pas davantage; qui peut le plus, peut le moins. C'est un 72 dogme de notre foi que l'Église n'a pas erré dans ses règles restrictives de l'usage des saintes Ecritures ; donc, à plus forte raison, elle a pu, sans tyrannie, laisser dans un langage sacré et non vulgaire des formules au sujet desquelles il n'a pas été dit comme des livres saints : scrutez les Écritures (1). Les fidèles avec la permission de leur pasteurs, peuvent avoir la Bible dans leurs maisons, ils peuvent se livrer à toutes les études qui les mettront à même de profiter de la lecture qu'ils en feront avec foi et intelligence; le jour et la nuit, ils peuvent consulter ces divins oracles, avec un cur docile à l'Église qui seule en possède la clef; cependant cette auguste maîtresse des fidèles du Christ dit un solennel anathème à celui qui enseignerait que la lecture des livres saints est une obligation du chrétien. Elle ne souffre pas qu'on dise qu'il existe un devoir qui ne serait pas accessible aux pauvres, aux simples et aux ignorants qui font la majeure partie du genre humain ; comment donc son esprit pourrait-il être de prodiguer, par les langues vulgaires, l'expression des mystères les plus profonds et les plus incompréhensibles, aux oreilles de ces pauvres, de ces simples, de ces ignorants, si souvent exposés à de dangereuses erreurs, précisément parce que les lumières leur manquent ? Que la foi soit vive dans le cur des simples fidèles, que leurs yeux soient attentifs au langage des cérémonies, que des pensées vaines pu terrestres ne viennent pas troubler l'action de l'Esprit-Saint dans leurs âmes ; leur oreille entendra, par la bouche du prêtre, les accents d'une langue étrangère, mais leur cur aura tout compris. Est-ce dans nos églises de ville, où chacun des assistants est à même de suppléer, par des traductions de la messe, à la connaissance de la langue sacrée, ou dans ces rustiques (1) Joan., V, 39. 73 paroisses de campagne si fréquentées encore dans les provinces éloignées de la capitale, que l'attitude des assistants est plus recueillie, le respect de la maison de Dieu mieux observé, les mystères de la foi mieux sentis ? Si le peuple fidèle peut vivre dans la foi et la charité de Jésus-Christ, sans le secours de l'Écriture sainte en langue vulgaire, il peut donc, à plus forte raison, suppléer à l'intelligence immédiate de la langue liturgique. En outre, la Liturgie étant, selon la belle expression de Bossuet, le principal instrument de la Tradition (1), il importe que ses formules soient anciennes, et par ce moyen inviolables. Or le propre des langues vivantes est de varier et de se transformer sans cesse. La langue des livres liturgiques doit être en dehors de ces mouvements, produit du génie mobile et de la fusion des peuples ; la conservation des vérités que ces livres contiennent en dépend. L'Église n'a-t-elle pas été obligée de recourir à une langue morte pour formuler ses décisions dans les matières de foi, et si elle ne l'a pu faire, aux premiers siècles, parce que les langues grecque et latine étaient encore vivantes, quels troubles n'enfanta pas dans la société chrétienne la facilité avec laquelle le vulgaire se trouvait à même de juger de la propriété des termes employés par les conciles dans leurs décisions ? La Liturgie est une confession de foi permanente qui doit être placée au-dessus des caprices de la multitude, et c'est avoir écarté de grands dangers pour la foi que d'avoir soustrait ses formules à l'examen indiscret du vulgaire. Ajoutons que la Liturgie est le lien d'association des peuples chrétiens. Us forment une société, parce qu'ils sont unis par la participation aux mêmes mystères, aux mêmes sacrements; la conséquence est qu'une même langue doit, autant qu'il est possible, servir d'expression (1) États d'Oraison, livre VI, pag. 208, édit. de Lebel, tom. V. 74 à leurs manifestations religieuses. Les Églises qui pratiquent la même Liturgie ont toujours vécu dans une fraternité plus étroite. Cette fraternité est due à la communauté des formules ; elle est due d'abord à l'identité de la langue liturgique. Les Églises qui gardent la Liturgie romaine sont toutes unies à la Chaire de Saint-Pierre ; dans l'Orient, celles qui observent les Liturgies grecque, syrienne, copte, etc., non seulement ne sont pas unies au Siège apostolique, mais elles ne forment pas corps entre elles. Dans l'Occident au contraire, l'ancienne Église gallicane et l'Église gothique d'Espagne autrefois, les Églises du rite ambrosien aujourd'hui, les Églises de France qui se sont donné des liturgies au XVIII° siècle, ont conservé l'union avec le Siège apostolique; mais la langue latine les protégeait toutes ; avec la diversité des formules, le lien a été moins étroit, mais la fraternité du langage les a maintenues dans la chrétienté latine. Nous avons fait voir ailleurs (1) les redoutables conséquences de la diversité des Liturgies entre l'Orient et l'Occident; une même langue liturgique avec Rome eût sauvé du schisme, il y a quelques années, plusieurs millions de catholiques soumis à l'autocrate de Russie. Le royaume de Pologne toujours vivace, toujours répugnant à une odieuse fusion, toujours redouté par ses oppresseurs, personne ne l'ignore, a dû sa vitalité à sa qualité de royaume latin. Or c'est uniquement par la Liturgie qu'il est latin, et cette circonstance, en dépit des usages et de la langue slaves, a suffi pour maintenir sa glorieuse nationalité, et pour déconcerter jusqu'ici tous les stratagèmes et tous les ressorts d'une politique perfide et cruelle. Cette communauté de langue qui triomphe des races en unissant les peuples, est donc fondée sur les livres liturgiques. Par eux, l'idée d'un centre unique, d'une origine (1) Institutions liturgiques, loin. I, pag. 227. 75 commune pénètre et se maintient dans la mémoire des peuples; il n'est plus de distances, plus de frontières. Fût-il exilé ou captif chez une nation ennemie, le chrétien retrouve sa patrie avec tous ses souvenirs, jusque dans une terre étrangère. Voilà pourquoi la Liturgie, comme nous le verrons bientôt, ne parla d'abord que les trois langues sacrées qui représentaient par leur étendue la portion choisie du genre humain. Celles qui vinrent ensuite par une dégénération du principe, ne sont qu'en petit nombre, et leur inauguration a peu servi au développement de la communauté chrétienne. Mais entre les trois langues, il en est une qui domine les deux autres, par l'étendue de ses "conquêtes ; c'est la langue latine. La Liturgie la rendit le lien des peuples civilisés, l'instrument de la fraternité des nations. La réforme du XVI° siècle conspira contre cette unité sublime en réclamant l'usage des langues vulgaires dans le service divin, et l'humanité se ressentira longtemps des suites de cette scission violente et maladroite. De plus longs développements de cette vaste question ne sont pas de notre sujet; il nous suffit de les avoir indiqués. Mais, s'il est important que la langue des livres liturgiques soit fixe et inviolable, qu'elle ne soit pas purement nationale, il est aussi dans sa nature d'être mystérieuse ; elle ne doit donc pas être vulgaire. C'est un sentiment qui a fait le tour du monde, parce qu'il est fondé sur la nature, que celui qui porte à voiler les choses saintes sous l'ombre de paroles mystérieuses. Les prophètes, conduits par l'inspiration de l'Esprit-Saint, ont enveloppé d'énigmes les oracles qu'ils rendaient ; le Verbe incarné conversant avec les hommes, leur a parlé en paraboles. L'Écriture sainte tout entière, remplie de figures souvent des plus hardies, pleine d'un bout à l'autre d'allusions empruntées au génie oriental, sera toujours pour le vulgaire, en dépit des traductions, un livre mystérieux. 76 Il faut bien que les rationalistes qui se disent chrétiens, en conviennent : la plus profonde connaissance des livres saints n'enlève jamais l'exercice de la foi. Dans le demi-jour de la vie présente, les hommes ont besoin d'adorer les mystères, et non de les soumettre à une appréciation charnelle. Or, s'il en est ainsi des saintes Écritures, pourquoi, et à plus forte raison, n'en serait-il pas de même de la Liturgie dans laquelle s'opèrent les mystères simplement annoncés dans les livres saints ? L'Église a fait une application spéciale de ce principe en portant cette loi inviolable et universelle que les plus solennelles prières du Sacrifice se réciteraient à l'autel, à voix basse, quelle que soit la langue en laquelle elles soient prononcées. On conçoit que les partisans de la langue vulgaire dans le service divin aient attaqué cet usage vénérable qui les condamne. Mais en attendant que nous ayons à traiter cette importante question qui viendra en son temps, nous n'en prenons pas moins acte de cette loi auguste qui nous apprend combien l'Église tient à environner de mystère ses relations avec Dieu, et le lecteur catholique, pour peu qu'il soit attentif, ne verra qu'un seul et même principe dans le règlement qui prescrit de lire le canon à voix basse, et dans celui qui exige l'usage d'une langue non vulgaire dans la Liturgie. Nous présenterons même au Janséniste une observation des plus simples, et qui détruit toutes ses prétentions devant l'évidence des faits. Qu'il obtienne de l'Église qu'elle renonce aux langues sacrées dans la Liturgie, qu'il lui fasse observer la Novelle de Justinien, par laquelle ce digne précurseur de Joseph II, voulut, mais en vain, contraindre les évêques et les prêtres à prononcer à haute voix les paroles mystérieuses du Sacrifice, afin que le peuple pût répondre Amen, en connaissance de cause; nous lui dirons avec Thomassin : « Il était entièrement impossible que le prêtre ou l'évêque 77 pût jamais tellement élever et soutenir sa voix durant tout le canon de la messe, que cette foule innombrable de monde qui y assistait, surtout aux grandes fêtes, pût l'entendre distinctement, et ensuite répondre Amen. Une fort grande multitude s'impose donc elle-même cette nécessité, de ne pouvoir entendre ce que le sacrificateur prononce, quoiqu'elle puisse fort bien entendre un prédicateur qui publie l'évangile d'un lieu éminent, d'une voix tonnante, et avec un effort et une contention qui ne conviendraient nullement à un sacrificateur ou à un pontife, souvent chargé d'années et destitué de forces (1). » Ces paroles d'un auteur d'ailleurs assez facile sur la question de la langue liturgique, font parfaitement comprendre que dans la Liturgie le lien entre le sacrificateur et le peuple est la foi, en même temps qu'elles expliquent la différence essentielle qui existe entre l'autel et la chaire. Le but de la Liturgie est de mettre les hommes en rapport avec Dieu par la religion ; mais, s'il est vrai de dire que la science des langues sacrées apporte de précieux avantages pour cette communication à ceux qui les possèdent, à la condition cependant que leur foi soit simple comme celle du peuple, Dieu et son Église n'oublient pas pour cela les simples qui sont la partie la plus nombreuse du troupeau, les simples qui ne comprendraient pas même toujours les formules saintes, quand bien même elles seraient proférées en langue vulgaire à leurs oreilles. L'homme absorbé dans les nécessités de la vie matérielle n'a pas d'ordinaire les idées à la hauteur d'un langage sublime; il suffit à Dieu que son cur soit pieux, et qu'il aspire à posséder par la vertu le bien qu'il ne comprend pas, mais dont la grâce divine lui inspire l'attrait. A ceux-là, la Liturgie, en quelque langue qu'elle s'exprime, est (1) Traité de l'Office divin, Ière partie, chap. VIII, n. 10. 78 toujours lumineuse, et lAmen qui s'échappe de leur poitrine toujours en plein rapport avec les vux que le prêtre fait entendre à l'autel. Les croisés de Godefroy de Bouillon, les paysans vendéens qui se levèrent seuls pour la liberté de leur foi, les défenseurs de Saragosse en 1809, n'ouïrent jamais célébrer le service divin dans leur langue maternelle ; leur amour pour les mystères, auxquels ils sacrifièrent tout ce qu'ils avaient de plus cher au monde, en fut-il moins pur ou moins ardent ? Veut-on connaître la source de cet amour plus fort que la mort ? nous la dévoilerons en jetant le défi au rationalisme. C'est que la vertu de Dieu descend, par l'intermédiaire des paroles saintes, dans les curs qu'elle trouve ouverts. L'oreille ne perçoit pas, mais l'âme entend, comme disait un homme rustique, parlant de la prédication de son évêque. Dieu a placé dans les mots sacrés une puissance. La forme des sacrements a-t-elle besoin d'être comprise par ceux sur lesquels elle opère ? l'effet des sacramentaux dépend-il de l'intelligence des fidèles auxquels l'Église les applique ? Et, à ce propos, nous ne saurions résister au désir de citer ici un magnifique passage d'Origène, qui expliquait ainsi, il y a plus de quinze siècles, les effets merveilleux produits dans les âmes par la seule prononciation des paroles de la sainte Écriture par ceux mêmes qui ne les comprennent pas : Dieu fasse que cette doctrine si élevée et si simple ne paraisse pas trop nouvelle à nos lecteurs ! « Il est des choses qui semblent obscures, mais qui par cela seul qu'elles pénètrent nos oreilles, apportent cependant une grande utilité à notre âme. Si les gentils ont cru que certaines poésies qu'ils appellent enchantements, certains noms qui ne sont même pas compris de ceux qui les invoquent, murmurés par ceux qui font profession de magie, endorment les serpents ou les font sortir de leurs cavernes les plus profondes ; si l'on dit 79 que ces paroles ont la vertu de faire disparaître des fièvres et des maladies du corps humain, qu'elles peuvent même quelquefois jeter les âmes en une sorte d'extase, quand la foi du Christ n'en arrête pas l'effet ; combien devons-nous croire plus forte et plus puissante la récitation des paroles, ou des noms de l'Écriture sainte ? De même que, chez les infidèles, les puissances mauvaises sitôt qu'elles entendent ces noms ou ces formules, accourent et viennent prêter leur secours à l'uvre pour laquelle elles se sentent appelées, selon les mots qui ont été proférés, obéissant à l'homme au service duquel elles se sont vouées ; à plus forte raison les Vertus célestes et les anges de Dieu, qui sont avec nous, comme le Seigneur l'a appris à son Eglise, au sujet même des petits enfants, sont réjouis en entendant sor tir de notre bouche, comme de pieux enchantements, les paroles de l'Écriture et les noms qui s'y lisent. Que si nous ne comprenons pas les paroles que profère notre bouche, ces Vertus qui nous assistent les entendent, et invitées comme par un chant qui les attire, s'empressent d'arriver et de nous porter secours. « C'est une vérité incontestable qu'il est un grand nombre de Vertus au milieu de nous, auxquelles est confié le soin de nos âmes et de nos corps. Comme elles sont saintes, elles se délectent à nous entendre lire les Écritures; mais leur sollicitude pour nous redouble, quand nous proférons des paroles qui portent notre esprit à la prière, tout en laissant notre intelligence sans lumière. Le saint apôtre l'a dit, et a révélé un mystère digne d'admiration pour l'homme, quand il a enseigné qu'il peut arriver quelquefois que l'esprit qui est en nous soit en prière, et que cependant notre intelligence demeure privée de son exercice (1). Comprenez donc ce qu'il nous (1) I Cor., XIV. 80 apprend par ces paroles. Les Vertus qui sont données à notre âme pour la secourir, et qui sont comme notre esprit, se repaissent comme d'une nourriture divine et intellectuelle, dans les paroles de l'Ecriture qu'elles nous entendent prononcer. Mais que dis-je de ces Vertus célestes ? Jésus-Christ Notre-Seigneur lui-même, s'il trouve notre bouche occupée à proférer les paroles de la divine Ecriture, non seulement daigne se nourrir en nous, mais, s'il y trouve un tel festin préparé, il y descend avec le Père. Et si ces merveilles vous semblent trop élevées et au-dessus de l'homme, elles sont cependant appuyées, non sur ma doctrine, mais sur la parole du Seigneur et Sauveur lui-même, qui a dit : « En vérité, je vous le dis : Moi et mon Père nous viendrons, et nous demeurerons, et nous souperons avec lui (1). Avec qui ? avec celui qui garde ses commandements. « Ainsi donc, par cette pieuse application, nous attirons en nous la compagnie, et nous nous assurons le secours des Vertus divines, en même temps qu'en prononçant ces paroles et ces noms, nous repoussons les embûches des puissances mauvaises. De même que vous avez vu quelquefois un serpent endormi par des enchantements, se laisser porter à la main, ou encore se laisser tirer de son trou,sans plus pouvoir nuire par son venin dans lequel il a subi la puissance du charme ; ainsi par la vertu de la divine lecture, si vous la supportez avec patience, si vous tenez bon contre l'ennui, si vous ne détournez pas l'oreille, le serpent ennemi qui pourrait être en nous, le reptile qui nous y tendait des embûches, se retire de notre cur, expulsé par les chants des Écritures, par l'assiduité à la parole divine. Ne devenez donc pas semblables à l'aspic qui est sourd et qui bouche (1) Joan., XIX, 23. 81 ses oreilles, pour ne pas entendre la voix de l'enchanteur et du magicien habile (1). » Nous nous sommes laissé aller au plaisir de citer ce long passage (2) qui explique mieux que tous les raisonnements l'influence des paroles saintes sur la multitude recueillie, en présence des mystères. Ce que Origène dit ici de l'Écriture sainte, s'applique, proportion gardée, à la Liturgie (3). Ses formules sont sacrées, l'Eglise les a produites par le mouvement et sous l'assistance de l'Esprit qui dicta les Écritures, et c'est pour cela même que le sentiment de la foi répugne à employer dans le sanctuaire, à lire au saint autel, des paroles composées par les hérétiques, fussent-elles d'ailleurs pures quant à la doctrine; Aussi le trente-deuxième canon du concile de Laodicée a-t-il été inséré au corps du droit comme renfermant l'esprit même de l'Église. Il est ainsi conçu : « Il ne faut point recevoir les bénédictions des hérétiques ; car elles sont des malédictions, et non pas des bénédictions (4). » Mais si l'Église sait que les paroles de la liturgie, (1) Psalm. LVIII, 4, 5. (2) Vid. la note B, à la fin du chapitre. (3) Origène n'est pas le seul à avoir remarqué l'influence des paroles sacrées, lors même que l'intelligence ne comprend pas ce qu'entend l'oreille. Nous lisons dans les vies des Pères des déserts d'Orient, que le saint abbé Pmen et plusieurs des illustres fondateurs de la vie monastique dans la Thébaïde, avaient expliqué pareillement la vertu intrinsèque des paroles de l'Écriture, en empruntant la comparaison des formules qui servaient aux enchantements. ( Vitae Patrum, pag. 507. Rufin. lib. III, cap. XL.) Ce fait fut rappelé, en 1673, par le Patriarche des Maronites, dans une lettre insérée au troisième volume de la Perpétuité de la Foi (pag. 719), pour expliquer comment la Liturgie en langue non vulgaire ne laisse pas d'être utile au peuple fidèle. D'autres saints Docteurs ont remarqué les mêmes effets de la parole sainte; nous citerons seulement saint Jean Chrysostome, dans son troisième discours sur Lazare, n° 2. (4) Non oportet haereticorum benedictiones accipere, quoniam magis sunt maledictiones, quam benedictiones. (Causa I, quaest. 1, can. 66.) 82 même prononcées dans une langue étrangère, épanchent sur le peuple fidèle une grâce de sanctification et l'unissent au divin objet de nos mystères, elle ne veut pas pour cela que ce peuple qu'elle enfante à la lumière divine ignore les trésors de vérité et de vie que recèlent les paroles sacrées. S'il est interdit au prêtre d'emprunter la langue vulgaire dans ces moments redoutables où il est placé entre le ciel et la terre, comme un médiateur puissant qui unit l'un à l'autre, il lui est ordonné d'instruire les fidèles, du haut de la chaire, non seulement des vérités générales de la religion, mais spécialement des choses qui sont renfermées sous les paroles liturgiques. Voici le décret formel du saint concile de Trente qui exprime l'intention de l'Eglise à ce sujet : « Quoique la messe renferme un grand fond d'instruction pour le peuple fidèle, il n'a cependant pas semblé aux Pères qu'il fût à propos qu'on la célébrât en langue vulgaire. C'est pourquoi chaque Église retiendra ses rites antiques et approuvés par la sainte Église romaine, mère et maîtresse de toutes les Églises ; mais afin que les brebis du Christ ne souffrent pas de la faim, et que les petits enfants ne demandent pas du pain quand il n'y aurait personne qui leur en rompît, le saint concile ordonne aux pasteurs et à tous ceux qui ont charge d'âmes, d'expliquer souvent durant la célébration de la messe, par eux ou par d'autres, quelque chose des formules qui se lisent à la messe ; et entre autres d'exposer quelques détails sur le mystère de ce très saint sacrifice, principalement les dimanches et fêtes (1). » L'Église, dont le pouvoir ne s'étend pas jusqu'à donner au peuple l'intelligence d'une langue qu'il n'a pas apprise, a donc pourvu avec sollicitude à l'instruction de ses fidèles, et ce n'est donc pas pour les maintenir dans (1) Conc.
Trid. Sess. XXII, cap. VIII. 83 l'ignorance qu'elle a prescrit l'usage des langues sacrées dans la célébration des mystères. Le protestantisme a détruit la religion en abolissant le sacrifice ; pour lui l'autel n'existe plus ; il n'a plus qu'une table ; son christianisme s'est concentré uniquement dans la chaire. L'Église catholique sans doute se fait gloire de la chaire de vérité ; car la foi est de l'ouïe (1) : du haut de cette chaire elle proclame sa doctrine immuable et victorieuse, dans la langue du peuple qui l'écoute ; mais sa mission n'est pas uniquement d'instruire ce peuple. Si elle lui révèle les vérités divines, c'est afin de l'unir à Dieu par les mystères de l'autel ; après avoir éclairé sa foi, elle le met en communication avec Dieu par l'amour. Quand elle a fait naître en lui le désir du bien infini, en présence duquel il n'y a plus ni savant ni ignorant, elle remonte comme Moïse sur la montagne, et sa voix cesse de se faire entendre aux oreilles, pour ne plus retentir que dans les curs. Les accents d'une langue mystérieuse retentissent seuls dans l'assemblée sainte, et transportent la pensée au delà des limites du présent; ceux mêmes qui comprennent cette langue sont avertis que quelque chose d'extraordinaire s'accomplit ; bientôt les paroles de ce langage sacré viennent se perdre dans un silence au sein duquel Dieu seul entend ; mais les cérémonies symboliques continuent toujours, et par leurs formes visibles ne cessent d'élever le peuple saint à l'amour des choses invisibles. Telle est la religion dans l'Église catholique ; en rapport avec les besoins de l'humanité et avec l'infini, toujours grande et simple, mais trop simple pour être comprise par les esprits qui croient pouvoir raisonner le sentiment. C'est ce que n'avaient pas assez senti la plupart des auteurs catholiques des deux derniers siècles qui (1) Rom., X, 17. 84 traitèrent la question de la langue vulgaire dans la Liturgie. Aujourd'hui que le protestantisme, dévoré dans son propre sein par le principe rationaliste duquel il est sorti, n'a plus la force de rien affirmer, et peut à peine constater les pertes journalières qui lépuisent, la lutte a, pour ainsi dire, cessé. Le catholicisme triomphant reçoit chaque jour dans son sein des hommes qui se jettent à lui, subjugués par l'aspect imposant de sa doctrine immuable et de ses institutions qui expriment cette doctrine avec tant de grandeur et de simplicité. Ces nouvelles recrues ne s'arrêtent pas dans les étroits sentiers du gallicanisme, comme faisaient au XVII° siècle les convertis qui se rendaient à l'Exposition de la foi catholique, ou pour lesquels la révocation de l'édit de Nantes avait été l'occasion de prendre enfin un parti. Quant aux écrivains catholiques, ils peuvent tout dire aujourd'hui sans crainte, et personne ne s'est avisé, comme on l'eût fait au XVIII° siècle, de taxer d'enthousiasme ou d'illuminisme les deux grands auteurs qui s'expriment sur les langues sacrées en les termes que nous transcrivons ici : « C'est une chose remarquable : les oraisons en langue latine semblent redoubler le sentiment religieux de la foule. Ne serait-ce point un effet naturel de notre penchant au secret ? Dans le tumulte de ses pensées et des misères qui assiègent sa vie, l'homme, en prononçant des mots peu familiers et même inconnus, croit demander les choses qui lui manquent et qu'il ignore; le vague de sa prière en fait le charme, et son âme inquiète, qui sait peu ce qu'elle désire, aime à former des vux aussi mystérieux que ses besoins (1). » « Quant au peuple proprement dit, s'il n'entend pas les mots, c'est tant mieux. Le respect y gagne, et l'intelligence n'y perd rien. Celui qui ne comprend point, (1) Génie du Christianisme, IVe partie, liv. I, chap. IV. 85 comprend mieux que celui qui comprend mal. Cornet ment d'ailleurs aurait-il à se plaindre d'une religion qui fait tout pour lui ? c'est l'ignorance, c'est la pauvreté, c'est l'humilité qu'elle instruit, qu'elle console, qu'elle a aime par-dessus tout. Quant à la science, pourquoi ne lui dirait-elle pas en latin la seule chose qu'elle ait à lui dire : Qu'il ny a point de salut pour lorgueil (1) ? » Mais il est temps de voir en quelle manière l'Église a appliqué, dans le cours des siècles, le principe des langues sacrées dans le service divin. La Liturgie est, par le fait, célébrée en diverses langues. Les protestants nous l'objectent avec complaisance ; les auteurs catholiques dont nous avons parlé, semblent en triompher avec une joie secrète. Les uns et les autres ont tort de s'arrêter à la surface de la question au lieu de la pénétrer avec fermeté. Ils ne se rendent pas compte de deux faits, qui suffisent à eux seuls pour briser à jamais toutes leurs espérances. Le premier de ces faits est qu'il y a beaucoup plus de nations chrétiennes que de langues liturgiques ; ainsi voilà toujours la majeure partie des fidèles privée d'entendre dans sa langue les paroles de la Liturgie. Le second fait est que les langues employées par différents peuples dans le service divin ont toutes cessé d'être vulgaires, et, depuis bien des siècles, ne sont plus parlées chez les peuples qui les entendent à l'autel. Nous allons exposer historiquement la marche de la Liturgie dans ses rapports avec les langues. Nous ne faisons aucune difficulté de convenir que l'Église, à son origine, a dû commencer par employer la langue vulgaire à l'autel. Nos adversaires en voudraient-ils tirer avantage ? nous leur demanderions s'il trouveraient bon qu'une société parvenue à l'âge parfait demeurât (1) Du Pape, livre I, chap. XX. 86 soumise aux conditions qu'elle dut subir à son berceau. Dans les premiers jours du christianisme, nous voyons les apôtres saint Pierre et saint Jean allant offrir leurs prières au temple de Jérusalem, quoique le voile se fût déchiré du haut en bas, au moment où le Christ expirait sur la croix. C'est sous les portiques de ce temple maudit et déshérité, dont bientôt il ne restera pas pierre sur pierre, que la prédication apostolique retentit maintes fois, dans les premiers jours qui suivent la venue de l'Esprit-Saint, parce que les disciples du Christ savent qu'ils y trouveront des Juifs disposés à les entendre parler de l'accomplissement des prophéties. Pour ménager la susceptibilité de la synagogue, nous voyons saint Paul circoncire son disciple Timothée. Dans le concile de Jérusalem, si les Apôtres proclament enfin l'affranchissement des fidèles à l'égard des cérémonies légales, ils maintiennent encore l'antique défense de se nourrir du sang et des viandes suffoquées. S'agit-il de choisir des évêques pour présider aux nouvelles chrétientés, on accepte ceux qui sont dans les liens du mariage, pourvu qu'ils n'aient eu qu'une seule femme. Nous ne finirions pas si nous voulions entreprendre l'énumération complète des conditions extraordinaires que l'Église dut subir à son berceau ; ce n'est donc pas à cette époque primordiale qu'il faut aller demander en toutes choses les formes disciplinaires vers lesquelles l'Église tendait par sa nature, et qu'elle devait réaliser quand elle jouirait de sa parfaite indépendance. Nous convenons donc sans aucune peine que l'Église, ns la première période, a célébré les saints mystères en langue vulgaire. Il en a été de la Liturgie comme des saintes Écritures du Nouveau Testament; le privilège a été pour le premier âge, et il en devait être ainsi. Le temps seul peut faire d'une langue vulgaire une langue sacrée : l'homme n'invente pas les langues à priori. Elles 87 peuvent cesser d'être parlées, s'éteindre comme langues vivantes, sauf à recevoir une nouvelle vie par la consécration de la science et de la religion. Ainsi donc, les Apôtres et leurs premiers successeurs célébrèrent la Liturgie dans la langue des peuples, dans cette même langue qui leur servait pour donner à ces peuples l'instruction. Mais, comme l'exprime excellemment saint Thomas, quand les fidèles furent instruits, quand ils eurent connu le sens des choses qu'ils entendent réciter dans l'office pour lequel ils se réunissent, on fit les prières en langue non vulgaire (1). » Nous ne manquerions pas d'arguments pour rapporter déjà à cette époque primitive, où le texte de l'Écriture et la Liturgie étaient en langue vulgaire, l'usage de réciter à voix basse les prières les plus solennelles du sacrifice ; nous pourrions insister sur ce que nous avons dit sur l'impossibilité, dans une assemblée nombreuse, d'entendre toujours la voix du prêtre à l'autel, ce qui réduit considérablement l'importance de la langue vulgaire dans la Liturgie; nous aimons mieux élargir la discussion en établissant par les faits que si, dans l'Église primitive, on employa la langue vulgaire à l'autel, ce privilège, durant les trois premiers siècles, ne s'étendit pas à d'autres langues qu'aux trois qui avaient figuré sur le titre de la croix du Sauveur, hébraïque ou syriaque, grecque et latine. Pour ce qui regarde les Apôtres eux-mêmes, il est hors de doute qu'ils ont célébré la Liturgie dans les langues des peuples qu'ils instruisaient ; c'est le sentiment des différents auteurs qui ont agité la question qui nous occupe; mais en même temps il faut reconnaître que la plupart des Apôtres n'ont point dépassé dans leurs pré- (1) Dicendum est quod hoc forte fuit in Ecclesia primitiva ; sed postquam fideles instructi sunt, et sciunt quae audiunt in communi officio, fiunt benedictiones in latino. (In cap. XIV, epist. I, ad Corinth., lect. III.) 88 prédications les limites des pays au sein desquels se parlaient les trois langues bibliques. Le latin était connu dans toute l'étendue de l'Empire ; le grec était plus répandu encore; le syriaque, avec ses divers dialectes, s'avançait au loin dans l'Orient soumis aux Romains. Quant à ceux des Apôtres qui auraient prêché à des peuples chez lesquels les trois langues n'avaient pas pénétré, rien ne s'oppose à ce qu'on admette qu'eux aussi aient célébré la Liturgie dans la langue de ces peuples ; le contraire du moins serait impossible à démontrer. Nous ferons observer toutefois, que ces Apôtres ne leur ont point donné l'Écriture sainte dans leur langue, et ne leur ont rien laissé d'écrit sur la Liturgie. Il faut même ajouter qu'ils n'y ont pas fondé d'Églises au moins d'une manière durable, puisqu'il a fallu, dans les siècles suivants, prêcher de nouveau la foi dans l'Inde, l'Ethiopie et autres régions lointaines qu'on prétend avoir été visitées par quelques Apôtres. Ce sont donc d'abord les trois langues dépositaires des oracles divins qui furent chargées d'exprimer à Dieu les vux de son Église, et véritablement on ne peut s'empêcher de plaindre les auteurs catholiques qui se sont permis de traiter avec légèreté cette croyance primitive qui a pour elle les monuments et les plus solides conjectures. Sans doute, on a eu tort d'écrire au XVI° siècle que la Liturgie n'avait jamais parlé plus de trois langues; mais l'ignorance où l'on était alors sur les choses de l'Orient excuse les controversistes qui portent la responsabilité de cette méprise. Que si d'autres, à la même époque, ont placé la langue hébraïque parmi les trois que revendique la Liturgie primitive, on devait entendre leur assertion de la langue syriaque, qui était l'hébreu parlé au temps de Jésus-Christ et des Apôtres, et Renaudot a fait une dépense inutile de son érudition lorsqu'il a pris la peine de prouver qu'il est absurde de dire que la Liturgie ait jamais été célébrée dans l'hébreu de Moïse et 89 d'Isaïe. Quant à ce qu'il ajoute que de telles méprises trahissent la cause catholique, au lieu de la défendre (1), il faut convenir que c'est donner beaucoup trop d'importance à une erreur de fait qui se rapporte au premier âge de la controverse contre les protestants, comme si Bellarmin et Du Perron n'avaient pas fait oublier Eckius et quelques autres débutants dans une polémique à laquelle la scolastique ne les avait malheureusement pas préparés. Les Apôtres ayant célébré d'abord la Liturgie à Jérusalem, il est probable qu'ils l'ont fait en syriaque, et que cette langue est la première qui ait été employée dans la Liturgie. Le grec, il est vrai, était parlé dans la Syrie ; mais on ne peut disconvenir que le dialecte syro-chaldéen ne formât le langage usuel de la nation juive; aussi figure-t-il le premier sous le nom d'hébreu au titre de la Croix. Il était juste que la langue qu'avait parlée le Sauveur, et dans laquelle fut écrit le premier Évangile, eût aussi l'honneur de servir la première à la Liturgie. Cette langue se rattachait à l'ancien hébreu et avait reçu les derniers livres de lAncien Testament ; elle fut bientôt en possession d'une version complète de l'Écriture par la traduction successive des anciens livres hébreux et des nouvelles Écritures en langue grecque ; il était donc dans la nature des choses qu'elle eût la première les honneurs de l'autel chrétien. Toutefois, il faut convenir que la langue grecque ne le cède guère en antiquité à la langue syriaque dans la Liturgie. Le grec était aussi répandu dans la Syrie que le syro-chaldéen. On peut même dire que dans les principales villes de cette contrée, la première de ces deux langues était d'un usage plus fréquent que la seconde. Dès les premières années du christianisme, la foi pénétra dans Antioche et avec un tel succès que le nom chrétien, (1) Liturgiae Orientales. Dissertat, praelimin., tom. I, pag. XIII. 90 comme nous l'apprend saint Luc (1), commença dans cette ville. La presque totalité des livres du Nouveau Testament fut écrite dans la langue grecque, que les Apôtres préférèrent, comme plus répandue, à celle qu'ils avaient parlée à Jérusalem, et nous avons vu que, dans le III° siècle, à Scytopolis de Palestine, on lisait encore dans l'église l'Écriture en grec, ce qui obligeait le lecteur à l'expliquer ensuite en syriaque au peuple. On peut donc dire que si la langue syriaque a eu les premiers honneurs de la Liturgie, la langue grecque, déjà sanctifiée par la version des Septante, par le privilège d'avoir reçu en original le livre de la Sagesse et le second des Machabées, et enfin la plupart des livres du Nouveau Testament, fut bientôt proclamée par le fait la langue chrétienne par excellence. Saint Paul écrivant aux Romains le faisait en grec, et saint Clément, le premier pape dont nous ayons conservé les écrits, les composa dans la même langue. A la fin du IV° siècle, saint Jean Chrysostome prêchait encore en grec ses homélies au peuple d'Antioche, et saint Cyrille les siennes au peuple d'Alexandrie, dans le siècle suivant. Cependant, la langue latine ne devait pas tarder à obtenir aussi son rang parmi les langues liturgiques. Il suffisait pour cela que la foi pénétrât dans l'Occident. Saint Pierre et saint Paul ayant fondé l'Église romaine, et le prince des apôtres transférant d'Antioche son siège dans la capitale de l'empire, la langue du peuple-roi qui reçut probablement l'Évangile de saint Marc en texte original, et dans laquelle les saintes Écritures furent si promptement traduites, arrivait tout naturellement à prendre sa place parmi les langues liturgiques. La troisième sur le titre de la croix, la troisième dans l'ordre de la prédication évangélique, c'est à elle, cependant, qu'étaient réservées les plus hautes destinées; mais elle (1) Act., XI, 26. 91 n'en jouit pas immédiatement ; et nous devons remarquer, à l'avantage de notre thèse, que le grec paraît avoir été jusqu'au me siècle la langue officielle de l'Église romaine, aussi bien dans la Liturgie que dans les actes de ses pontifes. Les trois langues régnèrent seules dans le sanctuaire jusqu'à la paix de l'Église, de même qu'elles possédèrent seules, durant cette période, le texte ou la version des saintes Écritures. De nombreuses nations, pendant ces trois siècles, furent appelées à la lumière de l'Évangile; mais puisqu'il faut bien reconnaître qu'elles ne possédèrent pas de versions du texte sacré dans leurs langues, nous soutenons qu'elles ne célébrèrent pas non plus la Liturgie en langue vulgaire, jusqu'à ce que nos adversaires nous en aient apporté au moins l'ombre d'une preuve. Nous avons fait voir les raisons à fortiori, qui militent pour les langues sacrées dans la Liturgie plus encore que pour les saintes Écritures, dont l'usage peut convenir aux simples fidèles avec certaines précautions, tandis que la Liturgie concerne surtout les prêtres et les pontifes, et ne s'exerce que dans le sanctuaire, et dans les moments consacrés au service divin. Mais le temps arriva où les langues liturgiques se multiplièrent. N'allons pas croire cependant que chaque peuple chrétien ait eu la sienne ; ici nous rencontrons encore un privilège. Nous avons vu que dans le IV° siècle la haute Egypte commença à jouir d'une traduction des livres saints en langue copte; on peut rapporter à la même époque l'usage de célébrer en cette contrée la Liturgie en la même langue. Parmi les souscriptions des conciles d'Éphèse et de Chalcédoine, au V° siècle, on trouve celles de plusieurs évêques égyptiens qui signent en copte. Il est naturel de penser que dès lors ces prélats se servaient de cette langue dans les offices divins. Cet usage s'étendit peu à peu à l'Egypte entière, à la faveur des 92 progrès du monophysisme, qui éleva un mur de séparation entre les chrétiens d'Egypte et les Grecs demeurés catholiques. L'invasion musulmane, qui apportait avec elle la barbarie, acheva de ruiner en Egypte l'usage de la langue grecque, et le copte y régna bientôt seul dans la Liturgie. L'Ethiopie paraît n'avoir jamais célébré la Liturgie que dans sa langue ; mais nous avons vu que sa conversion au christianisme ne date que du IV° siècle. Cette Église est plongée, depuis plus de douze siècles, dans les erreurs du monophysisme, et n'a fait depuis lors que d'inutiles efforts pour s'en retirer. L'Église arménienne, fondée par saint Grégoire l'Illuminateur vers la fin du III° siècle, ne fait pas remonter sa version de la Bible au delà du V°. On en doit conclure qu'elle célébrait antérieurement les saints mystères dans la langue où elle avait lu jusqu'alors les saintes Écritures, c'est-à-dire en syriaque. Nous voyons, il est vrai, saint Basile occupé à chercher des personnes qui connussent la langue arménienne, pour l'accompagner, lorsqu'il alla visiter la petite Arménie, afin d'y établir des évêques ; mais ce fait se rapporte au IV° siècle. Il nous faut encore ici reconnaître que l'abandon de la langue sacrée, pour en attribuer le privilège à une langue nationale, n'a pas profité non plus à l'Église arménienne; car, depuis le V° siècle, elle est captive dans les liens de l'hérésie monophysite, dont elle a jusqu'ici vainement cherché à s'affranchir. Nous trouvons encore, au IV° siècle, une quatrième langue liturgique, en dehors des trois anciennes auxquelles nous avons donné le nom de sacrées ; c'est la langue gothique. Les Grecs ariens de Constantinople livrèrent les saints mystères aux Goths, en même temps qu'ils leur enseignèrent leur croyance impie. Mais cette nation barbare s'étant établie en Espagne, après avoir fait la 93 conquête de ce pays, changea promptement la langue de sa Liturgie d'origine grecque, et adopta le latin dans le service divin. La langue gothique ne saurait donc être comptée au nombre des langues liturgiques en usage aujourd'hui, n'ayant été dépositaire des saints mystères que durant un petit nombre d'années, à la suite desquelles on l'a vue s'éteindre d'elle-même. Nous ne placerons pas non plus la langue géorgienne au rang des langues liturgiques. Il est vrai que les chrétiens de cette contrée reçurent la Liturgie de Constantinople en leur langue, et qu'elle y existe encore; mais cette nation, qui est à peine de trois cent mille âmes, compte plus d'un tiers d'arméniens, de juifs et de mahométans. En second lieu, les abus que l'ignorance a introduits dans ce pays sur l'administration essentielle du baptême, permettent à peine de compter cette petite nation au nombre des peuples chrétiens. Enfin, la Géorgie faisant maintenant partie des pays soumis à l'autocrate de toutes les Russies, il est hors de doute que les débris de cette Liturgie, déjà entamés par le rite de l'Eglise russe, finiront par succomber sous l'envahissement graduel du slavisme (1). (1) Dom Martène et d'autres écrivains modernes qui ont cherché à amoindrir l'importance des faits que nous signalons, en exagérant le nombre des langues dans lesquelles la Liturgie a été célébrée, ont insisté sur le fait relatif à saint Antoine, que nous avons expliqué ci-dessus (page 69) et qui n'a véritablement aucune portée. Ils ont réuni plusieurs passages des Pères dans lesquels il est dit que toutes les nations louent Dieu, et célèbrent sa gloire dans leurs langues diverses. Il est évident que ceci doit s'entendre de toute autre sorte de louange que de la louange liturgique. Il n'a jamais été interdit aux chrétiens de quelque nation que ce soit de chanter des cantiques en leur langue; l'Apôtre y exhorte même tous les fidèles. Mais, si des Liturgies eussent existé dans la langue de tous les peuples, comment se fait-il qu'elles ne se soient pas conservées ? qu'on n'en trouve nulle part aucune mention ? Il faut donc entendre les paroles des Pères d'une louange de Dieu privée et familière, et non d'une forme liturgique. Nous accorderons même, si l'on veut, que les Psaumes qui sont l'aliment spirituel et la consolation du chrétien auront pu être traduits de bonne heure pour l'usage des fidèles, dans la plupart des langues parlées par des chrétiens; mais le Psautier n'est pas à lui seul la Liturgie. On allègue avec complaisance un fait du VI° siècle, relatif au saint abbé Théodose le Cénobiarque. Il est dit dans sa vie publiée par Allatius, qu'il avait bâti quatre églises dans son monastère. La psalmodie était célébrée dans la première par les Grecs, dans la seconde par les Besses, dans la troisième par les Arméniens, dans la quatrième par les Frères qui étaient tourmentés de l'esprit malin. On faisait séparément dans ces quatre églises les lectures dont se composait la messe des Catéchumènes, et quand le moment d'offrir le Sacrifice était arrivé, tout le monde se réunissait dans l'église des Grecs, pour accomplir les mystères et pour y participer. On voit de même dans la vie de saint Sabbas qui vivait pareillement au vie siècle, que son monastère était composé en partie d'Arméniens qui accomplissaient aussi en particulier la psalmodie dans leur langue, et se réunissaient ensuite dans l'église des Grecs pour le sacrifice. Nous avouons ne pas comprendre l'avantage que nos savants adversaires pensent retirer de ces faits. Ils prouvent surtout que la langue vulgaire n'est pas nécessaire dans la Liturgie, puisque ces moines qui psalmodiaient, il est vrai, dans leurs langues, se rassemblaient pour assister à la messe dans une langue qui n'était pas celle du plus grand nombre. C'est une application des principes que nous avons soutenus; nous n'y pouvons voir autre chose. Ajoutons que la Liturgie arménienne existait déjà à cette époque, et que les moines de cette nation auraient pu la célébrer tout aussi bien qu'ils accomplissaient la psalmodie en leur langue; cependant saint Théodose et saint Sabbas exigent qu'ils assistent à la messe célébrée en grec, que ces Arméniens n'entendent pas. Ces faits n'offrent donc que la confirmation de ce que nous avons vu jusqu'ici. Quant aux Besses, on n'est pas d'accord sur la désignation de ce peuple auquel appartenaient les moines qui psalmodiaient dans la seconde église du monastère de saint Théodose; il serait donc difficile de dire quelle langue ils parlaient. Quoi qu'il en soit, on n'a jamais pu découvrir la plus légère trace d'une liturgie dans la langue des Besses, qu'ils aient fleuri dans la basse Mysie, ou qu'ils aient été, selon d'autres, les anciens habitants de la Bosnie. 94 Enfin nous ne tenons pas compte de l'introduction de la langue roumaine dans quelques Églises des bords du Danube. Ce fait est d'une date récente, et il n'a pu se produire qu'à la faveur du schisme ; si le Saint-Siège n'a pas cru possible de déraciner cet abus, quand un heureux mouvement a ramené vers lui une partie des Roumains de la Transylvanie, il n'est pas possible de tirer de cette 95 condescendance un argument contre la thèse que nous soutenons. Ainsi, en dehors des trois langues du titre de la croix, il faut en compter trois autres dans l'Orient qui sont présentement admises dans la Liturgie : le copte, l'éthiopien et l'arménien, auxquels nous joindrons, tout à l'heure, pour l'Occident, le slavon. Il est bien évident que le nombre de ces langues n'est pas en rapport avec celui des nations chrétiennes : si donc on veut soutenir, comme l'ont fait les protestants et les jansénistes, que les droits essentiels du peuple fidèle sont lésés, du moment qu'il n'entend pas la messe en langue vulgaire, il faut dire que l'Église s'est rendue coupable de cette injustice dans toutes les parties du monde, et dans tous les siècles du christianisme. Mais ce n'est pas tout, et le lecteur verra bien mieux encore, dans ce qui nous reste à dire, le véritable esprit de l'Église ; disons mieux, ce qu'exigeait la nature même des mystères, et ce qu'elle a produit sans effort, et sans qu'il ait été besoin d'avoir recours à l'ombre même d'une loi. Le savant Usserius s'est jeté dans une méprise inexcusable, lorsqu'il s'est avisé, dans un livre imprimé, il est vrai, après sa mort, de mettre en parallèle, quant à la langue liturgique, l'Église romaine et celles de l'Orient, bien persuadé que l'Église romaine était la seule qui repoussât la langue vulgaire. Les Syriens, dit-il avec triomphe, célèbrent le service divin en syriaque, comme les Grecs en grec, les Coptes en copte, les Arméniens en arménien, les Éthiopiens en éthiopien (1). » Pourquoi n'ajoutait-il pas : et l'Église latine en latin? Toute la question est de savoir si ce syriaque, ce grec, ce copte, cet arménien et cet éthiopien, dans lesquels toutes ces Églises (1) Syri enim syriace, ut Graeci grce, Coptitse coptice, Armeni armenice, Aethiopi ethiopice sacra faciunt. (Historia dogmat. controv. inter orthodoxes et pontificios de Scripturis et Sacris vernaculis, pag. 145.) 96 célèbrent la Liturgie, sont des langues vulgaires plus que le latin dans l'Occident. Il est certain qu'elles l'ont été à l'origine ; mais le fait est qu'elles ne le sont pas plus aujourd'hui que le latin, et cela depuis un grand nombre de siècles, en sorte que les Églises orientales, malgré la diversité de leurs langues liturgiques, célèbrent, tout aussi bien que nous, le service divin dans une langue qui n'est plus entendue du peuple. Pour les Grecs d'abord, tout le monde sait que leur langue, appelée grec moderne, diffère autant de l'ancien grec, que l'italien diffère du latin ; or la Liturgie de cette Église n'a pas suivi l'altération de la langue, mais elle est demeurée dans le grec ancien ; les livres de prières et de dévotion à l'usage des fidèles sont seuls en grec moderne. En Syrie, en Egypte, l'Église grecque possède encore un nombre assez considérable d'adhérents, connus sous le nom de Melchites ; la langue grecque est encore de droit leur seule langue. Seulement, pour aider les prêtres qui l'ignorent et les mettre à même d'instruire le peuple des choses contenues dans la Liturgie, les livres grecs à leur usage sont accompagnés d'une traduction arabe, qui leur donne l'intelligence des formules sacrées dans une langue qui leur est familière. Cette condescendance est devenue une tentation, et des prêtres ont pris l'habitude de lire l'arabe au lieu du grec même à l'autel. Telle est leur rusticité, que le Saint-Siège a dû souvent fermer les yeux sur un abus qu'il était presque impossible de déraciner. Il y a là un fait regrettable, mais qui laisse le droit intact. L'arabe n'est point officiellement reconnu comme langue liturgique ; le grec ancien a seul cet honneur. Le syriaque de la Liturgie a pareillement cessé d'être vulgaire, depuis bien des siècles. Au XII° siècle, Grégoire Albufarage ayant publié son Nomocanon et sa grammaire, dans le véritable et pur araméen, fut contraint d'en donner lui-même une traduction arabe, à l'usage de ses 97 compatriotes de Syrie. L'ignorance du clergé syrien oblige souvent de placer, en regard du texte liturgique, une traduction arabe, comme on le fait pour les Melchites, dans le même pays ; mais cette version n'est pas employée dans le service divin. Il y a plus encore : la secte nestorienne a étendu ses colonies jusque dans la Tartarie, la Perse et l'Inde; la Chine même a possédé de ses établissements comme l'atteste la fameuse inscription syriaque en caractères chinois, trouvée, en 1625, dans la province de Schen-si ; or tous ces nestoriens sont demeurés scrupuleusement fidèles jusqu'aujourd'hui à la langue syriaque, dans la Liturgie. Il existe une traduction persane de la Bible entre leurs mains ; quant à la Liturgie, partout ils l'ont laissée scrupuleusement en syriaque, sa langue primitive. L'Église copte n'a pas été moins fidèle à sa langue i liturgique. La basse Egypte perdit la langue grecque après la conquête du pays par les Sarrasins, et accepta le joug de la langue arabe. Dans la Liturgie, elle admit insensiblement l'usage du copte, qui servait déjà à l'autel, non seulement dans la Thébaïde, mais dans une partie considérable de la haute Egypte. Or cette langue, depuis de longs siècles, est exclusivement liturgique et n'est plus parlée. On trouve aussi, à l'usage du clergé copte, des livres de Liturgie qui portent en regard la version arabe du texte ; mais cette version n'est pas lue dans l'église, et elle n'est placée dans ces livres que pour suppléer à l'ignorance du clergé, de la même manière que nous l'avons remarqué pour les Melchites de Syrie, et pour les prêtres du rite syriaque. Les prêtres coptes lisent seulement l'épître et l'évangile en arabe, devant le peuple, mais c'est après l'avoir récité en langue copte. L'éthiopien liturgique est cette langue de l'Abyssinie, connue sous le nom de Gheez ancienne ou Axumite, qui sest éteinte depuis longtemps, après avoir été la plus 98 riche de toute l'Afrique (1). Elle fut remplacée par la langue ancharique, lorsque le siège de l'empire cessa d'être à Axum, et que la dynastie venue du pays d'Anchara monta sur le trône d'Ethiopie. Cette révolution n'eut aucun effet sur les livres liturgiques ; ils demeurèrent et sont toujours restés depuis dans l'ancienne langue axumite, qui est ignorée du peuple, et connue seulement des lettrés. Enfin la langue arménienne, que nous avons vue, au commencement du V° siècle, acquérir une version des saintes Écritures par les soins du savant Mesrob, et qui, vers la même époque, fut admise au rang des langues liturgiques, offre matière à la même observation que nous avons faite sur le grec, le syriaque, le copte et l'éthiopien. Cette langue est divisée en trois dialectes : le sublime, le moyen et le simple. Les livres liturgiques sont écrits dans le dialecte sublime, dont l'intelligence n'appartient qu'aux savants de la nation ; le moyen, qui est parlé dans la société polie, n'est déjà plus la langue liturgique, et diffère encore de l'arménien simple qui est à l'usage du peuple. Tel est l'état des cinq langues liturgiques de l'Orient. Pas une qui se soit perdue, mais pas une aussi qui soit restée vulgaire. Ainsi, trois langues sacrées au commencement ; trois principales leur sont ensuite adjointes; mais à peine ont-elles senti, les unes comme les autres, le contact des mystères de l'autel, qu'elles deviennent immobiles et impérissables. Les peuples se mêlent, se renouvellent, voient changer leur état politique, émigrent sous d'autres cieux ; la langue liturgique survit à tout, et n'accepte point ces révolutions. Consacrée aux secrets de l'éternité, elle n'est plus du temps ; les peuples la vénèrent comme le lien qui les rattache au ciel, comme le voile (1) Balbi, Atlas ethnographique du globe, tableau III°. 99 sacré qui couvre l'objet de leurs adorations. Elle est le lien du passé avec le présent, le signe de fraternité qui triomphe de toutes les distances et réunit les races les plus dissemblables (1). Au sein du paganisme, les anciens Romains avaient compris cette immobilité de langage de la prière publique. Quintilien nous apprend que les vers chantés par les prêtres Saliens remontaient à une si haute antiquité, qu'on les comprenait à peine (2), et cependant la majesté de la religion n'avait pas permis qu'on les changeât. Nous avons vu que les Juifs, avant le christianisme, dans leurs assemblées religieuses, lisaient la Loi et les prières du culte en langue hébraïque, quoique cette langue ne fût plus entendue du peuple. Ne serait-ce pas se refuser à l'évidence que de ne pas reconnaître dans tous ces faits l'expression d'une loi de la nature d'accord avec le génie de la religion ? Après avoir décrit les langues liturgiques de l'Orient, passons à celles de l'Occident. Elles sont au nombre de trois : le grec, le latin et le slavon. Pour ce qui est du grec, nous en avons parlé suffisamment à propos de l'Orient; tout à l'heure nous nous occuperons du slavon ; arrêtons-nous maintenant sur la langue latine. Si l'on doit juger de la dignité d'une langue liturgique à la qualité des Églises qui l'emploient et à son degré d'étendue (1) Sous un autre point de vue, la langue liturgique conserve les traditions de l'âge où elle était encore parlée. La nécessité de l'étudier, a conservé dans chaque pays les monuments de la littérature contemporaine de la rédaction des formules liturgiques. Que fût devenue l'Europe, sous le rapport des sciences, après l'invasion des barbares, si l'étude de la langue latine eût subi une interruption de quelques siècles ? Cependant, si les apôtres des nations occidentales eussent traduit le service divin dans la langue des peuples qu'ils conquéraient à l'Evangile, on s'imagine difficilement l'intérêt qui se fût attaché à la langue latine. (2) Carmina
Saliorum vix sacerdotibus suis intellecta, sed quae mutari vetat Religio. Instit.
Orator., lib. I, cap. VI.) 100 géographique, il n'en est pas une seule qui ait le droit d'être comparée à la langue latine. « Séparée de toutes les autres, comme l'hébraïque et la grecque, sur le titre de la croix du Seigneur, dit le pape saint Nicolas Ier, revêtue d'une insigne principauté, elle prêche à toutes les nations Jésus de Nazareth, Roi des Juifs (1). » Elle est la langue de l'Église mère et maîtresse ; et tandis que les autres sont circonscrites dans des limites étroites, elle ne règne pas seulement dans les sanctuaires de l'Europe, mais elle est parlée à l'autel dans les cinq parties du monde. La syriaque a vu usurper ses droits par l'arménienne, la grecque n'a pu se maintenir à Alexandrie, à Antioche, à Jérusalem ; le latin a vu s'ouvrir devant lui, à plusieurs reprises, un nouveau monde. Seul il s'avance aux deux Indes et dans la Chine, et au sein même des contrées où règnent les langues liturgiques de l'Orient, les missionnaires du Pontife romain le portent comme un fanal de vie et de lumière destiné à rendre l'espérance à ces malheureuses Églises immobiles dans l'isolement et l'erreur. L'héritage de la langue latine
fut tout d'abord l'Italie, la province d'Afrique, la Gaule et l'Espagne ; dès
le premier siècle, la foi romaine prit possession de ces vastes régions. Le (1) Et quae cum hebra, atque grca in titulo Domini a reliquis discreta, insignem principatum tenens, omnibus nationibus praedicat Jesum Nazarenum Regem Judaeorum. (Labb. Concil., tom. VIII, pag. 298.) 101 provinces, et si la foi chrétienne poussa d'abord ses conquêtes jusque sur les bords du Rhin, comme les monuments le prouvent, nous y trouvons encore la langue latine parlant seule dans le sanctuaire. Au second siècle, la Grande-Bretagne est évangélisée à la demande d'un de ses rois par les apôtres envoyés de Rome ; cette Église bretonne, qui n'était pas éteinte au vie siècle, et dont le moine saint Augustin recueillit les débris, n'avait jamais eu d'autre langue que celle de Rome, dans l'usage de l'Écriture sainte et dans la Liturgie. Mais la langue latine avait à subir l'épreuve que nous avons vu traverser par celles de l'Orient chrétien. Après avoir été vulgaire, elle dut cesser d'être parlée dans la vie publique et privée des peuples. Hors de l'Italie, elle avait régné en souveraine sur toutes les provinces de l'Occident, mais sans pouvoir anéantir les idiomes de tant de peuples divers, elle succomba dans Rome même, et dès le VII° siècle, la langue italienne commençait déjà ses destinées. Après saint Grégoire le Grand, nous ne trouvons plus d'homélies en langue latine prononcées devant le peuple de Rome ; les Goths et les Lombards avaient accéléré la ruine des lettres romaines par leurs dévastations, et d'ailleurs il est reconnu que les langues ne résistent pas dans la décadence des empires qui les ont portées à leur plus haut point de gloire. Dans le reste de l'Occident, les langues que la conquête des Romains n'avait pu anéantir se relevèrent à mesure qu'elles sentaient moins la pression de l'Empire ; mais une autre épreuve les attendait. Les provinces se virent tour à tour occupées par des races barbares qui leur apportaient des moeurs inconnues, et successivement des langues nouvelles surgirent de ce chaos, portant la trace d'éléments divers, dans la proportion de ceux qui vivaient au sein des peuples. Au milieu de cette transformation, comme après qu'elle fut consommée, la langue latine ne cessa pas d'être parlée à l'autel. Les 102 anciennes Églises de l'Occident la conservèrent avec fidélité dans le sanctuaire, pendant qu'elle périssait dans l'usage profane. Les Francs et les autres conquérants qui furent soumis à leur tour par les vaincus dont ils embrassèrent la foi, s'assujettirent docilement à n'entendre dans l'église que la langue, désormais immortelle, de cet ancien Empire, pour la destruction duquel Dieu les avait appelés de l'Aquilon. Mais il existait dans l'Occident de vastes régions que . l'invasion n'avait point encore épuisées d'habitants, et sur lesquelles s'étendaient les ténèbres de l'infidélité. L'Église était restée conquérante après la ruine de cet empire romain dont elle avait triomphé d'ailleurs avant les barbares. Après avoir initié au christianisme ceux qui s'étaient d'abord présentés comme les fléaux de Dieu, elle songea à visiter leurs frères et à les appeler dans son sein maternel. Saint Augustin partit bientôt pour l'île des Bretons, devenue l'île des Anglo-Saxons. Le VIII° siècle vit les conquêtes de saint Wilfrid, de saint Swidbert, de saint Corbinien, de saint Kilien, du grand saint Boniface, de saint Willibrord, à travers les diverses régions de la Germanie et de l'ancienne Gaule-Belgique, et les grands sièges de ces contrées s'élever tout à coup à leur parole. Le IX° siècle fut témoin de la conversion du Danemark par saint Anschaire, qui porta l'Évangile jusque dans la Suède ; le X° éclaira les conquêtes de saint Adalbert dans la Bohême et la Pologne ; le XI° vit s'avancer la lumière jusque sur la Norvège par les soins de saint Lubentius ; le XII° admira les succès de saint Othon de Bamberg, qui avait adopté l'apostolat de la Poméranie. Or tous ces apôtres qui sont la gloire de l'Église romaine et de l'ordre monastique, ne portèrent point d'autres livres liturgiques dans ces nouvelles chrétientés que les livres de l'Église romaine, dans la langue latine. Cette langue sacrée fut le lien qui les unit entre elles, et leur 103 donna de faire corps avec le reste de l'Occident. Le latin fut, par les livres liturgiques de Rome, l'instrument de l'unité européenne, unité qui fut brisée le jour où les sectaires du XVI° siècle crièrent qu'il fallait célébrer l'office divin dans la langue du peuple. Ces nations, appelées à la foi et à la civilisation, ne s'étonnèrent pas de voir employer, dans les mystères qu'on leur apportait, une langue différente de celle dans laquelle on les avait instruites. Elles étaient encore trop près de la nature pour ne pas sentir que la ferveur de la prière émane bien plus de l'amour qui échauffe le cur que des sons perçus par l'oreille, et ne s'étonnèrent pas d'apprendre que la langue qui doit être parlée à Dieu pouvait être différente de celle dans laquelle les hommes expriment leurs besoins et leurs passions. Mais un fait, au IX° siècle, vint apporter comme une légère contradiction à tous ceux que nous avons exposés jusqu'ici. Une nouvelle langue liturgique, la slavonne, parut dans l'Occident, et Rome l'accepta et la reconnut. La chose s'est passée ainsi, nous en convenons volontiers, et loin d'en être étonné, après avoir exposé le fait, nous en ferons sortir une nouvelle confirmation des principes que nous avons établis ci-dessus. Un peu après le milieu du IX° siècle, les Slaves reçurent la bonne nouvelle de l'Évangile par le ministère des deux saints moines grecs, Cyrille et Méthodius. Ces apôtres étaient venus de Constantinople, et après une première station en Bulgarie, où ils plantèrent la foi, ils remontèrent jusqu'à la Moravie où ils s'arrêtèrent. Partis des Églises de la langue grecque, ils se dirigeaient sur l'Occident où régnait seule à l'autel la langue latine. La Moravie qu'ils évangélisèrent semblait même avoir déjà reçu quelques rayons de la prédication des missionnaires envoyés par le Siège apostolique. Les deux saints furent les civilisateurs des peuples slaves au sein desquels leur 104 prédication avait tracé comme un immense sillon de la
lumière évangélique, et leur donnèrent un alphabet, au moyen duquel ces peuples
purent désormais écrire leur langue. Or cette langue était, et est toujours
Tune des plus étendues qui soient parlées, puisque dans ses divers dialectes,
elle réunit la Bohême, la Moravie, la Gallicie, la Hongrie, la Pologne, la
Lithuanie, la Volhynie, la Podolie, la Grande et la Petite Russie et la Russie
Blanche, et au Saint Cyrille et saint Méthodius crurent non seulement devoir traduire dans cette langue les livres saints, mais ' encore l'employer dans la célébration du service divin. ' Il est probable néanmoins qu'ils n'entreprirent pas d'abord cette innovation, mais qu'ils ne s'y laissèrent aller que plus tard, dans l'espoir d'accélérer, par ce moyen, la conversion des peuples au salut desquels ils s'étaient voués. En effet, nous voyons, en 866, les deux saints mandés à Rome par saint Nicolas Ier qui leur écrit avec toute sorte de bienveillance. Son successeur Adrien II consacra évêque saint Méthodius, et on ne voit aucune trace du mécontentement que l'usage du slavon dans la Liturgie excita à Rome quelques années après. Ce fut seulement sous Jean VIII, qui succéda à Adrien II, que ce fait attira l'attention du Saint-Siège. Le pontife, en 879, écrivit en ces termes : « Nous avons entendu dire aussi que vous célébrez la messe en langue barbare, c'est-à-dire slave ; c'est pourquoi nous vous l'avons déjà dé fendu par nos lettres qui vous ont été adressées par Paul, évêque d'Ancône. Vous devez donc célébrer en latin, ou en grec, comme fait l'Église de Dieu qui est répandue par toute la terre, et dans toute les nations. Pour ce qui est de la prédication, vous pouvez la faire dans la langue du peuple ; car le psalmiste exhorte toutes les nations à louer le Seigneur, et l'Apôtre dit ; 105 « Que toute langue confesse que le Seigneur Jésus est dans la gloire de Dieu le Père (1). » Le Siège apostolique, par ces paroles, montrait assez que l'on croyait alors les deux langues sacrées, grecque et latine, assez établies pour ne plus partager avec d'autres l'honneur de servir à l'autel. Jean VIII ne parle pas du syriaque, du copte, de l'éthiopien, ni de l'arménien, parce que les peuples qui s'en servaient dans la Liturgie étaient tous hérétiques et hors la communion de l'Église; les réunions partielles de ces nations avec le Siège apostolique n'ayant eu lieu que plusieurs siècles après. Mais ce ne fut pas le dernier mot du pontife dans la cause de la liturgie slave. Par une de ces variations auxquelles Jean VIII était sujet, et qui ont motivé sur son caractère les jugements sévères de la postérité (2), ce pontife, qui devait bientôt (1) Audimus etiam quod missas cantes in barbara,
hoc est, in sclavina lingua; unde jam litteris nostris per Paulum episcopum
Anconitanum tibi directis prohibuimus, ne in ea lingua sacra missarum solemnia
celebrares; sed vel in latina, vel in graeca lingua, sicut Ecclesia Dei toto
terrarum orbe diffusa et in omnibus gentibus dilatata cantat. Praedicare vero,
aut sermonem in populo facere tibi licet quoniam psalmista omnes admonet
Dominum gentes laudare; et Apostolus : Omnis, inquit, lingua
confiteatur, quia Dominus Jésus in gloria est Dei Patris. (Labbe, Conc.,
tom. IX, p. 127.) (2) On est aujourd'hui si peu familier avec
l'histoire ecclésiastique, que nous ne serions pas surpris de nous entendre
reprocher quelque jour la sévérité de notre jugement sur Jean VIII. Nous nous
mettrons donc à couvert derrière la grande autorité de Baronius, qu'on
n'accusera pas, sans doute, de passion contre les Papes qui ne partagent pas
ses idées. Voici ses paroles à propos de l'inconcevable conduite de Jean VIII à
l'égard de Photius : « Quod
igitur Johannes Papa loco supplicii persolverit praemia scelestissimo viro,
magnam existimationi suae, et cathedras pontificiae notam inussit. Hinc puto
factum (si quae tum veritatis vel saltem species mendacii apertissimi esse
potuit) quod ob nimiam Johannis animi facilitatem et mollitudinem, abjecta
penitus omni virilitate, fractus animo, sacerdotalis constantiae expers, atque
robore enervatus, non Papa ut Nicolaus et Hadrianus, sed Papissa fuerit contumeliae
loco dictus, utpote quod qui nec
resistere sciret eunucho, quique vinceretur a semiviro, non vir, sed esset
femina potius nuncupandus, et sic nomen contumelias transierit posteris rerum
insciis in veritatis opinionem, atque ita a compluribus decantatum fuerit,
Johannem Octavum fuisse Papam feminam, sicque jactata vulgo invenerit commodo
locum fabula. » (Baronii Annales, ad ann. 879, n. 5.) 106 donner à l'Église le triste spectacle de la réhabilitation de Photius, se relâcha bientôt de sa sévérité sur la langue slavonne dans la Liturgie. Dès l'année suivante, il écrivait à Svatopulk, prince de Moravie, cette lettre fameuse par laquelle il élève saint Méthodius à la dignité de métropolitain, et confirme l'usage de la langue slavonne dans le service divin pour ces contrées. Voici les paroles du pontife. Après avoir fait l'éloge de l'alphabet slavon inventé par le philosophe Constantin, c'est le nom sous lequel saint Cyrille avait d'abord été connu, il ajoute : « Nous ordonnons que l'on célèbre dans cette même langue (la slavonne) les louanges et les uvres du Christ, Notre-Seigneur ; car la sainte Écriture ne nous enseigne pas à louer le Seigneur seulement en trois langues, mais dans toutes, quand elle dit : Toutes les nations, louez le Seigneur ; célébrez-le, tous les peuples, et les Apôtres remplis de lEsprit-Saint racontèrent en toutes langues les merveilles de Dieu. C'est pourquoi Paul, la trompette céleste, nous donne cet avertisse ment : Que toute langue confesse que Notre-Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père, et au sujet de ces langues, il nous enseigne clairement, dans la première épître aux Corinthiens, à parler les langues, de manière à édifier l'Église de Dieu. Il n'est donc contraire ni à la saine foi, ni à la doctrine, de célébrer les messes dans la langue slavonne, d'y lire le saint évangile, ou les leçons divines du nouveau et de l'Ancien Testament traduites et interprétées fidèlement, ni d'y chanter les autres offices. Celui qui a fait les trois 107 langues principales, l'hébraïque, la grecque et la latine, a créé aussi toutes les autres pour sa louange et sa gloire (1). » La contradiction entre cette lettre à Svatopulk, et celle à saint Méthodius ne saurait être plus flagrante ; les mêmes textes de l'Écriture sont employés dans des sens contraires; il faut donc que le pontife, dans l'un ou l'autre cas, ait agi soit avec emportement, soit avec faiblesse. Ces exemples de l'infirmité humaine sont rares sur la Chaire de Saint-Pierre ; mais l'histoire les enregistre, et les enfants de l'Église n'ont aucun intérêt à les dissimuler, parce qu'ils savent que celui qui a assuré aux pontifes romains l'infaillibilité de la foi dans l'enseignement, ne les a point garantis de toute faute dans l'exercice du gouvernement suprême. Toutefois, Jean VIII, en accordant droit de cité dans le sanctuaire à la langue slavonne, stipule par convenance un hommage pour la langue latine ; Nous ordonnons cependant, dit-il, que dans toutes les églises de votre gouvernement, on lise l'évangile en latin, pour plus grand honneur, et qu'ensuite on le lise traduit en langue slavonne, pour le peuple qui n'entend (1) Literas denique sclavonicas a Constantino quodam philosophe repertas, quibus Deo laudes débite resonent, jure laudamus ; et in eadem lingua Christi Domini nostri praeconia et opera ut enarrentur jubemus. Neque enim tribus tantum, sed omnibus linguis Dominum laudare auctoritate sacra monemur, quas prsecipit, dicens : Laudate Dominum omnes gentes, et collaudate eum omnes populi. Et Apostoli repleti Spiritu Sancto locuti sunt omnibus linguis magnalia Dei. Hinc et Paulus clestis quoque tuba insonat, monens : Omnis lingua confiteatur, quia Dominus noster Jesus Christus in gloria est Dei Patris. De quibus etiam linguis in prima ad Corinthios epistola, satis et manifeste nos admonet, quatenus linguis loquentes Ecclesiam Dei dificemus. Nec sanas fidei, vel doctrinal aliquid obstat, sive missas in eadem sclavonica lingua canere, sive sacrum Evangelium, vel lectiones divinas Novi et Veteris Testamenti bene translatas, et interpretatas légère, autalia horarum officia omnia psallere : quoniam qui fecit très linguas principales, hebraeam scilicet, graecam et latinam, ipse creavit et alias omnes ad laudem et gloriam suam. (Labbe, Conc, tom. IX, pag. 177.) 108 pas les paroles latines, en la manière qu'il se pratique dans certaines églises. Enfin, s'il vous est plus agréable à vous et à vos officiers, d'entendre la messe en langue latine, nous ordonnons qu'on la célèbre pour vous en cette langue (1). » La concession de Jean VIII avait pour premier résultat d'arrêter le progrès de la langue latine, qui depuis près de trois siècles marchait victorieuse à la conquête du Nord; elle assignait les limites de l'unité européenne qui, sans l'intervention de saint Grégoire VII dont nous parlerons tout à l'heure, eût expiré en deçà de la Bohême. Peut-être une telle indulgence servit-elle pour le moment à la propagation de la foi chez les Slaves ; mais voici ce qui en résulta dans l'avenir. Au commencement du XI° siècle, l'Église de Constantinople, qui était alors en communion avec le Saint-Siège, commença la conquête de la Ruthénie et de la Moscovie à la foi chrétienne. Les apôtres qu'elle envoya ne se montrèrent pas plus difficiles au sujet de la langue liturgique que ne l'avaient été pour les slaves occidentaux saint Cyrille et saint Méthodius. Le patriarcat de Constantinople, dans son ardeur à pousser ses conquêtes, avait déjà donné des marques de sa complaisance en cette matière. Nous avons vu comment la Géorgie avait reçu de lui le privilège liturgique pour sa langue. Il en avait été de même pour la Mingrélie, qui, plus tard, est retombée dans l'idolâtrie. Les nouveaux missionnaires donnèrent donc aux Ruthènes convertis la Liturgie grecque en slavon, et une immense partie de l'Europe se trouva former corps, au moyen (1) Jubemus tamen, ut in omnibus ecclesiis terne vestrae, propter majorem honorificentiam, Evangelium latine legatur ; et postmodum sclavonica lingua translatum in auribus populi latina verba non intelligentis, annuntietur; sicutin quibusdam ecclesiis fieri videtur. Et si tibi, et judicibus tuis placet missas latina lingua magis audire, praecipimus ut latine missarum tibi solemnia celebrentur. (Ibid.) 109 d'une langue liturgique qui n'était ni celle de Rome, ni celle de Constantinople. La chute des Grecs dans le schisme entraîna la rupture de la Ruthénie et de la Moscovie avec le Siège apostolique, et les isola peut-être pour toujours du centre de la foi catholique. Les Slaves occidentaux hésitèrent au milieu de cette crise redoutable ; les provinces voisines de la Ruthénie la suivirent dans le schisme; les autres s'appuyèrent sur l'Occident et résistèrent ; la Pologne, la Bohême, la Hongrie, royaumes slaves, mais dont les deux premiers sont latins presque en totalité, et le troisième au moins en grande partie, leur faisaient un point d'appui. Au XVI° siècle, Rome reconquit sur le schisme slave la Ruthénie à peu près entière, soumise alors à la domination polonaise ; mais cette Église garda la Liturgie sla- , vonne. Elle aspirait vers Rome par les désirs de la foi et de l'unité; mais un lien la retenait aux formes de la religion du czar ; ce lien était la langue liturgique. Pendant deux siècles elle résista à toute séduction ; mais à la fin du XVIII° siècle, quand le partage de la Pologne l'eut fait tomber sous la domination de l'ancienne Moscovie, devenue la Russie, Catherine II employa tous les ressorts de sa puissance pour l'entraîner de nouveau dans le schisme, et elle réussit pour une partie de ces Églises, grâce à la différence des rites et de la langue liturgique qui les séparait toujours de Rome. Nous avons vu, dans ces dernières années, la chute de celles qui étaient demeurées fidèles, sans qu'il ait été possible de la prévenir ni de l'arrêter, et personne n'ignore que l'audace du czar et ses désastreux succès n'aient eu pour instrument unique la communauté de la langue sacrée entre ces malheureuses provinces et le reste de l'empire russe. Au reste, la politique de l'autocrate n'est un mystère pour personne, et l'on sait que ses efforts impies ne s'arrêteront que lorsqu'il aura réuni dans son 110 unité schismatique toutes les races slavonnes. Il s'irrite contre les provinces que la Liturgie latine a soustraites à son action immédiate, et il pense, avec raison, que son uvre ne sera complète que le jour où il aura aboli la Liturgie romaine dans le royaume de Pologne, son dernier boulevard. Si Jean VIII eût refusé de confirmer l'usage liturgique de la langue slavonne dans la Moravie et dans les autres provinces occidentales de cette langue qui furent converties au christianisme, du IX° au XI° siècle, peu importait que les missionnaires de Constantinople eussent traduit en slavon leur Liturgie grecque pour les peuples qu'ils avaient évangélisés; un mur de séparation s'élevait entre les Slaves occidentaux et les Slaves orientaux. Ces derniers pouvaient suivre Byzance dans ses erreurs, sans entraîner leurs frères, comme l'histoire nous apprend que les diverses défections qui ont eu lieu autour de lui n'ont jamais ébranlé le royaume de Pologne. Des millions d'âmes restaient dans les voies du salut éternel, et le colosse du Nord, qui menace l'Église et l'Europe, et dont la politique est désignée sous le nom redoutable de Panslavisme, se trouvait arrêté dans sa marche et contraint d'essayer plutôt sur l'Orient ses plans de monarchie universelle. Varsovie désarmée, mais latine, excite encore ses inquiétudes ; d'autres provinces de la même Liturgie l'eussent averti de rester en deçà de ses frontières. Au reste ce n'est pas la première fois que, dans le cours de cet ouvrage, nous avons fait remarquer l'intime liaison de la question liturgique avec les questions sociales, et nous ne serons pas sans doute le premier à observer que l'Asie, ses murs et son gouvernement commencent, en Europe, là même où s'arrête la Liturgie romaine. Telle est donc la portée de l'acte complaisant de Jean VIII, et le lecteur est à même de voir si cette désastreuse indulgence est de nature à infirmer les principes que nous avons 111 émis plus haut sur l'importance de ne pas multiplier les langues liturgiques. Quant à la question de droit, on aura observé sans doute que le Pontife accordait l'usage du slavon dans le service divin comme une dispense du droit commun, et qu'il ne le faisait qu'après avoir protesté contre l'uvre de saint Méthodius. Après la lettre de ce pape à Svatopulk, l'Église compta une langue liturgique de plus ; ce fut la septième, et probablement la dernière. Ainsi légitimé pour le service de l'autel par l'autorité compétente et responsable devant Dieu, le slavon dut, comme les six autres langues sacrées, passer par l'épreuve du temps. La forme de langage dans laquelle les deux saints moines avaient traduit les Écritures et à laquelle ils confièrent bientôt la Liturgie, vieillit et sortit de l'usage commun. Après quelques siècles, il arriva donc que le service divin cessa d'être célébré dans la langue du peuple, chez les Slaves, parce que la Liturgie avait communiqué son immutabilité à la langue qui d'abord lui avait servi d'interprète. Les Slaves se soumirent à cette loi du mystère, comme s'y sont soumis les Romains, les Grecs, les Syriens, les Coptes, les Éthiopiens et les Arméniens, en sorte que l'accession d'une nouvelle langue liturgique n'occasionna point une dérogation permanente au principe qui exclut du sanctuaire la langue vulgaire. C'est ce que n'ont pas pesé suffisamment certains auteurs qui ont raconté avec complaisance la concession de Jean VIII aux Slaves, concession dont l'effet n'était, après tout, que d'accroître d'une simple unité le nombre des six langues liturgiques antérieures, et qui n'ont pas vu que l'Église, en définitive, y trouvait un nouvel et solennel exemple à alléguer à ceux qui se scandalisent ou s'étonnent qu'elle adresse à Dieu ses prières dans une langue ignorée du peuple. Deux formes liturgiques se partagent 4es pays de la langue slavonne, la grecque et la romaine. La grecque 112 règne dans toutes les Russies, dans plusieurs provinces qui
dépendaient autrefois du royaume de Pologne, et au (1) Bullarium, tom. IV. Constit. XXXVIII. Ex pastorali munere. 113 Il y aurait lieu d'examiner si la Liturgie que traduisirent en slavon saint Cyrille et saint Méthodius, était celle de Rome, ou celle de Constantinople. Dans la Bulgarie, pays si voisin de l'Empire grec, il n'est pas douteux que les deux apôtres n'aient établi tout d'abord la dernière, qui y a toujours régné ; mais est-il probable que, dans la Moravie, par exemple, province attenante à d'autres qui ne connurent jamais que la Liturgie romaine, les deux apôtres aient établi la Liturgie grecque ? On a de la peine à se le persuader. D'autre part, les pays de la Liturgie latino-slave sont aujourd'hui très restreints, si on les compare aux vastes régions où règne la Liturgie gréco-slave. Il est permis d'en conclure que la Liturgie de Constantinople a dû s'accroître aux dépens de celle de Rome dans ces provinces, et avec d'autant plus de raison que les Eglises latino-slaves, encore aujourd'hui, pratiquent en beaucoup de choses la discipline de l'Église grecque : ce qui témoigne d'une fraternité qu'on explique aisément par l'identité de langage et d'origine, et qui facilitait grandement l'échange des usages. Quoi qu'il en soit, les évêques d'Allemagne avaient ressenti de bonne heure pour leurs Églises l'inconvénient de la traduction des prières liturgiques à l'usage d'une nation voisine, avec laquelle leurs ouailles étaient d'autant plus en rapport, que la même foi les réunissait désormais. Ils avaient dénoncé au Siège apostolique cette nouveauté, et lorsque Jean VIII en écrivit à saint Méthodius pour le reprendre de cette hardiesse, il avait sous les yeux la lettre de l'archevêque de Salzbourg, dans laquelle le prélat s'exprimait ainsi : « Un certain Grec, nommé Méthodius, a nouvellement inventé un alphabet slavon, et méprisant, dans sa sagesse, la langue latine, la science romaine et l'autorité de l'alphabet latin, il a comme déprécié aux yeux du peuple les messes, les évangiles et l'office de l'Église pour ceux qui le célèbrent en 114 latin (1). » Ces paroles étaient dures, sans doute, car il s'agissait d'un apôtre qui n'avait tenté cette entreprise que dans le but d'accélérer la conversion des Moraves ; mais il est facile de comprendre le fâcheux effet qui devait en résulter pour les nouvelles Églises qui s'élevaient alors de toutes parts dans l'Allemagne. Le privilège accordé aux Slaves attestait une faveur dont les Germains n'avaient pas été jugés dignes. Le Siège apostolique ne revint pas cependant sur la concession de Jean VIII. Le Pontife avait pu agir avec faiblesse, mais le privilège qu'il avait octroyé était durable, sauf à produire ses conséquences dans l'avenir. Rome n'eut qu'une chose à faire, ce fut d'arrêter l'envahissement du slavon dans la Liturgie des provinces occidentales. Les monuments qui attestent la vigilance des Pontifes romains à cet endroit ne se sont pas tous conservés ; cependant nous trouvons, en 967, une lettre du Pape Jean XIII aux Bohémiens, dans laquelle il leur commande d'élire un évêque non selon les rites et la secte de la nation bulgare, de la Russie ou de la langue slavonne, mais au contraire un prélat obéissant aux constitutions et aux décrets apostoliques, et instruit exactement dans les lettres latines (2). » Ces paroles font assez voir que le Siège apostolique voyait avec peine l'extension que la force des choses donnait à la concession de Jean VIII. Au XI° siècle, vers 1070, Alexandre II fit (1) Usquedum quidam Grcus, Methodius nomine,
noviter inventis Slavinis litteris, linguam latinam doctrinamque Romanam, atque
litteras auctorabiles latinas philosophice superducens, vilescere fecit cuncto
populo ex parte Missas et Evangelia, ecclesiasticumque officium illorum qui hoc
latine celebraverunt. (Assemani, Orig. Eccles. Slavorum, part. I, cap. III,
pag. 134.) (2) Non secundum ritus aut sectam Bulgaric
gentis, vel Russias, aut Slavonic linguae; sed magis sequentem constituta et
décréta Apostolica, latinis apprime litteris eruditum. (Cosmas Pragensis,
cité par Assemani. Orig. Eccles. Slav,, tom. IV, pag. 389.) 115 assembler par un de ses légats un concile des évêques de la
Dalmatie et de la Croatie, et on y décréta que désormais on ne célébrerait plus
les saints mystères en langue slavonne dans ces provinces, mais seulement en
latin ou en grec. Ce fait est attesté par Thomas, archevêque de Spalatro (1),
qui est cité par le cardinal Bona (2), par Mais le grand et saint archidiacre Hildebrand, qui avait été l'âme du glorieux pontificat d'Alexandre II, monta bientôt lui-même sur la Chaire de saint Pierre, sous le nom de Grégoire VII, et parmi les innombrables sollicitudes qui remplirent les douze années que l'Eglise se glorifia de l'avoir pour chef, la question de la Liturgie en langue slavonne méritait d'attirer son attention. Le duc de Bohême, Vratislas, lui avait demandé de pouvoir étendre à ses peuples, qui étaient aussi de race slave, la dispense que Jean VIII avait accordée à Svatopulk pour la Moravie. Grégoire refusa avec fermeté, et, sans accuser son prédécesseur, ni revenir sur un fait consommé, il proclama les principes de l'Église sur les langues liturgiques. Quant à ce que vous avez demandé, dit-il à ce prince, dans une lettre de l'année 1080, désirant notre consentement pour faire célébrer dans votre pays l'office divin en langue slavonne, sachez que nous ne pouvons en aucune manière accéder à cette demande. Pour ceux qui ont réfléchi sérieusement à cette question, il est évident que ce n'est pas sans raison qu'il a plu au Dieu tout-puissant que la sainte Écriture demeurât cachée (1) Historia
Episcoporum Salonitanorum, cap. XVI. (2) Rerum
Liturgicarum, cap. IX, § 4. (3) Breviarium Gestorum Pontificum Romanorum,
tom. II, pag. 410. (4) De Slavica lingua litterali in divinis celebrandis,
n° XXXIII, apud Assemani, ibid. 116 en certains lieux, dans la crainte que si elle était accessible aux regards de tous, elle ne devînt familière et exposée au mépris, ou encore que se trouvant mal entendue par les esprits médiocres, elle ne fût une cause d'erreur pour eux. Ce n'est pas une excuse de dire que certains hommes religieux (saint Cyrille et saint Methodius) ont subi avec condescendance les désirs d'un peuple rempli de simplicité, ou n'ont pas jugé à propos d'y porter le remède; car l'Église primitive elle-même a dissimulé beaucoup de choses que les saints Pères ont corrigées, après les avoir soumises à un examen sérieux, quand la chrétienté fut affermie, et que la religion eut pris son accroissement. C'est pourquoi, par l'autorité du bienheureux Pierre, nous défendons d'exécuter ce que nous demandent les vôtres avec imprudence, et, pour l'honneur du Dieu tout-puissant, nous vous enjoignons de vous opposer de toutes vos forces à cette vaine témérité (1). » En ces quelques lignes, saint Grégoire VII énonçait avec une pleine énergie le sentiment de l'Eglise, qui a toujours été de ne pas offrir sans voiles les mystères aux yeux du vulgaire; il excusait la concession faite avant lui, et proclamait ce principe d'une si fréquente application, (1) Quia vero nobilitas tua postulavit, quo, secundum Sclavonicam linguam apud vos divinum celebrari annueremus officium, scias nos huic petitioni tuae nequaquam posse favere. Ex hoc nempe saepe volventibus liquet non immerito Sacram Scripturam omnipotenti Deo placuisse quibusdam locis esse occultam, ne, si ad liquidum cunctis pateret, forte vilesceret et subjaceret despectui, aut prave intellecta a mediocribus, in errorem induceret. Neque enim ad excusationem juvat, quod quidam religiosi viri hoc quod simpliciter populus quaerit patienter tulerunt, seu incorrectum dimiserunt, cum primitiva Ecclesia multa dissimulaverit, qu a sanctis patribus, postmodum firmata Christianitate, et religione crescente, subtili examinatione correcta sunt. Unde ne id fiat quod a vestris imprudenter exposcitur auctoritate beati Petri inhibemus, teque ad honorera omnipotentis Dei huic vanae temeritati viribus totis resistere prcipimus. (Labb., Conc, tom. X, pag. 234.) 117 que les nécessités qui se sont présentées lors de l'établissement de l'Eglise ne sauraient prudemment être érigées en lois pour les siècles suivants. Ce grand Pontife, qui travailla avec tant d'énergie à ramener le clergé à la dignité du célibat, n'ignorait pas non plus que les Apôtres et leurs successeurs avaient imposé les mains à des chrétiens engagés dans les liens du mariage. La foi chrétienne régnait en Bohême, elle s'y était établie et maintenue avec la Liturgie latine ; introduire dans cette Église l'usage de la langue vulgaire, c'était la faire rétrograder aux conditions de l'enfance. En reculant les frontières de la langue latine jusqu'à la Bohême, saint Grégoire VII, comme nous l'avons déjà dit, les avançait jusqu'à la Pologne qui, restant latine, se trouvait ainsi consacrée comme le boulevard catholique de l'Europe du côté de l'Asie. Quant aux provinces dans lesquelles la langue slavonne était
établie, il n'y avait plus lieu d'y rien changer. Le Siège apostolique se fit
un devoir de la protéger dans les Eglises qui en usaient légitimement au
service divin. Ainsi nous trouvons, en 1248, une lettre d'Innocent IV à un
évêque de Dalmatie, dans laquelle il répond à la consultation de ce prélat, et
l'autorise à se servir de la langue slavonne, avec l'alphabet hiéronymien, dans
les lieux où la coutume est telle, à la condition toutefois que la traduction
du texte des offices divins soit exacte (1). En 15g6, le concile provincial
d'Aquilée, tenu par (1) Raynaldi, Continuat. Baronii, ad annum
1248, n° 53. (2) Labb., Conc,
tom. XV, pag. 1482. 118 du missel et du bréviaire de saint Pie V, en langue illyrienne, et nous avons vu plus haut la constitution de Benoît XIV sur cette matière. Le Saint-Siège exigea seulement trois choses de ces Églises latino-slaves : que la traduction des livres romains fût fidèle ; que le slavon ancien dit littéral, et non le vulgaire, y fût seul employé ; enfin qu'ils fussent imprimés en caractères hiéronymiens. Pour ce qui est des Églises gréco-slaves, après la réunion de la Lithuanie et des autres provinces ruthènes avec l'Église romaine, dans le concile de Brzesc, en 1594, leurs livres, en caractères cyrilliques, subirent, dès que les circonstances le permirent, une revision, qui tout en les laissant dans la forme de la Liturgie de Constantinople, veilla sur l'orthodoxie des textes, et fit des changements importants, spécialement dans les cérémonies, pour séparer entièrement les uniates des schismatiques. Les missels de 1659, 1727, 1790, et celui qui fut publié, en ce siècle, par le métropolitain Josaphat Bulhak, attestent cette sollicitude des Pontifes romains, et la foi n'a succombé dans les provinces du rite slave-uni, que par l'introduction forcée du fameux Missel publié en 1831, à l'imprimerie impériale de Moscou (1). Ainsi, jusqu'au jour où le défaut d'une langue liturgique non nationale s'est fait si cruellement sentir aux catholiques de l'Empire russe, Rome avait non seulement toléré, mais protégé la langue slavonne, et si elle n'avait pas souffert qu'elle étendît plus loin ses conquêtes, saint Grégoire VII lui-même n'était pas revenu sur la concession de Jean VIII. Au XIV° siècle, un fait isolé, mais qui demeura sans produire de résultat durable, n'en a pas moins attiré l'attention du P. Le Brun (2), et ne saurait être passé (1) Institutions liturgiques, tom. II, pag. 659-672. (2) Explications de la Messe, tom. IV, pag. 211. 119 entièrement sous silence, On connaît les missions des Dominicains et des Franciscains dans la Tartarie, vers le milieu du XIII° siècle, jusque dans le XIV°. Ils y convertirent quelques princes, et y établirent des chrétientés en divers lieux. On ne voit pas cependant que ces missionnaires aient songé à traduire la Liturgie en langue tartare jusque vers l'an 13o5, date sous laquelle on trouve dans Rinaldi, une lettre du célèbre Jean de Montcorvin, de l'ordre des Frères Mineurs, adressée au Général de son ordre. Dans sa lettre, ce missionnaire qui avait été envoyé par Nicolas IV, et passa quarante-deux ans en Tartarie, demande qu'on lui envoie un antiphonaire, un légendaire, un graduel et un psautier noté, parce que, dit-il, il n'a qu'un petit missel et un bréviaire portatif qui ne contient que des leçons abrégées. Il ajoute qu'il a traduit en tartare tout le Nouveau Testament et le Psautier, et que si le défunt roi Georges, son néophyte, eût vécu plus longtemps, il était convenu avec ce prince que l'on traduirait tout l'office latin pour le faire chanter dans les églises. Jean de Montcorvin avait célébré, durant la vie de Georges, la messe selon le rite latin dans la langue tartare, tant pour les paroles du canon que pour celles de la préface. Ce sont les paroles du missionnaire (1). Jean de Montcorvin avait agi pour les Tartares dans (1) Ministro generali Ordinis nostri supplico pro antiphonario, legenda Sanctorum, graduali, et psalterio cum nota pro exemplari, quia non habeo ni breviarium portatile cum lectionibus brevibus, et parvum Missale..... Didici competenter linguam et literam Tartaricam, quae lingua usualis Tartarorum est, et jam transtuli in linguam illam et literam totum Novum Testamentum et Psalterium, quae feci scribi in pulcherrima litera eorum, et scribo, et lego, et praedico in patenti manifesto in testimonium Legis Christi. Et tractavi cum supradicto Rege Georgio, si vixisset, totum officium Latinum transferre, ut per totam terram cantaretur in dominio suo, et eo vivente in ecclesia sua celebrabam Missam secundum ritum Latinum, in litera et lingua illa legens tam verba Canonis, quam prfationis. (Raynaldi, Continuat. Baronii, ad annum 13o5, n°20.) 120 le même zèle qui avait animé saint Cyrille et saint Méthodius pour les Slaves, mais quoi qu'en dise le P. Le Brun, il ne nous est parvenu aucun document qui atteste l'approbation du Saint-Siège en faveur de cette innovation. Il est vrai que Clement V, qui siégeait alors à Avignon, éleva en 1307 Jean de Montcorvin à la dignité d'archevêque de Cambeliach, ou Cambalu, dans le royaume du Cathay, et lui envoya sept autres missionnaires, tous de l'ordre des Frères Mineurs, et honorés de l'épiscopat, pour lui servir de suffragants. Nous trouvons les pièces relatives à la fondation de cette Église relatées dans un grand détail, à l'année que nous venons d'indiquer, dans Rinaldi ; mais parmi les privilèges dont le Pontife décore la nouvelle Église métropolitaine et ses suffragantes, on ne trouve pas un mot qui ait rapport à la traduction de la Liturgie en tartare (1). La chose en valait cependant la peine, et Clément V, s'il eût voulu confirmer l'uvre de Jean de Montcorvin, avait tout autant d'autorité que Jean VIII pour le faire. Concluons donc que rien n'est moins certain que l'existence d'une Liturgie approuvée en langue tartare, et qu'on a eu tort de s'appuyer sur ce fait pour donner à entendre que l'Église est assez indifférente sur les langues dans lesquelles la Liturgie doit être célébrée. Dans tous les cas, cette Liturgie tartare eût été d'une bien courte durée ; car, avant la fin du XIV° siècle, les désastreuses conquêtes de Tamerlan déracinèrent les chrétientés qui commençaient à fleurir dans la Tartarie, et arrêtèrent pour des siècles les progrès de la foi dans ces contrées. Nous avons cru devoir traiter avec quelque étendue l'histoire de la langue slavonne dans ses rapports avec la Liturgie, et éclaircir ce qu'on a avancé sur la langue tartare ; bientôt la marche de notre sujet nous conduira (1)
Raynaldi, Continuat. Baronii, ad annum 1307, n° 29. 121 jusque dans la Chine ; mais la suite des événements relatifs à la langue liturgique en général exige que nous nous arrêtions quelque temps en Occident, pour constater le mouvement des idées sur cette question dans les temps qui ont précédé et suivi la réforme protestante. Jusqu'au XII° siècle toutes les Églises de l'Orient et de l'Occident avaient célébré la Liturgie en langue non vulgaire, et aucune voix ne s'était élevée contre la discipline universelle qui maintenait dans le service divin les langues qui avaient péri dans l'usage vulgaire. L'invasion du rationalisme sur l'Occident vint troubler cette paix universelle. L'hérésie du XVI° siècle, qui tendait à anéantir la religion chrétienne en détruisant la notion du sacrifice et du sacerdoce, déclara la guerre aux pratiques mystérieuses dont toutes les Églises s'étaient plu à environner les relations de l'homme avec la divinité. Mais le mouvement antiliturgique de Luther et de Calvin n'eut pas seulement pour précurseurs Wiclef et Jean Hus; ce fut dès le XII° siècle que le défi fut porté à l'Église entière par les Vaudois et les Albigeois. Ces sectaires, qui prétendirent les premiers à l'interprétation de la Bible par le jugement individuel, furent les premiers aussi à protester contre la langue liturgique, et à célébrer les mystères et les sacrements en langue vulgaire. Ils firent de cette pratique un des articles fondamentaux de leur secte (1), et nous avons vu que la première version française des saintes Écritures est leur ouvrage. C'était un grand pas de fait, (1) Nous l'apprenons de Reynier, auteur contemporain, dans son traité contre les Vaudois, où il s'exprime ainsi : « Dicunt quod omnis laicus et etiam femina debeat praedicare. Item, quidquid praedicatur, quod per textum Biblias non probatur, pro fabulis habeat. Item, dicunt quod sacra scriptura eumdem effectum habent in vulgari quam in latino. Unde etiam conficiunt in vulgari et dant sacramenta. Item, Testamenti Novi textum et magnam partem Veteris vulgariter sciunt corde, etc. » (Biblioth. Max. Patrum, tom. XXV. Reinerus, contra Waldenses, pag. 265.) 122 et ce ne fut pas sans raison que les Calvinistes français du XVII° siècle proclamèrent les Vaudois et les Albigeois pour leurs ancêtres. L'hérésie antiliturgique fut comprimée et même éteinte pour un temps par les armes catholiques ; mais elle devait se réveiller avec un succès terrible trois siècles après. A l'époque où elle éclata pour triompher de l'antique foi dans de nombreuses contrées, plusieurs de ses tendances furent imprudemment admises par des catholiques imprévoyants, et lon vit, comme nous l'avons remarqué ailleurs (1), un rationalisme modéré s'établir dans certains pays catholiques, et y préparer la voie à cette seconde émission de l'esprit protestant connue sous le nom de Jansénisme. Érasme est peut-être le plus complet représentant de ces périlleuses tendances. Résolu de demeurer catholique, il accueillit, en les atténuant, un grand nombre d'idées qu'avaient lancées les réformateurs, et fut plus d'une fois sur le point de faire naufrage. La Sorbonne s'émut à la publication de ses écrits, qui respirent en mille endroits l'esprit de Luther sans en accepter les excès, et,en 1526, une censure fameuse de cette Faculté vint résumer et proscrire le dangereux système que ce docteur avait formulé, principalement dans ses Paraphrases du Nouveau. Testament. Erasme n'avait point anathématisé la pratique de l'Église sur les langues sacrées ; sa prudente réserve le préservait toujours des derniers excès ; mais il s'était exprimé ainsi : « C'est chose inconvenante et ridicule de voir des ignorants et des femmes marmotter, comme des perroquets, leurs psaumes et leurs prières à Dieu ; car ils n'entendent pas ce qu'ils prononcent (2). » (1) Institutions liturgiques, tome II, 197. (2) Indecorum, vel ridiculum potius videtur quod
idiotae et muliercul, psittaci exemplo, psalmos suos et precationem dominicain
immurmurant, cum ipsae quod sonant non intelligant, (Prfat. in Matthum.) 123 La Faculté relève en ces termes l'assertion inconvenante du bourgeois de Rotterdam : « Cette proposition, qui est de nature à détourner mal à propos les simples, les ignorants et les femmes, de la prière vocale prescrite par les rites et les coutumes de l'Église, comme si cette prière était inutile pour eux du moment qu'ils ne l'entendent pas, est impie, erronée, et ouvre la voie à l'erreur des Bohémiens, qui ont voulu célébrer l'office ecclésiastique en langue vulgaire. Autrement il faudrait dire que, dans l'ancienne Loi, il était inconvenant et ridicule au simple peuple d'observer les cérémonies de la loi que Dieu avait établie, parce que le peuple ne comprenait pas le texte qui les prescrivait ; ce qui serait blasphématoire contre la loi et contre Dieu qui l'a portée, et, de plus, hérétique. En effet, l'intention de l'Église dans ses prières n'est pas seulement de nous instruire par la disposition des mots, mais encore de faire que, nous conformant à son but, en qualité de ses membres, nous prononcions les louanges de Dieu, nous lui rendions les actions de a grâces qui lui sont dues, et implorions les choses qui nous sont nécessaires. Dieu voyant cette intention dans ceux qui récitent ces prières, daigne enflammer leur affection, illuminer leur intelligence, soulager l'humaine faiblesse, et dispenser les fruits de la grâce et de la gloire. Telle est aussi l'intention de ceux qui récitent les prières vocales sans entendre les paroles. Ils sont semblables à un ambassadeur qui ne comprendrait pas les paroles que son souverain lui a données à porter, et qui, toutefois, les transmettant selon l'ordre qu'il a reçu, remplit un office agréable à son souverain et à celui auprès duquel il est envoyé. En outre, on chante dans l'Église un grand nombre de passages des Prophètes, qui, bien qu'ils ne soient pas compris par la plu part de ceux qui les chantent, sont néanmoins utiles et 124 méritoires à ceux qui les prononcent ; car en les chantant on rend un devoir agréable à la Vérité divine, qui les a enseignés et révélés. D'où il suit que le fruit de la prière ne consiste pas seulement dans l'intelligence des mots, et que c'est une erreur dangereuse de penser que la prière vocale n'a d'autre but que de procurer l'intelligence de la foi, tandis que cette sorte de prière se fait principalement pour enflammer l'affection, afin que l'âme, en s'élevant à Dieu avec piété et dévotion en la manière susdite, se ranime, qu'elle ne soit pas frustrée, mais obtienne ce que demande son intention, et que l'intellect mérite la lumière et les autres grâces utiles et nécessaires. Or tous ces effets sont bien autre ment riches et précieux que la simple intelligence des mots, qui apporte peu d'utilité, tant que l'affection en Dieu n'est pas excitée. Quand bien même on traduirait les psaumes en langue vulgaire, ce ne serait pas une raison pour que les simples et les ignorants en eussent la pleine intelligence (1). » Nous ne donnerons point ici l'histoire des efforts que firent les sectaires du XVI° siècle pour irriter les peuples contre l'usage des langues non vulgaires à l'autel. On sait que les Hussites, dans la Bohême, défendaient cette prétention les armes à la main, et qu'ils formulèrent la demande d'une Liturgie en langue vulgaire, au concile de Bâle. L'incendie éclata dans toute sa force lorsque Luther et Calvin eurent pris en main la cause de la prétendue Réforme, et le principe se montra tellement fondamental dans le système protestant, que l'Église anglicane et celles du Nord, qui n'acceptèrent pas toutes les formes du Luthéranisme et du Calvinisme, affectèrent unanimement de remplacer le latin par la langue vulgaire dans le service divin. Le concile de Trente se vit (1) Voir la note C, à la fin du chapitre. 125 obligé de publier une décision de foi sur cette matière en même temps que, pour donner une nouvelle énergie au principe de la langue sacrée dans le patriarcat d'Occident, il décréta l'unité liturgique dans les textes, en renvoyant au Pontife romain le soin de rédiger un missel et un bréviaire universels. Le Jansénisme accepta la succession d'Érasme en cette matière; il ne poussa point, comme les réformateurs, à la destruction violente de la langue liturgique, mais il plaignit avec éloquence les fidèles privés de la consolation de joindre leurs voix à celle de l'Église. Il créa des traductions françaises de la Liturgie, et, dans son Église de Hollande, où il pouvait agir avec plus de liberté, on vit ses adhérents administrer les sacrements en langue vulgaire. Le caractère des adversaires de la pratique de l'Église en ce point, depuis les Vaudois et les Albigeois jusqu'à Quesnel et l'abbé Chatel, prouve jusqu'à l'évidence la légitimité, nous dirions presque la nécessité des langues sacrées pour les prières de la Liturgie. Une religion sans mystère, c'est-à-dire une religion humaine, pouvait seule exclure les habitudes mystérieuses du langage. Il est donc bien clair que l'Église, dans les circonstances où elle a permis qu'on usât d'une langue vulgaire dans la Liturgie, a cédé à la nécessité, et n'a eu en vue que d'accélérer l'établissement de la foi chez un peuple ; jamais elle ne l'a fait dans l'intention directe d'exposer aux yeux du vulgaire les prières mystérieuses. La nécessité exista aux premiers jours du christianisme ; l'Église, comme nous l'avons dit, ne pouvait pas créer une langue qui n'existait pas auparavant, uniquement pour la faire dépositaire de la Liturgie. D'autre part, l'intérêt de la propagation de la foi peut légitimer, dans l'enfance d'une chrétienté, des concessions qui ne seraient plus à propos lorsqu'elle est devenue adulte ; c'est le lait des enfants que 126 lon donne à ceux qui ne pourraient supporter le pain des forts. Encore est-il arrivé constamment que la langue, vulgaire au commencement, a cessé de l'être, pour devenir purement liturgique, et cela sans que les peuples aient eu même l'idée de réclamer. Mais une telle concession est loin d'être un droit pour les Églises naissantes. Nous avons vu que, durant les trois premiers siècles, il n'y eut d'autre langue liturgique que la syriaque, la grecque et la latine : celles qui vinrent après dans l'Orient, sont en petit nombre, et pour l'Occident, nous n'en trouvons que deux. Aucune autre n'a partagé avec la latine l'honneur de porter les mystères aux chrétientés du Nouveau Monde et à celles des Indes orientales. C'est ici le lieu de raconter un fait important qui se rattache à l'histoire des Missions de la Chine, et qui nous fournira mieux que tout autre l'occasion d'apprécier l'esprit de l'Église en cette matière. Il y avait trente ans que le P.
Matthieu Ricci, de la Compagnie de Jésus, avait ouvert glorieusement
l'apostolat de ce vaste empire, lorsque les zélés missionnaires chargés de
continuer son uvre, espérant que l'usage de la langue chinoise dans le service
divin consoliderait les conquêtes de l'Évangile, présentèrent à Paul V un
mémoire qui paraît avoir été rédigé par le P. Trigault, pour obtenir de ce
Pontife la permission d'user de ce moyen. Par un décret du (1) De
Miss sacrificio, lib. Il, cap. II, n° 13. 127 En 1667, un second mémoire
composé par le P. Rougemont proposa de nouveau la question au jugement du Saint-Siège;
on y parlait au nom des Vicaires apostoliques français qui avaient été envoyés
à la Chine. Une congrégation composée de cardinaux, de prélats et de
théologiens distingués, parmi lesquels on remarquait le P. Chrétien Wolf, fut
chargée d'examiner la demande des missionnaires. La décision sembla tellement
difficile, que le Siège apostolique s'abstint de rendre le décret (1).
Cependant, les missionnaires jésuites, en même temps que leur obéissance si
connue envers le Saint-Siège leur interdisait de prendre l'initiative dans
l'application, préparaient avec zèle les voies pour ramener la cause. Le savant
Père Verbiest rédigea un troisième mémoire dans le sens des deux premiers, en
1678, et à ce mémoire était joint, pour être offert à Innocent XI, un exemplaire
du Missel romain traduit en chinois et imprimé. Le Pontife adressa un Bref de
remerciement pour cet envoi au P. Verbiest, en date du Le P. Couplet, Procureur général de la Mission des jésuites en Chine, était venu en Europe pour presser l'approbation et l'usage du Missel chinois; il passa plusieurs années à Rome, mais sans pouvoir obtenir du Saint-Siège ce qu'il désirait. Il vint à Paris en 1688, et communiqua à plusieurs personnes la Dissertation qu'il avait composée en faveur de la traduction chinoise des livres liturgiques. Ce travail, qu'il avait soumis à son savant ami et compatriote le P. Papebrock, ne se trouve plus ; mais l'ardent et infatigable bollandiste en a inséré un (1) Bened. XIV. Ibid. (2) Lebrun, Explication de la Messe, tom IV, pag. 241. 128 précis dans son Propylée du mois de Mai (1). La dernière tentative des jésuites de la Chine, dans le but dont nous parlons, se rapporte à l'année 1697. Un quatrième mémoire fut présenté à Innocent XII (2); mais il resta sans résultat comme les précédents. Depuis lors, la question n'a pas fait un pas; elle a même cessé d'être agitée, et il est devenu évident, pour les missionnaires comme pour tout le monde, que l'intention du Siège apostolique est de ne pas accorder aux Églises de la Chine l'usage de la langue vulgaire dans la Liturgie. Il n'est pas difficile de trouver les motifs qui ont porté Rome à ne pas s'avancer dans cette voie. D'abord, nous avons vu combien l'usage de la langue vulgaire dans la Liturgie répugne à l'esprit de l'Église. Les protestants ont invoqué cette liberté comme un des principes fondamentaux de leur réforme religieuse. La concession faite aux Slaves a constamment menacé l'orthodoxie d'un peuple nombreux, jusqu'au jour où elle en a si cruellement triomphé. Cependant, les Églises du rite slavon étaient, pour ainsi dire, attenantes à celle du rite latin, et Rome pouvait surveiller la Ruthénie avec autant de facilité qu'elle régissait la Bohême et la Pologne. En outre, n'eût-il pas été d'une extrême imprudence de braver le reproche de contradiction que n'eussent pas manqué d'adresser les protestants à l'Église romaine, et cela pour autoriser l'usage de la langue vulgaire dans une immense contrée, séparée du reste de la chrétienté par une distance énorme, habitée par un peuple tenace dans ses préjugés et ses usages, et dont la langue ne sera jamais familière en Europe qu'à un petit nombre de savants ? (1) Propylaeum Maii. Dissertatio XVIII, pag. 137-139. (2) On peut lire ce mémoire dans le précieux ouvrage du P. Bertrand, de la Compagnie de Jésus, sur la Mission du Maduré, tom. Ier, pag. 348-360. On y trouve aussi des fragments des mémoires des PP. Rougemont et Verbiest. 129 Quand on veut bien se rappeler que la Liturgie est le principal instrument de la tradition, peut-on ne pas s'inquiéter de ce que fût devenue cette tradition au bout d'un siècle, lorsque son principal dépôt aurait été remis entre les mains d'un peuple laissé à lui-même, et au sein duquel (en supposant comme on l'espérait gratuitement que la conversion de la Chine au christianisme dépendît d'un Missel chinois), au sein duquel, disons-nous, la langue latine, la langue de Rome n'eût été représentée que par quelques missionnaires européens, par quelques Légats ou visiteurs apostoliques ? Quelles précautions sévères Rome n'a-t-elle pas été obligée de prendre pour empêcher qu'il ne se formât une sorte de christianisme chinois, au moyen de certaines cérémonies qui ont été trop souvent et trop énergiquement condamnées par le Saint-Siège, pour qu'il soit permis aux catholiques de penser qu'elles n'entraînaient pas après elles un véritable péril ? Quel aurait été le lien de cette chrétienté lointaine avec le reste de l'Eglise ? Le grand Empire du milieu, devenu chrétien, eût couru risque de reprendre bientôt ses habitudes d'isolement superbe, et son peuple, qui a tant besoin de se résigner à recevoir la lumière de l'Occident et de sortir de son sommeil, n'eût point été averti d'une manière assez efficace qu'il est appelé, comme tous les autres, à faire nombre dans l'Église qui est la famille des nations. Nous raisonnons toujours dans l'hypothèse beaucoup trop flatteuse selon laquelle le Missel chinois eût pu être le j levier souverain à l'aide duquel les disciples de Bouddha auraient été soulevés de leur immobilité, pour devenir ] disciples de Jésus-Christ ; mais peut-on se défendre d'inquiétude à la pensée d'une révolution religieuse qui eût amené au christianisme, sans l'inoculation de la langue de Rome, la Chine, le Japon, la Cochinchine, le Tongking, le royaume de Siam, etc., auxquels, selon le mémoire du P. Couplet, la traduction du Missel était 130 destinée. Qu'il eût été à craindre que de si magnifiques espérances n'eussent été déçues, et que la force des habitudes n'eût bientôt rattaché à son passé cette masse de peuples qui ne s'entamera jamais sérieusement que par le contact avec l'Europe ! Dans cette situation étrange et toute spéciale, Rome ne pouvant se faire chinoise, c'est à la Chine de se faire latine, quant à la Liturgie, tout en restant elle-même pour ses institutions, et dans tout ce que ses murs ont de compatible avec la régénération chrétienne. Maintenant, quel était le motif qui porta pendant un siècle les jésuites de la Chine à solliciter du Saint-Siège l'admission de la langue chinoise au nombre des langues liturgiques ? Assurément, ce n'était pas le goût des innovations; cette Compagnie a trop glorieusement mérité les antipathies de tous les ennemis de l'Église par son admirable entente du génie catholique en toutes choses, pour qu'on puisse même la soupçonner de s'être manqué à elle-même dans cette question plus délicate peut-être que ne le pensaient, dans les élans de leur zèle, les pieux et Savants traducteurs du Missel romain en chinois. Une seule chose les préoccupait : la propagation et la conservation du christianisme à la Chine. Persuadés que l'une et l'autre étaient impossibles sans un clergé indigène, ils proposaient avec ardeur, dans leurs mémoires, ce moyen comme le seul efficace pour la formation de ce clergé, qui se trouve principalement retardée, disaient-ils, par la nécessité imposée aux clercs d'étudier et de posséder la langue latine. Il ne s'agit pas d'examiner ici jusqu'à quel point cette nécessité peut être considérée comme l'obstacle principal au développement du clergé indigène à la Chine et ailleurs ; nous pensons que des obstacles plus sérieux et d'une toute autre nature retarderont longtemps encore sur ce point l'accomplissement des désirs du Saint-Siège et des missionnaires ; mais, en ce moment où l'on 131 cherche à faire croire que la Compagnie de Jésus s'est toujours opposée par système à la création du clergé indigène dans les missions qui lui sont confiées, il ne nous semble pas indifférent de remarquer au prix de quelle responsabilité, durant un siècle entier, les jésuites de la Chine persistèrent à vouloir ce clergé indigène. Les faits parlent ici assez haut, et des réclamations motivées qui s'étendent de l'année 1615 jusqu'à l'année 1698, des mémoires rédigés par les missionnaires eux-mêmes, déposés aux pieds du Souverain Pontife par le Général de la Compagnie, mentionnés et défendus jusque dans les colonnes d'un ouvrage aussi public et aussi célèbre que le sont les Acta Sanctorum, sont des monuments qu'il n'est ni permis d'oublier, ni possible d'anéantir. Nous sommes heureux de rendre en passant cette justice aux hommes apostoliques dont nous venons d'enregistrer les noms, et d'autant plus que nous avons le regret d'émettre sur l'objet de leurs constants désirs un sentiment fort différent de celui que le zèle du salut des âmes leur avait fait embrasser. Du reste, la question est jugée depuis longtemps, et nous ne doutons pas que les zélés missionnaires qui s'étaient faits les champions du Missel chinois, ne se soient soumis sincèrement aux refus du Siège apostolique d'accéder à leur demande. Nous devons dire un mot des moyens de preuve qu'ils employaient dans leurs mémoires. D'abord, les missionnaires généralisent trop le privilège accordé à quelques nations d'user de la langue vulgaire dans la Liturgie. Les Coptes, les Éthiopiens, les Arméniens et les Slaves ne constituent pas toutes les nations chrétiennes en dehors des trois langues syriaque, grecque et latine; ils ne forment au contraire qu'une bien faible minorité, et les Slaves sont les seuls auxquels cette liberté ait été octroyée directement par le Siège apostolique. 132 La raison tirée de la distance qui sépare la Chine du reste de la chrétienté, et la difficulté de trouver des missionnaires convenables pour ce pays, loin de favoriser un système qui tend à multiplier les Églises nationales, réclame bien plutôt l'emploi de tous les moyens propres à resserrer les liens de l'unité et de la dépendance. Les missionnaires conviennent que les progrès de ta foi peuvent exister dans le peuple, sans le secours du moyen qu'ils réclament ; ils ont surtout en vue les Mandarins et les Lettrés dont ils veulent ménager les préjugés et la susceptibilité. N'est-il pas à craindre que cette caste privilégiée devant laquelle il faudrait que le Siège apostolique s'inclinât, devenue dépositaire de la religion tout entière, ne se renferme de nouveau dans un isolement impossible à rompre; et n'est-ce pas une illusion que d'espérer dans l'avenir, de la part des Lettrés, une disposition plus favorable à la langue latine ? L'argument tiré de l'immense étendue des pays de la langue chinoise, nous semble prouver tout le contraire de ce qu'on voudrait en conclure. Plus vastes seraient les domaines du christianisme en Chine, plus serait imminent le danger de voir se former une aggrégation de peuples vivant à part dans la religion, avec les murs d'un gouvernement absolu, et tous les antécédents qui ont rendu jusqu'ici ce peuple inaccessible aux moindres changements. Quant à ce qu'on ajoute que si le Sauveur fût né en Chine, et si les Évangiles eussent été écrits en chinois, les peuples de l'Europe eussent trouvé dure la nécessité d'apprendre cette langue, et qu'il eût été à désirer que les apôtres de nos contrées nous en eussent dispensés; le fait est que Dieu, dans sa miséricorde, n'a point procédé ainsi. Il a d'abord préparé toutes choses en faveur des peuples qu'il voulait appeler les premiers en les fondant tous dans l'empire romain, précurseur de l'empire du Christ. Trois 133 langues, le syriaque, le grec et le latin, représentaient l'immense majorité des peuples qui formaient cette aggrégation; ces trois langues, après avoir été sacrées sur le titre de la Croix du Sauveur, ont suffi pour le premier établissement de l'Église. Celle qu'a parlée le Christ lui-même a été la moins féconde, et n"a reçu qu'une faible portion des saintes Écritures du Nouveau Testament, et la grecque, plus favorisée que les deux autres, plus conquérante au commencement, a cédé l'honneur à la latine qui représente à elle seule presque toute la chrétienté orthodoxe. Que Dieu ait mis, dans les arrêts de sa justice, de sévères conditions à l'admission de certains peuples dans le christianisme, c'est ce que nous ne pouvons nier; mais dans l'histoire de l'Église les hypothèses expliquent peu de choses : les faits éclairent davantage. N'avons-nous pas vu, dès les trois premiers siècles, plusieurs nations admises à la foi, sans qu'on ait traduit pour elles ni les Écritures, ni la Liturgie ? Et parce que les lettrés chinois ont plus d'orgueil, les leçons de l'humilité, sans lesquelles on n'entre ni on ne se maintient dans l'Église, doivent-elles leur être épargnées ? Les missionnaires sont plus fondés quand ils disent que la séparation des Grecs d'avec l'Église romaine n'est pas venue de la différence des langues liturgiques; personne aussi ne l'a pensé; mais il n'en est pas moins vrai que si une même langue eût réuni les deux Églises, il y eût eu un lien de plus à rompre, comme il est indubitable que cette dissemblance dans la Liturgie formera toujours un obstacle de plus à la réunion. Quant à ce que dit le mémoire à propos de l'Église anglicane, qui s'est séparée du Saint-Siège, bien qu'elle usât de la langue latine dans le service divin, cette remarque n'a aucun sens, si ce n'est d'insinuer qu'il est indifférent d'avoir une même langue liturgique avec Rome. Il est évident qu'un tel argument ne prouve rien, par là même qu'il prouve trop ; car personne 134 n'a jamais prétendu que la communauté de langue liturgique avec l'Église romaine rendît impossible la chute d'une Église particulière dans le schisme ou l'hérésie. On a seulement pensé, d'après l'expérience et la nature même des choses, que les Églises particulières trouvaient dans cette communauté un appui et un lien de plus avec le centre de l'unité. Pour répondre à l'objection tirée de la difficulté des communications entre Rome et la Chine devenue chrétienne, sans adopter la langue latine dans la Liturgie, les missionnaires allèguent encore l'exemple de l'Église grecque, qui, aux jours de l'unité, n'en demeura pas moins sous la surveillance des Pontifes romains par les relations fréquentes auxquelles la diversité des langues ne mit point obstacle. C'est oublier deux choses : la première, que le territoire de l'Église grecque a toujours été limitrophe de celui de l'Église latine; ce qu'on ne pourrait dire assurément de l'Église chinoise : la seconde, la facilité avec laquelle les Latins peuvent apprendre la langue grecque, qui n'a jamais cessé d'être étudiée chez eux, et n'a aucun rapport avec le chinois dont l'extrême difficulté, jointe à létrangeté des caractères, apaisera toujours l'ardeur des philologues les plus empressés. Tels sont les motifs allégués dans le mémoire du P. Verbiest, qui résume ceux de ses prédécesseurs. Le P. Papebrock, dans le Propylée du mois de Mai, reproduit la plupart des raisons que nous venons d'exposer; mais dans sa courte dissertation, il allègue quelques raisons qui lui sont propres. Il nous semble toutefois qu'il est possible de répondre aux faits sur lesquels il s'appuie. Ainsi il n'est pas fondé quand il attribue au Pape Adrien II la concession de la langue vulgaire dans la Liturgie aux Slaves. La lettre de Jean VIII, successeur de ce Pontife, à saint Méthodius, prouve matériellement que le Saint-Siège n'avait pas eu connaissance jusqu'alors de la traduction que saint 135 Cyrille et son compagnon avaient faite de l'office divin en langue slavonne.Si les Actes des deux saints disent le contraire, ils doivent être abandonnés, comme l'a fait voir Assemani (1). Le savant jésuite regarde comme indubitable la facilité avec laquelle Rome accorderait l'usage de la langue vulgaire au Danemark et à la Suède, si ces royaumes voulaient rentrer dans l'unité catholique. Il est permis de penser qu'une telle faveur ne s'obtiendrait pas aussi facilement que s'en flatte le P. Papebrock, et Rome a eu grandement raison d'attendre pour l'Angleterre, qui reviendra d'elle-même à la foi catholique et à la langue latine. Au reste, le cas est fort différent; les Suédois et les Danois, rentrés dans l'Église catholique, resteraient en Europe, et continueraient de participer aux relations européennes, l'étude même du latin ne cesserait pas de faire la base de l'enseignement classique dans les écoles de ces deux royaumes; toutes choses qu'on ne saurait espérer des Chinois. Les communications de la Chine devenue chrétienne avec le centre de l'unité n'en seraient pas moins difficiles, en attendant qu'elles devinssent impraticables. Le P. Papebrock répète ensuite ce qu'on lit dans les mémoires des missionnaires au sujet du Japon, et prétend que le christianisme s'y fût conservé au moyen d'un clergé indigène célébrant la liturgie en la langue du pays. A la réflexion, il est aisé de voir combien cette assertion est hasardée. Les édits de cet empire s'opposant à toute communication avec les chrétiens, resterait à expliquer par quelle voie la mission des pasteurs se fût perpétuée, comment la foi se fût maintenue dans sa pureté, sans rapports avec le centre de l'unité; comment, par quel privilège, en un mot, la Liturgie en langue vulgaire eût assuré à l'Église du Japon des avantages que tant (1) Origines Ecclesi Slav., tom. III, part. II, cap.I, n° 4. 136 d'autres Églises ont perdus, par le seul fait de la difficulté des rapports hiérarchiques. Cette illusion du zèle est honorable, sans doute; mais elle a contre elle l'expérience. Les Apôtres, dit encore le P. Papebrock, n'ont point soumis les nations qu'ils évangélisaient à l'obligation d'apprendre la langue de la Galilée; pourquoi imposerait-on la connaissance du latin à ces peuples si éloignés de l'Europe? A cela nous répondons qu'il faut distinguer le ministère de la prédication de la célébration du saint Sacrifice. En effet, si les Apôtres étaient allés prêcher l'Évangile par le monde, en langue syro-chaldéenne, il est douteux qu'ils eussent converti beaucoup de monde; mais Dieu avait pourvu à cet inconvénient en leur donnant l'intelligence de toutes les langues, et aux peuples la facilité de les entendre, en quelque idiome qu'ils s'exprimassent. Il est nécessaire de faire ici une distinction capitale que le P. Papebrock perd de vue : la distinction de la chaire et de l'autel. Dans la chaire, la langue vulgaire est indispensable ; à l'autel, on peut s'en passer, même dans les commencements d'une chrétienté, comme des faits innombrables l'ont prouvé. Ensuite, il n'est pas exact de raisonner dans l'hypothèse où les Apôtres n'auraient eu que la seule langue syro-chaldéenne pour instrument de la prédication évangélique; il faudrait pour cela avoir oublié le miracle de la Pentecôte. Maintenant, quant à la Liturgie, nous avons reconnu et établi qu'elle existait en trois langues, comme les saintes Écritures, au temps des Apôtres. Nous avons relevé le privilège de ces trois langues vulgaires et sacrées, qui représentent par leur étendue la circonscription de l'empire romain. Depuis cette époque, l'honneur d'être employées dans le service divin a été accordée un bien petit nombre d'autres; mais toutes ont été admises pour la prédication de l'Évangile; il importe donc de ne pas confondre ici le double usage que l'Église peut faire des langues. 137 C'est à tort que, pour autoriser une Liturgie en langue chinoise, le savant hagiographe avance indistinctement que les Syriens, les Perses, les Égyptiens, les Arméniens, les Abyssins et les Chrétiens dits de saint Thomas, aux Indes, ont célébré la Liturgie en leurs langues, dès l'origine du christianisme dans leurs pays. Pour les Syriens, nous l'avons admis comme un fait capital, leur langue était biblique, et Tune des trois du titre de la Croix; encore faut-il convenir que dans les villes de Syrie, la Liturgie se célébrait en grec, en sorte qu'on était obligé d'expliquer l'Évangile en syriaque, encore au IV° siècle, pour qu'elle fût entendue du peuple. Les Arméniens ont eu l'Écriture sainte et la Liturgie en syriaque, et paraissent n'en avoir usé dans leur langue qu'après l'envahissement du mono-physisme. Chez les Abyssins, la foi chrétienne ne date que du IV° siècle. Les Églises de la Perse n'ont jamais célébré la Liturgie en persan, et si la haute Egypte s'est servie de la langue copte pour l'Écriture sainte et la Liturgie, dès le IV° siècle, ce qui n'est pas absolument évident, Alexandrie et toute la basse Egypte usèrent encore du grec dans l'Église pendant les deux siècles suivants. Quant aux chrétiens de saint Thomas, leur langue liturgique est le syriaque, qui n'a jamais été vulgaire dans l'Inde, en sorte qu'il est impossible de comprendre pourquoi ils sont allégués ici. Entraîné par cette ardeur dont il a donné d'autres preuves, le P. Papebrock va jusqu'à nier l'importance de la communauté de langues liturgiques pour conserver l'union des Églises, et conclut de ce que Rome n'exige pas de changement à ce sujet dans les Églises hérétiques ou schismatiques de l'Orient qui se réunissent à elle, qu'il faut agir d'une manière analogue dans la fondation des chrétientés nouvelles. Nous ne nous arrêterons pas sur ces assertions hardies ; il est facile de les juger d'après les principes que nous avons exposés plus haut. Dans son 138 enthousiasme pour la Chine, le docte jésuite veut rendre raison de l'étendue du règne de la langue latine dans la Liturgie de l'Occident, en disant que les nations occidentales ne jouissaient pas d'une telle civilisation que lon dût ménager leurs langues, en leur annonçant le christianisme, comme si la civilisation de la Gaule et de l'Espagne sous les Romains n'eût pas valu celle dont jouissent les Chinois ; comme si encore une nation moins populeuse que la Chine n'avait pas les mêmes droits aux ménagements qui peuvent lui faciliter l'initiation à la foi. D'ailleurs, ce n'est pas seulement l'établissement de la foi chez un peuple qu'il faut considérer, mais encore sa conservation. Dans l'Occident, on a été facile pour les peuples slavons quant à la langue liturgique, et cette langue est devenue l'instrument de leur séparation d'avec l'Eglise. Tandis que les autres nations européennes qui ont voulu rompre avec la catholicité ont été obligées de se dépouiller préalablement de la langue latine, les Slaves, entraînés dans le schisme russe, ont conservé la langue liturgique qui déjà les isolait de Rome. Le P. Papebrock montre très bien que la langue grecque devait être admise dans la Liturgie à raison de sa grande étendue et de sa célébrité; nous dirons plus encore, en répétant que la langue grecque a été chrétienne avant la langue latine ; l'honneur dont elle a joui ne prouve donc rien en faveur du chinois. Il ajoute que les progrès de la foi ont fait étendre le privilège de la Liturgie aux langues syriaque, arménienne et copte, et enfin aux autres nations civilisées de l'Orient à mesure que la foi s'avançait vers elles. Nous n'avons garde de contester la qualité de langue liturgique au syriaque, son privilège date du premier jour du christianisme ; moins glorifiée que la langue grecque, cette langue marche cependant de pair avec elle. Quant à l'arménien et au copte, ils ne sont entrés dans l'usage liturgique qu'après l'établissement du christianisme 139 dans les pays où l'on parlait ces deux langues, et les faits
ne suffisent que trop à démontrer quel avantage les peuples en ont retiré pour
l'unité et l'orthodoxie. Le P. Papebrock mentionne en termes généraux d'autres
nations vers l'Orient chez lesquelles la Liturgie en langue nationale eût été
l'instrument de la propagation de la foi. Sauf la Géorgie et la Mingrélie, qui
est redevenue païenne, nous n'avons pu encore découvrir, en dehors des nations
que nous avons nommées, une seule qui ait été chrétienne et qui ait célébré la
Liturgie dans sa langue. Au Tels sont les principaux traits du plaidoyer que l'illustre Bollandiste a consacré à la cause du clergé indigène dans la Chine. On y retrouve la franchise de sa discussion et la hardiesse de ses vues; mais il faut y reconnaître en même temps la trace de ce zèle apostolique inhérent pour ainsi dire à tous les actes, à tous les mouvements de sa Compagnie, en sorte qu'il a fallu arriver aux jours de distraction et de légèreté où nous vivons, pour entendre reprocher aux jésuites un défaut d'énergie et un calcul étroit dans ce qui touche aux intérêts de la propagation de la foi. Le Siège apostolique a eu besoin de toute la fermeté et de toute la lumière que l'Esprit-Saint a déposées en lui, pour avoir pu résister aux instances généreuses et continues dont il a été poursuivi sur cette question, pendant près d'un siècle. Le sentiment du mystère dans la Liturgie, le principe d'union des Églises par l'uniformité de la langue sacrée, ont triomphé; et, depuis un siècle, Rome n'a plus été sollicitée d'accorder une faveur dangereuse tout à la fois aux chrétientés anciennes et aux chrétientés nouvelles. Les progrès de l'Église à la Chine n'ont pas été rapides; l'affaire des cérémonies chinoises et la suppression des jésuites ne suffisent que trop à expliquer un tel retard dans la conversion de ce peuple. Il n'est pas 140 de notre sujet d'approfondir ici la question du clergé indi-' gène dans les Missions ; mais nous croyons avoir justifié suffisamment la sévérité du Saint-Siège à maintenir le principe de la langue non vulgaire dans la Liturgie, en face même des théories les plus séduisantes d'un zèle tout apostolique. On sentira mieux en méditant cet épisode de l'histoire des Missions combien la question de la langue liturgique est grave et importante, puisqu'elle peut être mise quelquefois en balance avec les intérêts mêmes de la propagation de la foi. Il nous reste encore quelques faits à consigner ici, pour mettre dans tout son jour la question de la langue des livres liturgiques. Le plus important de ces faits, qui est en même temps le plus évident, est que des diverses Églises qui sont en possession d'une langue liturgique différente de celle de l'Église romaine, il n'en est pas une seule qui ait pu éviter le schisme ou l'hérésie : pour plusieurs, la langue vulgaire dans le service divin paraît même avoir été l'instrument direct de la séparation. Un empire formé de peuples dissemblables de murs et de langage ne se maintient pas aisément dans l'unité du régime de sa métropole : l'emploi de la force et l'habileté politique peuvent seuls en retarder le démembrement successif. Comment l'Église, dépourvue des moyens matériels d'obtenir l'obéissance, eût-elle triomphé du mauvais vouloir de tant de peuples, que l'orgueil ou l'indifférence nationale retenaient au moyen des langues dans un isolement dangereux ? Dans les premiers siècles, où l'ardeur de la foi récemment embrassée, où la sève vigoureuse qui suffit à produire tant de martyrs maintenaient un sentiment énergique de fraternité, où le seul intérêt de la foi unissait les chrétiens, qui nulle part ne formaient encore de nations politiques, la diversité des langues n'empêchait pas les communications, et l'échange des idées et des sentiments, des hommes mêmes, d'une église à l'autre, était 141 continuel. Durant tout le cours de cette époque primitive nous voyons l'Orient prêter à l'Occident des évoques, des moines, des docteurs, et en emprunter de lui à son tour. Mais cette familiarité ne devait pas durer toujours; la charité se refroidit, et les églises s'isolèrent peu à peu les unes des autres, parce que le langage liturgique ne les unissait pas comme la foi. Ce n'est point à nous, fils aînés de l'Église romaine, de nous scandaliser de ces défections. Unis à cette Mère commune par la langue de l'autel, nous aurions, pour nous séparer d'elle, un lien de plus à briser. Si d'autres peuples, soumis à une épreuve que nous n'avons point connue, n'ont pas su se maintenir fidèles, adorons la souveraine justice de Dieu, qui ne permet jamais que l'homme soit tenté au delà de ses forces, et bénissons sa miséricorde, qui a eu compassion de notre faiblesse. Faisons des vux pour que ces rameaux, si cruellement détachés du tronc, viennent y retrouver bientôt la sève et la vie. Dans cette attente, que les siècles ne lassent jamais, Rome tient toujours ses bras ouverts du côté de l'Orient; et pour rendre ses invitations plus pressantes, elle ne cesse de témoigner ses égards maternels pour ces Liturgies, les unes antiques, et les autres modernes, qui sont confiées à des langues si différentes de la sienne; et c'est là un fait non moins important à connaître que celui que nous venons de constater. Les langues grecque et syriaque n'ont-elles pas précédé la langue latine dans l'honneur de recevoir le dépôt des oracles divins ? N'ont-elles pas été les premiers instruments de la prédication évangélique ? Les langues copte, éthiopienne, arménienne ne sont venues qu'après les deux premières; elles ont été fatales peut-être aux chrétientés qui s'en servent à l'autel; mais, après tout, on n'en doit accuser que la malice des hommes. Elles ont la possession du temps ; et d'ailleurs, au sein même des Églises qui les emploient dans le sanctuaire, de vrais 142 fidèles ont presque constamment attesté, par la pureté de leur foi, que s'il est plus difficile de demeurer uni au centre de la communion catholique, quand on en est séparé par de telles barrières, cette fidélité est toujours possible, avec le secours de la grâce divine. Du moins ces Églises infortunées n'ont point répudié leur langage liturgique ; elles n'ont pas innové dans les choses du service divin, comme l'ont fait celles du nord de l'Europe, au jour où elles voulurent s'affranchir de la foi romaine. Les Liturgies orientales sont demeurées des témoins irrécusables de la foi de ces Églises, aux jours de l'unité, et Rome, qui vit de traditions, protège avec sagesse, et dans l'intérêt de la doctrine, des livres et des idiomes qui attestent que, dès les premiers siècles, l'Orient croyait ce que croit encore l'Occident catholique. Enfin, comme la charité est le plus riche trésor de l'Église, le Siège apostolique a toujours veillé avec sollicitude à écarter tout prétexte qui pourrait retarder le jour si désiré de la réunion ; il a ménagé, pour ainsi dire, à l'excès, les susceptibilités de ces peuples infortunés, en prenant sous sa protection les Liturgies d'Orient, leurs langues et leurs rites. Cette sauvegarde maternelle préservera de la destruction ces monuments de l'antique foi, au jour où le rationalisme d'Europe, qui commence déjà ses ravages en Grèce, étendra son souffle glacé sur ces Églises que l'unité ne protège plus. Nul de nous ne connaît l'avenir dont le Père céleste s'est réservé le secret ; mais peut-être est-il permis de penser qu'un temps viendra où la langue de Rome, comme sa foi, sera pour l'Orient, aussi bien que pour l'Occident, le moyen unique de l'unité et de la régénération ? Déjà les catholiques de l'empire russe commencent à sentir que la Liturgie latine pourrait seule assurer la conservation des restes de la foi dans leur pays, et promettre quelques gages d'avenir. Les protestants de l'Angleterre, de l'Allemagne ou du Nord reviennent 143 à lantique Église, sans se plaindre delà rigueur de la loi qui les oblige désormais à ne plus entendre la langue vulgaire dans le service divin. Au XVII° et au XVIII° siècle, diverses tentatives de réunion des Églises réformées avec le Saint-Siège furent essayées par des hommes qui, malheureusement, n'avaient pas caractère pour servir d'organes à un tel rapprochement ; plusieurs d'entre eux n'étaient même pas dans des conditions rassurantes d'orthodoxie. Dans les utopies qu'on échangeait de part et d'autre, de grands sacrifices, dans l'ordre de la discipline, étaient proposés comme nécessaires, comme faciles même ; les temps n'étaient pas venus, et Dieu voulait que ceux qui s'étaient séparés de la Mère commune, avec scandale et ingratitude, au XVI° siècle, accourussent un jour se remettre à sa discrétion. Mais pour revenir aux langues liturgiques de l'Orient, qui sont aussi légitimes que celles des Églises protestantes le sont peu, nous rappellerons ici succinctement ce que les Souverains Pontifes ont fait en leur faveur, et pour la conservation des rites antiques auxquels elles servent d'expression. D'abord, la plupart de ces rites, depuis plus de mille ans, ont été constamment célébrés à Rome, sous l'il des Pontifes romains, dans les diverses églises et monastères desservis par les Orientaux dans cette capitale du monde chrétien. Rome possède encore des églises grecques et arméniennes, et si les rites syrien, copte et éthiopien, n'y sont pas exercés dans des églises propres à ces nations, rien ne s'y oppose, du moment qu'il serait agréable à des ecclésiastiques de ces rites, unis avec le Saint-Siège, de venir s'y établir. En attendant, le Collège de la Propagande renferme des élèves appartenant à toutes les Liturgies orientales, et son église, le jour de l'Epiphanie, présente l'imposant spectacle de messes célébrées publiquement dans tous ces rites à la fois. Une Congrégation permanente de cardinaux est spécialement chargée de la 144 Correction des livres de lEglise orientale, et l'imprimerie de la Propagande les a presque tous publiés, depuis deux siècles, dans de belles éditions où la langue propre et les formules de chaque Eglise de l'Orient sont fidèlement respectées, sauf les rares corrections nécessitées par l'orthodoxie. Enfin, lorsque le Pontife romain célèbre solennellement les saints mystères, les Églises orientales sont représentées, à Saint-Pierre, dans la pompe auguste de cette fonction, par les prélats de leurs rites qui se trouvent à Rome, et qu'on voit alors figurer, avec les évêques latins, dans toutes les particularités de leur costume pontifical. Ce n'est pas tout encore; les Souverains Pontifes sont intervenus directement, un grand nombre de fois, pour arrêter les efforts d'un zèle trop ardent qui eût pu compromettre l'existence des Liturgies orientales, ou blesser du moins les peuples qui les professent. Nous voyons le grand Innocent III, après la prise de Constantinople par les Latins, insister, dans une décrétale publiée dans le quatrième Concile de Latran, pour la conservation du rite grec par les vainqueurs (1). En 1247, Innocent IV écrit à Daniel, roi de Russie, qu'il accorde aux prêtres de ce pays la permission de conserver leurs rites (2) ; le même Pontife, dans une lettre à Othon, cardinal de Tusculum, son Légat en Chypre, accorde le même droit aux Grecs de cette île (3). Quelques années après, c'est Alexandre IV qui écrit aux évêques latins du même royaume de Chypre de se montrer favorables au rite de l'Église grecque (4). Bientôt, Nicolas III émet une intention non moins bienveillante pour cette Liturgie. Nous retrouvons, au XVI° siècle, de nouvelles marques (1) Decretal, lib. III, tit. XLII, cap. XI. Licet. de Baptismo. (2) Raynaldi, ad annum 1247, n° 29. (3) Ibid., ad annum 1246, n° 3o. (4) Labbe, tom. XIV, edit. Venet., pag. 279, et XV, pag. 775. 145 de la protection des Pontifes romains envers les rites de l'Orient. Pie IV déclare qu'il n'entend pas que les Grecs qui demeurent dans les diocèses des Latins soient enlevés à leur Liturgie (1). L'un de ses successeurs, Grégoire XIII, fonde à Rome trois collèges, pour les Grecs, les Maronites qui suivent le rite syriaque, et les Arméniens, et il prescrit qu'ils garderont fidèlement leurs usages dans le service divin. Au siècle suivant, en 1615, Paul V déclare, dans un Bref, que l'Église romaine n'a jamais eu l'intention d'enlever aux provinces de la Russie qui étaient récemment rentrées dans la communion du Saint-Siège, la Liturgie qu'elles avaient reçue autrefois de l'Église de Constantinople. Le prédécesseur de ce Pontife, Clément VIII, pour compléter l'uvre de Grégoire XIII, avait établi à Rome un évêque du rite grec, chargé de conférer les ordres aux élèves du collège de cette nation. Un second évêque du même rite est établi, au siècle suivant, pour donner l'ordination, selon la Liturgie melchite, aux Italo-Grecs qui sont encore en assez grand nombre dans plusieurs provinces du royaume de Naples. Benoit XIII confirma les actes du concile que les Grecs-unis de la Russie avaient tenu à Zamosk, et dont nous avons parlé ailleurs (2) ; et il déclare, dans son Bref de 1724, qu'il n'entend aucunement déroger, ni aux constitutions de ses prédécesseurs, ni aux conciles cuméniques de Lyon et de Florence, qui avaient maintenu les Grecs dans la liberté de suivre leurs rites. Le Bullaire de Benoit XIV renferme un grand nombre de constitutions de ce vigilant Pontife, qui témoignent de sa sollicitude en faveur de la pureté des rites orientaux. Elles ont rapport aux Liturgies grecque-melchite, gréco-russe, italo-grecque, latino-grecque, copte, syrienne-maronite, et tel est l'intérêt (1) Constitution : Romanus Pontifex. (2) Institutions liturgiques, tom. II, pag. 658. 146 que témoigne ce grand pape en faveur de toutes ces formes
approuvées du service divin, qu'il interdit aux patriarches et aux évêques des
Églises d'Orient toute innovation, diminution, ou altération des rites antiques
(1). Depuis Benoît XIV, de nombreux documents émanés, les uns de l'autorité
directe du Pontife romain, les autres de la Congrégation de la Propagande, font
foi du zèle persévérant avec lequel Rome veille à la conservation des Liturgies
orientales. Nous avons mentionné ailleurs (2) le Bref de Grégoire XVI, en date du
La délicatesse du Saint-Siège en cette matière est allée plus loin encore. Rome a enlevé même aux simples particuliers qui professent les rites orientaux la liberté de passer au rite latin, dans la crainte que ses missionnaires, qui sillonnent l'Orient et portent tous avec eux la Liturgie romaine, ne paraissent aux yeux des peuples les ennemis des antiques usages de ces contrées. Les règles du Siège apostolique réservent au Pontife romain le droit de donner aux Orientaux la permission d'embrasser les formes latines, en même temps qu'elles interdisent sévèrement aux fidèles du rite latin le droit de retourner aux Liturgies orientales (3). Quant aux Grecs d'Italie qui sont mêlés aux Latins, les formalités sont moins sévères. Il suffit de la permission de lévêque aux simples fidèles pour passer à la Liturgie romaine ; les ecclésiastiques seuls ont besoin de l'autorisation du Saint-Siège (4). Quel que soit le sort que l'avenir réserve aux langues liturgiques de l'Orient, Rome, qui les a acceptées sincèrement, (1) Tome Ier. Constitution LXXXVII. Demandatum. (2) Lettre à Mgr l'archevêque de Reims, sur le Droit de la Liturgie, page 3o. (3) Benoît XIV. Ibidem. (4) Tome 1er. Benoît XIV. Constitution LVII. Etsi pastoratis. 147 ne serait donc pas responsable d'une révolution qui en amènerait l'extinction successive, et nous devions mentionner les mesures pleines de franchise et d'énergie qu'elle , n'a cessé de prendre dans l'intérêt de ces populations qui ont le malheur de vivre hors de l'unité, depuis tant de siècles. Mais il nous reste encore plusieurs particularités à consigner ici, pour compléter la question des langues liturgiques. Un fait que nous ne devons pas omettre, est la représentation des trois langues sacrées primitives dans la Liturgie romaine, comme sur le Titre de la croix. Sans doute les formules en langue latine constituent le fond des prières de l'Église de Rome; mais l'hébreu y figure avec honneur, d'abord par l'Alleluia triomphal, que les missionnaires du Pontife romain ont fait répéter non seulement aux barbares de la Germanie et de la Scandinavie, mais jusqu'aux habitants des îles situées au delà de ces mers que ne visitèrent jamais les flottes de Salomon. Dans le chant du Trisagion, avant d'ouvrir le Canon du sacrifice, Rome proclame le Dieu trois fois saint, Seigneur des armées; mais elle ne traduit pas le terme sacré, et l'oreille latine entendra retentir Sabaoth jusqu'aux portes de l'éternité. La troisième parole hébraïque et chaldéenne conservée dans la Liturgie latine est Hosanna! qui rappelle le triomphe du Christ, et ne saurait non plus être traduit sans perdre une partie de sa force et de sa grandeur. Enfin, la quatrième est cet Amen de conclusion et d'assentiment, par lequel le peuple chrétien s'unit à tous les hommages et à toutes les supplications que le prêtre et le Pontife adressent à la majesté divine. La langue des Septante, qui est en même temps la langue du Nouveau Testament, .trouve aussi sa glorification dans la Liturgie latine. Neuf fois, à l'autel, l'Église romaine répète Kyrie ou Christe eleïson : cette invocation byzantine ouvre aussi les Litanies, et paraît à certains 148 jours, dans les Heures de l'office. Le Vendredi saint, parmi les chants qui accompagnent l'adoration de la Croix, Rome fait retentir le Trisagion en langue grecque, par ces paroles écrites en lettres latines : Agios, o Theos ! Agios ischyros! Agios athanatos! eleison imas! Lorsque le Pontife romain célèbre solennellement les saints mystères, après l'épître chanté par le sous-diacre latin, le sous-diacre grec la fait entendre dans la langue de son Église; un diacre grec prononce également l'évangile en grec, après que le diacre latin l'a chanté dans la langue de Rome. Autrefois, ce mélange des deux langues était plus fréquent dans l'Église Mère et Maîtresse. Ainsi, nous apprenons d'un ancien auteur cité par Dom Martène que le Gloria in excelsis était chanté en grec à la messe de la nuit de Noël (1). Le Liber pontificalis raconte que les douze] leçons du samedi saint et les six du samedi de la Pentecôte se chantaient alternativement dans les deux langues (2). L'union des langues sacrées parut encore avec plus d'éclat en 1409, dans la cérémonie du couronnement d'Alexandre V, au concile de Pise; on y chanta, disent les Actes du concile, l'épître et l'évangile en hébreu, en grec et en latin (3). Hors de Rome, au moyen âge, la langue grecque obtenait encore d'autres honneurs, dans certaines églises de l'Occident, particulièrement dans les monastères. Ainsi, au Mont-Cassin, encore au X° siècle, le mardi de Pâques, les chants de la messe étaient exécutés alternativement en grec et en latin, jusqu'après l'évangile (4). A Saint-Denis en France, avant la suppression des ordres monastiques, l'épître et l'évangile étaient pareillement chantés dans ces deux langues, et tout le monde sait que le jour de l'octave (1) De antiquis Ecclesi ritibus, tom. I, pag. 279. (2) Anastas. in Benedictum III. (3) D'Achery, Spicileg.,
tom. VI, pag. 334. (4) Martène, ibid., pag. 281. 149 de saint Denys, la messe était célébrée en entier, dans cette insigne église abbatiale, en langue grecque, mais toutefois selon le rite latin, et avec le chant grégorien. On trouve encore assez facilement des exemplaires de cette messe, dans laquelle se voient traduites mot à mot toutes les paroles du missel romain, en la fête de saint Denys avec la prose d'Adam de Saint-Victor : Gaude prole, Grcia. L'intention des moines, par cette pratique, était d'honorer dans leur glorieux patron la qualité d'Aréo-pagite d'Athènes que la critique moderne lui a contestée, malgré la possession et le témoignage liturgique de l'Orient et de l'Occident. Les évêques constitutionnels du conciliabule de 1797 s'avisèrent de relever cet usage, parce que la fête de saint Denys tombait pendant la durée de leur assemblée. Ils se servirent des livres de l'abbaye royale pour chanter cette messe grecque à Notre-Dame de Paris. Au fond, c'était une grande inconséquence à ces prélats schismatiques, qui témoignent dans leurs actes d'une si ardente sympathie pour la moderne Liturgie parisienne, dans laquelle a été renié si solennellement le glorieux souvenir qui rattachait l'Église de Paris à l'Apôtre des gentils, par son disciple de l'Aréopage. Ainsi, la Liturgie romaine associe à la louange de Dieu les deux langues qui figurèrent avec le latin sur l'inscription prophétique de la Croix du Sauveur. L'Église grecque, aux jours de son union avec le Siège apostolique, assignait aussi une place honorable à la langue latine dans ses solennités. Aux principales fêtes, à Constantinople, on chantait l'évangile dans la langue de l'ancienne Rome, avant de le réciter dans celle de la nouvelle, et il y avait cela de remarquable que la leçon latine précédait la grecque. C'est ce que nous apprenons de la lettre du Pape saint Nicolas Ier à l'empereur Michel (1), et on voit par (1) Epist. VIII ad Michaelem imperatorem. Labb., tom. VIII, pag. 298. 150 une lettre de saint Léon IX au patriarche Michel que cet usage existait encore au XI° siècle (1). Il est vrai que l'origine de cette coutume était plutôt politique que religieuse. L'empire transféré à Constantinople prétendait toujours, même après la perte de l'Occident, au titre d'empire des Romains, et les empereurs grecs, jusqu'aux siècles qui précédèrent immédiatement la prise de Constantinople, écoutaient d'abord les harangues en latin, avant de les entendre en grec, et gardaient la même étiquette dans les allocutions qu'ils prononçaient en public, en certaines occasions solennelles. Mais le temps vint où le latin cessa d'être représenté dans la Liturgie melchite : l'antipathie pour Rome accéléra l'abolition de cet antique usage, et présentement, l'Église grecque n'admet plus dans ses formules liturgiques d'autre langue que l'hébreu, représenté par les quatre paroles sacrées que la prière romaine conserve religieusement. Les autres Liturgies de l'Orient, syrienne, copte, éthiopienne et arménienne, sont moins complètes encore quant à la représentation des trois langues du Titre de la Croix. L'élément latin en est totalement absent ; mais on trouve un hommage rendu à la langue grecque dans la Liturgie copte d'Alexandrie. Le dialogue du prêtre et du peuple avant la Préface est en grec, quoique la Préface soit en langue copte ; il en est de même des principaux avertissements du diacre à l'assemblée, et de plusieurs acclamations du peuple avant et après la consécration (2). C'est un dernier souvenir de la langue sacrée, qui, au siècle de saint Athanase, régnait seule dans la Liturgie d'Alexandrie. Ainsi la Liturgie latine se trouve être la seule à offrir à Dieu l'hommage des trois langues qui proclamèrent la royauté du Christ, et il ne nous a pas semblé indifférent d'en faire ici la remarque. (1) Epist.
I ad Michaelem patriarcham. Labb., tom. IX, pag. 963. (2)
Renaudot, tom. I, Liturgi Coptitarum, pages 13-23. 151 Nous dirons maintenant un mot de l'emploi des langues vulgaires dans les Eglises d'Occident. A certains jours et en certains lieux, on avait, au moyen âge, l'usage de réjouir le peuple en entremêlant les Epîtres des grandes fêtes de paroles qui lui fussent familières. Cette coutume avait lieu principalement en France, à la fête de saint Etienne. Le sous-diacre chantant l'épître qui contient le récit du martyre du grand diacre, s'interrompait à chaque membre de phrase, pour faire entendre une ou plusieurs strophes d'un chant en langue vulgaire, qu'on appelait les plancts de saint Estève. L'abbé Le Beuf en a donné plusieurs, empruntés à des manuscrits liturgiques provenant des églises d'Amiens, de Soissons, etc. (1). Dom Martène cite une pièce du même genre extraite d'un missel de Saint-Gatien de Tours, et nous apprend que l'usage de chanter ces épîtres qu'on appelait farcies (farsitae) s'était conservé dans le diocèse de Reims jusqu'au temps de l'archevêque Charles Le Tellier, qui l'abrogea (2). Cette coutume durait encore en 1735 à Aix, en Provence, comme l'atteste l'édition du Glossaire de Ducange donnée par Dom Carpentier (3). On sent qu'un tel usage, tout naïf qu'il était, n'était pas sans inconvénients pour la dignité du service divin, et pour le respect de la langue liturgique. Aussi fut-il imité par les compositeurs des chants destinés à accompagner l'incroyable profanation qui souilla nos églises pendant plusieurs siècles, sous le nom de la fête de l'Ane. Une coutume plus contraire encore à l'esprit de l'Église est celle qui s'est établie en Allemagne, au rapport de Kraser (4), et selon laquelle le peuple chante en langue vulgaire le Kyrie, le Gloria, le Credo, lOffertoire, le (1) Traité historique sur le chant ecclésiastique, pages 122 et suiv. (2) De antiquis Ecclesi ritibus. Ibid., page 282. (3) Aux mots farsa, et Epistol farsit. (4) De antiquis Ecclesi Occident. Liturgiis, page 664. 152 Sanctus, et autres prières que le prêtre récite en latin à l'autel. A moins d'abolir totalement la langue sacrée, on ne pouvait imaginer une pratique plus éloignée de l'intention de l'Église universelle, puisque nous avons vu qu'il n'est aucune des langues liturgiques en usage aujourd'hui qui soit demeurée vulgaire. C'est en vain que le Père Krazer prétend justifier cet abus, en disant qu'il convient de donner une part au peuple dans la célébration du Sacrifice. Il est vrai que cet auteur ne demande pas que les paroles prononcées par le prêtre soient traduites en allemand; mais on voit que le savant Dominicain a peu visité les autres Eglises. S'il eût passé le Rhin, il aurait pu entendre le peuple en France chanter avec le clergé, non seulement les Kyrie, Gloria, Credo et Sanctus, mais encore les proses, les hymnes et les psaumes, et, dans les Églises au sein desquelles le règne de la Liturgie romaine n'a pas souffert d'interruption, la plus grande partie des chants de lAntiphonaire et même du Graduel. Il faut donc considérer un tel usage comme une corruption dangereuse, et comme un sacrifice inspiré par l'esprit de la réforme qui influe trop souvent sur les habitudes catholiques, dans les pays où les deux religions vivent en présence. Il serait donc à désirer qu'on établît dans toutes les Églises d'Allemagne ce beau et catholique statut que portait l'église d'Augsbourg en 1548, par l'autorité de son évêque, le cardinal Othon : « La langue latine, qui est comme un instrument divin dédié aux usages sacrés, sur l'autel même de la Croix, et à laquelle l'Église occidentale est redevable de la religion chrétienne, sera conservée dans l'administration des sacrements et dans les autres offices de l'Église, par tout notre diocèse, et sera rétablie dans les choses où on l'avait suspendue. Seulement on ne changera pas, mais on conservera les paroles qui ont coutume d'être prononcées en langue allemande, selon les anciens 153 Agenda (1). » Il s'agit ici des interrogations et
réponses que renferme le Rituel ou
Agenda, dans l'administration
du baptême et la célébration du mariage. L'Église de France a toujours été franche de cet abus ; car à l'époque même où l'on chantait les épîtres farcies, le texte latin était toujours récité en son entier, bien qu'il fût interpolé de strophes en langue vulgaire. Mais n'a-t-on pas droit de signaler comme une dérogation fâcheuse au principe de la langue liturgique, la déplorable facilité avec , laquelle s'introduit de jour en jour l'usage de chanter dans l'Église ce qu'on est convenu d'appeler des Cantiques. Ces couplets en langue française, dont l'insignifiance! poétique est loin d'être rachetée par la mélodie des airs . de romances ou d'opéras dont on les revêt, envahissent de plus en plus les Églises, dans certains diocèses, et si l'on ne prenait des mesures pour arrêter cet abus, le temps viendrait où beaucoup de gens finiraient par considérer ces étranges nouveautés comme une partie du culte divin. On ne saurait blâmer, sans doute, l'usage de ces chants, dans une Mission où l'on espère attirer, par ce moyen, à l'église certaines personnes qui ne sont pas dans l'habitude de fréquenter les exercices religieux. Dans les écoles et pensionnats, de tels chants, quand ils sont ce qu'ils doivent être, peuvent récréer saintement la jeunesse, et contribuer à faire passer plus agréablement aux enfants les moments où ils assistent au service divin ; mais n'y a-t-il pas lieu de s'affliger, lorsque, dans des églises paroissiales, cathédrales même, à la suite des Vêpres, dans la pompe d'un Salut solennel, le clergé (1) Lingua latina, cui veluti divino instrumento in ipsa crucis ara sacris usibus dedicato, Ecclesia occidentalis Religionem Christianam fert acceptam, in sacramentorum administratione, aliisque Ecclesiasticis officiis per totam nostram Dioecesim retineatur, et exclusa revocetur. Quae vero germanica lingua, secundum antiquas agendas pronunciari consueverunt, mutare fas non sit, sed et ipsa quoque conserventur. (Hartzheim, Concilia Germanice, tom. VI, page 368.) 155 interrompt tout à coup les chants de l'Église pour donner place à un chur de voix de femmes qui font entendre ces soi-disant cantiques, après lesquels le prêtre chante l'oraison, et donne la bénédiction du saint Sacrement. Certes, nous avons de la peine à croire que saint Charles n'eût pas fait prompte et vigoureuse justice d'un tel usage, au nom des convenances liturgiques. Nous vivons à une époque où les idées se faussent, parce que les traditions s'en vont, et que peu de personnes en prennent souci. Nous ne serons donc pas surpris que, l'on s'étonne encore une fois de notre franchise; mais jusqu'à ce qu'on nous ait prouvé que le chant grégorien ne fait plus partie essentielle de la Liturgie, et qu'on peut interrompre les fonctions de la Liturgie pour faire chanter des couplets en français par des churs de femmes, nous soutiendrons que, sur ce point encore, les idées ont pris et prennent un cours déplorable. Une heureuse innovation a signalé ces dernières années. La touchante et gracieuse dévotion du Mois de Marie s'est établie chez nous avec une rapidité dont nous ne saurions assez remercier la Mère de la divine grâce. Autour d'un autel paré de fleurs, les fidèles se réunissent en foule pour entendre raconter les grandeurs et les miséricordes de Marie, et pour exécuter des chants à sa gloire. Nous sera-t-il permis d'émettre ici le vu de ne voir employer, dans ces occasions, que les graves et touchants Cantiques de l'Église: lAve, maris Stella, lInviolata, le Regina cli, le Magnificat, etc., qui, en y joignant les Litanies de la sainte Vierge, l'emportent infiniment, en mélodie religieuse et pure, sur ces couplets d'une musique profane, qui reportent trop souvent la pensée à d'autres concerts, et ne produisent guère d'autre effet que d'attirer dans nos églises une foule d'amateurs blasés, qui viennent y satisfaire périodiquement leurs yeux et leurs oreilles ? La dignité, dans tout ce qui touche au service divin, est une 155 nécessité dont rien ne saurait dispenser ; or cette dignité, l'Église en a déposé le secret dans la langue liturgique et dans la mélodie sévère du chant grégorien. N'y a-t-il pas un danger réel à exposer les fidèles à perdre le goût de la langue latine à l'Église, à désaccoutumer leurs oreilles de ces chants mâles qui furent un des principaux éléments de la foi' naïve et robuste de nos pères ? Et puisque nous voulons bien maintenant admirer les sublimes édifices qu'ils bâtirent pour y faire entendre ces harmonies de l'Église militante, craignons de manquer au respect dû à ces voûtes sacrées, en réveillant leurs échos par des accents efféminés qu'elles ne répétèrent jamais. Pour nous, bien loin de nous résigner à voir la langue liturgique partager l'empire avec la langue vulgaire dans nos églises, nous désirerions bien plutôt voir s'étendre la connaissance du latin au delà des limites dans lesquelles l'usage l'a circonscrite. Si Fénelon disait il y a cent cinquante ans, en parlant de l'éducation des filles, que « l'étude du latin serait bien plus raisonnable pour elles que celle de l'italien et de l'espagnol; car, ajoute-t-il, c'est la langue de l'Église, et il y a un fruit et une consolation inestimables à entendre le sens des paroles de l'Office divin, où l'on assiste si souvent (1) ; » il nous semble que dans ce siècle, où l'éducation des jeunes personnes a pris un si grand développement, le moment serait venu d'en agrandir le cercle de ce côté. La piété y gagnerait, et la science de la religion, si nécessaire aux mères de famille, y puiserait un degré d'autorité et de gravité dont on ne tarderait pas à ressentir l'heureuse influence. Mais nous avons hâte de terminer ce long chapitre, et de tirer la conclusion de faits nombreux que nous y avons (1) De l'Éducation des Filles, chap. XII, page 102. uvres complètes, tom. XVII. 156 rassemblés. Il est donc démontré que les livres liturgiques, sur lesquels est fondée la science de la Liturgie, et dont la forme première remonte aux siècles primitifs du christianisme, ont droit aussi h nos respects par le caractère mystérieux et sacré des langues dans lesquelles ils sont écrits. Nous avons vu que ce caractère leur est inhérent, au point que les langues vivantes admises à l'honneur de servir d'organe à la Liturgie conservent cette prérogative lors même qu'elles ont cessé d'être parlées. Enfin, l'accord des diverses Églises dans cette pratique, et la sympathie des hérétiques pour la langue vulgaire dans le service divin, nous ont aidé à comprendre comment le saint concile de Trente avait été amené à prononcer une définition dogmatique en cette matière, qui semblait au premier coup d'il n'intéresser que la discipline. 157 NOTES DU CHAPITRE IIINOTE AResponsa dans
Dominus ad Moysen et Aaron, dicit : Nolite exterminare de tribu sua plebem
Caath in medio filiorum Levi, sed hoc facite eis, et vivent et non morientur
cum accedent ad Sancta Sanctorum. Et reliqua. (Num. IV, 18.) Primo intelligamus
ea, quae secundum litteram referuntur, et ita praestante Domino ab intellectu
litterae ascendemus ad intelligentiam spiritalem. Intellige ergo priusipsam
collocationem tabernaculi testimonii, intellige et Sancta Sanctorum, quae
interjecto asanctis velamine dirimuntur, quae inspici non licet ab ullo
hominum, nisi a sacerdotibus solis. Post haec intellige, quomodo ubi ventum
fuerit ut castra moveant filii Israël, solvitur tabernaculum, et Aaron ac filii
ejus sacerdotes intra Sancta Sanctorum operiunt singula quaeque operimentis, ac
velaminibus suis, et obtecta ea relinquentes in eodem quo fuerant loco,
introducunt filios Caath, qui ad istud officium deputati sunt, et faciunt eos
elevare humeris suis omnia illa quae manus sacerdotalis obtexerat. Et propter
hoc dicitur a Domino : Ne exterminetis de tribu sua plebem Caath : quasi
in eo exterminandi essent, si Sancta Sanctorum nuda et patentia contigissent,
quae non solum non contingere, sed ne intueri quidem fas erat non velata. Si
intellexisti quid historiae ordo contineat, ascende nunc ad splendorem mysterii
: et legis spiritalis lumen, si purus tibi est mentis oculus, contuere. Si quis
dignus ex iis qui Deo ministrant, divina capere et videre mysteria, ad quae
contuenda caeteri minus capaces sunt, hic Aaron, vel filius Aaron esse
intelligitur, qui ingredi potest ad ea quae adire aliis fas non est. Si quis
ergo talis est, huic soli revelata patet arca testamenti, hic videt urnam intra
se habentem mannam, hic considerat et intelligit propitiatorium. Hic intuetur
et Cherubim utrumque, et mensam sanctam, et candelabrum luminis, et altare
incensi. Iste haec considerat, et intelligit spiritaliter, id est, qui verbo
Dei et sapientiae mysteriis operam dat, et Deo soli in sanctis vacat. Sciat
sane cui haec revelantur, et spiritaliter inspicienda creduntur, non sibi tutum
esse aperire ea, et pandere quibus non licet pandi, sed operire débet singula,
et operta caeteris minus capacibus tradere portenda in humeris, et cervicibus
imponenda. Cum enim ex verbis mysticis eruditi, et perfecti quoque doctores opera
populis injungunt, et plebs agit quidem et implet quae mandantur, non tamen
eorum quas geruntur intelligit rationem : quid ahud geritur, nisi operta et
velata Sancta Sanctorum super humeros portantur ? Et ut adhuc manifestius quae
dicuntur advertas, exemplis te ex divinis voluminibus adhibitis informabimus.
Moyses intelligebat sine dubio quae esset vera circumcisio, intelligebat quod
esset verum Pascha, sciebat quae 158 essent veras
neomenias, et quas vera sabbata : et cum haec omnia intellexisset in spiritu, verbis tamen ea per
rerum corporalium species adumbrationesque
velabat : et cum sciret verum Pascha immolandum esse Christum, ovem corporalem immolare
mandat in Pascha. Cumque sciret diem festum agi debere in azymis sinceritatis et veritatis, tamen de
farina; azymis praecipiebat agi diem festum. Haec ergo et hujusmodi erant
Sancta Sanctorum, quas cum Moyses
portanda caeteris traderet, id
est, rébus et operibus implenda, cooperta tamen ea, et velata communi
sermonum tradebat eloquio. Humeri autem quod operum indicium teneant, in multis
Scripturas saspe locis ostendimus. Sed et in ecclesiasticis observationibus sunt
nonnulla hujusmodi, quas
omnibus quidem facere necesse est, nec
tamen ratio eorum omnibus patet. Nam quod, verbi gratia,
genua flectimus orantes, et quod ex omnibus cli plagis ad solam Orientis
partem conversi orationem fundimus, non facile cuiquam puto ratione compertum.
Sed et Eucharistias sive percipiendas, sive eo ritu quo geritur explicandas,
vel eorum quae geruntur in Baptismo verborum, gestorumque, et ordinum atque
interrogationum, ac responsionum quis facile explicet rationem ? Et tamen omnia
haec operta et velata portamus super humeros nostros : cum ita implemus ea et
exequimur, ut a magno pontifice
atque ejus filiis tradita et commendata suscepimus. Cuncta haec ergo et horum similia cum
gerimus, nec tamen eorum assequimur rationem, levamus humeris nostris et portamus adoperta et obtecta divina
mysteria, nisi quis sit inter nos Aaron aut nlius Aaron, quibus ista conceditur
nuda et revelata perspicere. Ita tamen conceditur ut sciant sibi velanda haec et
operienda, ubi caeteris dari ea et in opus proferri ratio poposcerit,
(Origines, in Numeros, Homilia V.) NOTE B
Etiam illud
admoneo, non parum ex hoc ipso utilitatem animas conferri, quod aures nostras
licet obscura videantur, penetrant. Si enim creditum est a gentibus, quod
quasdam carmina, quas praecantationes appelant, quibus istud artis est,
insusurrantes, nominibus quibusdam compellatis quas ne illi quidem qui
invocant, norunt, ex solo vocis sono vel sopiunt serpentes, vel etiam de
cavernis protrahunt abstrusis. Saepe autem et in corporibus humanis tumores,
vel fervores, aut alia hujuscemodi voce sola reprimere dicuntur, interdum etiam
animas stuporem quemdam sensus infligere, ubi tamen Christi non restiterit
fides : quanto magis totius praecantationis, et carminis validiorem et
potentiorem ducendam credimus quamcumque illam Scripturas sanctae, vel
sermonum, vel nominum appellationem ? Sicut enim apud infideles contrarias
virtutes audientes illa vel illi nomina in carminibus, vel praecantationibus,
adsunt et exhibent famulatum, et dant operam in hoc, ad quod invocari se ex
illo vel illo nomine senserint, officii sui rem quodammodo ac ministerii cui
semetipsos mancipaverint dependentes : eo magis utique caelestes virtutes et
Angeli Dei, qui nobiscum sunt, sicut et Dominus de parvulis 159 Ecclesias dicit,
quia Angeli eorum semper assistunt in conspectu Domini, videntes faciem ejus,
libenter et grate accipiunt, si semper verba Scripturas, et horum nominum
appellationes velut carmina quasdam et praecantationes ex nostro ore promamus.
Quia etsi nos non intelligimus quas de ore proferimus, illas tamen Virtutes
quas nobis adsunt intelligunt, et velut carmine quodam invitatas adesse nobis,
et ferre auxilium delectantur. Quia autem sunt non solum circa nos multas
divinas Virtutes, sed etiam intra nos,
indicat Propheta cum dicit in Psalmis : Benedic anima mea Dominum, et omnia interiora mea
nomen sanctum ejus.
Hoc est omnia quas intra me
sunt. Constat ergo multas esse Virtutes intra nos, quibus vel animarum
nostrarum, vel corporum cura permissa est, quas utique si sanctas sunt, cum
Scripturas leguntur a nobis, delectantur, et validiores erga nostri diligentiam
fiunt si linguis loquamur, et spiritus
noster oret, sensus autem noster sine fructu sit. Dixit enim et hoc sanctus
Apostolus, et mirum quodammodo mysterium humanis auribus pro-tulit, dicens
aliquando fieri posse, ut spiritus qui in nobis est oret, et sensus noster sine
fructu sit. Intellige ergo ex hoc, quia fit aliquando noster quidem sensus sine
fructu : Spiritus autem, id est Virtutes illas, quas animas nostras in
adjutorium datas sunt, pascuntur et reficiuntur ex auditu Scripturas sanctas,
velut ex divinis et rationabilibus cibis. Quid dico quia divinae Virtutes
pascantur et epulentur in nobis, si
nos verba divinas Scripturas proferamus ex ore ? Ipse
Dominus noster Jesus Christus, si nos inveniat his vacantes, et hujuscemodi
studiis et exercitiis operam dantes, non solum pasci et refici dignatur in
nobis, verum etiam si lias epulas apud
nos viderit apparatas, Patrem secum dignatur adducere. Sed haec quia satis
magna, et supra hominem videntur, non meis tibi, sed ipsius Domini et
Salvatoris sermonibus comprobentur dicentis : Amen dico vobis quia ergo et
Pater veniemus, et mansionem faciemus et cnabimus apud eum. Quem ? illum
profecto qui sua mandata custodit. Sed sicut diximus, quia ex hujuscemodi
meditationibus, divinarum erga nos Virtutum consortia et officia provocamus :
ita e contrario malignarum virtutum insidias, et pessimorum daemonum
incursiones, ex hujuscemodi sermonum, et nominum appellationibus effugamus.
Verbi gratia, ut si quis vestrum aliquando perspexit praecantationibus sopitum
serpentem portari in manibus, vel protrahi de cavernis nihil valentem nocere
venenis, utpote incantationis virtute torpentibus : ita etiam lectionis divinae
virtute, si quis intra nos est contrarias potestatis serpens, si quis ad
insidiandum coluber latet, si patienter feras, si non taedio fatigatus
avertas auditum, Scripturas carminibus et divini sermonis assiduitate
depellitur. Si ergo vides, o auditor, aliquando legis scripturam in auribus tuis, quam
non intelligis, et sensus ejus tibi videtur obscurus, interim hanc primam
suscipe utilitatem quod solo auditu velut praecantatione quaedam, noxiarum
virtutum, quas te obsident et quae tibi insidiantur, virus depellitur et
fugatur. Observa tantum ne efficiaris sicut aspides surdas, et
obturantes aures suas,
ne audiant vocem
incantationis 160 et veneficii,
quod incantatur a sapiente. (Origenes, in librum Jesu Nave, Homilia XX.) NOTE C
Propositio v. Prfat. in Matth. Indecorum, vel ridiculum potius videtur quod idiotae et mulierculae,
psittaci exemplo, Psalmos suos et Precationem Dominicam immurmurant, cum ipsas quod
sonant non intelligant. CENSURA. Haec propositio simplices, idiotas et mulierculas aborationevocali juxta
ritum et consuetudinem Ecclesias perperam retrahens, ac si inutilis sit, nisi
ab eis intelligatur, impia est et erronea, viam praebens errori Bohemorum, qui
Officium Ecclesiasticum idiomate vulgari celebrare conati sunt. Alioqui in Lege
veteri indecorum fuisset et ridiculum simplicem populum ex Dei instituto
caeremonias Legis observare, quas non intelligebat, quod asserere est in Legem
et ejus Latorem Deum, blasphemum et haereticum. Neque enim per verba orationis
solum praetendit Ecclesia quod serie verborum illorum erudiamur, sed ut ejus
fini nos conformando veluti ipsius membra divinas laudes pronuntiemus, débitas
gratiarum actiones persolvamus, et nobis necessaria imploremus, Unde propter
talem orantium intentionem, Dei munere affectus inflammetur, illuminetur
intellectus, humana inopia sublevetur, atque gratias et glorias fructus
comparetur. Quae certum est orantes per tales orationes vocales quamvis verba
non intelligant, praetendere. Quemadmodum legatus, et si verba domini sui non
capiat, illa tamen juxta mandatum domini referens, gratum impendit obsequium et
domino et ei cui destinatur. Multas similiter prophetias in Ecclesia cantantur,
quae quamvis a multis cantantibus non intelligantur, plurimum tamen utilis est
et meritoria earum pronuntiatio et cantus : divinae siquidem veritati, quas
illas docuit ac re-velavit, eas cantando gratum obsequium exhibetur. Per quas
sane constat non in sola verborum intelligentia fructum orationis consistere ;
perniciosum quoque esse errorem existimantium solum ad erudiendum intellectum
fieri, orationem vocalem, cum praecipue fiat talis oratio ad inflammandum
affectum, ut ,pio et devoto animo in Deum modis praedictis re erigendo mens
reficiatur, et obtinendo quas petit sua intentione non frustretur, mereatur
itidem intellectus illuminationem quemadmodum et caetera alia utilia aut
necessaria, qui nimirum fructus longe uberiores sunt, quam sola verborum
intelligentia, quae absque excitatione affectus in Deum, parum affert
utilitatis. Quod si contingeret Psalmos in linguam vulgarem traduci, non
propterea simplices et idiotae plene perciperent. (D'Argentré, Collectio
judiciorum, tom. II, pag. 61.) |